Enfance et adolescence
Je suis né le 31 mai 1941 à Dax, département des Landes. Mes parents, Alexandre García et Elvire García López, sont tous deux nés en Espagne, Province de Soria dans la Vieille Castille. Ils ont émigré dans les Landes avec leur famille, mon père en novembre 1924, et ma mère, en janvier 1925. Mon père appartient à une famille de petits agriculteurs du village de Judes. Il est enfant naturel, ma grand-mère, âgée de dix-huit ans, ayant refusé d’épouser le père, Patricio Tejedor, lui préférant l’ouvrier agricole de la famille, Bartolomé Donoso, dont elle aura tous ses autres enfants et qui l’emmènera vivre en France. Du côté maternel, mon grand-père, originaire de la contrée de Medinaceli, était maréchal-ferrant. Il exerça son métier dans plusieurs villages de la vallée du Jalón, aux confins de l’Aragon, et mourut en 1914. Ma grand-mère, Luisa López, épousa en secondes noces Alejandro Múñoz, agriculteur d’Utrilla, village proche d’Arcos de Jalón. Après quelques années (1925-1934) passées dans la Haute-Lande (Richet, Pissos, Ychous pour ma famille maternelle ; Trensac et Morcenx, pour ma famille paternelle), ma mère, qui était devenue l’aînée de la famille, ses deux sœurs plus âgées s’étant mariées, entraîna ses parents et les plus jeunes vers Dax, où elle et mon père avaient décidé de se marier et de s’installer. Leur projet était de travailler dans l’industrie et de pouvoir offrir à leurs enfants une scolarité complète. [sur ce sujet, je renvoie à mon Histoire de la famille]
A la naissance de mon frère Guy, en 1937, notre père travaillait à la fonderie Boulard, qui venait d’être installée près de la ligne de chemin de fer de Dax à Pau. Ayant dû quitter la fonderie pour un conflit violent avec un contre-maître, mon père trouva un emploi dans les Salines voisines, dans la cité de laquelle la famille trouva à se loger gratuitement. C’est là que je suis né et ai vécu jusqu’à l’âge de 16 ans. En 1957, mes parents déménagèrent dans une maison qu’ils avaient fait bâtir dans un lotissement créé par l’usine à l’extrémité opposée du terrain que celle-ci occupait, dans le quartier du Village des Pins.
Mes parents avaient envisagé de retourner vivre en Espagne mais la Guerre Civile qui éclate en juillet 1936 leur fit renoncer à ce projet. Ils envisagèrent trop tard de se faire naturaliser français et passèrent toute l’Occupation en qualité d’étrangers. Dès la fin du conflit, ils firent les démarches en ce sens. Elles aboutirent en avril 1948. Depuis cette date, eux et leurs enfants seront désormais français (j’avais 7 ans et mon frère, onze).
Dax se trouve à quelque 80 kms de l’Espagne, mais je n’ai franchi la frontière qu’en 1955, lorsque nous partîmes, mes parents, mon frère et moi, en expédition dans le but de faire la connaissance de la famille que nous avions là-bas et avec laquelle notre grand-père Donoso et son fils, André, avaient renoué l’année précédente à l’occasion d’un périple aventureux à moto. C’est lors de ce voyage mémorable que mon père fit la connaissance de son propre père et nous, de notre grand-père Patricio.
Guy fut un élève brillant, au point que le directeur de l’école primaire, M. Saran, et le Principal du collège, M. Chassériau, persuadèrent nos parents qu’il devait suivre des études secondaires. Ils firent toutes les démarches nécessaires pour lui obtenir des bourses (nationale, départementale et municipale) suffisantes. Je suivis la voie ainsi tracée et, à l’imitation de mon frère, je passai moi aussi à 16 ans le concours d’entrée à l’Ecole Normale d’Instituteurs, ce qui m’assurait une scolarité sans frais jusqu’au baccalauréat et l’assurance d’un métier, très respecté à l’époque, qui constituait un aboutissement inespéré pour les enfants d’une famille aussi modeste. Bien qu’exaltant par bien des côtés, ce choix me coûta quelques larmes, parce qu’il m’obligeait à abandonner l’enseignement des langues anciennes, qui étaient ma matière de prédilection, puisque les Ecoles Normales ne dispensaient qu’un enseignement « moderne », c’est-à-dire, sans grec ni latin.
Toujours suivant l’exemple de mon frère, une fois le second baccalauréat en poche, je décrochai une bourse de continuation d’études qui me permit de préparer l’Ecole Normale Supérieure de Saint-Cloud. J’optai pour la Préparation du Lycée Chaptal, alors même que, comme je l’appris par la suite mais trop tard pour en profiter, j’aurais pu bénéficier de celle de l’Ecole Normale de Montpellier, qui était réservée aux normaliens primaires. Le choix aurait été plus judicieux car, si mes souvenir sont bons, plusieurs des premiers reçus, dont le major de la Promotion, venaient de cette Préparation, alors que celle du lycée Chaptal était considérée comme une des plus faibles de Paris, comparée à celles, prestigieuses, des lycées Louis-le-Grand, Henri IV et Lakanal.
Scolarité à l’ENS de Saint-Cloud
Je parvins malgré tout à « intégrer » en 1962 cette Grande Ecole, ainsi que l’ENSET, que je tentais en même temps. Etant reçu aux deux, je choisis la première. Mais j’étais seul hispaniste de ma promotion et aucun enseignement spécifique ne me fut proposé à l’Ecole, ce qui fit de moi un étudiant à temps plein de l’Institut Hispanique de la rue Gay-Lussac. C’est là que je connus Michèle Enjolras, qui rentrait d’un séjour de deux ans à Madrid. Nous nous sommes mariés au terme de l’année universitaire (29 juin 1963).
Il m’arrivait, cependant, de me glisser en auditeur libre dans certains cours d’Agrégation dispensés à l’ENS et c’est ainsi que je fis la connaissance de deux enseignants qui m’ont profondément marqué et que j’ai fréquentés jusqu’à leur disparition : Marie-Madeleine Pardo et Maurice Molho. Pour compléter ma licence qui comportait à l’époque quatre certificats, je choisis comme certificat optionnel celui qui était dispensé à l’Institut de l’Amérique Latine qui venait d’être entièrement reconstruit. Le programme de licence était très varié, puisqu’il comportait de la linguistique, sanctionnée par une version, de la littérature, de la géographie, de l’histoire de l’art, de l’anthropologie, de l’économie politique et couvrait la totalité de l’aire géographique, du Mexique à la Terre de Feu, y compris le Brésil. Le programme était lourd et je n’obtins le diplôme qu’à la session de septembre. Mais j’eus le bonheur d’entendre d’éminents chercheurs : René Dumont, Pierre Monbeig, François Bourricaud, Henri Lehmann, spécialiste de l’art méso-américain, etc. Malgré l’intérêt que je pris à cette initiation, je n’envisageai pas de me spécialiser dans le domaine américain.
Licence d’Espagnol en poche, j’entrepris la préparation d’un Diplôme d’Etudes Supérieures, équivalent du master d’aujourd’hui, dont le mémoire consista en une étude et index de la revue El Mono Azul, organe de l’Alliance des Intellectuels Antifascistes, qui parut à Madrid tout au long de la Guerre Civile. Robert Marrast, mon directeur de recherches, étudiait la vie et l’œuvre de Rafael Alberti et s’intéressait alors aux activités du poète pendant la Guerre Civile. Ma camarade Monique Roumette avait réalisé, l’année précédente, le même travail sur Hora de España et une autre étudiante travaillait parallèlement à moi sur la Gaceta de Arte, qui avait paru à Tenerife sous la direction d’Eduardo Westerdahl. Je consacrai deux années à la rédaction du mémoire. Une des raisons était que nous étions trop occupés, cette année-là, pour mener à bien en une année universitaire une tâche de cette envergure. Si nous séjournions principalement à Madrid, nos voyages étaient fréquents : l’Andalousie en février, les Canaries en avril, Barcelone et Valence en mai-juin. A quoi s’ajoutaient des voyages en France, dont un pour assister à l’enterrement de Jean Sarrailh à Monein, en mars 1964. L’autre raison était que, l’année à l’étranger n’étant pas comptabilisée comme une année de scolarité à l’Ecole, je n’étais encore qu’en première année et n’avais nullement l’intention de brûler les étapes et devoir passer l’Agrégation dès la deuxième année, alors que la scolarité en prévoyait quatre. Je me contentai donc de réunir le matériau nécessaire, ce qui n’alla pas sans mal. Il me fallut d’abord accéder aux numéros de la revue conservés dans l’Hémérothèque Municipale de Madrid, et, en ces temps de censure franquiste, on ne facilitait pas l’accès aux publications de l’Espagne républicaine (je dus d’ailleurs graisser la patte d’un huissier de la mairie pour pouvoir enfin obtenir l’autorisation) et, la collection étant incomplète, je dus rechercher les numéros manquants. Ce fut Miranda, libraire antiquaire de la rue du Prado (peut-être sur le conseil de R. Marrast), où se trouvait la pension Romero où nous logions, qui me les procura.
Les trois années suivantes, Michèle passa sa licence d’Espagnol et donna naissance à Patrice (1967). Quant à moi, j’achevai mon mémoire, passai l’Agrégation (1966) et pus bénéficier d’une quatrième année d’ENS, pendant laquelle je réappris à vivre sans les œillères de la Préparation au Concours, et appris mon métier de père.
A la sortie de l’ENS, Pierre Geneste, sur le conseil d’Aristide Rumeau, m’offrit de le rejoindre à l’Université de Lille sur un poste d’Assistant. C’est là que j’ai vécu Mai 68, non plus comme un étudiant engagé, mais comme un jeune enseignant solidaire, en lutte contre le mandarinat qui sévissait alors. A la suite de Mai 68, les Lettres et Sciences Humaines réunies à la Sorbonne furent réparties entre cinq nouvelles Universités. P. Geneste obtint sa mutation à l’une d’entre elles, l’Université Paris 3. Dès que je le sus, j’envisageai moi aussi de quitter celle de Lille et de me rapprocher de Paris, alors que s’annonçait la naissance de notre second enfant, Virginie. Je me vis proposer par l’ENS de Saint-Cloud le poste d’Assistant d’Espagnol que l’on venait d’y créer. J’acceptai avec joie, parce que je me retrouvais ainsi à la tête d’une section, certes petite, mais où je ne dépendrais de personne, outre le fait que nous habitions à proximité. L’inconvénient de ce poste était qu’il appartenait à une des composantes de l’ENS, son Centre Audio-visuel (CAV), et qu’en principe je n’avais pas à travailler avec les élèves. Au prix d’un surcroit de travail, j’obtins cependant d’élargir mes compétences à cette activité et je siégeai dès la première année au jury du Concours d’entrée.
Pendant les quatre années d’Assistanat à l’ENS, ma contribution au CAV consista à achever une méthode audio-orale (c’est-à-dire sans images) de l’Espagnol, qu’avait entreprise avant ma nomination le lecteur qui m’avait précédé, Ricardo León, fils du romancier homonyme. Par ailleurs, je participais au recrutement de futurs hispanistes et les suivais pendant leurs études. Lorsque je quittai mon poste en 1973, il y avait une dizaine de spécialistes, alors que, lorsque je cessai d’être élève, il n’y en avait que deux.
Le choix du médiévisme : les Chansonniers et Pedro de Escavias
Mes travaux sur la Guerre Civile n’allèrent pas au-delà de mon Mémoire de Maîtrise. Ils eurent, cependant, des suites inespérées, pour un travail d’étudiant, sous la forme d’un article de synthèse paru dans les Cahiers H en 1974 et d’une édition facsimilée de la revue du Mono Azul réalisée par Enrique Montero en 1975, dont je rédigeai l’Introduction et les index.  Mais je n’avais aucun goût pour revenir à un sujet qui m’obligeait à remuer de pénibles souvenirs, ceux que transportaient avec eux les anciens combattants républicains, qui étaient nombreux à s’être réfugiés dans les Landes, et aussi à remâcher les raisons d’une défaite dont la proximité avec la frontière nous permettait de mesurer les effets catastrophiques. Bref, je désirais tourner définitivement la page d’une époque douloureuse et envisageai une recherche dans un domaine susceptible de m’ouvrir de nouvelles perspectives.
Mais je n’avais aucun goût pour revenir à un sujet qui m’obligeait à remuer de pénibles souvenirs, ceux que transportaient avec eux les anciens combattants républicains, qui étaient nombreux à s’être réfugiés dans les Landes, et aussi à remâcher les raisons d’une défaite dont la proximité avec la frontière nous permettait de mesurer les effets catastrophiques. Bref, je désirais tourner définitivement la page d’une époque douloureuse et envisageai une recherche dans un domaine susceptible de m’ouvrir de nouvelles perspectives.
Mon goût du Moyen Age venait de ma plus tendre enfance. Le plus précieux des livres de prix que je reçus à la fin du Cours Préparatoire (j’avais six ans) fut une vie illustrée de Charlemagne, dans laquelle on voyait l’empereur dans tous les attributs de sa puissance et à tous les âges de la vie, y compris quand, dans la force de sa jeunesse, il pratiquait la natation dans sa piscine du palais d’Aix-la-Chapelle. Jusqu’à quel point l’empreinte de cette image glorieuse, bien que douteuse au regard de la réalité historique, s’est gravée dans ma mémoire, je ne saurais le dire, mais il me resta un intérêt évident pour les siècles médiévaux, matériellement présents dans ma bonne ville de Dax. C’est ainsi qu’une légende voulait que l’église Saint-Vincent de Xaintes, dont le mur latéral nous servait de fronton en attendant qu’on ouvre le portail d’accès à la cour de récréation de notre école publique, eût abrité pendant quelques jours la dépouille de certains des Pairs qui avaient péri à Roncevaux.
Le programme du Concours de l’Agrégation d’Espagnol en 1966 comportait le volume de poésies du Marquis de Santillane de Vicente García de Diego pour la collection des Clásicos castellanos d’Espasa Calpe. Je découvris à cette occasion que la littérature médiévale hispanique offrait un immense champ en matière d’édition, et plus précisément des textes poétiques du XVe siècle, dont peu de collections avaient été publiées. Je ne sais plus qui m’orienta vers le chansonnier d’Oñate, riche anthologie dont on venait de retrouver la trace et dont on possédait des descriptions du contenu, mais que le nouvel acquéreur refusait de laisser consulter directement. Je m’intéressai au dernier poète présent dans le recueil, Pedro de Escavias. Sa production poétique était trop maigre pour nourrir une recherche d’envergure mais il se trouve qu’il était aussi l’auteur d’un résumé de la chronique castillane, le Répertoire des Princes d’Espagne qui, lui, était inédit. De là naquit l’idée de consacrer une Thèse de Troisième cycle à la publication commentée de ses œuvres complètes. Le Professeur Darbord, dont la Thèse d’Etat avait porté sur la Poésie religieuse en Castille sous le règne des Rois Catholiques, accepta de la diriger. L’été 1968, une fois libéré de mes obligations militaires, je visitai la Bibliothèque de l’Escurial, où j’obtins en un temps record d’un bienveillant photographe un microfilm du manuscrit du Répertoire, et j’allai visiter, dans la Province de Jaén, les archives de la capitale et la ville d’Andújar, où Escavias était né et avait passé l’essentiel de sa vie. J’y rencontrai un érudit local, médecin généraliste, le docteur Carlos de Torres Laguna, qui n’ignorait rien de l’histoire de sa ville et qui facilita mon premier contact avec la documentation connue. J’en tirai un enseignement, que je n’ai cessé de mettre en pratique ni de conseiller à mes doctorants, qui est que, même pour les époques lointaines, rien ne remplace le contact direct avec un érudit, même s’il n’est pas formé aux subtilités de la recherche universitaire.
La transcription des 254 folios du Répertoire fut une rude entreprise mais aussi une salutaire initiation à la paléographie et une excellente introduction à l’Histoire de l’Espagne d’Alphonse Le Sage, dont je n’ai cessé depuis d’être un lecteur assidu. Quant à l’édition des textes poétiques, elle me donna l’occasion, pour la première fois, de m’exercer à la critique textuelle, encore qu’à petite échelle. Je menai ces travaux, ainsi qu’une transcription du Chansonnier d’Oñate y Castañeda, dans une grande confidentialité, pour ne pas dire sous le sceau du secret, puisque le Moyen Age hispanique n’était pas reconnu comme domaine de recherche par mon employeur, l’ENS et son CAV. C’est tout aussi discrètement que je soutins ma Thèse en 1971, devant un jury présidé par Pierre Vilar, dont j’avais suivi quelques séminaires aux Hautes Etudes et qui eut la bonté d’accepter cette tâche. A ma grande surprise, il se montra particulièrement élogieux, malgré les grosses lacunes qu’il n’avait pu manquer d’observer dans ma méthodologie, ce qui n’a pas peu contribué à me persuader que je devais poursuivre dans la voie de la recherche en médiévistique. Les érudits de Jaén, regroupés dans l’Instituto de Estudios Giennenses (IEG), étaient informés de mes travaux sur Pedro de Escavias. J’avais eu l’occasion de m’en entretenir par courrier puis de vive voix avec le Président de 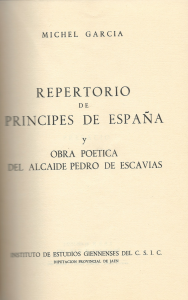 l’Instituto, José Antonio de Bonilla y Mir. C’était un délicieux personnage, qui ne nous tint jamais rigueur, à ma femme et à moi-même, de partager si peu ses opinions politiques et religieuses et se montra, au contraire, d’une extrême générosité à notre égard. C’est grâce à lui et au rapport élogieux que don Enrique Toral Peñaranda fit de ma Thèse, que l’IEG se chargea de la publier sous le parrainage flatteur du CSIC (le CNRS espagnol), auquel l’Institut était rattaché. Je confiai la traduction de mon Introduction à notre ami valencien Juan Miguel Romá, qui habilla ma prose universitaire d’une dimension littéraire inespérée. Enfin, un illustre Professeur de Londres, Alan D. Deyermond, que je ne connaissais guère mais que j’avais dû croiser au Congrès de l’Asociación Internacional de Hispanistas (AIH) qui s’était tenu à Salamanque en septembre 1971, me fit l’honneur de consacrer à mon ouvrage un long article élogieux dans le Times Litterary Supplement.
l’Instituto, José Antonio de Bonilla y Mir. C’était un délicieux personnage, qui ne nous tint jamais rigueur, à ma femme et à moi-même, de partager si peu ses opinions politiques et religieuses et se montra, au contraire, d’une extrême générosité à notre égard. C’est grâce à lui et au rapport élogieux que don Enrique Toral Peñaranda fit de ma Thèse, que l’IEG se chargea de la publier sous le parrainage flatteur du CSIC (le CNRS espagnol), auquel l’Institut était rattaché. Je confiai la traduction de mon Introduction à notre ami valencien Juan Miguel Romá, qui habilla ma prose universitaire d’une dimension littéraire inespérée. Enfin, un illustre Professeur de Londres, Alan D. Deyermond, que je ne connaissais guère mais que j’avais dû croiser au Congrès de l’Asociación Internacional de Hispanistas (AIH) qui s’était tenu à Salamanque en septembre 1971, me fit l’honneur de consacrer à mon ouvrage un long article élogieux dans le Times Litterary Supplement.
Pedro López de Ayala
Louis Urrutia Salaverri, Maître-de-Conférences à la Sorbonne, rêvait de soutenir une Thèse sur l’œuvre de Pío Baroja. Malheureusement, « le sujet était déjà pris », selon l’expression consacrée à une époque où chaque doctorant avait l’exclusivité de son sujet de Thèse. Faute de mieux, il engagea des recherches sur le Chancelier Ayala, mais, lorsque le « propriétaire » de Baroja, Jacques Rebersat, s’orienta définitivement vers la carrière d’inspecteur, il revint à son sujet de prédilection et m’abandonna le sien, en m’offrant le fruit de ses premiers travaux, qui consistait essentiellement en un essai bibliographique, ce qui m’épargna bien des recherches préliminaires. Je sautais sur l’occasion et demandai à Maurice Molho s’il voulait bien être mon Directeur de Recherches. Il faut dire qu’à l’époque, il n’y avait, dans les Départements d’Espagnol des Universités françaises, aucun Professeur titulaire spécialiste du Moyen Age susceptible de diriger une Thèse dans ce domaine. Quant à Maurice Molho, son immense culture lui permettait d’échapper, tant en linguistique qu’en littérature, à une assignation chronologique étroite. Il accepta de m’accompagner dans la rédaction de « mon livre », le terme de « Thèse » lui déplaisant souverainement.
Ce fut le moment où je quittai l’ENS en 1973 pour un poste de maître-de-conférences à l’Université Paris XIII, nouvellement créée. Mon recrutement dans un département qui ne comptait que cinq enseignants et dont le Directeur, Jean Roudil, était lui-même médiéviste, ne répondait pas précisément à la nécessité d’ouvrir le plus largement possible l’éventail des enseignements dans un domaine aussi vaste que le domaine hispanique. Mais il permettait la constitution d’un pôle médiéval en adjoignant à un linguiste passionné de critique textuelle comme l’était J. Roudil un jeune chercheur au profil plus traditionnel, tourné vers la littérature. Je sus gré à mon nouveau collègue de m’avoir recruté et fis en sorte de l’aider au mieux de mes possibilités. Je renonçai à enseigner les auteurs médiévaux et me chargeai du Siècle d’Or et des Siècles Modernes. Je le rejoignis aussi à la direction de la Faculté, dont il était le Doyen, en devenant son adjoint aux finances. Enfin, je l’accompagnai dans la création d’un centre d’études dont la principale réalisation fut la publication à partir de 1976 des Cahiers de linguistique hispanique médiévale, qui devinrent, sous la direction de son successeur, Georges Martin, les Cahiers de linguistique et de civilisation hispanique médiévales et qui sont désormais publiés par Carlos Heusch, à l’ENS de Lyon, sous le titre de Cahiers d’études hispanique médiévales.
Du fait de ces nombreuses activités, mes recherches n’avançaient guère, aussi, j’accueillis avec soulagement ma nomination à la Casa de Velasquez à compter de septembre 1976. Je ne soupçonnais pas que les conditions de travail idéales qui me seraient offertes, sans autre obligation que celles d’effectuer des recherches dans les archives et bibliothèques de Madrid et ses environs (L’Escurial), auraient à rivaliser avec le désir de suivre de près le grand chamboulement que connaissait l’Espagne, un an après la mort du dictateur. J’arrivai à Madrid pour y chercher un appartement pour la famille, le jour-même où Adolfo Suárez abandonnait sa tenue de tennisman pour le costume de chef du gouvernement. Les deux années que nous avons passées, rue Juan Bravo, furent, par bien des côtés, exaltantes. La régularisation des partis, la multiplication des journaux et revues, la disparition de la censure cinématographique et théâtrale, les meetings de la campagne électorale pour le Parlement et le Sénat étaient autant de nouveautés dont nous ne voulions rien manquer. Notre appartement ne désemplissait pas. Il fallait aussi accompagner nos deux enfants afin de faciliter leur adaptation, même si nous fûmes autorisés à les inscrire au Lycée français. Autant dire que mes recherches pâtirent quelque 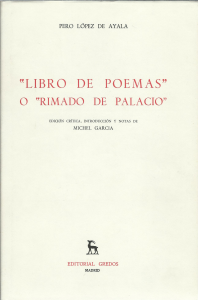 peu de ces circonstances. Je parvins, cependant, à achever mon édition du Rimado de Palacio, qui sortit chez Gredos en 1978, avec un financement complémentaire de la Diputación Foral de Alava, et à réunir assez de matériau pour envisager de commencer la rédaction de la Thèse proprement dite. C’est à cette dernière phase que je consacrai ma troisième année à la Casa (1978-1979), dans laquelle je me réfugiai avec une mentalité d’ermite, Michèle et les enfants étant rentrés en France.
peu de ces circonstances. Je parvins, cependant, à achever mon édition du Rimado de Palacio, qui sortit chez Gredos en 1978, avec un financement complémentaire de la Diputación Foral de Alava, et à réunir assez de matériau pour envisager de commencer la rédaction de la Thèse proprement dite. C’est à cette dernière phase que je consacrai ma troisième année à la Casa (1978-1979), dans laquelle je me réfugiai avec une mentalité d’ermite, Michèle et les enfants étant rentrés en France.
Dans la tradition française, cette Thèse était conçue comme une somme indépassable, un ouvrage définitif capable de décourager toute autre recherche sur le sujet, si ce n’est de détail. En somme, une Thèse n’était réussie que lorsqu’elle avait littéralement épuisé son sujet. De fait, certaines y sont parvenues, du moins pour quelques générations, comme, pour n’en citer qu’une, les Recherches sur le Libro de Buen Amor de Félix Lecoy (1937), qu’Alan Deyermond réédita soixante années plus tard, en se contentant de l’accompagner d’un prologue et d’une bibliographie actualisée. Cette particularité française était un motif de fierté et bien des collègues étrangers nous l’enviaient. Mais ses effets collatéraux étaient terribles, car c’était une grande dévoreuse de temps et d’énergie. Il n’était pas rare que la soutenance intervînt à la veille de la retraite, voire après. Je m’étais promis de ne pas tomber dans ce traquenard et de soutenir ma Thèse d’Etat avant mes quarante ans, chose rarissime à l’époque ; à ma connaissance, seul Edmond Cros y était parvenu. Je tins le pari, puisque je soutins en 1980, même s’il me fallut « cravacher », les derniers mois, M. Molho, avec sa perspicacité habituelle, m’ayant fait remarquer que je n’abordais pas le Rimado dans ma première rédaction. Dans mon esprit, le sort du grand poème avait été réglé par l’édition de 1978.
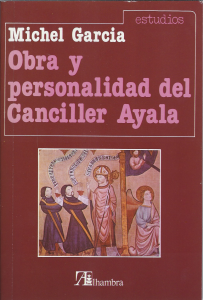
Après-Thèse
Le Département de l’Université Paris 13 ne pouvait accueillir un second Professeur, encore moins un médiéviste. Il me fallut donc partir et je fus tout heureux d’être élu à l’Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris 3, en 1983, grâce à l’appui d’Augustin Redondo, qui regrettait l’absence d’un enseignement spécifique de Moyen Age dans une UER où tous les domaines, y compris l’Amérique coloniale, étaient couverts. Sur le plan de la recherche, la création de ce domaine procurait aussi au Centre de recherches sur l’Espagne du Siècle d’Or, qu’il dirigeait et qui constitua toujours la plus grosse équipe de l’UER, un arrière-plan très utile.
Je vécus une période d’adaptation délicate. Il me fallut d’abord créer des enseignements de Moyen-Age qui, dans un premier temps, prirent la forme d’options à l’intérieur des enseignements de Siècle d’Or. Peu à peu, les programmes d’Agrégation aidant lorsqu’ils comportaient une question médiévale, je parvins à une certaine autonomie. Ma solitude me pesait car mon rôle se limitait trop souvent à inaugurer, -chronologie oblige-, les colloques que nous organisions à l’intérieur de l’UER. Cette solitude me pesait car j’étais, avec Jeanne Battesti-Pelegrin à Aix-Marseille, un des deux seuls Professeurs médiévistes en exercice dans l’Université française. Aussi, je me donnai pour objectif de contribuer de toutes mes forces à la restauration d’une discipline qui avait eu tant d’illustres représentants, à l’intérieur et à l’extérieur de l’Université : Prosper Mérimée, Théodore de Puymaigre, Albert de Circourt, Alfred Morel-Fatio, Raymond Foulché-Delbosc, Georges Cirot, Félix Lecoy, Pierre Le Gentil, Charles-Vincent Aubrun. La solution passait par la direction de Thèses et, pour cela, il fallait créer une structure d’accueil. Ce fut d’abord un cours de maîtrise, dans lequel j’enseignais la paléographie et l’édition des textes. Puis vint le Centre de Recherches sur l’Espagne Médiévale (CREM) à l’imitation de ceux qui existaient dans l’UER pour les autres domaines (1988). De la maîtrise à l’inscription en Thèse, le pas fut franchi par certains étudiants, dont une majorité d’élèves de l’ENS de Fontenay-Saint-Cloud. Enfin, Carmina Virgili, Directrice du Collège d’Espagne de la Cité Universitaire, avec laquelle me lia très vite une relation amicale profonde, accepta d’héberger le séminaire d’Etudes Médiévales, que j’eus la joie d’animer jusqu’à mon départ à la retraite et quelque peu au-delà (2002). Ces activités n’étaient pas comptabilisées dans mon service d’enseignant de l’UFR mais c’était le prix à payer pour parvenir au but que je m’étais assigné. En outre, les rencontres bimensuelles du Collège, qui réunissaient un public varié, composé, outre les doctorants, des enseignants en activité ou à la retraite, me procuraient une joie intense. Elles me permettaient aussi d’accueillir des conférenciers étrangers de passage à Paris.
Parallèlement à cette « montée en puissance », j’exerçai des responsabilités diverses. Pendant deux années, je fus Directeur de l’UFR. En 1989, mes amis et moi avons emporté les élections municipales à Chinon, et j’occupai un poste d’adjoint dans la nouvelle équipe municipale. En 1990, j’abandonnai cette lourde responsabilité à la suite de ma désignation comme directeur du Centre d’Initiation à l’Enseignement Supérieur (CIES) Paris-Centre, structure que venait de créer le ministère de l’Education dirigé par Lionel Jospin, afin de préparer les futurs docteurs à l’exercice du métier d’enseignant (1990-1994). Jusque-là, cette formation, pourtant bien nécessaire, était cantonnée au Primaire et au Secondaire. En conséquence, l’Université offrait le paradoxe d’une concentration de grands chercheurs dispensant un enseignement généralement médiocre. Pendant ces quatre années, j’ai exercé ces fonctions absorbantes sans allègement de service, et avec le secours d’une seule secrétaire, excellente par ailleurs. Je dirigeais aussi à distance, depuis 1985, Les Amis du Vieux Chinon, société savante à la présidence de laquelle j’avais succédé au Professeur Raymond Mauny, spécialiste de l’Afrique occidentale. Outre les activités habituelles à ce genre de corporation, Les Amis du Vieux Chinon administraient le musée d’art et d’histoire de la ville ainsi qu’un musée d’arts et traditions populaires.
A compter de 1993, les premières Thèses rédigées sous ma direction arrivèrent à échéance. Les soutenances se suivirent à raison d’une ou deux par an jusqu’en 2001. Le recrutement des nouveaux docteurs contribua à 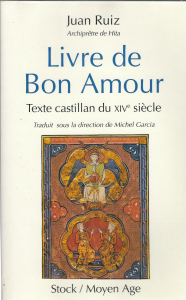 combler le vide concernant la période médiévale dans les Universités françaises. La satisfaction d’avoir rempli un de mes objectifs principaux compensait en partie la frustration qui était la mienne de ne pouvoir consacrer plus de temps à la recherche. Pendant cette période, mon éloignement des fonds d’archives m’en détourna. Comme, par ailleurs, je n’ai jamais couru les colloques et n’ai jamais eu aucun talent pour solliciter des invitations, je me retrouvai de fait à l’écart de la communauté des chercheurs, comme le témoin passif de travaux qui me parvenaient à travers les revues et autres publications. Pour compenser, je me lançai dans la traduction, -celle collective du
combler le vide concernant la période médiévale dans les Universités françaises. La satisfaction d’avoir rempli un de mes objectifs principaux compensait en partie la frustration qui était la mienne de ne pouvoir consacrer plus de temps à la recherche. Pendant cette période, mon éloignement des fonds d’archives m’en détourna. Comme, par ailleurs, je n’ai jamais couru les colloques et n’ai jamais eu aucun talent pour solliciter des invitations, je me retrouvai de fait à l’écart de la communauté des chercheurs, comme le témoin passif de travaux qui me parvenaient à travers les revues et autres publications. Pour compenser, je me lançai dans la traduction, -celle collective du  Livre de Bon Amour et celle personnelle du Comte Lucanor-, exercice salutaire qui impose une saine discipline de travail. Je trouvai là aussi le moyen de renouer avec la langue française, dont mes nombreuses publications en espagnol m’avaient éloigné. Outre ces circonstances de vie et de travail peu favorables, la réforme, que je juge personnellement néfaste, des Universités à la suite du Processus de Bologne finit par faire de moi un étranger dans ma propre institution. J’en tirai la conséquence que je devais prendre au plus tôt une retraite à laquelle me donnaient droit mes plus de quarante années de bons et loyaux services, dans le but de reprendre une vie de chercheur à part entière. C’est ce que je fis en 2001.
Livre de Bon Amour et celle personnelle du Comte Lucanor-, exercice salutaire qui impose une saine discipline de travail. Je trouvai là aussi le moyen de renouer avec la langue française, dont mes nombreuses publications en espagnol m’avaient éloigné. Outre ces circonstances de vie et de travail peu favorables, la réforme, que je juge personnellement néfaste, des Universités à la suite du Processus de Bologne finit par faire de moi un étranger dans ma propre institution. J’en tirai la conséquence que je devais prendre au plus tôt une retraite à laquelle me donnaient droit mes plus de quarante années de bons et loyaux services, dans le but de reprendre une vie de chercheur à part entière. C’est ce que je fis en 2001.
Années de retraite
Trois projets étaient prioritaires ; pendant la vie active j’en avais repoussé la réalisation à plus tard. Encore fallait-il leur trouver un éditeur. Jusque-là, je n’avais écrit aucun ouvrage sur commande et c’était le cas aussi pour ces trois-là. Après bien des tergiversations, sur le conseil d’un ami libraire de Chinon, j’adressai à Claude Durand, directeur des éditions Fayard, ma traduction commentée de la Pucelle de France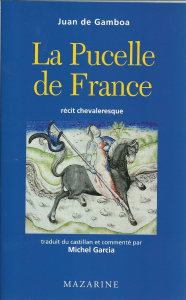 , récit chevaleresque castillan rédigé autour de 1479, qui dormait dans mes dossiers. Il accepta de la publier et elle parut en 2007 dans la collection Mazarine. Quant au manuscrit de la Chronique d’Henri III, j’en avais obtenu une photocopie, il y avait fort longtemps, de la Biblioteca de Palacio, comme on l’appelait alors, mais il avait cessé d’être prioritaire dans mes recherches.
, récit chevaleresque castillan rédigé autour de 1479, qui dormait dans mes dossiers. Il accepta de la publier et elle parut en 2007 dans la collection Mazarine. Quant au manuscrit de la Chronique d’Henri III, j’en avais obtenu une photocopie, il y avait fort longtemps, de la Biblioteca de Palacio, comme on l’appelait alors, mais il avait cessé d’être prioritaire dans mes recherches.  En outre, la graphie de la fin du seizième siècle dans lequel il avait été transcrit s’avérait singulièrement plus ardue que celle des xive et xve siècle, qui m’était familière. Je finis par le transcrire puis par le commenter et l’adressai au libraire Marcial Pons, qui l’accepta. Il ne parut en définitive qu’en 2013.
En outre, la graphie de la fin du seizième siècle dans lequel il avait été transcrit s’avérait singulièrement plus ardue que celle des xive et xve siècle, qui m’était familière. Je finis par le transcrire puis par le commenter et l’adressai au libraire Marcial Pons, qui l’accepta. Il ne parut en définitive qu’en 2013.
Le troisième projet concernait le Traité de fauconnerie de Pedro López de Ayala. C’est le seul ouvrage du chancelier à ne pas avoir trouvé place dans ma Thèse et j’en avais conçu du remords, parce que, de toutes ses œuvres, c’est celle qui a connu la plus large et la plus constante diffusion. Mais, pour être en mesure de la commenter, il fallait de solides connaissances en entomologie, en botanique, en matière de chasse au vol et d’art vétérinaire appliqué aux oiseaux. J’en étais très dépourvu. Le hasard me mit en contact avec le Professeur de Louvain la Neuve, Baudouin Van den Abeele, qui dirigeait pour lors une collection de textes cynégétiques chez Jacques Laget, qui depuis a été reprise par la Librairie Droz. M’aidant de la connaissance intime que j’avais acquise avec le temps sur l’auteur du traité et au prix de quelques colloques spécialisés, d’une mise à contribution abusive d’érudits de France et d’Espagne et d’une sollicitation constante de mon directeur de collection, je parvins à une maîtrise satisfaisante de ce texte ardu mais passionnant pour pouvoir le soumettre au regard critique des connaisseurs. Pour toutes ces raisons, il n’est paru qu’en 2018.

En 2007, la Diputación Foral de Alava organisa à Vitoria et à San Juan de Quejana, fief de la famille Ayala, des manifestations pour commémorer le six-centième anniversaire de la mort de Pedro López. L’idée me vint de rééditer mon édition du Rimado de Palacio (1978), désormais épuisée et de toute façon établie selon des critères que je jugeais désormais très discutables. Mes collègues de l’Université du Pays Basque acceptèrent de l’accueillir dans leurs collections. J’ai travaillé sur elle avec régularité mais sans précipitation, en alternance avec les autres projets en cours, jusqu’au printemps 2018 où un collègue espagnol très bien informé m’annonça que le texte avait été inscrit au programme de l’Agrégation d’Espagnol pour les sessions de 2019 et 2020. Je me mis d’urgence à la rédaction finale de sorte que le volume puisse paraître à temps. Il sortira finalement au-début du mis de mai 2019.

Les autres volumes que j’ai publiés pendant cette époque l’ont été à la suite de sollicitations extérieures. Pour rédiger le volume des écrits espagnols des Œuvres Complètes de Mérimée, dirigée par Antonia Fonyi aux Editions Honoré Champion, il fallait un bon connaisseur de la Chronique de don Pèdre, texte qui constitue l’essentiel du volume. Mais, compte tenu du contexte éditorial, il fallait aussi une bonne connaissance générale de l’œuvre de Prosper Mérimée. Une décade opportunément organisée à Cerisy et ma fréquentation assidue du Séminaire fondé par la même  Antonia Fonyi, sans faire de moi un mériméen pur jus, m’ont tout du moins familiarisé avec l’ensemble d’une œuvre que l’on réduit trop souvent à ses seules nouvelles.
Antonia Fonyi, sans faire de moi un mériméen pur jus, m’ont tout du moins familiarisé avec l’ensemble d’une œuvre que l’on réduit trop souvent à ses seules nouvelles.
Les Universités de Séville et de Grenade en collaboration avec la Librairie Marcial Pons avaient entrepris une réédition facsimilée de la Collection de chroniques castillanes du xve siècle publiée au début des années 1940 par Juan de Mata Carriazo, précédée d’une étude chargée d’une mise à jour bibliographique et critique. J’acceptai volontiers, à l’invitation de Manuel González Jiménez, de rédiger celle de la Chronique du Connétable Miguel Lucas de Iranzo et de renouer ainsi avec mes travaux sur Jaén et sa Province. Elle parut en 2009.
C’est aussi au programme de l’Agrégation d’Espagnol de 2014 que l’on doit ma réédition de la traduction du Comte Lucanor de l’Infant don Juan Manuel, la précédente étant épuisée et méritant de toute façon quelques corrections. 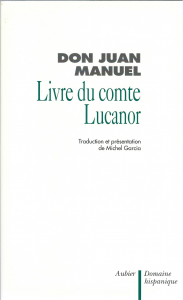 Enfin, ma contribution à la traduction du livret d’Unamuno, Comment se fait un roman, fut des plus modestes, même si Bénédicte Vauthier, qui en est le véritable auteur, jugea bon de m’en attribuer aussi la co-paternité.
Enfin, ma contribution à la traduction du livret d’Unamuno, Comment se fait un roman, fut des plus modestes, même si Bénédicte Vauthier, qui en est le véritable auteur, jugea bon de m’en attribuer aussi la co-paternité.
Les circonstances qui ont rendu possible et accompagné de l’édition de la Chronique de Jean II illustrent assez bien les circuits inattendus qu’emprunte parfois la recherche universitaire. Mon jeune collègue Francisco Bautista, de l’Université de Salamanque, s’était fait connaître par des travaux d’une grande finesse et d’une grande érudition sur les récits historiographiques médiévaux castillans. Il eut le grand courage d’entreprendre de dévider le complexe écheveau des chroniques du règne de Jean II (1405-1454) et certaines de ses trouvailles réalisées dans des archives publiques et privées lui ont permis de renouveler notre approche de ces textes et des circonstances de leur composition. Mais le temps lui manquait pour réaliser une édition de la totalité du corpus. Dans un premier temps, je lui proposai de l’aider en lui épargnant certaines tâches ingrates mais, en fin de compte, nous nous résolûmes à nous partager les différentes Parties. Je me chargeai de la première d’entre elles, correspondant aux quinze premières années du règne. Voilà comment je me trouvai engagé dans une opération de grande envergure, qui a trouvé un terme heureux dans l’excellente collection créée et dirigée à l’Université de Salamanque, par Pedro Cátedra, à l’automne 2018.
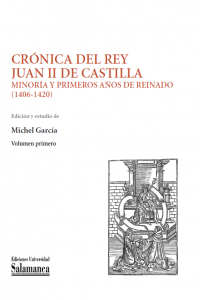
Epilogue
Les promesses d’une vieillesse studieuse et productive sont difficiles à tenir, tant il est vrai que les sollicitations, qu’elles soient familiales ou associatives, auxquelles est exposé un « jeune » retraité (un retraité « novel », dirait-on en espagnol) sont nombreuses et souvent impératives. Un autre obstacle menace, celui de devoir constater que les projets étaient trop ambitieux et que, devant l’épreuve, les capacités manquent pour les réaliser dignement. Un choix s’impose nécessairement, l’essentiel étant de ne pas baisser les bras et de renoncer à tout au premier échec. Au risque de paraître prétentieux, il me semble pouvoir dire que le bilan que j’ai pu dresser ici est en fin de compte plutôt flatteur. Si mes travaux s’arrêtaient là, je n’aurais pas à rougir de ces dix-huit années passées hors des contraintes du travail quotidien.
Cependant, une autre constatation s’impose, plus douloureuse, celle-là. Un travail intellectuel ne se conçoit pas sans un soutien régulier extérieur. Or, si j’ai eu, depuis ma retraite, des échanges fréquents et enrichissants avec des collègues étrangers, principalement espagnols, non seulement parce qu’ils ont accepté de publier mes travaux, mais aussi parce qu’ils m’ont accompagné pendant leur processus d’élaboration, force m’est de constater que je n’en ai guère eu, sauf exception, avec des collègues français. Faut-il incriminer des individus ? En partie seulement. Il semble plutôt que la responsabilité de ce comportement incombe à une certaine tradition de l’Université française, qui tranche sur les pratiques d’autres nations, et aussi à un système d’échanges entre chercheurs corseté par des normes administratives qui favorisent l’esprit routinier et encourage l’entre-soi.
Le principal danger qui menace la recherche, c’est une excessive spécialisation ; il y a longtemps que le diagnostic a été posé. Je revendique une certaine dose d’éclectisme et j’y vois la seule garantie face à une sclérose toujours menaçante, même si c’est au prix d’erreurs passagères. Il sera toujours temps de les réparer. Que la leçon vienne d’un retraité en dit long sur la réalité d’aujourd’hui.