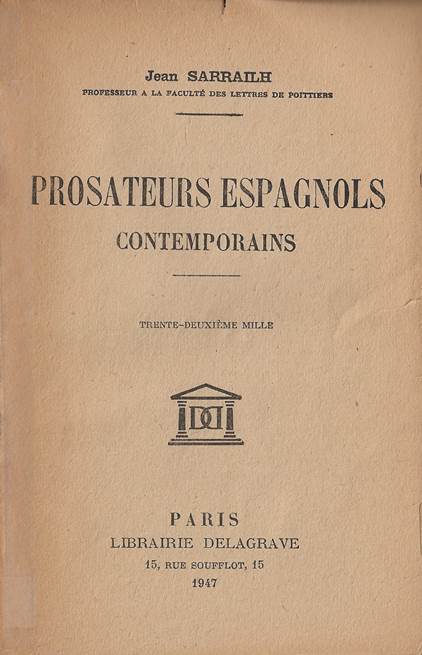
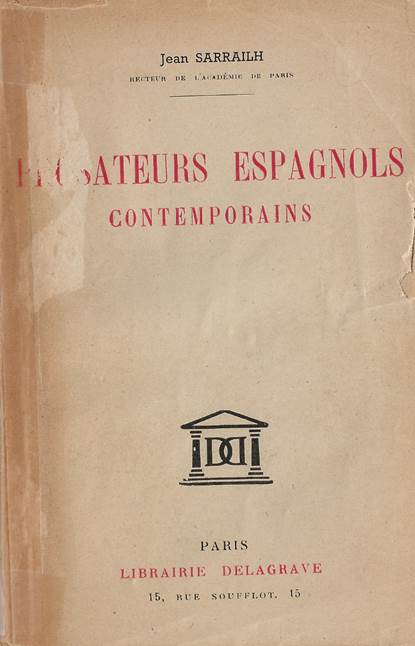
À propos des Prosateurs espagnols contemporains
de Jean Sarrailh
Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, dans les lycées et les collèges, l’apprentissage de la littérature se faisait essentiellement à partir de Morceaux choisis. Les universitaires n’étaient pas beaucoup mieux lotis. Ceci explique que l’anthologie des Prosateurs espagnols contemporains de Jean Sarrailh (1927) ait été bien accueillie et ait connu un succès prolongé. Dans les années cinquante, à l’École Normale d’Instituteurs de Dax, notre professeur, René Sylvain, en faisait un large usage, au point qu’un personnage de Pío Baroja nous inspira l’idée de donner son nom à notre économe (‘Lecochandegui’ devenant ‘L’Éco[nome] Chandègue’). Je ne crois pas m’être entretenu de son livre avec Jean Sarrailh, les rares fois qu’il me fut donné de le rencontrer avant sa mort prématurée (début 1964). J’étais trop impressionné, moi qui n’étais à l’époque qu’un jeune licencié d’espagnol. C’est à la lecture des Mémoires dictées par son épouse Marie-Amélie (Mariam), dans lesquels elle évoque leurs années de Madrid (1917-1925), que j’ai eu l’idée de reprendre cet ouvrage et de l’analyser, car je suppose qu’il fut conçu et peut-être même rédigé à cette période. La fréquentation des auteurs qui étaient encore en vie y avait peut-être laissé quelques traces perceptibles. J’envisageai sérieusement aussi l’hypothèse selon laquelle Mariam, grande lectrice, familière des décades de Pontigny, qui enseignait, elle aussi, à l’Institut français de Madrid et qui tira profit du bain linguistique offert par ce séjour de plusieurs années, eût collaboré à la rédaction. La lecture détaillée réalisée par Michèle (Garcia-Enjolras) puis par moi nous a permis de retrouver sa patte dans certains jugements parfois péremptoires, comme elle aimait à les prononcer.
Présentation du volume
Le volume s’ouvre sur un Avertissement (p. 5-7) et se clôt sur une Note finale (p. 233-238) et une Table. Chaque chapitre comporte une notice introductive de deux à trois pages (quatre exceptionnellement) suivie de plusieurs extraits de l’œuvre de l’auteur retenu, chacun étant précédé d’un titre rédigé par Jean Sarrailh. Chaque texte est agrémenté de notes.
Principes de l’anthologie
L’essentiel du bref Avertissement initial vise à présenter une démarche qui se veut originale et qui tranche sur les pratiques traditionnelles en cours à l’époque. Jean Sarrailh se démarque, en particulier, de la pratique des Morceaux choisis, en adoptant le point de vue de Julien Bézard (1867-1933), agrégé de lettres, qui publia de nombreux travaux sur l’organisation de l’enseignement secondaire, dont un ouvrage intitulé De la Méthode littéraire, dont il reproduit un passage (p. 412, note 1) qui, de toute évidence, traduit sa pensée sur le sujet : En général, « les morceaux choisis proposent une série de pages, et nous cherchons à faire connaître une série de livres. Ils éparpillent l’attention sur un grand nombre d’ouvrages de second ordre [souligné dans le texte], et nous désirons la concentrer sur un petit nombre de chefs-d’œuvre [id.] ».
Ces principes impliquent de prendre en considération « la hiérarchie des valeurs littéraires espagnoles », de refuser le pittoresque ou la couleur locale (« Nous ne citons pas un seul récit de courses de taureaux »), de tirer l’Espagne de l’isolement dans lequel elle est tenue par la critique, en matière de pensée et d’esthétique. Les extraits sont suffisamment longs pour que le lecteur se fasse une idée précise de l’écrivain et pour qu’ils puissent constituer des ensembles susceptibles d’illustrer des techniques d’écritures précises (« portraits, descriptions, récits »).
On voit que le projet est ambitieux et qu’il ne vise pas seulement à fournir aux étudiants un outil de qualité mais aussi à remettre en cause des pratiques jugées désuètes et néfastes. Il s’appuie aussi sur l’enthousiasme que suscite chez son auteur la création littéraire espagnole du moment, qu’il estime « en pleine splendeur ». C’est sur ces mots que s’achève l’Avertissement.
Les auteurs retenus
La liste des auteurs est la suivante :
Pedro Antonio de Alarcón (1833-1891) p. 9-20
Leopoldo Alas (Clarín) (1852-1901) p. 21-29
Pereda (1835-1905) [il ne cite jamais son prénom, José María] p. 30-39
Benito Pérez Galdós (1843-1920) p. 40-52
Comtesse de Pardo Bazán (1851-1921) p. 53-63
Juan Valera (1824-1905) p. 64-76
Palacio Valdés (né en 1853) [ne cite pas son prénom et l’appelle parfois Valdés] p. 77-92
Blasco Ibáñez (1867-1928) p. 93-109
Miguel de Unamuno (né en 1864) p. 110-117
Ramón del Valle-Inclán (né en 1869) p. 118-133
Pío Baroja (né en 1872) p. 134-152
Azorín (né en 1874) p. 153-169
R. Pérez de Ayala (né en 1880) p. 170-188
Gabriel Miró (né en 1879) p. 189-200
Eugenio d’Ors (né en 1882) p. 201-214
Ortega y Gasset (né en 1883) p. 215-227
Juan Ramón Jiménez (pas de date) p. 228-232
Distribution du volume
Les extraits des œuvres reproduits occupent 223 pages réparties entre 17 auteurs, ce qui donne une moyenne de 13 pages par auteur.
Pagination réservée à chaque auteur :
5 pages : Juan Ramón
8 pages : Unamuno
9 pages : Clarín
10 pages : Pereda
11 pages : Pardo Bazán
12 pages : Alarcón ; Miró
13 pages : Galdós ; Valera ; Ortega y Gasset
14 pages : D’Ors
16 pages : Palacio Valdés ; Valle-Inclán
17 pages : Blasco Ibáñez
18 pages : Azorín
19 pages : Pío Baroja ; Pérez de Ayala
Sans vouloir tirer de conclusions hâtives d’une donnée quantitative qui obéit à des critères dont la maîtrise échappe en partie à l’auteur de l’anthologie, par exemple la nécessité de préserver une certaine cohérence dans le découpage des textes, on peut observer un traitement différencié selon les auteurs. La brièveté du chapitre consacré à Juan Ramón Jiménez, outre qu’il s’agit d’un ajout de l’édition de 1947, semble exprimer le relatif embarras que ressent Jean Sarrailh en cédant à la tentation de faire une place, parmi ces prosateurs, à un poète, alors qu’il la refuse à Antonio Machado, qu’il cite pourtant en tête de la notice introductive de Juan Ramón.
Des dix-sept auteurs répertoriés, neuf bénéficient d’un espace proche de la moyenne, entre 11 et 16 pages – Pardo Bazán, Alarcón, Miró, Galdós, Valera, Ortega y Gasset, D’Ors, Palacio Valdés et Valle-Inclán -, ce qui n’appelle pas de commentaire particulier. J’observe que ceux qui ont droit au traitement le plus avantageux – Blasco Ibáñez (1867), Azorín (1874), Pío Baroja (1872) et Pérez de Ayala (1880) – sont tous nés à une date rapprochée, entre 1867 et 1880, et appartiennent à une génération bien plus jeune que les sept premiers, qui sont nés entre 1824 et 1853. Ce n’est sans doute pas un hasard, si ces quatre prosateurs appartiennent à la génération qui précède immédiatement celle de Jean Sarrailh (1891) et de son épouse, Marie-Amélie (née en 1889). Le fait qu’Unamuno, Pereda et Clarín occupent si peu de pages pourrait s’expliquer a contrario par leur éloignement dans le temps. Il n’en reste pas moins qu’ils sont cités. Peut-être faut-il y voir l’intention de donner une profondeur à l’anthologie en permettant, dans le choix des textes mais aussi dans les notices, d’effectuer d’utiles rapprochements entre les plus jeunes et leurs devanciers. Sans préjuger d’une analyse plus fine, cela semble sous-entendre, dans l’esprit de l’auteur de l’anthologie, une filiation de fait entre des écrivains relativement éloignés dans le temps, le passage de l’un à l’autre se traduisant par des changements sans rupture. On imagine combien il serait difficile de proposer une liste équivalente dans une anthologie consacrée aux prosateurs français, parce que cela reviendrait à faire se côtoyer, toutes proportions gardées, Jules Renard (1864), Romain Rolland (1866), Marcel Proust (1871), avec Villiers de l’Isle-Adam (1840), Huysmans (1848), Anatole France (1844) et Paul Bourget (1852).
Le fait de réunir tous ces auteurs dans une anthologie traduit le sentiment que cette production littéraire se caractérise par une forme de continuité, ce qui fait l’originalité (ou les limites) de l’Espagne dans ce domaine, comparée à d’autres nations. Il offre aussi la possibilité de mesurer les changements survenus au cours de ce demi-siècle, ce qui revient, de fait, à mettre en valeur par comparaison les qualités de la production récente.
Les auteurs et leurs œuvres
La liste des auteurs figurant dans l’anthologie n’est guère originale, si l’on en juge par le fait que les Histoires de la littérature espagnole publiées depuis, lorsqu’elles abordent cette époque, en reproduisent systématiquement la liste à peu de variantes près. À la réflexion, il n’y pas lieu de s’en étonner, si l’on veut bien considérer que les conditions de production et de diffusion du livre étaient telles à l’époque qu’elles ne concernaient qu’un nombre restreint de personnes et d’institutions, sans parler des lecteurs potentiels. J’imagine que si quelqu’un entreprenait aujourd’hui d’en faire de même avec les auteurs de notre époque, disons ceux qui sont nés depuis les années quarante du siècle passé, le résultat serait très différent.
Le choix des auteurs
À titre de comparaison, nous possédons une liste d’auteurs espagnols établie par Antonio Marichalar pour le numéro double de la revue Intentions (n° 23-24), paru peu d’années auparavant (avril-mai 1924). Je ne mentionne que ceux qui seront retenus par Jean Sarrailh. Marichalar, reprenant la classification établie par Valery Larbaud, distingue quatre générations : celle de 1898 (Unamuno, Baroja, Valle-Inclán) ; celle de 1900 (Juan Ramón Jiménez, Ortega y Gasset, Eugenio D’Ors) ; la génération suivante, âgée de 30 à 40 ans : Pérez de Ayala, Miró ; enfin les plus jeunes, qui n’entrent pas dans le champ d’étude de Jean Sarrailh. Cette liste permet de mieux cerner le propos de ce dernier. Il ne s’intéresse qu’aux trois premières « générations » définies par Valery Larbaud, exclut les auteurs les plus jeunes, et ajoute les noms de quelques devanciers, qui ne relèvent pas, quant à eux, d’un classement générationnel.
Quelques années plus tard (1931), Jean Cassou, dans sa Littérature espagnole (Paris, éditions KRA), reproduit, à peu de choses près, la liste de Jean Sarrailh. Cassou connaissait bien Jean Sarrailh, à en juger par l’amicale dédicace qu’il rédige à son intention en lui adressant son livre : « à Jean Sarrailh avec ma très cordiale et dévouée sympathie ».
Les auteurs dont il traite sont les suivants : Juan Valera ; Alarcón ; José María de Pereda ; le P. Coloma ; Pardo Bazán ; Armando Palacio Valdés ; Ricardo León ; Pérez Galdós ; Angel Ganivet ; Unamuno, Azorín, Pío Baroja ; Ramón del Valle-Inclán ; Blasco Ibáñez ; Ramón Pérez de Ayala : José Ortega y Gasset ; Eugenio d’Ors ; Gabriel Miró ; Ramón Gómez de la Serna. La comparaison est instructive. La liste de Cassou ne diffère de celle de Jean Sarrailh que par l’ajout de deux noms, ceux du Père Coloma et de Ramón Gómez de la Serna.
Les rares différences s’expliquent aisément. En effet, si Angel Ganivet (1865-1898) et Ricardo León (1877-1948) ne figurent pas dans les Prosateurs contemporains, c’est comme l’écrit Jean Sarrailh dans une note finale placée avant la Table, qu’il comptait les inclure (avec Octavio Picón, 1852-1923 et Concha Espina 1877-1955) mais qu’il en a été empêché, « faute d’avoir reçu ou pour avoir reçu trop tard, les autorisations nécessaires ». Quant à Ramón Gómez de la Serna, il est né en 1888 et Sarrailh a pu le considérer comme appartenant à une génération plus jeune (il faut savoir se résoudre à clôturer une liste).
Reste le Père Coloma (1851-1914). Il a le même âge que Clarín, la comtesse de Pardo Bazán et Palacio Valdés et a acquis une certaine notoriété en tant qu’auteur de Pequeñeces (1891), deux caractéristiques qui auraient justifié qu’il figurât dans la liste. J’ai tendance à penser que l’omission est voulue. Pendant ses années madrilènes, Jean Sarrailh travaillait à la rédaction de ses Thèses sur Un homme d’état espagnol, Martínez de la Rosa (1787-1862) (Thèse principale) et sur La Contre-Révolution sous la Régence de Madrid (mai-octobre 1823) (Thèse complémentaire), toutes deux publiées en 1930. Ses sympathies allaient aux héritiers des libéraux de la Constitution de Cadix. Or, Coloma, dès son plus jeune âge, s’était déclaré hostile à la Révolution de 1868 et avait soutenu, le restant de sa vie, des opinions réactionnaires. En outre, Jean Sarrailh, qui n’a jamais caché sa désaffection à l’égard du fait religieux, ne devait guère porter ce jésuite dans son cœur. Un indice de ce refus de l’incorporer à sa liste réside paradoxalement dans son projet d’y faire une place à Jacinto Octavio Picón. Ce dernier est l’exact contemporain de Coloma et son œuvre à l’extrême opposé de celle du Père jésuite. François Beyrie décrit en ces termes l’orientation des thèmes de prédilection d’O. Picón : « mise en cause de l’emprise cléricale (El enemigo, 1887), critique de la condition de la femme et de l’institution du mariage dans des textes tels que La honrada (1890), Dulce y sabrosa (1891), ou Juanita Tenorio (1910), que par l’audace formelle de ses romans » (Jacques Beyrie, Robert Jammes, Histoire de la littérature espagnole, Paris, PUF, 1994, p. 351-352). On ne saurait imaginer opposition plus forte entre deux écrivains, ni mettre en doute que le choix de retenir l’un et pas l’autre est délibéré.
Cassou n’ignorait donc pas les Prosateurs contemporains, mais il n’a pas pour autant reproduit aveuglément la liste de Jean Sarrailh, même si la nature de leur projet respectif avait ceci de commun qu’elle incluait de remonter plus loin que les dernières trente années, Jean Sarrailh ayant choisi de s’en tenir au demi-siècle écoulé (Note finale). En revanche, Marichalar ne s’intéresse qu’à une nouvelle vague d’écrivains, essentiellement des poètes. Mais il convient d’observer que, lorsqu’il évoque des époques antérieures, il reproduit à peu près à l’identique une liste qui semble désormais arrêtée, pour ne pas dire canonique, comme le démontrent par ailleurs les Histoires de la littérature espagnole ultérieures, s’agissant de la même époque. Ces similitudes témoignent également de la relative pauvreté de la création littéraire en Espagne, qui laisse peu de place à des trouvailles inespérées.
La marge d’initiative dont bénéficie un auteur d’anthologie est étroite, surtout s’agissant d’une production relativement restreinte dans la durée et dans sa quantité. Elle existe pourtant et explique certains choix et certains « oublis ».
L’édition de 1947
En 1927, avant de remettre son manuscrit à l’éditeur, Jean Sarrailh a visiblement veillé à inclure des références à des œuvres récentes dans les notices consacrées à chaque auteur et plus particulièrement dans les bibliographies (« Principaux ouvrages ») qui les concluent (étrangement, le chapitre consacré à Azorín n’en comporte pas).
Cela ne concerne, bien évidemment, que ceux des auteurs qui sont encore en activité :
Unamuno : L’agonie du christianisme (1925).
Valle-Inclán : Tirano Banderas ; La corte de los milagros (1927).
Pío Baroja : Trilogie des Agonies de notre temps, dont le dernier titre, Los amores tardíos, est daté de décembre 1926.
Pérez de Ayala : El ombligo del mundo ; Tigre Juan ; El curandero de su honra (1926).
Gabriel Miró : El obispo leproso (1926).
Eugenio d’Ors : La primera lección de un curso de filosofía (1927).
Ortega y Gasset : « a fondé la Revue d’Occident (Revista de Occidente), qui, depuis 1923, paraît chaque mois à Madrid ».
Une réactualisation partielle est donc perceptible mais relève plus du scrupule d’un auteur désireux de combler le vide provoqué par le laps de temps qui sépare l’achèvement de son texte et la mise sous presse.
L’édition de 1947 (dépôt légal 3e trimestre 1947, 240 p.), tout en reproduisant la première (1927, 234 p.), a introduit de nouvelles mises à jour, comme la date de la mort de Blasco Ibáñez (1928), survenue entre temps et l’ajout d’un chapitre consacré à Juan Ramón Jiménez. C’est, du moins, ce que suggèrent la première phrase de la notice correspondante (« Un scrupule nous avait retenu d’introduire dans notre recueil des Prosateurs quelques fragments de Juan Ramón Jiménez […] »), ainsi qu’un passage de cette notice dans lequel est mentionnée une conférence de Jorge Guillén (« donnée récemment à l’Université internationale de Santander [août 1933] »).
Cette reproduction quasi identique a pour effet de ne pas proposer d’extraits des œuvres les plus récentes des auteurs qui continuèrent à publier après 1927 : Ramón Pérez de Ayala, Valle-Inclán, José Ortega y Gasset, Eugenio D’Ors. Elle a aussi celui de ne pas inclure d’auteurs qui se sont fait connaître avant la Guerre civile et sont alors en pleine création, bien que vivant en exil : Ramón Sender (Imán, 1930 ; Siete domingos rojos, 1932 ; Mr Witt en el Cantón, 1936) ; Max Aub (Luis Alvarez Petreña, 1934) ; Francisco Ayala (Cazador en el alba, 1930) ; Rosa Chacel (Estación, ida y vuelta, 1930).
Pour expliquer cette reprise à l’identique d’une anthologie désormais datée, on peut avancer plusieurs explications. La première est qu’un remaniement aurait eu des conséquences immédiates sur le volume lui-même : ou bien on complétait la première édition et il prenait des proportions trop considérables pour un ouvrage scolaire ; ou bien on compensait l’ajout de textes nouveaux par une suppression de textes plus anciens et on s’imposait un remaniement complet, qui impliquait de repenser l’économie générale d’un ouvrage qui avait posé pour principe que la production récente ne s’entendait que dans son rapport avec celle des devanciers, considérés comme des précurseurs.
Une autre explication est que, lorsque parut cette seconde édition, Jean Sarrailh, de retour à son rectorat de Montpellier, venait d’être nommé recteur de Paris. Ces activités prenantes lui laissaient peu de loisirs. En outre, il ne faut pas exclure que l’éditeur Delagrave fût tenté de rééditer l’ouvrage d’un auteur devenu aussi prestigieux et que Jean Sarrailh se soit laissé faire, même si, par scrupules peut-être ou pour apaiser sa conscience, il saisit l’occasion de rendre un hommage personnel à Juan Ramón Jiménez.
Une dernière explication, plus objective, réside dans le fait que Jean Sarrailh s’était promis de ne pas remettre les pieds dans l’Espagne gouvernée par Franco. Il tint sa promesse jusqu’à sa mort, malgré ce qui lui en coûta pour rédiger son Espagne éclairée de la seconde moitié du XVIIIe siècle sans pouvoir consulter personnellement les bibliothèques et archives espagnoles. Cette décision le priva aussi d’une relation suivie avec le monde culturel espagnol qui, par ailleurs, s’était considérablement appauvri sous le régime franquiste. Pour pouvoir prolonger son anthologie, il lui aurait fallu se tourner vers les auteurs de l’exil, dont la dispersion rendait pratiquement impossible de conserver l’approche unitaire de la littérature espagnole du moment, qui caractérise son Anthologie. En fin de compte, l’hypothèse d’une initiative de l’éditeur, désireux de rééditer un ouvrage dont le succès était assuré auprès des enseignants, est la plus probable.
À propos du titre
La notion de contemporanéité
Le terme de « contemporains » que Jean Sarrailh a placé dans le titre de son anthologie a une valeur relative et, de ce fait, est passablement ambigu. Les auteurs retenus sont-ils contemporains entre eux ? Se situe-t-il lui-même dans cette temporalité et à quelle place ? Quelles conséquences cette coïncidence chronologique réelle ou supposée entraîne-t-elle dans une approche plus générale de la littérature espagnole du XIXe siècle et des premières années du XXe ?
Dans son bref avertissement initial, Jean Sarrailh revendique le fait d’avoir « fait place aux grands écrivains de l’heure présente », mais, pour « ceux d’avant-garde », renvoie à la sélection dressée par Valery-Larbaud et Marichalar pour la revue Intentions. Il invite aussi ses lecteurs à « mesurer les progrès intellectuels et artistiques réalisés par l’Espagne depuis une cinquantaine d’années ». Cette périodisation permet de mieux cerner selon quels critères il a choisi les auteurs qui devaient figurer dans son anthologie.
Alarcón (†1891), Clarín, (†1901), Pereda (†1905), Juan Valera (†1905) sont des ancêtres plus ou moins illustres et respectés aux yeux d’écrivains qui n’ont pu les connaître ou ont commencé à publier après leur mort : R. Pérez de Ayala, Gabriel Miró, Eugenio d’Ors, Ortega y Gasset, tous nés entre 1879 et 1883. Pérez Galdós (†1920), la comtesse de Pardo Bazán (†1921) et Palacio Valdés (d’une longévité exceptionnelle, puisqu’il mourut en 1938) forment un groupe intermédiaire, qui eut certainement une influence – adhésion ou rejet -, sur les plus jeunes. Ces derniers (Pérez de Ayala, Miró, D’Ors, et Ortega), ainsi que leurs aînés immédiats, Blasco Ibáñez, Unamuno, Valle-Inclán, Baroja, Azorín, toujours en activité lorsque paraît la première édition de l’anthologie, sont ceux qui répondent le mieux à la notion de contemporanéité présente dans le titre. Jean Sarrailh a pu lire leurs œuvres les plus récentes lors de leur parution, pendant son séjour madrilène, entre 1917 et 1925. De ce point de vue, on peut donc considérer que l’anthologie est un témoignage direct, recueilli à la source, sur certains auteurs et sur leurs œuvres, ce qui, à n’en pas douter, augmentait l’intérêt du volume pour ses lecteurs.
Des lecteurs de 1927 se voyaient donc confrontés à deux conceptions différentes de cette notion. D’une part, on les invitait à découvrir des auteurs plus anciens, tous disparus, d’autre part, on leur proposait des extraits d’œuvres d’écrivains de leur temps. Leur regard pouvait-il être le même selon qu’il se portait sur l’un ou l’autre de ces groupes ? Certainement pas, puisqu’ils avaient à faire, d’un côté, à une œuvre achevée, relevant désormais des manuels d’histoire de la littérature, de l’autre, à une œuvre en cours de création, qui leur promettait de nouvelles découvertes. Si Jean Sarrailh a assumé le risque de cette ambiguïté, on peut supposer que c’est pour mieux satisfaire à la finalité pédagogique qu’il avait assignée à son ouvrage, pour l’accomplissement duquel le fait de remonter aussi loin que possible dans le XIXe siècle devait fournir à ses utilisateurs des éléments de comparaison qu’il jugeait indispensables.
Pour les utilisateurs de l’édition de 1947, ce qualificatif de « contemporains » devait paraître ou aurait dû (je ne crois pas que les élèves de René Sylvain se soient jamais posé la question en ces termes) paraître d’autant plus étrange que l’effet d’actualité créé par les mises au point de 1927 n’avait plus de prise sur eux. L’essentiel de la littérature espagnole se publiait désormais hors d’Espagne et prenait une dimension toute nouvelle, en subissant l’influence de thèmes et d’une esthétique propres aux pays d’Amérique latine (principalement) où ses auteurs vivaient désormais.
Définition de ‘Prosateurs’
Le terme de prosateurs mérite aussi commentaire. Il apparaît dans le titre mais est curieusement absent de l’Avertissement et de la Note finale, dans lesquelles Jean Sarrailh expose les principes de sa démarche. Dans le premier texte, on retrouve plusieurs fois celui d’écrivains et, dans le deuxième, il n’est explicitement fait mention que de romanciers. Finalement, dans l’Avertissement, une phrase isolée, formant à elle seule un paragraphe (p. 6), ce qui contribue à la mettre en exergue, stipule : « Nous ne nous occupons que de romanciers et des essayistes ». Il y a lieu de penser que Jean Sarrailh, ayant pris conscience de l’anomalie, songea à la corriger in extremis, car il est bien connu que les pièces liminaires sont rédigées au moment où le manuscrit est remis à l’imprimeur. L’absence d’une mention des essayistes aurait été d’autant plus choquante que ce sont eux qui inspirent à Jean Sarrailh les commentaires les plus enthousiastes, qu’il s’agisse d’Eugenio D’Ors ou de José Ortega y Gasset, auquel on pourrait joindre Angel Ganivet, qu’il comptait bien inclure aussi mais fut empêché de le faire pour des raisons indépendantes de sa volonté.
De l’œuvre d’Eugenio D’Ors, il propose des extraits d’articles initialement publiés dans la Presse (El nuevo glosario) ou de « narrations à caractères de poèmes », selon l’expression de Jacques Beyrie (op. cit, p. 363), non à proprement parler des extraits de romans. À propos de José Ortega y Gasset, il s’excuse tout d’abord d’avoir jugé bon d’inclure dans sa collection « un des grands philosophes de l’Espagne actuelle ». Puis il justifie cette entorse par trois raisons : « Ortega a donné aux écrivains espagnols un trésor idéologique qu’ils ont exploité ces dernières années pour la plus grande gloire des lettres hispaniques » ; il a fait comprendre aux romanciers l’importance des idées, au point que le roman actuel est devenu intellectuel ; enfin, « les mérites singuliers de son style nous obligeaient, enfin, à lui faire place dans notre ouvrage ». Les textes qu’il a retenus de cet auteur sont tirés des chroniques qu’il a réunies sous le titre de El espectador, dont la publication commencée en 1916 se poursuivra jusqu’en 1934.
Dès lors, si la littérature des essayistes est d’une qualité supérieure à celle des romanciers, pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? Pourquoi ne pas avoir réservé une place à Ramiro de Maeztu, connu pour ses essais depuis 1899 (Hacia otra España) et dont un recueil intitulé Don Quijote, Don Juan y La Celestina venait de paraître (1926) ? Je soupçonne que Jean Sarrailh ne portait pas dans son cœur cet écrivain qui, après s’être signalé, dans un premier temps, pour son anti-traditionalisme, finit par défendre un catholicisme intégriste.
En somme, l’ouvrage se présente plutôt comme une anthologie des romanciers espagnols, qui aurait été complétée, peut-être in fine, par quelques figures d’essayistes, que Jean Sarrailh jugeait comme les plus novateurs des écrivains espagnols de l’époque. Il en résulte que le choix des auteurs et des genres retenus ne découle pas seulement de la prise en compte de données objectives mais aussi de goûts personnels de Jean Sarrailh.
Éloge du temps présent
Dans sa Note finale, Jean Sarrailh tente de définir les contours des changements survenus dans le champ de la prose en Espagne pendant le demi-siècle écoulé. Il les qualifie de « progrès », notion qui, appliquée aux œuvres de création et à la littérature en particulier, susciterait des débats aujourd’hui, et les caractérise en soulignant les pratiques opposées qui distinguent les générations entre elles. À la facilité de l’une, il oppose la complexité de l’autre ; à la prolixité, la concision ; à la superficialité, la profondeur ; au banal, le poétique ; à la pauvreté du vocabulaire, son enrichissement par le recours à des termes nouveaux mais aussi à des termes anciens auxquels on redonne vie. Voilà pour la forme.
Pour ce qui est du fond, Jean Sarrailh insiste sur le renouvellement d’une thématique qui s’appuie sur une idéologie nouvelle. Les principaux défauts de la vieille école résident, selon lui, dans un attrait excessif pour le régionalisme, confinant au provincialisme, et dans l’imitation du roman réaliste ou naturaliste français, apport extérieur mal assimilé. Le jugement est sans pitié et n’admet quelques nuances que chez certains de ces auteurs, tel Blasco Ibáñez, qui ont su évoluer à temps. En revanche, Jean Sarrailh ne tarit pas d’éloges à l’égard des « écrivains d’aujourd’hui », qui ont su réduire le régionalisme et le réalisme au statut d’éléments constitutifs mais non plus dominants, ont su accorder une note d’humanité et une dimension psychologique à leurs personnages, explorer les richesses de la littérature du passé et les mettre à profit. Enfin, sortant des limites de leur pays et de ses traditions, ils ont « universalisé » leur esprit.
Ce court texte, plus qu’une présentation conçue pour guider les lecteurs s’apparente à un manifeste, à la célébration d’une littérature pleine de promesses dont certaines se sont déjà accomplies. Il s’agit aussi du témoignage, d’autant plus enthousiaste qu’il est personnel, d’un spectateur avisé qui vient de vivre pendant près de dix années en immersion dans le bouillonnement créatif espagnol de l’époque.
Le projet pédagogique
Notices introductives
Chaque chapitre comporte au-début une notice de deux à trois pages, qui, malgré sa brièveté, est d’une grande richesse. Elle comporte à la fin, à une exception près (Azorín), une liste des principales œuvres de l’auteur (très conséquente pour Pío Baroja) et un court paragraphe, rédigé dans une tonalité prescriptive – « On insistera… », « On soulignera… », « On fera voir… », etc. -, qui propose un axe en vue du commentaire, à l’aide de termes souvent mis en italiques : « On en fera voir l’exactitude et l’ironie débordante » (Clarín, p. 22) ; « il importera de souligner la valeur des détails, puisque nous aurons à faire à un styliste » (Gabriel Miró, p. 193).
Au-delà de ces éléments récurrents, ce qui frappe, c’est l’absence d’un plan systématique. Jean Sarrailh prend soin de relever chez chaque auteur ses caractéristiques, sans s’embarrasser d’autre critère que celui que lui inspire une connaissance approfondie de son œuvre entière. Il ne se prive pas non plus de recourir souvent à des comparaisons avec des écrivains français, domaine qui devait être familier aux utilisateurs de son anthologie. Il se réfère rarement à la biographie de ses auteurs, sauf pour les plus anciens d’entre eux (Alarcón, Pereda, Juan Valera), mais sans que ces données influent réellement sur son analyse.
Il est permis de penser que ces informations sont à l’intention des Professeurs autant ou plus qu’à celle de leurs étudiants, car ces textes étaient conçus pour être expliqués en classe. Autant qu’il m’en souvienne, René Sylvain s’en inspirait pour conduire son commentaire, qui laissait peu de place à l’initiative de ses élèves, lesquels n’avaient sous leurs yeux (transcrit au tableau ?) que l’extrait à commenter.
Extraits choisis
Malgré le peu d’espace dévolu à chaque auteur, les extraits appartiennent rarement à une seule de leurs œuvres (Alarcón, Sombrero de tres picos ; Pereda : Peñas arriba ; Unamuno : Ensayos ; Ortega y Gasset : El Espectador T. I). Dans les autres cas, Jean Sarrailh propose des extraits de trois, voire quatre œuvres différentes.
Le choix est souvent dicté par l’obligation de mentionner l’ouvrage le plus connu : le Sombrero de tres picos pour Alarcón ; La Regenta pour Clarín ; Peñas arriba pour Pereda ; Los Pazos de Ulloa pour la Pardo Bazán ; Juanita la larga et Pepita Jiménez pour Valera ; La Hermana san Sulpicio pour Palacio Valdés ; La barraca, et Cañas y barro pour Blasco Ibáñez ; La Sonata de primavera, pour Valle-Inclán ; Libro de Sigüenza et Nuestro Padre San Daniel pour Gabriel Miró ; Platero y yo pour Juan Ramón.
Pour les auteurs les plus jeunes, Jean Sarrailh prend quelques libertés. Il délaisse les grands romans de Galdós, leur préférant certains Episodios nacionales et Marianela. De l’œuvre d’Azorín, il retient des textes de critique littéraire, Lecturas españolas, à côté de Doña Inés. De celle d’Eugenio d’Ors, il reproduit quatre extraits de Oceanografía del tedio, mais il puise aussi dans des volumes moins « romanesques », El nuevo glosario. En ce qui concerne Ortega y Gasset, il use de la liberté de prendre des textes brefs dans les recueils de El Espectador. Quant à Pío Baroja et Pérez de Ayala, ce sont de toute évidence deux romanciers qu’il apprécie particulièrement. Les romans qu’il a retenus du premier ne sont pas les plus connus, – Idilios vascos, Nuevo tablado de Arlequín, Mala hierga, El escuadrón del brigante -, mais le fait qu’ils soient si nombreux semble démontrer qu’il s’est senti embarrassé lorsqu’il lui a fallu choisir. Du second, il fait un sort à Belarmino y Apolonio, qui eut un remarquable succès et fut très vite traduit en français, ainsi qu’au dernier roman qu’il publiera, Tigre Juan.
Notes
Les notes sont relativement nombreuses. Rares sont les pages qui n’en ont aucune et certaines en comportent jusqu’à dix. Elles ont pour but, dans leur majorité, d’expliciter le texte : traduction de mots et expressions, identification des lieux et des personnages cités, références à des passages antérieurs du texte, etc. Elles sont généralement brèves, comme l’exige la nature de l’ouvrage, même si Jean Sarrailh le déplore en quelque occasion. Ainsi, à propos de deux vers tirés d’un hymne religieux chanté en basque, pour se disculper auprès de l’érudit auquel il a demandé la traduction, il précise : « Le caractère du présent livre ne nous permet pas de donner le savant commentaire de ces deux vers basques que nous a envoyés M. H. Gavel » (p. 141, n. 2).
Quelques rares notes portent sur la langue et la grammaire. Jean Sarrailh s’intéresse à la transcription des accents régionaux, tel l’accent andalou dans La hermana San Sulpicio de Palacio Valdés. Il signale l’emploi du « conditionnel à sens dubitatif » (« la señá Frasquita frisaría en los treinta »), avec un rappel de la forme deber de, tener unos (Alarcón, El sombrero de tres picos, p. 13). Il critique l’emploi du pronom le pour lo : a prenderle. Il faudrait prenderlo. Mais l’usage veut qu’on emploie le datif le au lieu de l’accusatif lo quand l’accusatif est un nom de personne » Clarín, La Regenta, p. 23).
Certaines soulignent l’intérêt stylistique de tel ou tel passage et invitent à les commenter, parfois longuement : « Insister sur cet exposé un peu puéril des idées humanitaires de l’auteur. Cette puérilité est exigée par la vraisemblance : c’est une jeune fille peu instruite qui parle » (Galdós, Marianela p. 50). D’autres suggèrent d’utiles comparaisons avec les écrits d’autres écrivains sur le même sujet, ainsi lorsqu’on invite à comparer la description de la ville d’Avignon réalisée par Blasco Ibáñez avec celle de Daudet, dans La Mule du Pape (p. 108).
Quelques-unes ne ménagent pas l’auteur : « Relever le caractère oratoire de la fin de cette phrase. Constater la banalité des adjectifs trop nombreux, aussi bien que de la pensée. Des phrases de ce genre sont assez fréquentes dans l’œuvre de Mme de Pardo Bazán, qui manque souvent de sens artistique » (Los Pazos de Ulloa, p. 60). Ces critiques ne sont pas réservées aux auteurs, telle celle que Jean Sarrailh adresse à l’Académie Espagnole : « L’Académie espagnole publie de temps en temps un dictionnaire et une grammaire qui, officiellement, font autorité, mais qui, scientifiquement, laissent fort à désirer » (Clarín, La Regenta, p. 25, n.3).
Les notes les plus copieuses sont celles qui se rapportent à des événements ou à des personnages historiques du XIXe siècle, époque bien connue de Jean Sarrailh, qui préparait alors sa Thèse de doctorat sur Martínez de la Rosa.
Il arrive parfois que la note dépasse son objet, qui est d’éclairer le texte, comme si son rédacteur ne parvenait pas toujours à maîtriser sa propre érudition. Il y en a plusieurs exemples dans le chapitre premier (Alarcón). On trouve ainsi une note inutilement détaillée sur le sens du terme tertulia, que Jean Sarrailh prend dans une acception différente de celle du texte d’Alarcón ; il reproduit la définition contenue dans le dictionnaire de Nicolas de Séjournant (XVIIIe siècle). À propos de Simancas, qui abrite les Archives Générales, il éprouve le besoin de préciser « qu’il existe aussi des dépôts importants à Alcalá de Henares et plus encore à Madrid (Archivo histórico nacional) ». Il est vrai que ce sont ces derniers qu’il a consultés assidûment à l’époque pour la rédaction de sa Thèse, alors que celui de Simancas n’est même pas cité au chapitre de ses sources. Ses recherches menées sur le XIXe siècle espagnol sont présentes dans bien des notes. C’est ainsi qu’Andújar est présentée comme la ville où le duc d’Angoulême a signé une ordonnance célèbre en 1823, et non parce qu’elle a été pendant plusieurs siècles une place-forte importante sur la frontière du royaume de Grenade ; c’est d’ailleurs peut-être pour cette raison que les Cent Mille fils de Saint-Louis y ont fait étape. Toujours en note du chapitre consacré à Alarcón, le terme barbilampiño donne lieu à une note de 10 lignes sur les mots composés fréquents en espagnol.
Le fait que ces deux exemples appartiennent au premier chapitre de l’anthologie suggère que Jean Sarrailh n’avait pas encore arrêté sa méthode. Était-il bien nécessaire de retracer l’œuvre de Garcilaso de la Vega et de citer le nom de Boscán pour identifier deux vers d’un sonnet, reproduits par Juan Valera ? Le phénomène ne se reproduit plus par la suite, du moins pas dans cette proportion.
Contribution à une histoire de la littérature
Chaque notice et, dans une moindre mesure, les notes aux textes ont pour objet de proposer une analyse de l’œuvre entière de chaque auteur, ce qui revient à écrire, pour chacun d’entre eux, une page de l’histoire la littérature espagnole. Les textes sélectionnés ne sont qu’une illustration de ce propos plus général.
Sources contemporaines
Le projet est donc ambitieux. Il implique une connaissance approfondie de ces œuvres, qui s’appuie nécessairement sur les travaux déjà publiés. Jean Sarrailh ne dresse pas une liste des publications qui l’ont aidé à rédiger son anthologie, mais on retrouve leur trace dans les Notices introductives.
Il mentionne à deux occasions Eduardo Gómez de Baquero, Andrenio, (Pardo Bazán, p. 54 et Valle-Inclán, p. 118) et trois fois Salvador de Madariaga (Galdós, p. 40 et 42 ; Pío Baroja, p. 135). Il se réfère aussi à une étude de Pedro Saínz Rodríguez (Clarín, p. 21), à un jugement de Marcelino Menéndez Pelayo (Pereda, p. 31) et à une remarque de Ramón Pérez de Ayala sur Valera (p. 64).
Du côté des auteurs français, on retrouve Maurice Legendre (Unamuno, p. 110) ; Camille Pitollet (Blasco Ibáñez, p. 93) ; Georges Cirot (Galdós, p. 41) ; enfin, il énumère « Boussagol, Bataillon, Sarrailh » dans ce même chapitre (p. 40).
L’identification des œuvres des auteurs mentionnés n’est pas toujours évidente. Gómez de Baquero, Andrenio, s’est fait connaitre par de nombreux travaux qu’il a réunis dans El renacimiento de la novela en el siglo XIX (Editorial Mundo latino, Madrid, 1924) puis dans deux recueils publiés l’année de sa mort Nacionalismo e hispanismo y otros ensayos (Historia Nueva, 1928) et De Gallardo a Unamuno (Librería de Juan bastinos, 1928) ; de même, pour Salvador de Madariaga, Semblanzas literarias (Editorial Cervantes, Barcelona, 1924 [éd. Originale : The genius of Spain, Oxford University Press, 1923). Quant à Camille Pitollet, il venait de publier une biographie de Blasco Ibáñez (Ses romans et le roman de sa vie, Paris, Calman-Lévy, 1921, 327 p.).
Même lorsqu’il cite un ouvrage identifiable, Jean Sarrailh ne fournit pas d’autre précision textuelle, à l’exception des Semblanzas literarias de Madariaga, dont il précise la pagination du passage cité (p. 85-87 et 76-77). On parvient, cependant, à identifier certaines de ces publications, ainsi de l’étude de Saínz Rodríguez sur Clarín, texte d’une conférence qu’il prononça lors de l’ouverture solennelle des cours 1921-1922 de l’université d’Ovidedo, où il était alors professeur, intitulée « La obra de Clarín », et de l’article de Maurice Legendre, dont il est précisé qu’il parut dans la Revue des Deux Mondes (« Don Miguel de Unamuno », 22 juin 1922, p. 667-684). Pour le reste, on est démuni devant l’imprécision de la référence : « Roman de sang et de muscles, disait Menéndez Pelayo » (Pereda) ; « suivant la remarque très pénétrante de Pérez de Ayala » (Valera) ; « Suivant une heureuse remarque de M. G. Cirot » (Galdós) ; enfin, « Certes, on l’a démontré à plusieurs reprises (Boussagol, Bataillon, Sarrailh), Galdós ne se soucie pas d’aller aux sources ».
À la décharge de Jean Sarrailh, disons que son anthologie n’avait pas pour but premier de lancer ses lecteurs dans des recherches sur les auteurs inclus dans l’anthologie et que c’est par honnêteté intellectuelle qu’il rend à ces critiques, en les citant même brièvement, l’hommage qu’il leur doit. Le fait est indéniable s’agissant des auteurs espagnols, dont certains étaient à peine plus âgés que lui. Mais on ne peut s’empêcher de penser qu’une part de sa démarche est inspirée par le souci de ménager, pour les auteurs français, des personnalités universitaires de premier plan à l’égard desquelles il manifeste le respect qu’un jeune universitaire doit à d’illustres anciens : Georges Cirot, doyen de la Faculté des Lettres de Bordeaux et directeur du Bulletin Hispanique ; Maurice Legendre, secrétaire général de l’École des Hautes études hispaniques ; Gabriel Boussagol, Professeur à la Faculté des Lettres de Toulouse depuis 1920. La mention de C. Pitollet est révélatrice, de ce point de vue : Jean Sarrailh écrit « M. C. Pitollet a été bien inspiré en écrivant sa biographie » (Blasco Ibáñez, p. 93). Pourtant, G. Boussagol porte un jugement extrêmement sévère sur cet ouvrage (Bulletin Hispanique, 24-4, 1922), avec des arguments qui emportent la conviction. Dès lors, la formule employée prend toute sa valeur : Blasco Ibáñez méritait bien qu’on lui consacre une biographie, mais on se garde bien de se prononcer sur la qualité de l’ouvrage. On conçoit que Jean Sarrail se montre prudent, sachant que le recrutement des Universitaires et leur carrière dépendaient étroitement du bon vouloir des personnes en place.
Comparaisons flatteuses
Le premier paragraphe de la notice consacrée à Alarcón et, par voie de conséquence, le premier de tout le volume, est consacré au ballet inspiré à Manuel de Falla par le Sombrero de tres picos, à l’éloge du compositeur et à celle du récit qui lui a servi de trame. Jean Cassou fera de même dans son Histoire de la littérature espagnole, tout en ajoutant le nom de Picasso, auteur du décor, que Jean Sarrailh avait omis. On imagine que ce dernier parie sur l’écho que cet événement artistique (la création à Paris eut lieu le 23 janvier 1920) a pu laisser dans la mémoire de ses lecteurs. Il semble que ce paragraphe introductif n’ait eu d’autre objet que d’accrocher l’attention des lecteurs.
Palacio Valdés a droit à un traitement de faveur : « Valdés est l’un des écrivains espagnols qui pourraient le mieux passer pour français […]. Ou bien on le pourrait croire Anglais, disciple de Dickens […] » (p. 78). Cet argument est susceptible d’être reçu favorablement par des lecteurs français (ou anglais), mais on doute que les espagnols eussent apprécié.
Pour faire ressortir la vigueur employée par Galdós pour tracer les portraits de ses personnages, on l’oppose à Erckmann-Chatrian, « dont les personnages sont si falots et décolorés » (p. 41). Le commentaire n’ajoute rien au talent du romancier espagnol mais il fournit l’occasion de régler son compte à un auteur français qu’il estime probablement injustement célébré et excessivement honoré par les auteurs de Morceaux choisis à l’usage des collégiens.
Rapprochements mitigés, voire critiques
En ramenant l’attention vers les classiques espagnols dans ses écrits de critique littéraire, Azorín mérite d’être comparé à Jules Lemaître (En marge des vieux livres) et avec Taine, bien que « avec moins de rigueur et de puissance » (p. 154). La restriction finale réduit considérablement la portée de la comparaison élogieuse.
Gabriel Miró a droit à un traitement mitigé. On proclame qu’il est « un prodigieux paysagiste » et qu’il séduit ses lecteurs « par la franchise, la pureté, l’ingénuité de son âme, si contraire à la complication de notre société ». Mais auparavant, la comparaison établie avec Balzac ne le favorise pas : « On ne serait jamais tenté de comparer Miró à Balzac le prototype du romancier. Jamais un de ses personnages ne se détache avec la puissance et le relief du baron Hulot, par exemple, de la Cousine Bette ». De même, Miró ne brille pas non plus par la construction rigoureuse de ses intrigues et rejoint en cela le goût des lecteurs qui, contrairement à ceux de 1880, apprécient moins les œuvres solidement bâties, à preuve le « silence impressionnant qui s’est fait autour du livre formidablement balzacien de M. Fabre, Rabevel, paru ces dernières années » (p. 190). Ces commentaires surprennent. Qu’un romancier ne puisse se comparer à Balzac n’implique pas qu’il soit mauvais, ni même médiocre. Établir une échelle de valeurs entre des écrivains, qui ne sont même pas contemporains, ne peut que dévaluer l’œuvre du moins doué. Quant à Rabevel, signalons que ce roman fut couronné par le prix Goncourt en 1923, ce qui semble contredire le « silence impressionnant » dont il est question. Ces comparaisons répondent apparemment à la volonté irrépressible de dire ce que l’on pense, au risque de paraître hors sujet.
Dans le dernier paragraphe consacré à Blasco Ibáñez, il est fait état de son admiration pour Wagner, qu’il a souvent proclamée. La phrase qui suit tombe comme un couperet : « La musique de Debussy ne doit pas l’émouvoir » (p. 95). Pour quelle raison lui reproche-t-on un goût qu’il partageait avec beaucoup d’intellectuels, et non des moindres, et de quel droit lui fait-on un procès d’intention concernant la musique française, sans apporter la preuve qu’il l’ait véritablement dénigrée ?
Nouvelles voies de recherche
Certains rapprochements proposent une voie nouvelle pour la recherche : ainsi de l’influence, directe ou via Unamuno, de Pascal sur Pérez de Ayala (p. 171). De même, dans le volume de vers qui fut la première œuvre de cet auteur, « on retrouve parfois des sonorités et des réminiscences de Francis Jammes » (p. 172), dont il est inutile de rappeler qu’ayant vécu longtemps à Orthez, il était béarnais d’adoption, en quelque sorte un voisin des Sarrailh de Monein qui l’avaient en haute estime ; celle-ci rejaillit sur Pérez de Ayala. Pour caractériser l’art de Pío Baroja, Jean Sarrailh cite deux passages du Système des Beaux-Arts d’Alain (p. 135). Une note de la p. 157 suggère de rapprocher Azorín de Maeterlinck, lorsqu’il s’interroge sur la signification des détails les plus modestes (Lecturas españolas, n. 3. Une autre note (p. 175) signale deux conceptions de la théorie de l’ascétisme qui opposent Unamuno et Pérez de Ayala, et pourraient donner lieu à d’utiles développements.
Réception des Prosateurs espagnols contemporains
En France
Le Bulletin Hispanique n°30-1 (1928), p. 105, dans la rubrique « Chronique » a publié le texte suivant : « Jean Sarrailh, professeur agrégé d’espagnol au lycée de Poitiers, chargé de conférences à la Faculté des Lettres, Prosateurs espagnols contemporains, Paris, Delagrave, 1927, 235 pages in-16. – Romanciers et essayistes : P. A. Alarcón […] Ortega y Gasset. L’éditeur s’excuse de n’avoir pas fait figurer, faute d’autorisation, Ganivet, O. Picón, R. León, Concha Espina. Notices intéressantes et notes utiles pour les élèves des classes. »
C’est la seule mention de l’ouvrage que j’aie pu repérer dans une revue savante. La dernière phrase fournit une explication à ce désintérêt, dans la mesure où elle estime que l’anthologie est destinée à des élèves de l’enseignement secondaire et qu’elle ne peut donc être considérée comme un travail universitaire. Le point de vue se défend, même si on pouvait attendre un accueil un peu plus chaleureux de la part d’une revue à laquelle Jean Sarrailh collabore régulièrement depuis 1920. En tout état de cause, on ne peut nier que l’ouvrage reçut un accueil favorable de la part du public auquel il s’adressait puisque, trente ans après sa première édition, il était encore utilisé par notre professeur à l’École Normale de Dax.
En Espagne
Ramón Pérez de Ayala a consacré au moins trois de ses collaborations au quotidien El liberal de Madrid, 13, 17 et 28 juin 1928, à l’anthologie de Jean Sarrailh : « Es un pequeño libro, un verdadero libro, si bien de no mucha extensión, que no puede menos de ser sobre manera grato y halagüeño para quienes […] hemos puesto nuestras facultades al servicio del cultivo de las letras castellanas » (Ramón Pérez de Ayala, Pequeños ensayos, Madrid, Biblioteca nueva, 1963, p. 299-308). Le premier article consiste en une paraphrase du prologue et la reproduction de la liste des auteurs. Le deuxième s’intéresse à Alarcón, Clarín, Pereda et Galdós ; le troisième à la comtesse de Pardo Bazán. Pérez de Ayala reprend à son compte la plupart des assertions de Jean Sarrailh sur chacun de ces écrivains tout en y mêlant des considérations personnelles, dans l’esprit du feuilleton journalistique. Le principal intérêt de ces textes est de nous montrer que, pour des lecteurs espagnols, l’anthologie méritait d’être considérée au même titre qu’un ouvrage de critique littéraire.
Conclusion
L’impression que je retire de cette lecture détaillée de l’anthologie est qu’il ne s’agit pas d’une œuvre mineure dans la bibliographie de Jean Sarrailh. L’auteur de ce genre d’ouvrage s’impose une tâche très ingrate. Le corpus de textes dont il doit rendre compte est considérable et l’honnêteté exige de les connaître de façon quasiment exhaustive si l’on veut y effectuer un choix pertinent. De même ne peut-il ignorer l’essentiel des études auxquelles ces œuvres ont donné lieu. Enfin, il ne doit pas perdre de vue la finalité de son volume et le lectorat auquel il s’adresse. Ce sont autant de contraintes susceptibles de décourager d’avance un jeune chercheur engagé dans la préparation de sa Thèse (double à l’époque). Quelles motivations pouvait avoir Jean Sarrailh pour s’engager dans cette aventure ? Il serait sans doute excessif d’en rechercher la cause dans une sorte d’atavisme de petit-fils et fils d’instituteurs. En revanche, il a pu constater, pendant sa courte carrière d’enseignant, à sa sortie de l’École Normale Supérieure de Saint-Cloud, mais surtout à l’Institut français de Madrid, que, pour accompagner ses cours de littérature, un instrument de travail approprié lui faisait défaut. N’excluons pas, non plus, le désir de compléter ses recherches historiques sur le XIXe siècle espagnol en vue de sa Thèse, par d’autres, de nature littéraire.
Sans doute se prit-il au jeu, ce qui expliquerait qu’il ait décidé de prolonger cette étude au-delà du terme tout désigné, l’année 1898, qui marque la fin de l’aventure coloniale de l’Espagne, jusqu’à la date où il fut contraint de quitter ce pays pour rejoindre un poste en France. Cet élargissement temporel avait, en outre, l’intérêt de lui permettre de s’intéresser de près à la création contemporaine, dont je ne suis pas certain qu’il eût eu une idée de la richesse lorsqu’il intégra l’Institut français de Madrid en 1917.
Quoi qu’il en soit, l’enthousiasme que lui inspirèrent les travaux des jeunes créateurs et l’admiration qu’il ressentit pour certains d’entre eux, et dont il ne se cache pas, Azorín, Pérez de Ayala, Ortega y Gasset et Eugenio D’Ors, tout particulièrement, dut être un incitatif puissant.
Il a pu compter aussi sur le concours précieux de son épouse, Marie-Amélie Enjolras, ancienne Normalienne de Sèvres, littéraire jusqu’au bout des ongles, qui avait eu la chance, en 1913, de suivre une décade de Pontigny (dont témoignent des photos anciennes conservées à Cerisy-la-Salle) où elle put côtoyer, outre les maîtres des lieux, Paul Desjardins et son épouse, André Gide et Henri Ghéon, Jacques Copeau, Jean Schlumberger et sa femme. Pendant leurs années à Madrid, elle suivit les conférences d’illustres personnages, en particulier les cours que dispensa la comtesse de Pardo Bazán, pour laquelle elle conçut une évidente animosité, tant elle supportait mal la lecture de ses notes que l’oratrice menait tambour battant sans regarder son auditoire. Surtout, elle fréquenta assidûment l’Ateneo, qui entretenait un bouillon de culture permanent, où elle lut beaucoup et acquit ses connaissances en langue espagnole. Je ne suis pas loin de penser que certains rapprochements effectués entre les écrivains espagnols et certains auteurs français ou francophones, je pense à Maeterlinck, Jules Lemaître, Lucien Fabre, à des musiciens, je pense à Debussy, ne portent pas la marque de cette exigeante lectrice, que Jean Sarrailh décrira, dans l’Avertissement de son Espagne éclairée de la seconde moitié du XVIIIe siècle, dans ces termes : « […] l’agrégée de lettres qui me touche de près, dont les ciseaux furent parfois redoutables à mon texte, et dont l’aide intelligente a contribué singulièrement à l’améliorer ».
Il ne me déplairait pas d’imaginer que cette étroite collaboration ait pu commencer avec cette anthologie des Prosateurs espagnols contemporains.

Portrait de Jean Sarrailh réalisé au début des années 1920 à Madrid
octobre 2022