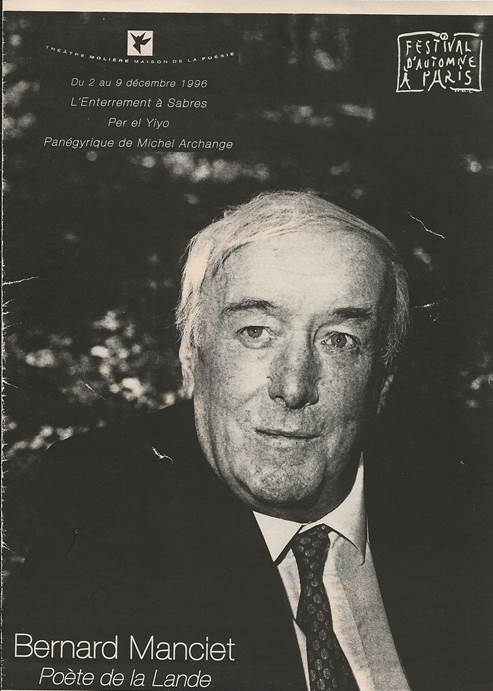Portraits croisés (2). Ignace de Loyola et l’abbé de Saint-Cyran
Ignace de Loyola et Duverger de Hauranne, abbé de Saint-Cyran :
portraits croisés par René-Louis Doyon
La comparaison est un moyen commode pour dessiner le caractère d’un personnage. Il suffit pour cela de le confronter à un individu ayant exercé dans le même domaine et faire ressortir par contraste les différences qui font son originalité.
On pourrait comparer [Ignace de Loyola] pour mieux éclairer sa physionomie, au vaincu de ses successeurs[1]: Duvergier de Hauranne, abbé de Saint-Cyran[2]; ils sont Basques tous deux, chacun d’un versant pyrénéen; tous deux ont la même rudesse, la même froideur, la même ardeur à entreprendre, à commander, la même inflexible maîtrise de leur caractère; l’un [Loyola], avec plus de souplesse, déploya tout son génie de conquête à capter doucement les hommes, puis à les réduire au service jusqu’à la destruction de la personnalité; l’autre [Saint-Cyran], dans une sombre spéculation théologique, destinait aux enfers les enfants sans baptême et maintenait l’homme dans l’épouvantement d’un destin irrévocable; le premier glaçait le cœur, le second la raison ; celui-là servit le pouvoir et ne compta pour rien[3] les concessions, les souplesses, les épreuves sociales qui devaient assurer ses fins ; Duvergier se heurta à un génie inflexible, et, n’ayant pas traité de puissance à puissance, perdit toute sa vie ; et sa pensée à peine écrite, transmise par des témoins, pourchassée dans ses moindres manifestations, mal comprise, calomniée, montée en épouvantail, servit de dispute à un siècle et au triomphe de l’autorité ignatienne ; l’abbé de Saint-Cyran eut peut-être plus de génie théologique ; ce n’était pas un homme d’action, un chef : il était surtout un abstracteur ; Iñigo connaissait mieux les hommes, leur maniement : il était tacticien et fin psychologue. En fait, ils sont tous deux sans poésie et leur parallèle va jusqu’à cette limite, la chance ayant fait de l’un le créateur d’une société destinée à maintenir, à développer l’ordre catholique romain, et de l’autre, une manière de réformateur qui eût transporté à Paris le siège de Saint-Pierre et mêlé au paganisme romain le rigorisme chrétien. Duvergier a échoué en théologien diffus ; Iñigo a triomphé en commandant d’armée. Qu’on s’étonne maintenant qu’il exerce encore un prestige sur les hommes d’action et que Napoléon ait consulté, dit la légende, un de ses traités sur les sièges de places fortes.
René-Louis Doyon, « Iñigo de Loyola ou le triomphe de l’esprit militaire »,
Étude préliminaire à Ramón Pérez de Ayala,
A. M. D. G. Scènes de la vie dans un collège de jésuites¸
traduit de l’espagnol par Jean Cassou,
Paris, La Connaissance, 1929, p. XVIII-XIX.
Pour pouvoir comparer deux personnages, il faut qu’ils aient quelques points communs. Le monde a bien changé, aussi bien dans le domaine politique que religieux, pendant le siècle qui sépare le fondateur de la Compagnie de Jésus du promoteur du jansénisme et on pourrait en déduire que la comparaison est vouée à l’échec. Cependant, la tentation est grande de confronter ces deux purs produits de la race basque, Ignace, né dans la province de Guipuzcoa, et le bayonnais Duverger de Hauranne. Le terroir d’origine n’explique pas tout, mais on est tenté de retrouver sa trace dans certains de leurs traits de caractère, à en juger par leur parcours personnel : froideur, ardeur à entreprendre, goût du commandement, inflexibilité de la volonté. Ces ressemblances existent aussi, encore qu’à un degré d’intensité moindre, entre Saint-Cyran et Vincent de Paul, son contemporain (cf. Thèmes landais / Portraits croisés). Mais ce rapprochement ethnique, s’il satisfait le chauvinisme des historiens locaux, ne suffit pas à rendre compte de la complexité de deux vies humaines.
Les différences sont beaucoup plus nombreuses et d’autant plus significatives qu’on peut les opposer terme à terme, avec un accent mis sur des questions de méthode. Ignace de Loyola se montre conciliant à l’égard de ses interlocuteurs officiels et sait attirer à lui de potentielles recrues. En revanche, il réserve sa rigueur, qui était grande, aux garnisaires (terme qu’apprécie particulièrement Doyon et qu’il emploie souvent dans son traité) de la Compagnie, du novice au profès, sans oublier les coadjuteurs spirituels et les coadjuteurs temporels. Ce terme désigne de véritables « bêtes de somme » condamnées à végéter toute leur vie dans un statut de subalternes, à qui on interdit tout apprentissage intellectuel, au point qu’ils ne peuvent apprendre à lire et à écrire s’ils sont illettrés. Il existe un fort contraste entre l’image que le fondateur de la Société de Jésus propose à l’extérieur et la pratique interne de la Compagnie.
Par opposition, l’abbé de Saint-Cyran ne sait pas feindre. La sévérité qu’il proclame à l’endroit des principes de la religion sont énoncés sans ambages et le refus d’une grâce quelconque offre peu de perspectives souriantes au croyant. Sa conviction est telle qu’elle ne laisse transparaître aucune humanité et qu’elle s’aliène nécessairement les meilleures volontés. Son projet de réforme de l’Église, qui s’appuie sur une interprétation sans concessions des Textes saints, faute de lui attirer des appuis nombreux hors un petit cercle de religieux, est promis à l’échec. Il finit par irriter le cardinal de Richelieu et par connaître la prison dont il ne sortira que pour mourir quelques mois plus tard.
Ce jeu de contrastes entre les deux personnages est une illustration, volontairement ou non de la part de Doyon, de l’opposition entre les Armes et les Lettres, motif qui court tout au long de la Renaissance. Mais, alors que l’humanisme s’est évertué à faire dialoguer ces deux états entre eux, Doyon, loin de chercher à les concilier, s’évertue, au contraire, à les opposer de façon systématique. Loyola, pur produit d’une vision guerrière du monde, organise sa Compagnie selon des principes militaires et n’accorde de vertu qu’à la sujétion des individus au profit d’une entreprise qui ambitionne de conquérir les esprits par la force et de les gouverner par la terreur. L’abbé de Saint-Cyran, tout au contraire, n’use d’autre arme que le raisonnement érudit et n’aspire qu’à gagner les esprits à sa vision d’une Église idéale, convaincu qu’il est que la justesse de son raisonnement finira par conquérir les volontés les plus rebelles, pour peu qu’elles soient honnêtes. On imagine sans peine qui devait sortir vainqueur de ce combat.
Doyon conclut, en manière de flèche du Parthe, sur un trait commun aux deux personnages qu’il avait volontairement omis de signaler au-début : « En fait, ils sont tous deux sans poésie et leur parallèle va jusqu’à cette limite ». Ce défaut rédhibitoire les condamne donc tous deux à ses yeux.
[1] NdE. Saint-Cyran fut la victime de la cabale menée par les Jésuites, successeurs d’Ignace de Loyola.
[2] Note de Doyon. Un seul trait souriant dans la vie de ce dur ascète, c’est la lettre charmante qu’il écrivit de son effroyable prison de Vincennes, à sa nièce qui lui offrait un petit chat ; le jansénisme n’a pas de sourires comme celui-là. [NdE : cf. Sainte-Beuve, Port-Royal, I, p. 491, n. 1. C’est sans doute là que Doyon a lu cette lettre par laquelle il refuse l’offre de sa nièce : « J’aurois volontiers retenu votre chat qui étoit si beau ; mais ma chambre est si petite que nous n’y pouvions demeurer tous les deux : conservez-le moi pour un autre temps que je vous le demanderai ».]
[3] NdE. « ne fit aucun cas, ne ménagea pas ».