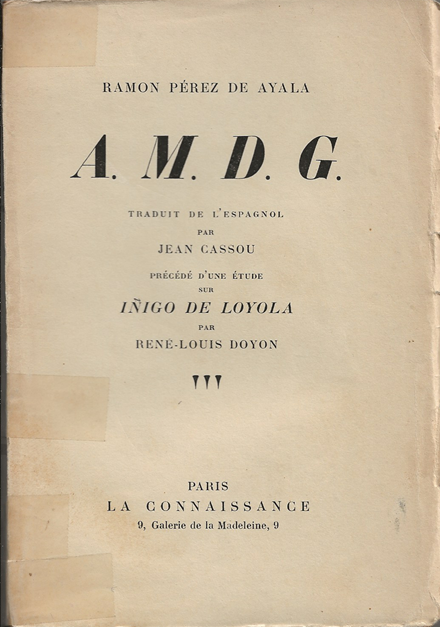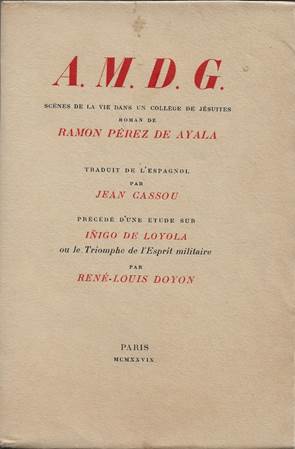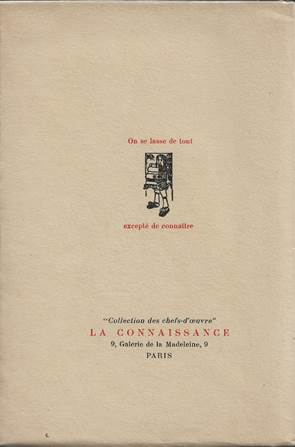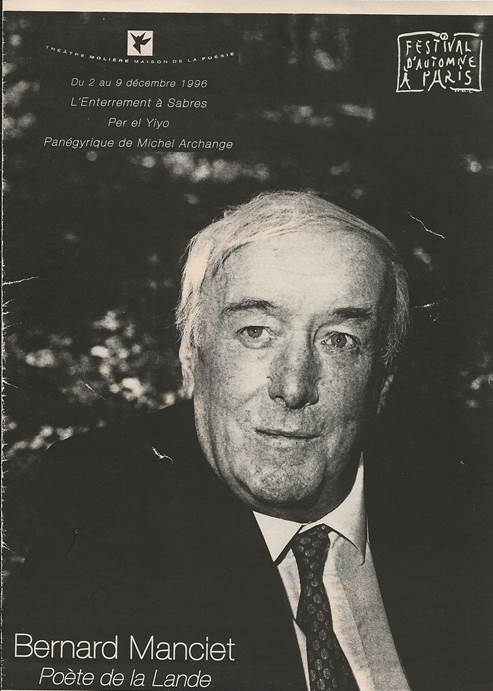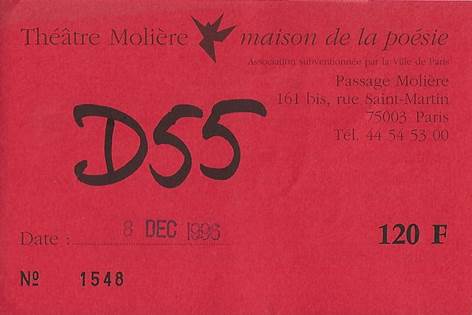MARGUERITE YOURCENAR ET L’ANDALOUSIE
Le 18 mai 1951, Marguerite Yourcenar, avec sa compagne
Grace Frick, embarque à New-York pour la France sur le Mauritania, afin de signer chez Plon le contrat d’édition
des Mémoires d’Hadrien. Les deux femmes séjourneront sur le continent
européen pendant quinze mois, jusqu’en août 1952. Vers la fin de ce séjour, une
fois remplies les obligations mondaines requises par la publication d’un ouvrage
de cette importance, elles décident de rejoindre l’Italie, où elles séjournent
à compter du début février 1952. Le 22 avril, elles embarquent à Naples pour un
voyage en Andalousie qui durera jusqu’au 20 mai.
Pour retracer ce périple, nous disposons d’une
information de première main, celle qui est contenue dans les carnets que Grace
tenait journellement et qui sont conservés dans les archives Yourcenar à la
Houghton Library à Harvard. Je dois à l’obligeance de Jesús Rodríguez Velasco,
Professeur à l’Université de Yale, de m’avoir guidé dans ma démarche. M. Lee
Davis, Reference Librarian de la
Houghton, a eu l’extrême amabilité de rechercher les appointment books
de Grace Frick et, ayant trouvé celui qui m’intéressait, de me communiquer une
reproduction photographique des pages correspondants à cette période. Je tiens
à les remercier tous deux.
Malgré la joie que j’ai ressentie à voir s’accomplir ainsi
un souhait que je croyais difficilement réalisable, dans l’incapacité où
j’étais de me déplacer à Harvard et de consulter directement ces archives, j’ai
éprouvé bientôt un scrupule. Lire ces notes sans apprêt, rédigées à la va-vite,
c’était comme surprendre une femme dans sa chambre d’hôtel, en négligé. La
réaction paraîtra peut-être excessive, à une époque où le moins que l’on puisse
dire est que la pudeur n’est pas la vertu la mieux partagée, mais, en 1952,
j’étais déjà leur contemporain et je ne me vois pas faire aujourd’hui ce que je
me serais interdit de faire alors. Pourquoi dirais-je que Grace a été malade
tel jour, qu’elle s’est rendue à la banque deux fois, qu’elle et sa compagne n’appréciaient
pas outre mesure la cuisine andalouse, qu’elles se sont parfois commises dans
des spectacles pour touristes, etc. ? Ce sont des informations sans
intérêt pour une bonne connaissance de leurs personnalités, encore moins pour
éclairer la signification d’un écrit, bref, tout juste bonnes à trivialiser
l’image que l’on peut avoir d’elles. Je ne pouvais pourtant pas me priver d’une
information nécessaire au déchiffrement de l’article que Marguerite allait
publier à son retour en France et qu’elle reprendrait trente ans plus tard dans
son recueil Le Temps, ce grand
sculpteur. Face à ce dilemme, j’ai choisi de ne pas reproduire l’intégralité
des notes de ces carnets, de n’en extraire que celles qui pouvaient être utiles
à mon projet et aussi peu compromettantes que possible pour leur mémoire. En
revanche, je conserverai toute ma liberté pour le commentaire du texte de
l’article.
Le séjour en Andalousie
Calendrier
Mardi 22 avril au samedi 26 avril à
midi : voyage par mer de Naples à Gibraltar via Gênes et Cannes
Dimanche 27 avril au mardi 28 avril : Cadix
Lundi 28 avril : voyage de Cadix (départ 5h30) à
Séville (arrivée à 21 h.)
Mardi 29 avril au vendredi 9 mai : Séville
Samedi 10 mai au vendredi 16 mai : Grenade
Samedi 17 mai : Séville
Dimanche 18 mai à lundi 20 mai : Cordoue
Mardi 20 mai : Madrid
Mercredi 21 mai : Hendaye et Bayonne
Jeudi 22 mai : Paris
Soit : 2 jours à Cadix ;
11 jours à Séville ; 6 jours à Grenade ; 2 jours à Cordoue ;
quelques heures à Madrid.
Le 17 mai,
Marguerite apprend, par un télégramme des éditions Plon, qu’elle vient
d’obtenir le prix Femina Vacaresco. Les voyageuses se réservent cependant deux
jours pour visiter Cordoue, les 18 et 19 mai. Le retour en France se fait de
façon précipitée, et principalement de nuit, de Cordoue à Madrid (une journée
entière à Madrid, sans nuit d’hôtel) puis de Madrid à Hendaye.
Voyage
d’agrément
J’ignore la date à laquelle Marguerite et Grace ont projeté de se rendre
en Andalousie ainsi que leurs motivations exactes. L’agenda de Grace n’apporte
aucune précision à ce sujet. Cependant, il m’apparaît clairement que ce voyage
répond au désir de découvrir des monuments et des paysages qui ont été évoqués
dans les Mémoires d’Hadrien à partir des seules sources livresques.
Curiosité ou scrupules d’auteur sont des raisons suffisantes sans qu’il soit
besoin d’en chercher d’autres.
Tout en étant très studieuse, la démarche de M. et G. ne les prive pas
des agréments qu’offre un tourisme de luxe. Il suffit de constater que les
hôtels dans lesquelles elles ont choisi de descendre, à leurs frais, car il
s’agit d’un voyage stristement privé, sont tous des établissements haut de
gamme. En voici la liste avec quelques impressions tirées du carnet : Gibraltar : Rock Hotel (« point de vue
admirable ») ; Cadix : Hotel Atlántico ; Séville :
Hotel Cristina ; Grenade : « petit hotel California en ville »
(10 mai), puis hotel Washington Irving, le 12 ; Séville : Hotel
Andalucía ; Cordoue : Hotel Regina.
Ce sont tous des établissements célèbres. Le Cristina
a été inauguré par le roi Alphonse XIII en 1929. Le vénérable hôtel Washington
Irving, du nom de l’auteur des Contes de l’Alhambra, qui y séjourna en
1829, est situé au pied de L’Alhambra et tout près des jardins du Generalife ;
M. et G. durent attendre deux jours avant d’y trouver une chambre. L’Hôtel
Regina de Cordoue, inauguré en 1923 tout près des Arènes, était, lui aussi,
luxueux. C’est là que s’habillaient les toreros avant la corrida. Je
soupçonne que cette coïncidence poussa nos deux voyageuses à se rendre, le 19
mai, sur la tombe du plus célèbre matador cordouan, Manolete (« Visite au
cimetière pour la tombe de Manolette »), qui fut tué en 1947, à une époque
où son souvenir demeurait encore vivace. Mais elles ont pu céder aussi à
l’injonction de leur amie Malvina Hoffman (cf. infra).
La plupart de ces hôtels ont été rasés ou ont subi de
grandes transformations dans les années 60 du siècle dernier. On peut dire que
M. et G. les connurent dans leur état premier. Elles y ont été traitées en
clientes de marque : elles prennent le café avec le directeur du Cristina.
Tourisme
studieux
Les
deux voyageuses cherchent à tirer le meilleur
parti possible de leur périple en s’imposant un rythme soutenu. Ainsi, elles
effectuent une visite express de Cadix et de Cordoue. La première n’est qu’une
étape avant Séville ; malgré tout, elles trouvent le temps d’aller au
Musée archéologique à la recherche de traces de la présence carthaginoise (la
tombe punique), de visiter la cathédrale et de se promener (en voiture). Elles
n’abandonnent pas non plus une visite à Cordoue, même si l’urgence d’un retour à
Paris rendu nécessaire par l’obtention du prix Fémina Vacaresco en a
manifestement réduit la durée. Les quelques heures passées à Madrid, entre deux
trains, leur donnent l’occasion de visiter le Prado, d’abord le matin puis
l’après-midi, malgré des démarches urgentes à accomplir. Elles ne quittent pas
Hendaye sans se rendre dans l’île des Faisans.
Les deux seuls séjours qui ne sont pas placés sous le
signe de la précipitation sont ceux qu’elles effectuent à Séville (11 jours) et
à Grenade (6 jours). Or, même alors, elles prennent le temps de se consacrer à
des tâches d’écriture. La plus occupée est Grace, qui s’est attelée à la
traduction des Mémoires d’Hadrien. Le mot « Travail » est
celui qui revient le plus fréquemment sous sa plume. À Gênes, « lettres et
travail ») ; à Cannes (« travaillé aux notes ») ; en
mer (« Travaillé aux notes ») ; à Séville, le 5 mai,
« travaillé à la traduction tout le jour » (il est vrai qu’il a plu,
ce jour-là) ; l’après-midi du 6 mai, après un déjeuner dans une cafetería
de la rue Sierpes, « travail » ; le 13 mai, à Grenade, entre une
visite de l’Alhambra (le matin) et de la Silla del Moro (l’après-midi),
« Travail » ; le soir du jeudi 15 mai, de retour de l’Alhambra,
la soirée est consacrée au « travail ». Cette constance est d’autant
plus méritoire que Grace n’est pas en très bonne santé et qu’elle a aussi
la responsabilité de l’intendance.
Quant
à Marguerite, la seule tâche d’écriture dont elle semble s’être acquittée
pendant ce voyage est la mise au propre d’un article (« Typed an
article »), qui pourrait bien être « Comment j’ai écrit les Mémoires
d’Hadrien », qui paraîtra dans Combat, le 17 mai, soit deux
semaines plus tard, et dont elle avait rédigé une première mouture à Rome.
Échanges
À Séville, Marguerite avait rencontré le directeur du
Musée d’archéologie, don Juan Laffita Díaz, lors de sa deuxième visite du lieu,
le 4 mai, la première ayant eu lieu la veille. Elle chercha à le revoir le 7,
mais il était absent. Lors de l’étape sévillane d’une journée entre Grenade et
Cordoue, le 17, c’est le directeur qui prit l’initiative de venir à l’hôtel
rendre une visite de courtoisie, témoignant ainsi de l’estime que lui avait
inspirée cette visiteuse férue de connaissances en archéologie.
Les occasions d’échanger avec des indigènes auront été
rares. Ce n’était pas faute d’essayer. Ainsi, le carnet indique, à la page du
lundi 12 mai, « conversation avec un espagnol rencontré sur un
banc ». Cette rencontre a lieu après un thé pris au Parador de San
Francisco de Grenade. Ce personnage, croisé dans un endroit si chargé de
culture, dut inspirer confiance aux deux visiteuses. J’ignore dans quelle
langue elles communiquèrent avec lui. À moins de supposer que
« l’espagnol » pratiquât le français ou l’anglais, ce qui était
relativement peu courant à l’époque, je soupçonne les deux femmes d’avoir usé
d’un sabir aux ¾ italien, qui était la langue étrangère qu’elles connaissaient
le mieux et qu’elles venaient d’utiliser pendant des semaines. On perçoit, a
contrario, qu’elles ne parvinrent pas à réaliser une véritable immersion
dans la vie andalouse. Pourtant, Marguerite et Grace firent de réels efforts
pour y parvenir : spectacle de danses pour leur première soirée à Séville
(le 29 avril) ; corrida à la Maestranza de Séville, le dimanche 4
mai ;
visite à la Macarena (8 mai) ; visite de l’atelier d’un « tailleur de
toreros » (9 mai) ; danses gitanes à Grenade (12 mai), sans
compter les promenades dans les rues, à pied ou en calèche (Grace les désigne
du terme italien de carrozza).
Marguerite et Grace durent souffrir de cet isolement.
Le 7 mai, pour se consoler peut-être de l’absence de Juan Laffita, elles
déjeunèrent « avec deux marins américains invités par [elles] à la
Bottega »,
un restaurant qu’elles affectionnaient particulièrement, préférant sans doute
persister dans leurs habitudes italiennes que de se risquer dans la cuisine
andalouse. Certains aspects de la vie courante retiennent aussi leur
attention : un rossignol au Parador de San Francisco de Grenade (le 12
mai : « rossignol ») ; « chevraux (sic)
égorgés », le 19 mai à Cordoue. Ces détails seront repris dans l’article.
À Grenade, elles jouiront de la présence de leur
vieille amie new yorkaise, la sculptrice Malvina Hoffman et sa compagne, qui
les accompagneront, le 13 mai, pour une « visite de la silla del
Moro », avant de quitter la ville, le lendemain. Grace et Marguerite
retrouveront Malvina à Madrid, pour un thé au Ritz, avant de prendre le train
pour Hendaye. Ce sont les seules rencontres avec des personnes de leur
connaissance qui soient enregistrées dans les carnets. Elles ne sont pas
fortuites. Malvina résidait à l’époque en Espagne, où elle a composé une série
de sculptures consacrées au thème de la corrida. En 1962, elle sculptera un
buste de Marguerite.
LES DEUX RÉDACTIONS
Peu après leur séjour en Andalousie, Marguerite
Yourcenar publie un article intitulé « Regards sur les Hespérides »
dans les Cahiers du Sud [n° 315 (second semestre), T. 36, p. 230-241]. L’article
sera repris sous le titre « L’Andalousie et les Hespérides » dans le
recueil Le Temps, ce grand sculpteur, Paris, éd. Gallimard, 1983, p.
167-181. Entre la première version, rédigée « à chaud », et la
réédition se sont écoulées trente années. Ceci suffirait à expliquer que
l’autrice ait souhaité apporter des modifications au texte initial. Cependant,
l’explication reste un peu courte tant sont nombreuses et parfois
substantielles les variantes entre les deux versions.
Divergences rédactionnelles
Sous chacun des textes du recueil Le Temps, ce
grand sculpteur, Marguerite Yourcenar ou son éditeur a pris soin de
mentionner la date de la rédaction : 1976, 1931, 1972, 1954-1982,
1977, 1980, 1976, 1975, 1957, 1976, 1977, 1977, 1982, 1982, 1970, 1952,
1955, 1972, 1972, 1980, 1929, 1969, 1976. On observera que la table ne
respecte pas la chronologie de composition, ce qui suggère des rapprochements
liés au contenu. Par ailleurs, chaque texte forme à lui seul un chapitre, à
l’exception de sept d’entre eux, qui ont fait l’objet d’un regroupement :
quatre sous l’intitulé « X. Fêtes de l’an qui tourne » et trois sous
celui de « XVIII. « Tombeaux ». Je les ai figurés en italiques.
Quant aux chapitres dont la pagination est transcrite en caractères gras, le
premier d’entre eux est celui qui a donné son titre au recueil (Le Temps, ce
grand sculpteur) et le deuxième est « L’Andalousie et les
Hespérides ».
Ces textes sont brefs, la plupart n’excédant pas 10
pages. « Ton et langage dans le roman historique », le plus long,
occupe 28 pages, cependant que trois d’entre eux en occupent une quinzaine.
C’est le cas de « L’Andalousie ou les Hespérides ».
La bibliographie établie par Valérie Cadet, jointe en
annexe à la biographie de Josyane Savigneau, qui propose une liste
chronologique des « Articles et prépublications », indique
précisément la date et le lieu de la première publication. Ainsi, pour les
textes les plus anciens : « Tombeau de Jeanne de Vietinghoff »
est paru dans la Revue Mondiale (15 février) 1929, pp. 413-418 (sous un
titre différent « En mémoire de Diotime : Jeanne de
Vietinghoff ») ; « Sixtine » dans la Revue Bleue, 69ème
année (1931), n° 22 (novembre), pp. 684-687 ; « Regards sur les
Hespérides » (cf. supra) ; « Le Temps, ce grand
sculpteur », dans la Revue des voyages, n° 15 (décembre 1954), pp.
6-9 ; « Oppien ou les chasses » sert de Préface à la Cynégétique
d’Oppien, dans la traduction de Florent Chrestien, Paris, Société des Cent-une,
1955, pp. i-vi ; « Sur quelques thèmes érotiques et mystiques de la
Gita-Gavinda », dans Cahiers du Sud, n° 342 (septembre 1957), pp.
218-228. Ceci pour les plus anciens. Le lieu et la date de publication des
textes plus récents est également répertoriée.
Le deux textes qui portent tous deux la date de 1982,
« Jours des morts » et « Qui sait si l’âme des bêtes va en
bas ? », ne figurent pas dans la bibliographie, ce qui laisse
supposer qu’ils étaient inédits au moment où l’ouvrage a été constitué, dont je
rappelle qu’il a été imprimé à la fin de l’année 1983.
Il s’agit donc d’un volume composite qui regroupe des
textes parus antérieurement, et parfois plusieurs décennies auparavant, et qui
n’avaient pas fait l’objet d’une réédition, encore moins d’une révision. C’est
le deuxième recueil d’essais composé par Marguerite Yourcenar mais le premier, Sous
bénéfice d’inventaire (1962, éd. déf. 1978), ne contenait que des textes
restés inédits. Il y en aura un troisième, posthume, En pèlerin et en
étranger, qui sera publié en 1989.
Contrairement à ce que laisse supposer l’indication de
date qui conclut chaque texte, ils ne sont pas reproduits dans leur version
originale. Il suffit pour s’en convaince de relever que l’article qui a donné
son titre à l’ouvrage comporte deux dates, 1954 et 1982 ; la première
étant celle de sa première parution, on déduit que l’autre est celle de sa
révision en vue de son incorporation dans le volume. On ne peut interpréter
autrement l’ajout de la seconde. Le fait que cette double datation n’apparaisse
qu’à la fin de cet article ne signifie par pour autant que les autres n’aient
pas également fait l’objet d’une révision. La preuve en est administrée par les
nombreuses variantes, y compris de titre, incorporées dans la version de
« Regards sur les Hespérides » publiée dans les Cahiers du Sud
pour aboutir à « L’Andalousie et les Hespérides » qui figure dans le
recueil. Je me propose ici d’analyser ces variantes en détail.
NB. Je présente les variantes sur
deux colonnes : celle de gauche reproduit la version des Cahiers du Sud,
celle de droite celle du recueil. Je signale par le chiffre 0 l’absence d’un
passage dans une des deux versions. Je transcris en caractères gras les termes
ou locutions brèves qui ont été modifiées ou abandonnées. Je souligne les
passages qui ont fait l’objet d’une nouvelle rédaction, même lorsqu’il sont
relativement brefs. J’attribue un numéro à chaque passage divergent afin de
disposer d’un moyen commode pour les désigner dans mon commentaire, et je
veille à élargir leur contexte textuel de façon à épargner au lecteur de devoir
se reporter au recueil.
Liste des variantes
Cahiers
du Sud Le Temps ce grand sculpteur
1. Suez, fissure artificielle faite de main d’homme
Suez,
fissure faite de main d’homme
2. Cadix, Ultima Gades, servit au monde gréco-romain
de portail sur l’Atlantique comme l’antique Byzance sur la Mer Noire et l’Asie.
À Grenade comme à Constantinople nous rencontrons la pointe avancée du monde de
la tente et du désert établi au sein des jardins d’Europe
À Grenade comme à Constantinople …
au sein des jardins d’Europe. Cadix, Ultima Gades, … Mer Noire et
l’Asie. [inversion des deux phrases]
3. L’Espagne a surtout été approchée par la
Méditerranée, c’est-à-dire par le flanc gauche
L’Espagne a surtout été appréhendée
par le flanc gauche
4. Tout ce qui compte en Andalousie
Ce
qui compte le plus en Andalousie
5. Atteint son apogée dans les rougeurs d’une fin de
Renaissance
N’atteint son destin qu’en
pleine aventure de la Renaissance
6. L’abîme qui mine son flanc droit était en un
sens moins menaçant que la grande masse asiatique
L’abîme
qui borde … était certes … plaine
7. les Champs-Elysées d’Achille; en plein Moyen-Age,.
les Champs-Elysées d’Achille, qu’une
autre tradition place au bord opposé du monde alors connu, dans la mer
Noire. En plein Moyen Age
8. Dante reprenant ce grand thème atlantique entraînait son
Ulysse bien loin d’Ithaque pour le faire sombrer corps et biens en vue des Açores,
vaincu par cet océan dont Colomb triomphera deux siècles plus tard.
En vue des Canaries, ou
peut-être du Cap Vert sous un ciel où pointent des étoiles déjà
différentes, et dans des parages que les conquistadores connaîtront plus tard.
9. Au moment où
tout
près de l’époque
10. l’image de la Toison d’Or devient effectivement pour
l’Espagne la Mer Hospitalière, la Mer Noire, dont Pizarre
devient effectivement la mer
Océane, dont Colomb, Pizarre
11. 0 La
nudité et la force de cette terre, les vastes espaces inoccupés des plateaux et
des sierras rapprochent pour ainsi dire l’Espagne, par-delà l’Océan, des pays
encore presque sans histoire.
12. Le dedans du sarcophage recèle
révèle
13. Sagonte et Numance liées jusqu’à la mort et aux
flammes du bûcher, l’une à Rome, l’autre à l’alliance de Carthage
dressent sur le sol ibérique deux exemples contradictoires de fidélité.
fidèles jusqu’à la
mort et aux flammes du bûcher, l’une à Rome et l’autre à Carthage dressent sur
le sol ibérique deux exemples contradictoires de loyauté.
14. le dur palais Renaissance de Charles-Quint
s’oppose dans Grenade aux délices de l’Alhambra musulmane
À
l’Alhambra éventé par les souffles de l’Orient islamique s’oppose dans Grenade
le sévère palais de Charles-Quint.
15. tint à reposer face à l’Albaicin conquis
voulut
reposer face à la ville conquise
16. des influences plus orientales se font jour
plus
antiques encore
17. Macarena aux lourds ornements d’idole
asiatique
Macareña
scintillant de pierres
18. des Borgia
des
Borgias
19. retrouver ici
retrouver
chez Hadrien, ici
20. réintroduite par le biais de l’Italie
réintroduite
par l’Italie
21. le Cirque et ses beaux jeux sanglants
le
Cirque et ses jeux sanglants
22. À Médina Alzahara, près de Cordoue, le Versailles des
Califes n’offre aux yeux qu’un tas de décombres
Le
palais de Medina Alzahara, près de Cordoue, n’est plus qu’un tas
de décombres
23. Tout pittoresque historique s’annule devant une
telle suavité
Une telle suavité littéraire
annule tout pittoresque
24. D’autres palais grenadins ont disparu sans laisser de
trace: leur perte ne nous cause pas l’amer dépit qui ailleurs s’empare
de nous à l’idée d’un temple grec anéanti ou d’une cathédrale supprimée:
On n’éprouve pas l’amer
dépit … cathédrale bombardée
25. Il accepte les mariages mixtes, les doux
adultères
les
unions mixtes, les secrets adultères
26. La victoire finale de l’Occident
le
triomphe définitif
27. Cette architecture tout extérieure détonne au
coeur de la mosquée comme un clairon dans un concert de flûtes.
Cet art tout de pompe et
de parade soufflette le visiteur au moment où d’arceaux en arceaux, de
colonnades en colonnades, il approche du centre de l’édifice, et fait voler en
miettes, comme sous l’effet d’une bombe, l’une des plus nobles méditations
jamais faites sur le plein et le vide, la structure de l’univers, le mystère de
Dieu.
28. rechercher ailleurs
en
d’autres pays
29. comme dans ce caveau béant et nu, cette espèce de
pourrissoir où quatre cercueils rouillés s’alignent côte à côte, qui s’ouvre
à Grenade sous les tombes de marbre blanc des Rois Catholiques.
côte à côte, à Grenade, sous les
tombeaux d’apparat
30. une église byzantine
un
oratoire byzantin
31. fait partout pour impressionner
fait
pour impressionner
32. est devenu foncièrement étranger. L’austérité de
l’architecture Renaissance, la profusion du Baroque offrent dans ce pays
l’équivalent de la sévérité romane ou du flamboiement gothique d’autres régions
de l’Europe chrétienne; de même les manifestations de la vie andalouse les
plus enracinées dans le Moyen-Age ou dans un passé plus lointain encore empruntent
au Baroque l’aspect définitif sous lequel nous les connaissons aujourd’hui: pompons
et broderies de toreros, costumes des danseurs du Corpus Christi,
argenterie et catafalques de Vendredis Saints. L’esprit ici retarde
sur la forme.
est devenu foncièrement étranger.
Les manifestations les plus baroques de la vie andalouse sont aussi les
plus enracinées dans le Moyen Âge chrétien ou dans un passé antique et
non-chrétien plus lointain encore: pompes des processions
tauromachiques, broderies des costumes de toreros, souvent déchirés et
sanglants, que raccommodent des petites mains dans un atelier de couture de
Séville, costumes des danseurs du Corpus Christi, pourpre du Nazaréen flagellé
et exposé au peuple, traînant comme une vague de sang sur les têtes de la foule,
argenterie et catafalques des Samedis Saints.
33. La statuaire polychrome de l’Espagne n’est pas
spécifiquement andalouse, mais elle a trouvé à Grenade son Praxitèle dans
Alonzo Cano, et c’est en Andalousie surtout que se perpétue l’état de ferveur
religieuse et d’émotion humaine sans lequel ces chefs-d’œuvre presque toujours
anonymes ne seraient plus aujourd’hui que de froids objets de culte
désaffectés. Les statues peintes à elles seules suffiraient à témoigner du
singulier conservatisme de l’Espagne ; de nos jours, c’est seulement dans
les églises et sur le pavois des processions de la péninsule que l’amateur
d’art grec prend contact avec ce que fut la statuaire antique sous son aspect
et dans sa fonction véritables. Plus qu’aucun autre peuple, les Grecs pensèrent
en sculpteurs, et cependant, ou peut-être pour cette raison même, ils ne
renoncèrent jamais aux prestiges de la couleur posée sur la forme : leurs
blancs marbres reçurent d’eux jusqu’au bout le glacis pâle et rose de la vie,
le roux et le noir des toisons, la fixité brillante de l’œil, tout le
revêtement des vieilles idoles chargées d’effluves magiques, des figurines
d’envoûtement et des cires funéraires, qui ne survit aujourd’hui, incompris et
ravalé, que dans les poupées et les mannequins de vitrine. Là-aussi, le
christianisme approfondit, condense, mais aussi rétrécit l’expression
humaine : de ce monde de gestes, de ce peuple de formes, la statuaire
polychrome de l’Espagne chrétienne ne garde que quelques types, quelques
attitudes rigides ou prostrées, mais dont la violences d’émotion dépasse de
beaucoup ce que se permit le pathétique grec. Ces groupes d’Office des
Ténèbres, ces Maries navrées penchées sur des Christs sanglants rentrent dans
tradition syrienne des Adonies, mais aucun jeune dieu renversé sur un lit
funèbre, aucune Vénus en larmes n’a jamais atteint au réalisme patibulaire de
ces corps transpercés, à la douleur de ces bouches qui tremblent. Ces Reines du
Ciel drapées d’étoffes bouillonnantes ou roides, le pied posé sur la lune ou
sur le serpent, descendent en droite ligne des orientales Astartés, mais
expriment avec une gravité poignante la gloire de la femme inabordable,
convoitée et chaste. La beauté virile fait défaut : le corps de l’homme
n’est que le cadavre du supplicié aux muscles mous ou la carcasse décharnée de
l’ascète. La veine de gaîté populaire de la sculpture des cathédrales, les
démons joviaux, frères dégradés des satyres antiques, sont complètement
absents ; la volupté ne figure que sous forme d’extase ; la chair ne
se révèle sourdement que dans le lourd balancement des anges aux rondeurs
féminines suspendus devant le maître-autel. Malgré la popularité des crèches de
Noël, où se révèle peut-être une influence napolitaine, on chercherait en vain
les images de Marie allaitant ou câlinant son fils ; le Jésus enfant est
ici le Petit Roi de Gloire et non le nourrisson serré dans ses langes ; en
dépit du pullulement des Ordres Mineurs, l’Espagne est peu touchée par la
douceur franciscaine.
0
34. La peinture andalouse
sévillane
35. Ici, au contraire, le profond christianisme et le
réalisme foncier de l’Espagne s’entendent pour revêtir chaque fois
d’un tragique et d’une dignité
s’unissent pour revêtir d’une
dignité et d’une singularité tragiques
36. la raison d’être de chaque créature contemplée. Aucun
art
rencontrée.
Pas d’art
37. Ce n’est pas la vision béatifique des moines de Zurbaran
qui nous est montrée
Dans les images de saints en
extase de Zurbaran ou d’Alonzo Cano, ce n’est pas la vision béatifique qui
nous est montrée
38. Cette concentration sur la figure humaine
Cette
obsession de l’individu
39. L’italianisme baroque élimine jusqu’à la dernière trace arabe
ou mudéjare
En même temps le faste baroque
élimine jusqu’à la dernière trace des raffinements arabes et mudéjares
40. La Vénus de Velasquez et la Maja de Goya
sont des chefs-d’oeuvre
La
Vénus de Vélasquez est un chef-d’oeuvre
41. 0
La Maja desnuda de Goya,
point andalouse, mais qui n’étonnerait pas cigarière à Séville, rentre au
contraire dans la tradition du réalisme individuel par son capiteux corps mal
bâti.
42. Inséparable de leurs haillons; leurs haillons
semblent faire partie d’eux-mêmes
inséparable de leurs haillons qui
semblent une part de leur substance
43. trop pris par l’immédiat, l’accidentel
par
le détail, l’accidentel
44. Dans la scène de genre ou la nature morte, l’école
andalouse s’impose par ce même réalisme
ce
même réalisme typiquement espagnol
45. ces puissants peintres réalistes de l’école de Séville
ne donnent pourtant de leur pays qu’une image, extraordinairement intense il
est vrai, mais limitée à certains aspects presque obsessionnels de l’Espagne:
les maîtres florentins, vénitiens, flamands …
presque obsessionnels de
l’Espagne; l’indolence ou la sévérité sévillanes en sont presque absentes.
Jusqu’à Goya qui croquera les belles promeneuses madrilènes (les laides aussi)
ou le tohu-bohu des pèlerinages du même trait net qu’il note ailleurs un
accident un accident ou une échauffourée sur la place publique, la peinture
espagnole a rarement essayé de rendre librement la vie au-dehors et en plein
jour. Les peintres flamands, florentins ou véitiens
46. ou s’arrêtent jeunes: tout ce qui leur arrive après
leur bref âge d’or est du domaine de la survie
tout ce qui suit leur brève
période de vigueur est du domaine de la survie
47. l’Andalousie reconquise tend à se fondre dans ce
brûlant concert de l’Espagne chrétienne
l’Andalousie
se fond
48. Jeanne la Folle errant le long des routes avec un
cercueil, couvant
suivant
le long des routes un cercueil, couvant
49. Jean de la Croix […] effaçant de son esprit ces
formes à demi visibles à la lumière des étoiles
écartant
de son esprit … à la lueur
50. Miguel Mañara allant de femme en femme dans les rues du
Barrio de la Cruz sous l’habit de serviteur des pauvres; et, par-delà les
hauts murs crépis à la chaux, l’immortelle voix triste d’Elvire
sous l’habit de serviteur des
pauvres, oublieux sans doute de la triste voix d’Elvire
51. Pour que Miguel Mañara devînt Don Juan
devienne
et reste Don Juan
52. Belles images, faits plus ou moins isolés dans
l’expérience de la race, qui ne nous renseignent pas moins sur ce qu’un
peuple a cru trouver en soi d’essentiel
qui
nous montrent surtout ce qu’un peuple
53. il a fallu Tirso de Molina, il a fallu surtout Molière,
et Byron, et Mozart.
Et Mozart, et Byron, et tel
conte de Balzac, et tels vers de Baudelaire, et, de nos jours encore, telle
farce tragique de Montherlant.
54. Cette terre si célébrée est merveilleusement vierge
d’artifices littéraires; la vie couve et flambe à même ce sol si plein de
chefs-d’oeuvre. Peu de contrées ont été plus rongées par la fureur
des guerres de religion, de races et de classes;
vierge d’artifices littéraires; la
préciosité même de certains de ses poètes ne l’affecte pas. Ce sol d’où
jaillirent tant de chefs-d’oeuvre n’est pas d’emblée senti, comme l’Italie, une
patrie privilégiée des arts, mais la vie y bat comme le sang dans une artère.
Peu de contrées ont été plus dévastées
55. Si nous supportons le souvenir ou la présence de
cette haine et de cette cruauté, c’est qu’elles nous apparaissent ici plus
nues, plus spontanées et moins hypocrites qu’ailleurs, presque innocentes dans
leur goût avoué de la douleur, simples manifestations de la vieille inimitié de
l’homme envers l’homme.
le souvenir de tant de fureurs
inexpiables, c’est qu’elles nous apparaissent ici plus nues, plus
spontanées et moins hypocrites qu’ailleurs, presque innocentes dans leur
aveu d’un plaisir qu’a l’homme de faire du mal à l’homme.
56. Pas de pays plus dominé par une religion puissante qui aboutit
le plus souvent, dans la pratique, à la bigoterie et à l’intolérance,
mais pas de pays non plus où l’on sente d’avantage, sous le brocard des
dévotions ou la pierre du dogme, sourdre le sang et la sève
humaine;
qui favorise le plus
souvent la bigoterie et l’intolérance mais pas de pays non plus où l’on sente
d’avantage sous le brocart des dévotions ou la pierre des dogmes,
sourdre la ferveur humaine;
57. Grenade était belle, mais ce rossignol qui chanta toutes
les nuits, cette gorge brune gonflée de sons
cette
gorge gonflée de sons
58. ce jeune garçon aux jambes brunes, enfoncé à mi-cuisses
dans l’eau pâle et bleue comme ses loques délavées, soucieux seulement
des profits et des déboires de sa pêche
comme ses haillons délavés
… et des déconvenues de la pêche
59. l’immensité massive de la
cathédrale de Séville semblait justifiée par la présence d’une femme solitaire
semblait
expliquée ou justifiée, peut-être
60. à ce tas de chevreaux
égorgés dans une charrette au seuil d’un boucher
de
moutons
61. à ces fleurs un peu moites, froissées par les mains chaudes
d’un petit mendiant d’Italica,
par
les mains tièdes d’un petit mendiant
62. à cette grenade d’où suinte un jus rose…
d’où
gicle un jus rose…
La plupart des
modifications pourraient passer pour des corrections de style, dans la mesure
où elles ne concernent qu’un mot ou une expression. Mais cette approche ne
résiste pas à une étude au cas par cas. Le regard critique que MY porte sur sa
première version, dont on mesure la portée aux modifications qu’elle y introduit,
est celui d’une lectrice exigeante qui, tout en assumant la paternité de son
premier jet, se montre sans indulgence à son égard. Le temps écoulé entre cette
première version et sa reprise, trente années plus tard, ne lui permet plus de
se glisser dans sa vêture d’antan. Elle ne le recherche d’ailleurs visiblement
pas et songe, au contraire, à proposer un texte en accord avec ses idées du
moment et, par conséquent, à retoucher ce qui lui paraît mériter une mise à
jour. Bien des corrections évoquent la plume sévère, et parfois agacée, du
professeur qui s’impatiente devant certaines leçons mal comprises par son
élève. En tous cas, elle ne laisse rien passer.
Suppressions et substitutions
Quelques suppressions de mots en témoignent (1, 3, 21,
22, 29, 31, 42) : un adjectif et une précision géographique inutiles, une
formule grandiloquente, un verbe innécessaire, un adverbe de trop, une
répétition mal venue.
Les plus nombreuses prennent la forme de substitutions :
4, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 43, 48, 52, 56,
58, 60, 61, 62. Trouver une explication à chacune d’entre elles est largement
illusoire, mais on peut s’y risquer dans le but de déceler les partis-pris
stylistiques de Marguerite Yourcenar à ce moment de sa vie d’écrivaine.
Certaines inexactitudes ou jugées telles à la
relecture sont corrigées : la lecture de Dante ne conduit plus vers les
Açores mais vers les Canaries ou le Cap-Vert (8) ; ce qui relit Numance à
Carthage est plus qu’une alliance (13) ; « oratoire » est
préféré à « église » pour désigner un lieu de culte byzantin
(30) ; le commentaire ne s’applique plus à la peinture andalouse mais à celle
des sévillans (34), de même que l’on substitue des influences antiques à des influences
orientales (16) ; comparer la Macarena à une idole asiatique est excessif
et inutile (17) ; enfin, on préfère évoquer des moutons égorgés, plutôt
que des chevreaux, quand bien même Grace dit le contraire dans son carnet (60).
On corrige aussi des affirmations hasardeuses ou des références inutiles :
« la mer Océane » (10) ; on supprime la référence à l’Italie (39).
D’autres modifications, plus formelles, peuvent
s’interpréter comme le désir de nuancer le propos en évitant : des
répétitions (42, 57), des formules trop péremptoires (4, 6), trop vagues (9,
19, 24, 28, 38 ) ou trop réductrices (15, 36), inutilement recherchées (12, 43,
48, 52, 56, 62), triviales (25, 26). Certaines consistent en une recomposition
par inversion de deux phrases (2), ou de syntagmes à l’intérieur de l’une
d’entre elles (23). MY se montre aussi exigeante dans le choix des termes, en
particulier des adjectifs : le « dur » palais devient
« sévère » et les « délices » de l’Alhambra, qui, en effet,
relèvent du cliché, sont remplacés par un syntagme (14) ; « tragique »
passe du statut de substantif à celui d’adjectif, qui lui convient mieux
(35) ; les « loques » laissent place aux « haillons »
et les « déboires » aux « déconvenues » (58) ; les
mains « chaudes » aux mains « tièdes » (61). Certaines
formulations peu heureuses sont réécrites dans la recherche d’une plus grande
simplicité (50, 55) : parfois, la
nouvelle version n’est guère meilleure que la précédente (46).
La version définitive n’introduit que quelques brefs
ajouts (7, 37, 44, 59). Ils ont pour objet de compléter la rédaction primitive
pour le premier, ou de la nuancer pour les deux autres.
Ces modifications ponctuelles ne doivent pas
s’analyser isolément, ou pas seulement isolément, car elles appartiennent
parfois à une série ou à un passage qui a fait l’objet d’une révision
particulière. Ainsi, la suppression de « brune » (57) s’explique par
le désir d’éviter la répétition d’un mot qui réapparaît quelques lignes plus
bas (58). Dans certains passages, stratégiquement situés (par exemple à la fin
du texte), l’autrice s’attache au moindre détail, ce qu’il ne fera peut-être
pas pour d’autres passages sans que cela signifie qu’elle y adhére plus
volontiers (15 à 31, 34 à 36, 57 à 62).
Ajouts et réécriture
En revanche, les ajouts plus substantiels (11, 41, 45,
53, 54) méritent un commentaire à part, parce qu’ils semblent répondre à une
approche différente.
La variante 11 est une parenthèse, un hors-texte, qui
rompt le fil du discours et dont on cherche la justification. MY semble gênée
par un rapprochement qui frise l’équivalence entre la patrie des conquistadors
et les terres qu’ils découvrent. Elle relativise son propos en se référant à
l’histoire, qui est un apanage de la première, et introduit habilement le
paragraphe suivant qui évoque les Archives des Indes conservées en Andalousie.
Cela confirme sa répugnance à trancher dans le vif du texte primitif ce qui
aurait peut-être mérité de l’être.
La variante 14 substitue à une formulation froide et
équivoque (“dur”, “délices”) une phrase bien rythmée et poétiquement réussie
(“À l’Alhambra éventé par les souffles de l’Orient islamique”).
Dans la rédaction première, la chapelle qui
matérialise l’éventrement de la mosquée de Cordoue est à peine évoquée, dans
une comparaison qui détonne dans sa trivialité (27). On comprend que MY ait
souhaité l’amender. Dans ce but, elle lui substitue une expression métaphorique
inspirée de la visite du monument : un autre fracas, celui des bombes,
remplace avantageusement les clairons primitifs.
La variante 32 offre un bon exemple de réécriture. Le
rapprochement avec d’autres régions de l’Europe chrétienne est supprimé. Quant
aux manifestations spécifiques de la culture andalouse, elles se nourrissent
directement des souvenirs du voyage. Ainsi de l’habit déchiré du matador que
les petites mains d’un atelier de couture se chargent de raccommoder. En
revanche, Marguerite et Grace sont arrivées trop tard à Séville, à une semaine
près, pour pouvoir assister aux processions de la Semaine Sainte, en particulier,
le Vendredi Saint (et non le Samedi), à celle du paso du Christ flagellé ;
elles sont reparties trop tôt pour pouvoir suivre les évolutions des danseurs
de la Fête Dieu (12 juin). Ces précisions s’appuient sur des lectures et sur
des souvenirs – visites d’églises et de musées – qui ont fini par
s’estomper.
La Maja desnuda de Goya reçoit un traitement
particulier dans la rédaction finale, alors qu’elle n’avait fait l’objet que
d’une allusion, associée à la Vénus de Velasquez, dans la première (41).
Ce petit paragraphe contredit la version primitive, mais il est vrai
qu’associer le tableau de l’aragonais à celui du sévillan pour illustrer le
commentaire sur la peinture sévillane a de quoi surprendre. Malgré tout, le
tableau de Goya sert trop bien la démonstration pour le supprimer, même si on
le considère comme une exception. Plus loin (45), Goya illustre à nouveau, par
contraste, le caractère peu éclectique de la peinture espagnole. Les deux
passages rompent avec la logique du discours mais, apparemment, MY ne se
contentait plus d’une vision étroite de la peinture espagnole, uniquement basée
sur les œuvres des peintres du Siècle d’Or.
La diffusion du mythe de Don Juan inclut la référence
à Molière, Byron et Mozart, écrivains et musicien étrangers à l’Espagne, qui
sonne étrangement dans le contexte de l’article (53). Il semble que MY ait
perçu cette anomalie mais, au lieu de la supprimer, l’a amplifiée en ajoutant
Balzac, Baudelaire et Montherlant. On peut s’interroger sur le bien-fondé de
cette décision. Enfin (54), la nouvelle rédaction n’hésite pas à contredire
l’observation qui précède (“vierge d’artifices littéraires”) et, plutôt que de
la supprimer, l’explicite en introduisant une comparaison avec l’Italie, qui
constitue en matière d’art une référence majeure pour MY.
Ces modifications témoignent d’une relecture
minutieuse du texte initial et de la volonté de l’amender non seulement dans la
forme mais aussi dans le contenu. Toutefois, Marguerite Yourcenar ne le réécrit
pas de fond en comble. On perçoit même parfois qu’elle retient le scalpel pour
ne pas pénétrer trop profondément dans une chair qu’elle estime encore vivante.
La principale leçon que l’on puisse tirer de ces
corrections est que Marguerite Yourcenar continue à souscrire, pour
l’essentiel, en 1982, au contenu de son article de 1952. Le fait qu’elle
l’incorpore, trente ans plus tard, à son recueil est une indication utile, mais
pas aussi significative qu’on pourrait le penser, puisqu’elle s’applique aussi
aux autres textes qui composent le volume. On pourrait y voir tout autant
l’insistance de l’éditeur, soucieux de tirer profit de la notoriété acquise par
l’autrice après son élection à l’Académie française. Ce fut un évènement d’une
ampleur nationale, retransmis à la télévision d’État, en présence du Président
de la République, Valéry Giscard d’Estaing, qui était sur le point, il est
vrai, de s’engager dans une nouvelle campagne électorale.
Développement sur la statuaire
Le numéro 33 constitue une exception à plus d’un
titre : il s’agit d’un chapitre en soi, qui appartient à la version
primitive et dont le contenu n’est pas repris, même modifié, dans la version
définitive. Le constat est d’autant plus intrigant que visiblement Marguerite
Yourcenar l’avait rédigé avec un soin particulier et que le passage n’aurait
pas dépareillé dans la version définitive. Elle s’y adonne à un de ses
exercices favoris : rapprochement entre des cultures différentes et très
éloignées dans l’espace et dans le temps, et identification d’une influence
ancienne dans des créations contemporaines. La polychromie de la statuaire
espagnole comme conservatoire d’une pratique habituelle chez les Grecs anciens
est une idée excitante, en effet. Par ailleurs, la deuxième partie du
paragraphe illustre les restrictions qu’une inspiration exclusivement
chrétienne apporte à cet art, en se limitant à « quelques attitudes
rigides ou prostrées » et en excluant la « beauté virile ». Ce
raisonnement s’inscrit parfaitement dans le contexte de l’article. Il faut donc rechercher ailleurs le motif de sa
suppression.
On ne manquera pas d’observer que le titre général du
volume reprend celui d’un article intérieur, « Le Temps, ce grand
sculpteur », et que ce dernier est entièrement consacré à la statuaire
antique. En introduction, Marguerite Yourcenar y rappelle que les sculptures
originales grecques étaient peintes avant de décrire par le détail les innumérables
processus de dégradations que la nature et l’homme se sont conjugués à faire
subir à ces œuvres, ainsi que les effets inattendus que ces processus
provoquent. Des restes apparemment informes conservent parfois la trace de la
main qui les a fait naître. Pour d’autres, ils perdent leur signification
première pour en adopter de nouvelles, souvent inattendues. Les restaurer ne
garantit pas qu’on leur restitue leur véritable visage et cette tentation a
perdu de sa vigueur parmi nos contemporains. Enfin, les sculptures qui gisent
au fond des océans tendent à retrouver l’aspect informe de leur matériau de
départ, réduisant la durée de leur vie d’œuvre d’art à un bref épisode
temporel.
La présence de ce bref article et le sort particulier
qui lui a été réservé, au point de fournir le titre du recueil, suffisent-ils à
expliquer que Marguerite Yourcenar ait jugé que la présence d’un développement
sur la statuaire espagnole contenu dans un autre article pouvait nuire à la
cohérence du volume et égarer ses lecteurs dans des voies qu’elle ne souhaitait
pas leur voir emprunter ? L’hypothèse n’est pas à écarter, mais on est
bien obligé de constater que cet article sur la statuaire antique n’a rien de
commun, si l’on excepte la brève référence à la polychromie de la statuaire
grecque, avec le paragraphe de « L’Andalousie et les Hespérides » qui
a été retiré de la version définitive. On serait donc tenté d’attribuer la
décision de Marguerite Yourcenar à une motivation autre que le risque d’une
répétition mal venue dans un même volume. Un doute subsiste, cependant, si l’on
veut bien considérer que la solution radicale adoptée à l’encontre de ce
développement est unique et que le texte concerné ne méritait pas un tel
opprobe. Le lecteur pourra en juger par lui-même.
COMMENTAIRE DE L’ARTICLE
La
théorie à l’épreuve des faits
J’ai
lu à peu près tout ce que nos historiens, nos poètes, et même nos conteurs ont
écrit. La lettre écrite m’a enseigné à écouter la voix humaine, tout comme les
grandes attitudes immobiles des statues m’ont appris à apprécier les gestes.
Par contre, et dans la suite, la vie m’a éclairci les livres. Mais ceux-ci
mentent, et même les plus sincères
(Mémoires d’Hadrien, p. 37).
Le voyage en Andalousie se déroule après la
publication des Mémoires d’Hadrien, Pourtant, même après la parution, s’impose
comme une nécessité le contact direct avec une réalité géographique et humaine
jusque-là uniquement appréhendée à travers la bibliographie. L’exercice est
risqué puisqu’il soumet à l’épreuve d’une présence physique une reconstruction élaborée
à partir de témoignages livresques, mais il contribue aussi à satisfaire
l’exigence d’exactitude et d’honnêteté que la romancière s’est imposée dans
l’élaboration de cet ouvrage et, plus généralement, de toute son œuvre. C’est
là tout le mérite de ce court traité : fournir l’occasion de corriger
certaines erreurs, tout en se donnant le moyen de confirmer, lorsque c’est le
cas, la pertinence du propos.
Depuis les temps préhistoriques, selon Marguerite
Yourcenar, l’Espagne n’existe que comme une finis terræ à laquelle on
accède par la mer. Ce paradoxe, qui mériterait peut-être d’être nuancé par
l’étude de l’implantation humaine en ces temps reculés, découle d’une vision
éminemment historique et ne prend en compte que les indices laissés par des
cultures méditerranéennes, à commencer par les Phéniciens, sur le territoire de
la Péninsule. Le contact se fait uniquement par la Méditerranée. Cette
affirmation péremptoire est nuancée et, dans une large mesure, contredite par
la référence à l’Atlantique mais dans des termes ambigus : l’Espagne est
certes méditerranéenne mais « ne l’est pourtant qu’à moitié. Elle est en
porte-à-faux sur l’Atlantique comme la Grèce sur l’Asie ». Autant dire que
l’océan offre peu de champ à l’analyse du peuplement de la Péninsule et, pour
un peu, s’apparenterait à une erreur de la nature.
Les premières attestations de l’Espagne sont de type
légendaire ou mythique :
Dès
l’Antiquité, les Grecs avaient vaguement situé au large de la côte ibérique
l’île des Héros, les Champs-Elysées d’Achille, qu’une autre tradition place au
bord opposé du monde alors connu, dans la mer Noire. En plein Moyen Age, Dante
reprenant ce grand thème atlantique, entraînait son Ulysse loin d’Ithaque pour
le faire sombrer corps et biens en vue des Canaries, ou peut-être du cap Vert,
sous un ciel où pointent des étoiles déjà différentes, et dans des parages que
les conquistadores connaîtront
plus tard (p. 168-169).
Même dans ce domaine, les données sont sujettes à
caution et les témoignages difficiles à concilier compte tenu de la distance
qui sépare la naissance du mythe achiléen et l’œuvre de Dante, sans parler de
l’allusion aux conquistadors. Reste l’étrangeté de ces lieux méconnus du
monde grec et latin et qui fit l’objet d’une colonisation tardive.
Marguerite Yourcenar débarque en Andalousie avec quelques
présupposés, tous hérités de sa connaissance érudite de l’Antiquité grecque et
latine, ce qui la pousse à négliger d’autres possibles pistes de réflexion et à
ne s’intéresser qu’à l’extrémité sud de la Péninsule, au détriment des régions
méditerranéenes plus septentrionales et, à plus forte raison, des régions
centrales et occidentales de la Péninsule.
L’idée maîtresse est que l’Andalousie et Séville
constituent le pendant occidental de la Grèce et d’Athènes, même si leur « entrée
sur la scène universelle » est bien plus tardive. Cette nuance enlève
beaucoup de force à cette affirmation, dans la mesure où les événements
similaires n’interviennent de façon concommittante dans ces deux régions que
pendant une période relativement réduite, qui, pour l’Andalousie, débute avec la
colonisation carthaginoise, la première à posséder une dimension politique et
non exclusivement commerciale. Ce rapprochement est d’ailleurs passablement
forcé : « Et l’air sec et léger de Séville, son rythme d’existence à
la fois continental et maritime rappellent irrésistiblement Athènes » (p.
168) ne résiste pas à un séjour un peu prolongé dans la capitale andalouse.
Ce cadre posé, il convient de tirer parti de
l’observation directe des lieux. Il ne faut pas se cacher que le bilan risque
d’être mince, à moins d’avoir la naïveté de croire que les dix-neuf siècles qui
ont passé depuis l’époque d’Hadrien ont pu laisser des traces concrètes. Bien
entendu, Marguerite Yourcenar n’est pas dupe mais elle sait aussi que la
géographie des lieux garde une mémoire de son passé même lorsqu’ils ont été abandonnés
de longue date.
L’Espagne
romaine a duré environ sept siècles, qui constituent de beaucoup la plus longue
période de paix qu’ait connue la péninsule. Partout, sur la carte et sur le sol
de l’Andalousie actuelle, affleurent les villes, les routes, les aqueducs, les
ports, les monuments de l’Espagne tranquille […]. Italica, patrie de Trajan, d’Hadrien, de Théodose, est plus
qu’aux trois quart enfouie sous la terre, mais ses mosaïques et ses quelques
statues attestent une splendeur due aux efforts de l’artisan local hellénisé ou
au luxe des importations de Grèce et de Rome.
Italica, patrie de la famille de l’empereur Hadrien et
son lieu de naissance, n’est plus qu’un monceau de décombres, mais ses vestiges
parlent encore à ceux qu’une longue fréquentation des sites archéologiques à
travers le monde grec et romain a rompus à cet exercice de déchiffrement. Celui-ci
a tout de même ses limites, car il ne permet pas de distinguer la production
artistique locale, s’il y en eut une, de l’importation d’œuvres, dont on sait,
ne serait-ce que par les naufrages de vaisseaux dont les cargaisons noyées dans
la Méditerranée finissent parfois par être repérées, qu’elle donna lieu à un
commerce intense. En fin de compte, la visite du site dévie bien vite vers la
vision mélancolique du poète Rodrigo Caro de la précarité des choses humaines,
ce qui ne nous informe guère sur la période de sa splendeur et sonne comme un
avis d’impuissance à en tirer un vrai parti.
Que penser des autres rapprochements qui, pour Marguerite
Yourcenar, témoignent d’une permanence au-delà des siècles ? Un séjour
d’un mois est bien trop bref pour fournir une matière solide à ce sujet et ne
donne lieu, le plus souvent, qu’à des remarques anecdotiques, qu’il s’agisse
des traditions culinaires andalouses ou des noms de rues de Séville. Beaucoup
plus révélateurs sont les témoignages qui ne sont pas à proprement parler
andalous. Ainsi du sarcophage punique du musée de Cadix qui atteste de
l’étroite relation entre ibéres et carthaginois, qui ne mérite qu’un trop bref
commentaire final.
Le petit musée provincial de Cadix contient un
sarcophage punique, frère des sarcophages sidoniens du Louvre : une lourde
forme anthropoïde, un bras replié dans une des poses habituelles aux morts, et
dont la main serre une grenade ou un cœur. Le dedans du sarcophage révèle un squelette vigoureux comme un tronc d’arbre. Ce
punique inconnu résume par avance une des grandes aventures de l’Espagne.
Marguerite Yourcenar ne le dit pas, mais cette
« grande aventure » fut définitivement interrompue par les victoires
des Scipions, grâce auxquelles les ancêtres de l’empereur firent souche dans la
Péninsule en profitant de la romanisation à marches forcées de la Péninsule qui
suivit la destruction de Carthage : « [Marullinus, mon grand-père]
descendait d’une longue série d’ancêtres établis en Espagne depuis l’époque des
Scipions » (Mémoires d’Hadrien, p. 47).
De cette tardive implantation de la lignée en
Andalousie, elle tire des conséquences dont on ne sait si elles sont attestées
ou simplement supposées. Le mutisme du grand-père, sa passion pour
l’astronomie, l’austérité du père et leur attention commune à une administration
rigoureuse et à la richesse qui en découle, leur désintérêt pour les arts,
présenté comme un trait commun à toute la société péninsulaire (« il n’y
avait pas, je crois, une seule bonne statue grecque dans toute la
péninsule », Mémoires d’Hadrien p. 52) contribue à définir un cadre
provincial auquel il ne manque même pas l’accent, dont le futur empereur dut se
défaire dès ses premières interventions publiques. Le profil de la mère
d’Hadrien, « cette figure allongée d’Espagnole », est peut-être
corroborée par « le buste de cire du mur des ancêtres », mais elle
évoque trop précisément une certaine ligne du visage qui, au moins depuis les
portraits d’Isabelle la Catholique, est un trait propre à la femme hispanique
pour ne pas être suspecte.
De même, l’identification d’éléments hispaniques introduits
dans la culture romaine par ceux que Marguerite Yourcenar appelle « le
clan espagnol à Rome » est tentante mais n’aboutit qu’à des considérations
générales peu convaincantes en fin de compte, qu’il s’agisse du « goût des
constructions colossales », « celui des fastes funèbres », « l’outrance
d’un Sénèque ou d’un Lucain, ou le nihilisme ascétique de Marc-Aurèle ».
Elle le reconnait elle-même en suggérant une interprétation inverse, « ces
plis si fortement marqués du tempérament ou de la pensée espagnole [auraient
tout aussi bien pu être] marqués par l’influence romaine ».
On mesure là toute la difficulté de l’exercice
consistant à tirer des conclusions solides de rapprochements trop liés à une
approche personnelle. Le fait est d’autant plus patent lorsque l’on se propose
de tracer de vastes tableaux comparatifs, sans s’imposer de limites spatiales
ou temporelles, exercice qui constitue l’essentiel de la première moitié de « L’Andalousie
ou les Hespérides ». Les phrases regorgent de noms de lieux et de
personnes, mythes et légendes s’y bousculent ; le tout débouche sur des jeux
d’équivalence hardis auxquels on n’est pas tenu d’adhérer :
La Vierge des Vendredis saints, la Macareña [sic]
scintillant de pierreries a pour sœur au début des temps la dame d’Elché sous
ses parures phéniciennes. Une plastique grecque ou héritée des Grecs a
contribué de part et d’autre à l’élaboration de ces deux pures idoles ;
les traits durs et fins sont ceux de la beauté ibérique, mais l’ardeur et la
fierté, la fixité, et les pesants joyaux sont venus d’Orient.
La présence arabe en Espagne, d’une durée équivalente
à celle de l’empire romain, a laissé d’innombrables traces dans l’architecture
et dans l’art de l’Andalousie. Marguerite Yourcenar peut s’en convaincre lors
de ce séjour ; elle n’en maintient pas moins le rapprochement suggéré avec
l’orient gréco-romain, bien que « la marée turque envahit l’Orient
chrétien » au moment-même, à un demi-siècle près (1453 / 1492), où tout
état musulman disparaît de la Péninsule. Cependant, elle introduit une nuance
de taille : « l’Islam en Espagne a sur sa contrepartie dans l’Orient
grec l’avantage d’être plus près de ses sources, de ses origines,
l’Hégire ».
Considérations sur l’art
espagnol
Cette précision temporelle, au demeurant banale
puisque l’invasion de l’Espagne par les arabes (711) survient moins d’un siècle
après le début de l’ère musulmane, ouvre le champ à une analyse qui se nourrit,
là aussi, de connaissances antérieures, en l’occurrence sur les premiers temps
de l’Islam et même au-delà. Les ruines du palais de Medina-al-Zahra évoquent
aux yeux de Marguerite Yourcenar une époque plus ancienne que l’hégire :
C’est une Asie
plus immémoriale que l’Islam, c’est l’Iran achéménide, ce sont les vers
mélancoliques des poètes persans sur les demeures royales hantées désormais par
l’onagre et la gazelle qu’on évoque dans ces salles nues, en présence d’un cerf
de bronze où s’affirme une technique millénaire, de ces stucs et de ces tessons
où l’obsession de la forme animale se déguise en arabesques et en rinceaux.
L’affirmation surprend, sachant que la ville et le
palais furent édifiés au Xe siècle, soit plus de trois cents ans
après l’hégire et qu’on conçoit mal que ces siècles n’aient pas effacé des
traces encore plus anciennes. Mais l’idée de la proximité de la conquête arabe
de l’Espagne avec les débuts de l’Islam réveille des images qui doivent
beaucoup aux lectures effectuées pour la rédaction des Mémoires d’Hadrien,
car ces contrées furent souvent parcourues par l’empereur. On peut supposer
aussi que les vestiges de Medina-al-Zahra, contrairement à ceux d’Italica, se
prêtaient à une lecture qui, en interdisant une restitution de la vie palatine
à l’époque de la splendeur du califat de Cordoue, débouchait sur l’évidence
d’un art oriental perçu dans son essence, aux limites de l’abstraction :
[…] l’art d’une civilisation pour qui tout délice et toute géométrie aboutissent à
la forme humaine se voit remplacé par un art voué à la seule modulation de
lignes qui s’étirent, se caressent, ne signifient plus rien qu’elles-mêmes,
musique abstraite, méditation mathématique éternelle.
Ce graphisme formel qui définit si bien
l’ornementation des édifices arabes est qualifié plus loin de « plus
féminin ». Il éloigne l’observateur émerveillé des contingences
historiques, fussent-elles les plus cruelles ou les plus tragiques, dans
lesquelles cet art fut créé, lequel emprunte « aux corolles, aux grottes,
aux alvéoles des ruches leur secret si profondément naturel et si éloigné de
l’humain ». Cette évocation d’un lyrisme maîtrisé exprime à l’évidence un
sentiment profondément ressenti, un véritable choc émotionnel devant une scène
bouleversante et inattendue :
Cette perfection quasi végétale se passe de l’unité de
style, ne dépend pas de l’authenticité du détail, subit avec une ravissante
docilité toutes les injures : le Généralife aux revêtements effacés, aux
pavillons refaits, aux bosquets retouchés par des jardiniers modernes reste ce
que son constructeur arabe souhaitait qu’il fût : le paradis des
méditations paisibles et des joies faciles. On n’éprouve pas, à l’idée d’autres
palais grenadins anéantis ou tombés en ruines, l’amer dépit qui nous saisit
devant les blessures du Parthénon ou sur l’emplacement d’une cathédrale
bombardée : on accepte que ces beaux objets aient fleuri et passé comme
des narcisses.
Cet art n’est pas figé dans ses manifestations. Il révèle
plus qu’il ne montre et, de ce fait, nourrit une réflexion sur la création
artistique et son histoire, ce qui intéresse au plus haut point Marguerite
Yourcenar.
Les autres périodes architecturales présentes en
Andalousie n’ont pas droit à un traitement aussi enthousiaste. Le gothique ,
« art militaire, implanté par la Reconquête, ramené du Nord, sorte de
moine armé » se limite à la cathédrale de Séville, « énorme
forteresse de la foi catholique » et ne mérite une mention que parce que
l’édifice recèle « la cour arabe des Orangers ». Cette parenthèse
fermée, on en vient à la Renaissance et à « ses succédanés
baroques », non tant pour eux-mêmes que parce qu’ils semblent n’avoir eu
pour mission que d’exalter jusqu’à l’excès une foi catholique qui n’admet pas
de rivaux même anciens. Cet art venu d’Italie se rapporte fort mal à son modèle :
« à un homme vêtu de soie un homme vêtu d’acier ». C’est un art de
combat. Cordoue et Grenade en témoignent, l’une par « l’éventrement de sa
mosquée » pour faire une place au palais de Charles-Quint, l’autre, par
« cet espèce de pourrissoir où quatre cercueils rouillés s’alignent côte à
côte, […] sous les tombeaux d’apparat des Rois Catholiques ».
Cédant au plaisir des rapprochements inattendus, Marguerite
Yourcenar fait remonter l’inspiration du baroque espagnol au Moyen Age chrétien
« ou dans un passé antique et non-chrétien plus lointain encore »,
preuve, s’il en était, que la Renaissance a été ignorée par « un peuple
habitué désormais aux tensions extrêmes ». Elle en trouve la preuve dans
les manifestations, à ses yeux, les plus baroques de la vie
andalouse » :
pompes des processions tauromachiques, broderies des
costumes de toreros, souvent déchirés et sanglants […], costumes des danseurs du Corpus Christi,
pourpre du Nazaréen flagellé et exposé au peuple, traînant comme une vague de
sang sur les têtes de la foule, argenterie et catafalques des Samedis Saints.
Cette vision folklorisante, dont on trouve la source
dans les carnets de Grace, propose une conclusion anecdotique à une réflexion
ambitieuse. Elle témoigne surtout de cette tendance à ne rien laisser en route
qui puisse illustrer son propos.
La dernière séquence de l’article est une longue
réflexion sur la peinture sévillane et sur ses modèles. Si elle s’inscrit dans
les grands courants européens issus de la Contre-Réforme, la peinture de
Murillo, Valdés Leal, Velázquez et Zurbarán s’en distingue par un cru réalisme,
qui la prive de toute projection vers un au-delà du sujet traité, « des
leçons que nous devinons universelles » : « ce n’est pas la mort
qui nous est présentée dans ce tableau de Valdez Léal dont Murillo disait qu’il
pue, c’est un cadavre, et ce cadavre est un portrait ».
L’art pictural est un terrain que Marguerite Yourcenar,
en bonne flamande, connait bien, ce qui explique ces formules percutantes qui
emportent la conviction du lecteur. Ainsi du nu, domaine privilégié de
l’humanisme classique (« la gloire du nu ») que les espagnols ont
ignoré, à de très rares exceptions près, Velasquez et Goya ; et même chez
ces derniers, « le détail, l’accidentel et l’instantané » les éloigne
du « pur chant des formes ». De même, dans la scène de genre ou la
nature morte, ces peintres nous montrent « non pas l’Essence ou l’Idée,
mais la Chose ». Marguerite Yourcenar conclut ces paragraphes sur une
observation d’une grande justesse sur les limites d’un prétendu réalisme :
Les peintres flamands, florentins ou vénitiens nous en
apprennent plus, respectivement, sur leur ciel et sur l’air des rues que les
peintres de l’âge d’or sévillan.
Bilan
Sacrifiée à l’idéologie castillane de la race,
l’Andalousie a été reléguée à une position subalterne qui ne lui a laissé
d’autre perspective qu’une quête inassouvie, incarnée par « ces figures
d’histoire et de légende [qui] se définissent toutes par ce puissant mot quero
(sic pour quiero) qui signifie à la fois aimer et chercher » :
errance de Jeanne la Folle avec le cercueil de son époux ;
visions nocturnes de Jean de la Croix ; aventures féminines de Miguel
Mañara, à l’origine du mythe de don Juan ; doña Belize et Bernarda Alba,
héroïnes du théâtre de Lorca. C’est une terre de poètes qui, pour être « perpétuellement
aimée et recréée à distance », a nécesité les talents de Tirso de Molina,
Molière, Mozart, Byron, Balzac et Baudelaire (à nouveau le mythe de don Juan).
Ce condensé schématise certainement la pensée de
Marguerite Yourcenar mais révèle aussi ce qu’a d’approximatif ce raisonnement
fait d’idées générales illustrées par des exemples empruntés à des époques
différentes et sortis de leur contexte. C’est une pratique courante dans la
critique française de l’époque, que dénonçait si justement Gómez Baquero dans la
conférence de Jean Cassou (cf. Textos inéditos / Literatura del siglo XX
/ Controversia literaria).
La page finale est beaucoup plus convaincant parce
qu’elle s’appuie sur les observations personnelles de Marguerite Yourcenar au
cours du voyage :
Et nous commençons à comprendre ce qui nous touche
dans ce pays et parfois nous bouleverse : le contact direct avec la
réalité, le poids brut de l’objet, l’émotion ou la sensation forte et simple,
antique et toujours neuve, dure ou douce comme l’écorce ou comme la pulpe d’un
fruit.
Ces lignes confirment combien l’historien doit se
garder d’une trop étroite dépendance de la bibliographie, surtout s’il dispose
d’éléments de comparaison accumulés lors de ces nombreux voyages culturels.
C’est grâce à cet acquit personnel que Marguerite Yourcenar peut affirmer avec
raison : « Ce sol d’où jaillirent tant de chefs-d’œuvre n’est pas
d’emblée senti, comme l’Italie, une patrie privilégiée des arts… ». De
même, les traces laissées par la récente Guerre civile, qui s’est achevée à
peine dix ans auparavant mais que le régime en place s’évertue à pérenniser,
autorisent-elles à affirmer que « peu de contrées ont été plus dévastées
par la fureur des guerres de religions, de races et de classes ». Quant à
l’omniprésence de la religion et au spectacle de la misère, ils témoignent de
l’état de la société à cette époque et au choc ressenti par des citoyennes d’un
pays durement éprouvé par la guerre mais à qui fut épargné la destruction et la
défaite, les États-Unis d’Amérique.
Loin de s’arrêter à ce ce triste constat, Marguerite
Yourcenar recherche les indices d’une liberté que nulle contrainte ne peut
complètement étouffer et dresse un bilan, somme toute optimiste, qui montre que
la tradition n’est pas seulement l’instrument d’un conservatisme rétrograde
mais qu’elle conserve les germes de résurgences inattendues :
Énumérons nos délices : Grenade était belle, mais
ce rossignol qui chanta toutes les nuits, cette gorge brune gonflée de sons
nous en apprit tout autant sur la poésie arabe que les inscriptions de
l’Alhambra. À Cadix, au bord de l’Océan, parmi les blocs submergés qui sont
peut-être ceux du temple de l’Hercule gadéditain (sic), ce jeune garçon aux
jambes brunes, enfoncé jusqu’à mi-cuisses dans l’eau pâle et bleue comme ses
haillons délavés, soucieux seulement des profits et des déconvenues de sa pêche,
ne nous émouvait pas moins qu’uns statue antique trouvée à fleur d’eau ;
cette vieille religieuse à demi aveugle qui nous montrait sans les voir les
tableaux de l’Hôpital de la Caridad prend place dans nos souvenirs à côté des
figures peintes ; l’immensité massive de la cathédrale de Séville semblait
expliquée, ou justifiée peut-être, par la présence d’une femme solitaire priant
les bras en croix. Moins encore ou mieux encore, je pense à ces deux paysans
couchés au bord de la route dans leurs vêtements de laine rayée, à ce tas de
moutons égorgés dans une charrette au seuil d’un boucher, pleine de la présence
obscène et candide de la mort, à ces fleurs un peu moites, froissées par les
mains tièdes d’un petit mendiant, à ce pain sur une table que survole insidieusement
une mouche, à cette grenade d’où gicle un jus rose…
Ces scènes de rue sont tout sauf anecdotiques.
L’interprétation qu’en donne Marguerite Yourcenar lui épargne l’écueil de
l’exotisme qui menace le touriste, fût-il cultivé et curieux d’autre chose que
de couleur locale. Mais qu’elle ait songé à clore ainsi son article en dit long
sur le choc qu’elle a pu ressentir à la vue de ces scènes, confirmé par la
lecture des carnets de Grace. Cette découverte d’un présent misérable ramène à
de plus justes proportions la place parfois démesurée qu’occupe chez l’érudit l’analyse
du passé.
_____________________________
ANNEXE
Dans ses carnets, à la date du jeudi 1er
mai, Grace Frick note que Marguerite Yourcenar a tapé un article (« Typed
an article »). J’émets l’hypothèse, comme le suggère fortement la
chronologie, qu’il s’agit du texte qu’elle a commencé à rédiger à Rome,
quelques semaines auparavant, et que publiera le quotidien Combat, dans son édition du samedi 17-dimanche 18
mai. À ma connaissance, ce texte n’a jamais été publié ailleurs que dans ce
journal. Je le reproduis ci-dessous.
Il est paru sur deux colonnes en haut de la page 6. La
photographie qu’en propose Gallica ne permet pas de lire les fins de ligne de
la seconde colonne, la marge intérieure étant cachée par la pliure. J’ai tenté
de restituer l’intégralité du texte et y suis généralement parvenu. Il reste, cependant,
quelques mots partiellement ou totalement illisibles. J’ai comblé les vides
entre crochets par des lectures conjecturales ou un blanc lorsque j’ai dû
renoncer à le faire.
Comment j’ai écrit
les « Mémoires d’Hadrien »
par Marguerite yourcenar
Madame Marguerite Yourcenar à qui le jury Femina vient
de
décerner
le prix Femina Vacaresco pour son dernier ouvrage Les Mé-
moires
d’Hadrien, a tenté l’interprétation psychologique d’un très
grand
homme qui assura au monde un demi-siècle de paix et lé-
gua
le pouvoir à Marc-Aurèle.
Elle
explique elle-même dans l’article ci-dessous comment
elle
écrivit son remarquable livre.
Alfred de Vigny a écrit quelque part cette phrase que
je cite de mémoire : « Une belle vie, c’est une pensée de la jeunesse
réalisée dans l’âge mûr ». Si cette formule contient quelque vérité, ma
vie aura été belle. Ces « Mémoires d’Hadrien » furent projetés pour
la première fois au cours d’une promenade à la Villa Adriana, pendant un séjour
à Rome : j’avais environ vingt ans. Ecrit tout entier, puis jeté au
panier, repris, puis abandonné plusieurs fois, ce livre, ou plutôt ce projet de
livre, m’accompagna en Grèce pendant des années. Mes recherches, mes lectures
ne cessèrent jamais de s’y reporter, même au moment où je m’étais découragée de
l’écrire. Une nouvelle rédaction du début, écrite en 1937, se perdit en
1940 : elle fut retrouvée en 1948 et me parvint aux Etats-Unis. J’acceptai
ce hasard comme un signe et me consacrai exclusivement à cette œuvre si
longtemps restée en suspens ; je me remis dans les bibliothèques
américaines, à compléter, à réviser minutieusement la documentation
d’autrefois.
On a trop l’habitude de mettre d’une part le travail
de la création littéraire, avec ce qu’il suppose d’ardeur, d’émotion, d’élan
instinctif, et de l’autre le labeur patient de l’érudit sagement enfermé dans
l’étude des textes et dans leur explication. Pour moi, pendant les trois années
qu’a duré la dernière rédaction de ce livre, ces deux formes de prises de
contact avec le passé n’en faisaient qu’une. Le mot roman historique est un
terme bien trompeur : il ne s’agissait pas, dans mon cas, de prendre la vie
d’un grand homme du passé comme prétexte à fabulation, mais au contraire,
d’apprendre à me servir, avec des prudences et des soins infinis, de ces
milliers de documents qui vont des papyrus d’Oxyrinchus au T[ ], des
écrits de Galien et de Marc Aurèle aux chroniqueurs du Bas-Empire, pour
reconstituer cette grande figure dans son entièreté, dans ses constructions
apparentes, dans son être intime. Bien plus qu’aux procédés du roman, la
technique adoptée ici s’apparentait à celles de l’essai ou de la tragédie, à
celle de Montaigne et de Shakespeare rêvant sur les pages refermées d’un volume
de Plutarque à l’individualité [physi]que de César ou de Marc Antoine. C’est
d’ailleurs pour avaliser pleinement le mode de la méditation tragique, si riche
de réticences et d’aveux que j’ai choisi de mettre le récit de la vie d’Hadrien
dans sa propre bouche, d’exprimer en [termes] qui fussent siens ses actions et
les motivations de celles-ci. Hadrien pouvait parler de lui-même avec plus
d’assurance et plus de subtilité que moi.
J’écris ces lignes en Italie à la Villa Adriana où
Hadrien acheva de vivre, à Baies, où il mourut, à Rome, où il [e…] sous la
coupole de son Panthéon une pensée religieuse aussi profonde que celle de nos
cathédrales, mais d’essence différente, dans le caveau funéraire du Château
Saint-Ange, où ses cendres impériales reposèrent jusqu’à l’arrivée des
Barbares. [Ici] on peut, plus facilement qu’ailleurs, prolonger cette
méditation, autour de cet homme de réflexion, de passion et d’action, autour de
l’amateur de culture grecque, du Prince. La vie d’Hadrien a commencé en
Espagne ; ses ardentes [..]lections ont été pour la […] ses faits et
gestes de […] voyageur sont encore […] sur toutes les routes de son immense
empire ; mais son destin s’est noué et s’est [accompli] à Rome.
Combat,
samedi 17-dimanche 18 mai 1952, p. 6.
Octobre 2024