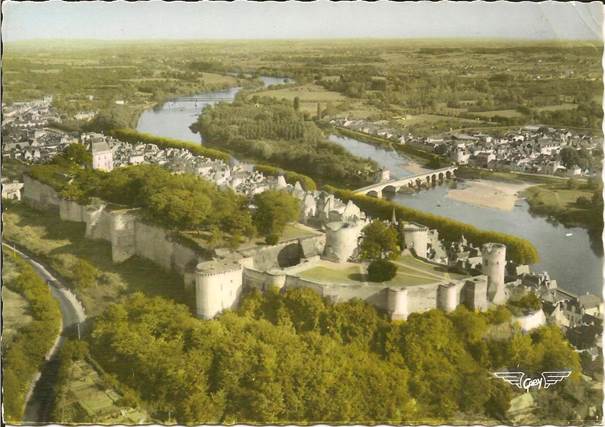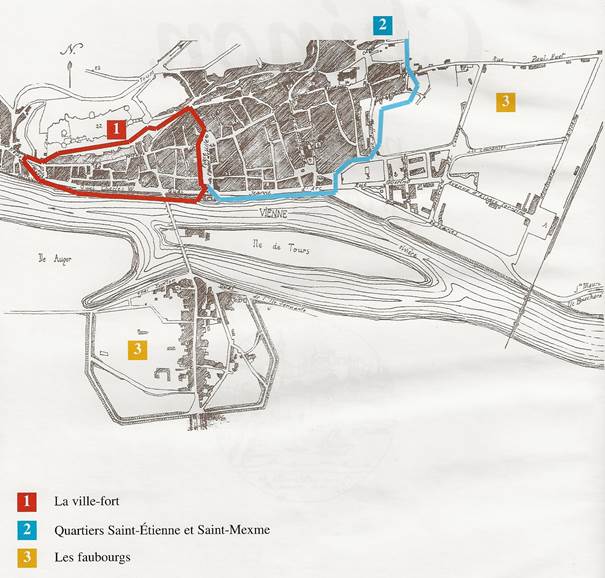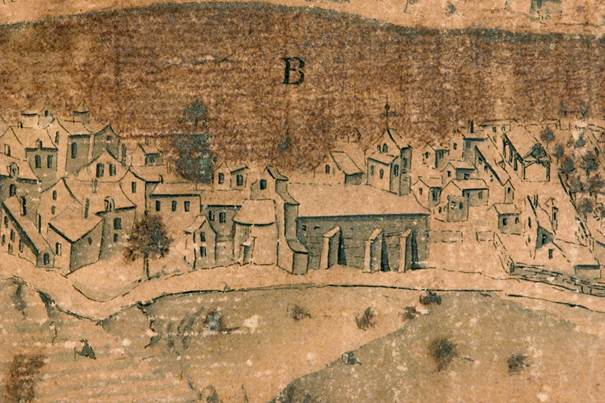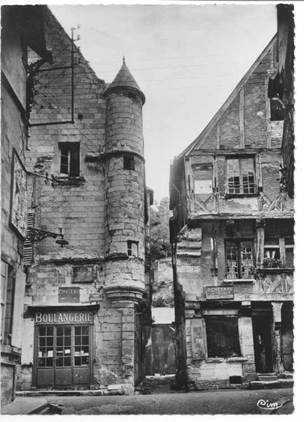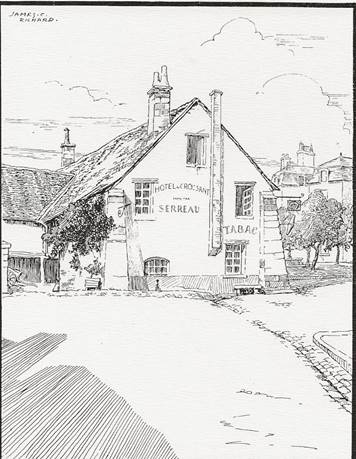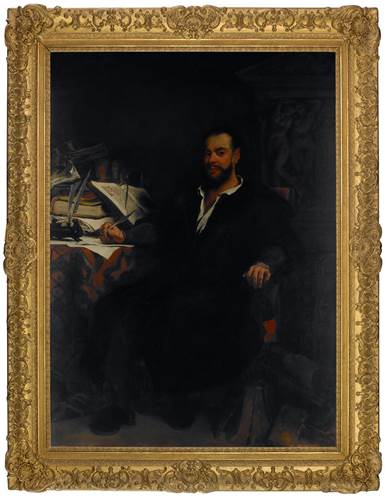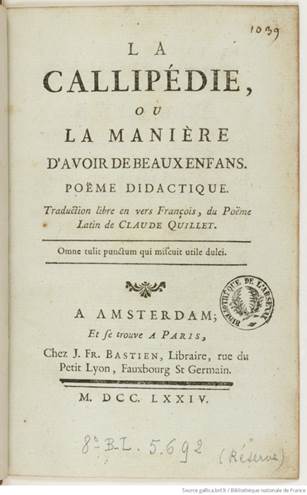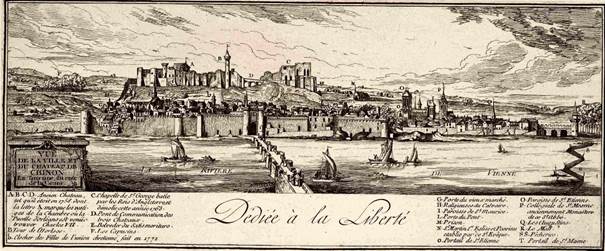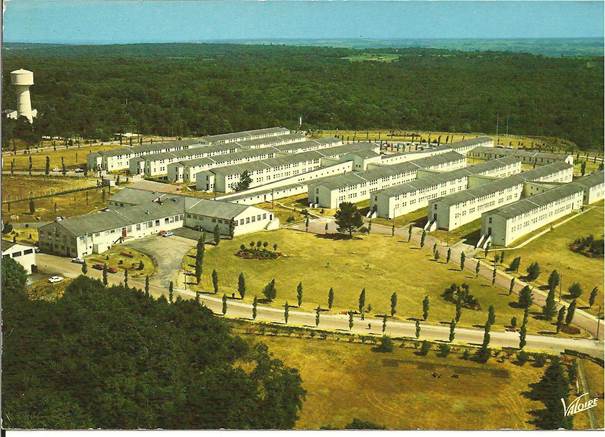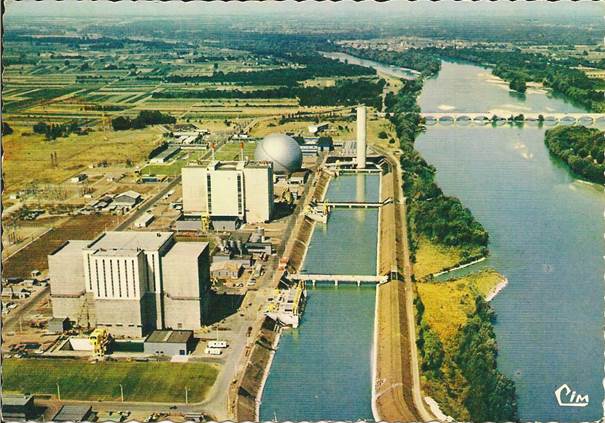Configuration des espaces
Vue aérienne de Chinon prise du NO. Au premier plan,
la forteresse ; en contre-bas, la ville-fort et la rangée de platanes qui
la sépare de la Vienne ; le pont et l’Île de Tours ; au-delà du pont,
le faubourg Saint-Jacques.
La ville de Chinon présente la particularité d’avoir
conservé, dans le tracé de ses rues comme dans la structure de ses édifices, la
marque des différents siècles au cours desquels elle s’est constituée. Bien des
vestiges anciens ont disparu ou sont devenus invisibles, parce qu’ils sont
enfouis sous les constructions qui occupent l’emplacement des précédentes, mais
ce qui reste est encore considérable. La raison en est que les époques de grand
bouleversement urbain ne se sont pas concentrées sur un périmètre unique ;
chacune a choisi d’investir un nouvel espace, laissant l’essentiel de la ville
antérieure dans son état primitif.
Pour bien comprendre ce phénomène, il suffit de traverser le
pont et, depuis la rive gauche, d’observer le panorama qui se présente à nos
yeux.
Plan du site indiquant ses différentes composantes
Ce qui frappe tout d’abord, c’est la nature du site : à
nos pieds, la Vienne, ses bancs de sable et ses berges empierrées ; à
l’arrière-plan, le coteau, surmonté de la forteresse ; dans l’espace
intermédiaire, la ville médiévale ou ville-fort et ses toits agglutinés. Si on
affine l’observation, on constate que cette disposition ne s’arrête pas au pont
mais continue bien au-delà, sur la droite, pour peu que le regard ne soit pas
arrêté par l’île de Tours qui divise le cours du fleuve en deux bras. En
s’éloignant de la Vienne, le coteau libère un vaste espace. On aperçoit à son
sommet la muraille récemment restaurée du Fort Saint-Georges, puis un habitat
plus diffus entouré de jardins. En contrebas, un autre quartier descend
jusqu’à la Vienne, le Quartier Saint-Etienne, du nom d’un de ses principaux
monuments. Enfin, derrière nous, s’étend le faubourg Saint-Jacques.
De la Tour Billard, au bas de la route de Tours, jusqu’au
pont du chemin de fer, à 500 m. de là, le dénivelé entre les quais et la
rivière est compensé par un talus empierré, surmonté d’un solide muret, de
pierre également. Ce sont les ‘perrés’. A intervalle régulier, ils sont
interrompus par des chaussées en pente douce, elle-même empierrées, les
‘cales’, sur lesquelles les barges et autres toues déchargeaient voyageurs et
denrées. La concurrence de la voie ferrée mit fin à cette activité.
L’équipement profite désormais aux pêcheurs, qui maintiennent la tradition des
barques à l’ancienne, dont le musée possède une remarquable collection de
maquettes. Perrés et cales embellissent le site en matérialisant le rapport
étroit qu’entretiennent entre elles ville et rivière. Jusqu’à maintenant, on a
su préserver cet ensemble remarquable de l’envahissement automobile.
Pour compléter le panorama, il faudrait ajouter quelques
éléments qu’on ne peut voir depuis ce poste d’observation. Vers l’aval, le
coteau s’interrompt brutalement, à l’endroit où s’achèvent la forteresse et la
ville médiévale. A partir de cette fracture, occupée par la route de Tours, il
reprend à perte de vue, en côtoyant la rivière, ce qui interdit toute
édification à ses pieds. En revanche, la hauteur est occupée par de nombreuses
édifications jusqu’au Prieuré de Saint-Louans. Le quartier Saint-Etienne et le
faubourg Saint-Jacques ont chacun aussi son prolongement : la Place
Jeanne-d’Arc et le quartier de la gare pour le premier, qui datent tous deux de
la fin du XIXe siècle ; le faubourg Saint-Lazare et le hameau
de Parilly, au bout de la rue sur digue, pour le second. Enfin, le XXe
siècle a investi le plateau qui prolonge vers le nord le sommet du coteau, en y
installant des lotissements, des supermarchés et la principale zone artisanale.
Survol historique
Les bons Tourangeaux sont simples comme leur vie,
doux comme l’air qu’ils respirent,
et forts comme la terre qu’ils fertilisent.
Alfred de Vigny, Cinq-Mars ou une conjuration sous Louis
XIII
On croit souvent que seules les
grandes villes ont un passé. Chinon, qui n’a pourtant jamais atteint les 10.000
habitants, prouve, au contraire, qu’une petite ville peut avoir une histoire
très longue et très riche, et avoir été le théâtre d’événements qui dépassent
largement les limites de son petit territoire. Je tenterai de retracer cette
histoire en m’appuyant sur la bibliographie mais aussi sur ma familiarité,
acquise au cours des années, avec la topographie des lieux et avec les
édifices. C’est donc une vision personnelle que je propose ici et non une
synthèse de la bibliographie existante et des idées reçues qu’elles a parfois
tendance à véhiculer.
Les
Temps antiques : Caïno
On chercherait en vain le document
de fondation de Chinon : il n’existe pas. Ses origines se perdent dans la
nuit des temps. L’ancienne Caïno s’est formée, peu à peu, sur un site
qui a toujours été occupé dès que l’homme s’est sédentarisé. Rabelais ne dit
rien d’autre, lorsqu’il commente, avec humour mais aussi avec une remarquable
acuité, l’étymologie fantaisiste qu’il prête au nom latin de Chinon, Caïno
(« la ville de Caïn »).
— Où est-elle ? demande
Pantagruel, quelle est cette première ville du monde […] ? — Chinon,
dis-je, ou Caïnon en Touraine. […] Je trouve dans l’Écriture Sainte que Caïn
fut le premier bâtisseur de villes. Il est donc vraisemblable qu’il a nommé la
première de son nom, Caynon, comme ensuite, en l’imitant, tous les autres
fondateurs et édificateurs de villes leur ont imposé leurs noms.
Cinquième
Livre, chapitre 35
Il faut chercher
l’origine de Caïno dans son site et dans son climat. Une large rivière
poissonneuse, un coteau calcaire pour s’abriter des crues et y creuser des
abris, des pâturages naturels, des terres fertiles, toutes conditions
susceptibles de favoriser l’implantation humaine.
Le promontoire
rocheux qui domine la Vienne est occupé depuis 3000 ans. Les témoignages
matériels de cette présence humaine aux temps préhistoriques, à Chinon même et
dans ses environs immédiats, sont nombreux : mégalithes, silex taillés, mobiliers
de l’âge du bronze, poteries et restes d’habitats de l’âge du fer pré-romains.
L’occupation romaine est attestée par les vestiges de villæ
gallo-romaines – rien que dans le secteur de L’Olive, on en dénombre deux –
mais aussi par des tombes du Bas-Empire retrouvées à Saint-Mexme, une stèle
funéraire et du mobilier archéologique retrouvés sur le site de la forteresse. Le
premier habitant répertorié sur le site est un guerrier, probablement un
vétéran des légions de César, dont la sépulture, retrouvée dans le
Fort-Saint-Georges, date du 1er siècle avant notre ère. Ce secteur a
abrité un cimetière jusqu’à la fin de la période gallo-romaine (Ve
siècle), ce qui suggère la présence d’un habitat permanent.

Stèle funéraire gallo-romaine
célébrant un vigneron ou un marchand de vin
(Robert Bedon, Lecture
découverte n°14, Société archéologique de Touraine, 2020)
La légende du
miracle de saint Mexme (vers 446), rapportée par Grégoire de Tours, raconte que
la population locale s’était réfugiée dans l’enceinte du castrum où elle
fut assiégée par le général romain Ægidius. Privée d’eau depuis plusieurs
jours, elle était sur le point de se rendre lorsque les prières du saint homme
provoquèrent un orage providentiel qui remplit les citernes et obligea les
assaillants à lever le siège. À en croire ce récit, le site actuel de la
forteresse était donc fortifié et capable d’abriter une population relativement
nombreuse, ce que confirment les fouilles récentes réalisées sur le site qui
attestent qu’à la fin de l’Empire, le promontoire était entouré d’une forte
muraille de 2,40 m d’épaisseur et comprenait plusieurs tours. En temps
ordinaire, la population devait résider dans le prolongement du castrum,
vers l’est. Dans ce secteur, on peut voir encore les restes d’une très ancienne
et modeste église, dont l’existence remonte au Ve siècle, au vocable
de saint Martin, ce qui n’est probablement pas l’effet du hasard.
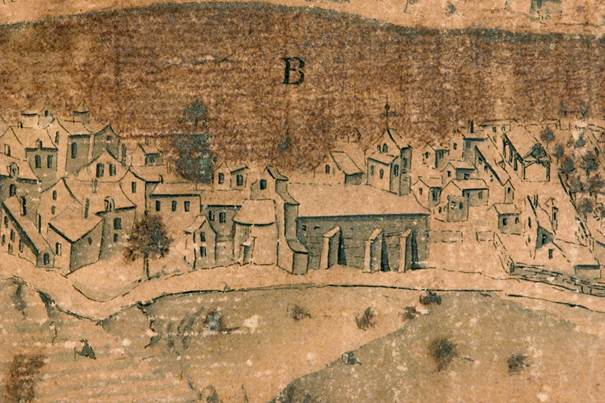
Église saint-Martin restituée (carte
figurative Delussay, 1767)
Aux ive et ve siècles, en effet, saint
Martin, évêque de Tours, s’attache à christianiser les populations locales.
Cette figure tutélaire, qui aimait à vivre dans de petites communautés, loin du
pouvoir laïc, a inspiré de nombreuses fondations érémitiques dans son diocèse.
Celles de Chinon sont toutes situées dans sa périphérie : Saint-Mexme, Sainte-Radegonde,
Saint-Louans.
Ces fondations sont
toujours actives pendant la période mérovingienne (vie–viiie
siècles), dont datent les premiers témoignages écrits sur l’existence d’une
agglomération. On les doit encore à Grégoire de Tours, qui cite plusieurs fois
dans ses écrits (560-580) le castrum (enceinte fortifiée) et le vicus
(localité dotée d’une église) de Caïno, ce dernier étant souvent désigné
comme un prolongement (suburbium) du castrum. Cette agglomération
devait être modeste mais assez importante pour devenir chef-lieu de viguerie et
pour abriter un atelier monétaire aux VIIe et VIIIe
siècles, puis de 920 à 954, lorsqu’on y transféra l’atelier de Tours, menacé
par les Normands. Par ailleurs, la fouille de la nécropole de Saint-Mexme a
permis de retrouver des tombes de personnages apparemment riches et puissants.
Comtes
de Blois et comtes d’Anjou (Xe-XIIe siècles)
À partir du xe siècle, Chinon est
l’enjeu des rivalités entre les seigneurs qui dominent le cours moyen de la
Loire, les comtes de Blois et les comtes d’Anjou. Les fouilles menées de 2007 à
2012 par le Service d’archéologie du Département d’Indre-et-Loire, sous la
direction de Bruno Dufaÿ, permettent de retracer précisément l’histoire de la
forteresse. L’histoire de la ville médiévale est, quant à elle, plus difficile
à tracer, faute de fouilles systématiques, surtout pour la période qui s’écoule
entre le vicus des époques mérovingienne et carolingienne, dans le
prolongement oriental du castrum, et la cité médiévale qui se développe
au pied de la forteresse, entre le promontoire rocheux et le cours de la
Vienne.
Pour ce qui est du
château, il est avéré que Thibaut le Tricheur, comte de Blois, fait édifier une
tour en pierre dans les années 960, dans l’angle nord-est de l’enceinte
antique, isolée par une muraille propre. Par ailleurs, on relève quelques
indices (silos, probables fonds de cabane) qui dessinent le contour d’un
habitat domanial. On a pu aussi identifier les restes d’un prieuré sur le futur
emplacement du fort du Coudray.
En 1044, à la suite
de la victoire de Geoffroy Martel (1040-1060), comte d’Anjou, aux dépens de
Thibaut III, comte de Blois,
Chinon passe pour un siècle et demi aux mains des comtes d’Anjou (1044-1205) :
Foulques le Réchin (1068-1109), Geoffroy le Bel, le premier à adopter le nom de
Plantagenet (1129-151), Henri II (1169-1183), Richard Cœur de Lion (1189-1199),
Jean Sans Terre. Tout au long de cette période, les comtes d’Anjou étendent
leur pouvoir : Geoffroy Plantagenet, dit le Bel, devient comte du Maine
puis duc de Normandie en 1144 ; Henri II ajoute la couronne d’Angleterre à
la mort de sa mère Mathilde en 1154 et Richard Cœur de Lion gouverne le duché
d’Aquitaine au nom de sa mère, Aliénor, à partir de 1168.

Henri II Plantagenet (peinture
murale de Sainte-Radegonde, XIIe siècle)
Le destin de Chinon
est directement affecté par ces circonstances, parce que sa position
stratégique, face au comté du Poitou et à la Touraine capétienne, qui se
renforce aussi en absorbant le domaine des comtes de Blois et le comté de
Touraine, lui confère un statut de cité frontalière. C’est dans ces termes que
le Poème de Guillaume le Maréchal, composé au début du xiiie siècle, fixe les
bornes de l’empire d’Henri II en 1189, date de sa mort : “De Baione
tresque a Chinon” (“De Bayonne jusqu’à Chinon”). Notre ville et sa forteresse
occupent donc une position stratégique, ce qui leur vaut des soins attentifs de
la part du souverain. Son prestige est à son comble lorsque la légende
arthurienne, qui fit tant pour la renommée des Plantagenets, raconte que Kei,
sénéchal du roi Arthur, s’y fit enterrer et que, pour honorer la mémoire du
grand disparu, le roi ordonna que l’on donnât son nom à la ville (Keinon).
Par voie de
conséquence, les défenses de la forteresse sont renforcées et l’enceinte
reprise dans sa totalité, excepté sur le front nord, qui conserve le rempart du
castrum. Sous le règne d’Henri II, l’ensemble est prolongé vers l’est
par un vaste espace lui aussi fortifié, le Fort Saint-Georges.
Ce renforcement et
cette extension de la forteresse ne se conçoivent pas sans un apport de
population nécessaire à sa défense et à son entretien. Le site du vicus
gallo-romain, trop à l’étroit et trop éloigné de la forteresse et de la
protection de ses murailles, ne pouvait accueillir ces nouveaux habitants. Dès
lors, s’imposait la nécessité d’édifier une ville nouvelle, dont la superficie
d’ensemble et la disposition générale sont visibles aujourd’hui encore. Cette
idée dut germer assez tôt dans l’esprit des comtes, mais nous ne disposons pas
d’une datation documentaire ou archéologique vérifiable. Du moins est-il permis
d’envisager au terme de quel processus ce qui allait devenir la ville-fort fut
constitué.
Pour reconstituer
la disposition de son noyau primitif, on dispose des informations que
fournissent le cadastre bâti et les bâtiments anciens conservés, ainsi que les
limites de la paroisse qui fut créée à l’occasion. Ce premier ensemble est
circonscrit à l’intérieur d’une muraille qui part du pied de la tour du Moulin,
à l’extrémité ouest de la forteresse, rejoint les bords de Vienne, longe la
rivière puis remonte vers l’enceinte au niveau du Grand Carroi actuel. Cet
espace correspond à l’exacte emprise de la paroisse de Saint-Maurice, puisque la
partie de la ville qui se trouve au-delà vers l’est relevait de la paroisse de
Saint-Jacques, dont l’église se trouvait sur la rive gauche de la Vienne.
Le long de la voie
qui, sur toute la longueur de cet espace, emprunte le pied du promontoire, sont
alignés des édifices appuyés, au nord, sur le coteau et ouverts vers le midi, sans
qu’il soit nécessaire de supposer qu’il y eût, dès le départ, une rue avec des
bâtiments se faisant face. À l’exact milieu et en contre-bas de cette ligne, dont
elle séparée par un espace qui est resté vide jusqu’à nos jours, l’église
paroissiale est édifiée sur la pente qui descend vers la Vienne, à une centaine
de mètres de la rive, par conséquent à l’abri de crues éventuelles.
La date de cette
opération urbanistique n’est pas connue, non plus que celle de l’érection de
l’église paroissiale. L’étude de l’architecture de Saint-Maurice, qui aurait pu
fournir une information précieuse sur ce point, ne permet pas, en l’état actuel
de nos connaissances (Claude Andrault-Schmitt…), de remonter au-delà du XIIe
siècle, au plus tôt sous le gouvernement de Geoffroy le Bel.
La tradition veut
que le pont, qui enjambe les deux bras de la Vienne en prenant appui au centre
sur la pointe de l’Île de Tours, ait été construit sous le règne d’Henri II. Il
est vrai que la concorde signée par l’évêque Barthélémy et Richard Cœur
de Lion en 1190, signale ce pont comme point de partage entre les pêcheries
relevant du roi et celles relevant de l’évêque. De même, Guillaume le Maréchal
le mentionne expressément lorsqu’il relate la mort du roi en 1189, les pauvres
étant empêchés de le franchir pour venir demander l’aumône auprès de la
dépouille du roi défunt. Peut-être ne faut-il pas écarter une confusion entre
le pont sur la Vienne et le pont de la Nonnain, étroite passerelle en bois s’appuyant
sur des arcs en pierre qui, sur la rive gauche, permettait de franchir à pied
les marais jusqu’au faubourg Saint-Lazare. Mais, dans ce cas précis, on ne
comprendrait pas que la concorde de 1190 s’y réfère pour diviser le
cours de la rivière entre amont et aval.
La construction
d’un pont sur la Vienne peut, par conséquent, sans trop de risques d’erreur,
être attribuée à Henri II. Autant il est peu vraisemblable de la situer à une
époque où Chinon constituait le point extrême du comté d’Anjou, car il aurait
affaibli les défenses de la place, autant il se justifie dès l’instant où le
Poitou passe sous l’autorité des Plantagenets, après le mariage d’Henri et
Aliénor, car il facilite la communication directe entre deux territoires amis.
La valeur stratégique de ce pont est soulignée par le fait qu’il ne concerne
pas la ville nouvelle mais qu’il la contourne par l’est pour rejoindre
directement la forteresse. Il a donc bien été conçu pour établir une relation directe
entre le château, la cour, ses fonctionnaires et sa garnison et le duché
voisin. On ignore s’il fut d’emblée construit en pierre ou s’il comporta
pendant un certain temps une passerelle en bois.
Sous le règne d’Henri
II, roi d’Angleterre, duc de Normandie, comte du Maine et d’Anjou et duc
consort du Poitou, Chinon joue un rôle important dans l’administration des
possessions continentales de cet immense domaine. Les fouilles menées sur le site
du Fort Saint-Georges ont révélé qu’il y édifia un vaste édifice, dont la
fonction présumée était d’abriter un personnel nombreux, chargé d’administrer ce
vaste territoire.
Vue d’ensemble des fouilles
réalisées au Fort Saint-Georges, où l’on découvre les fondations des importants
bâtiments qui y furent édifiés au XIIe siècle.
L’ampleur de ces
travaux puis les facilités qui en résultent pour un souverain contraint à de
fréquents et lointains déplacements à travers l’immense territoire qu’il
gouverne, conduisent Henri II à se rendre souvent à Chinon et à y séjourner. Par
ailleurs, il y retrouve ses enfants pour y fêter la Noël ou Pâques, comme en 1172,
où ils accomplissent ensemble un pèlerinage à Sainte-Radegonde, dont la belle
peinture murale semble porter témoignage. On comprend mieux, aussi, qu’il y ait
eu dans la forteresse une Tour pour abriter le Trésor royal.
Henri II meurt dans
le château le 6 juillet 1189, après une douloureuse entrevue avec le roi de
France, Philippe-Auguste, au cours de laquelle il apprend de la bouche de son
ennemi que son fils préféré, Jean Sans-Terre, l’a trahi. Le roi n’a sûrement
pas choisi de mourir à ce moment et en ce lieu, mais il semble certain que la
forteresse de Chinon était apte à accueillir un événement de cette importance.
C’est d’ailleurs là que la reine Aliénor se rend, après la mort de son mari,
lorsque son fils Richard Cœur de Lion la fait libérer de la prison anglaise où
elle croupissait. De même, pendant son court règne (1089-1099), Richard y fait
de nombreux séjours et y signe de nombreux documents. Il est possible qu’après
sa blessure mortelle subir à Châlus, sa dépouille ait fait étape à Chinon, sur
le chemin de Fontevraud où Aliénor organisa les funérailles de son fils. C’est,
du moins, ce que prétend une légende locale non vérifiée mais soigneusement
entretenue. Enfin, Jean Sans-Terre y épousa Isabelle d’Angoulême, qu’il venait
d’arracher à son rival Lusignan.
Tous ces faits
cumulés concordent à assigner à Chinon un rôle important à l’époque des souverains
Plantagenets. Il serait sans doute excessif d’en faire une capitale du domaine
continental des rois d’Angleterre, mais on peut affirmer qu’elle fut une
résidence privilégiée de cette dynastie.
Chinon,
cité royale française (XIIIe au XVe siècles)
Le roi de France Philippe
Auguste s’empare de la forteresse après un long siège, en 1205. Chinon est
annexée au royaume de France et n’en sortira plus. Cependant, c’est encore en
ses murs, probablement dans l’enceinte du château, que fut signée en septembre
1214 une trêve de 5 ans entre Philippe-Auguste et Jean-Sans-Terre, qui
entérinait la perte par le roi d’Angleterre du Maine, de l’Anjou et de la
Touraine.
Dans la nouvelle
carte politique du royaume, notre ville n’occupe plus la position privilégiée
qui avait été la sienne sous les Plantagenets, mais les rois de France ne la
négligent pas pour autant. Ils lui accordent le statut de ville royale, qu’elle
conservera jusqu’à la Révolution, même si, à partir de 1633, le cardinal de
Richelieu détournera certains droits et revenus dus à la Couronne au profit de
son duché-pairie. En 1323, lorsque le bailliage de Touraine fut séparé de celui
d’Anjou, il fut doté de deux sièges, l’un à Tours, l’autre à Chinon. Lors de la
création des élections (circonscriptions financières), notre ville fut désignée
chef-lieu au-début du xve
siècle. Ces titres successifs valaient aux villes qui en jouissait un prestige
que n’avaient pas les cités placées sous l’autorité d’un seigneur, civil ou
ecclésiastique. Elle en tirait aussi l’avantage d’abriter dans ses murs une
administration conséquente qui se mettra peu à peu en place :
gouvernement, pour le politique ; tribunal pour le judiciaire ;
divers administrateurs chargés de la perception des impôts directs ou indirects
(gabelle, droits d’octroi sur le commerce fluvial et terrestre) ou de la gestion
du patrimoine (eaux et forêts). Autres effets bénéfiques de cette
reconnaissance officielle : dès sa conquête par Philippe-Auguste, le
système de défense de la forteresse est renforcé par l’érection d’un nouveau
donjon, la tour du Coudray, séparée du reste de la forteresse par de nouvelles
douves.
Développement de la ville-fort
Au cours des deux
siècles suivants (xiiie–xive), la ville-fort se densifie.
L’alignement d’édifices sans vis-à-vis au bas du promontoire se double bientôt d’une
nouvelle ligne d’édifices pour former une rue continue, à l’exception de la
portion qui domine l’église Saint-Maurice. Ainsi, des études de
dendrochronologie menées sur la charpente de l’hôtel Bodard de la Jacopière, sur
le bord sud de la rue Haute, datent son érection au XIVe siècle. Les
constructions finissent par déborder le cadre primitif. La rue Haute se
prolonge vers l’est et dépasse peu à peu le Grand Carroi, qui devient le centre
de l’espace urbain dans son étape finale, à la croisée de la rue Haute et d’une
voie nouvelle qui permet d’accéder du pont au château.
Le
Grand Carroi, la Maison des États-Généraux et la maison Rouge, avant et après
leur restauration dans les années 1960-1970.
La muraille est repoussée
d’autant vers l’est, jusqu’aux limites actuelles de la ville-fort (Place de
l’Hôtel-de-Ville). Une rue basse (actuelle rue du Commerce) est tracée de long
de la nouvelle enceinte, ce que le dessin du noyau primitif n’avait pas permis.
Ce débordement aboutit à des douves situées à l’extrémité ouest de la Place de
l’Hôtel-de-ville.
Le nouvel espace
bâti dut provoquer un déplacement vers l’est de la voie extra-muros qui menait directement
du pont au château, ce qui se traduit, à la fin du XIVe siècle, par l’édification
d’une nouvelle porte d’accès à la forteresse, la Tour de l’horloge, qui
renferme la cloche Marie-Javelle, qui fut fondue en 1399. Les espaces libres en
contre-bas de l’église se comblent peu à peu. Chinon, ville royale, est
désormais en mesure d’accueillir le roi et sa Cour. Philippe-Auguste, saint
Louis, Philippe III y feront plusieurs séjours.
L’entretien de la
forteresse coûte cher au royaume, aussi veille-t-on à l’utiliser à d’autres
fonctions qu’au seul hébergement d’une garnison ou au logement occasionnel des souverains.
Elle sert de lieu de détention pour des prisonniers particulièrement
prestigieux ou dangereux. Les plus célèbres furent les dignitaires de l’Ordre
des Templiers. Depuis la découverte récente (2001) de documents dans les
archives du Vatican, on connaît mieux l’épisode qui s’y est déroulé en août 1308,
et qui n’était connu jusque-là que par une version résumée, rédigée par un
officier royal.
Après l’arrestation
sur son ordre des membres du Temple à travers tout le royaume, le 13 octobre
1307, et les premiers interrogatoires menés par le tribunal de l’Inquisition de
Paris, Philippe le Bel avait accepté, pour calmer l’irritation du pape, Clément
V, fâché d’une initiative qui le privait de ses prérogatives les plus
élémentaires, de faire conduire devant la Curie à Poitiers, à des fins
d’enquête, un groupe de Templiers (soixante-douze), dont aucun dignitaire et
beaucoup d’exclus que le roi avait réintégrés pour l’occasion. Sous prétexte de
ménager leur santé jugée chancelante le roi fit retenir, sur la route de
Poitiers, dans la forteresse de Chinon, les cinq dignitaires arrêtés : le
Grand-Maître, Jacques de Molay : le Précepteur d’Outre-Mer, Jacques
Raymbaud ; le Précepteur de France, Hugues de Pairaud ; le Précepteur
d’Aquitaine et de Poitou, Geoffroi de Gonneville ; le Précepteur de
Normandie, Geoffroi de Charnay. Il espèrait ainsi se donner un prétexte pour
dénoncer la procédure, au cas où le pape déciderait d’absoudre les Templiers
envoyés devant lui, l’absence du Grand-Maître étant susceptible de rendre
discutable toute initiative allant dans ce sens. Le pape décide de contourner
la manœuvre en envoyant sur place, à Chinon, trois cardinaux chargés
d’interroger secrètement les prisonniers. Au terme des interrogatoires, qui se
déroulent du 17 au 20 août 1308, les accusés reçoivent l’absolution de leurs
péchés et sont réintégrés dans le sein de l’Église. Devant cette résistance du
pape, le roi décide de ramener les dignitaires à Paris, où ils seront brûlés,
plusieurs années plus tard, le 18 mars 1314.
Sous le règne d’un
des fils de Philippe le Bel, Philippe le Long, le royaume connaît un des
épisodes les plus sinistres de son histoire. Le roi et ses conseillers décident
de renflouer les caisses en faisant un procès à deux groupes relativement
fortunés mais sans défense : les lépreux et les Juifs. On invente un
complot ourdi par les rois musulmans de Grenade et de Tunis pour anéantir les
chrétiens avec la complicité des deux communautés et on en propage la rumeur à
travers le royaume. Une épidémie survient en 1321 qui semble corroborer cette
thèse, en faisant croire que ces ennemis ont empoisonné les puits. Alors sont
perpétrés dans tout le royaume des massacres qui ne prennent fin que lorsque le
roi, ayant obtenu le gain espéré, décide de mettre un terme aux troubles qu’il
a lui-même fomentés. Les lépreux, dont les asiles, les biens et les troupeaux
ont été anéantis, sont abandonnés à eux-mêmes. Les Juifs sont expulsés du
royaume après avoir dû acquitter de fortes amendes. Ceux de Touraine ne furent
pas épargnés, et nombre d’entre eux furent brûlés. Une phrase ajoutée par un
continuateur anonyme à la Chronique royale de Nangis, affirme que 160 Juifs
furent brûlés dans une fosse à Chinon. Ce bref récit, qui évoque plus le
sacrifice volontaire des martyrs des premiers siècles du christianisme
(« beaucoup d’entre eux et d’entre elles, comme invités à des noces,
sautaient en chantant dans la fosse ») que la scène finale d’un pogrom,
est le seul témoignage sur lequel se fonde cette tradition. Il y eut certainement
une communauté juive à Chinon, ville royale ; elle eut sûrement à subir des
persécutions, car il y a tout lieu de penser que les Chinonais d’alors
n’étaient pas moins sensibles à la propagande officielle contre les lépreux et
les Juifs que les autres sujets du royaume. Cependant, rien ne permet
d’affirmer que ces persécutions furent telles que les rapporte le continuateur
anonyme. Toute autre affirmation est pure hypothèse.
Chinon se distingue
donc, pendant les xiiie
et xive siècles, par
les fonctions stratégiques et guerrières dévolues à sa forteresse. En tant que
ville royale, elle est aussi concernée par les péripéties souvent sanglantes
qui sont le triste lot du temps. Nous ignorons à quel point elle fut affectée
par la Peste Noire qui, à partir de 1348, sévit tragiquement en France comme en
beaucoup d’autres royaumes. En revanche, la première phase de la Guerre de Cent
Ans semble l’avoir épargnée, malgré la proximité du champ de bataille de
Poitiers (1356).
Au-delà de la ville-fort
L’évêque de Tours détenait
de nombreuses parcelles sur le territoire de Chinon et dans ses environs
immédiats. Il possédait aussi en commun avec le seigneur de la ville, – qu’il
s’agisse du comte d’Anjou, du roi d’Angleterre, puis du roi de France – la
« haute et basse forêt », les eaux et les îles et donc les pêcheries,
communément appelées « écluses » ; celles qui étaient en amont
du pont lui appartenaient en totalité (concordia du 28 mars 1190).
L’administration de ces biens impliquaient la présence d’un personnel qualifié
et d’équipements permanents. Aux fins d’entreposer les redevances en nature, une
grange à dîmes fut édifiée non loin de la rivière sur laquelle s’effectuaient
les transports de denrées, face à l’île de Tours qui, comme son nom l’indique,
relevait de l’autorité de l’évêque. Les officiers chargés de les percevoir
occupaient un hôtel tout proche (4, place Jeanne d’Arc). Entre la grange et
l’hôtel fut aménagée une place, dite de la Parerie (actuelle Place Mirabeau),
dont l’étymologie évoque la répartition à parité entre l’Église et le roi du
produit des transactions qui s’y effectuaient.
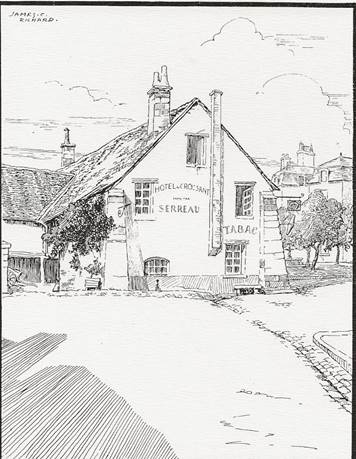
Ancienne grange à dîmes
dessinée par James Richard dans l’état où elle était jusqu’en 1920.
Au nord de la
place, un couvent augustin, contigu à l’hôtel de l’évêché, est fondé par une
bulle du pape Jean XXII en date de novembre 1334 et sa construction, contrariée
par la Peste Noire et le début de la Guerre de Cent Ans (défaite du roi Jean II
à Poitiers en 1356), ne débute qu’en 1359 et ne sera véritablement achevée
qu’en 1445, date de la consécration de son église. Ces trois fondations, plus
la Maison de la Charité et l’église Saint-Etienne, qui les prolongent au nord,
donnent à ce faubourg de la ville un caractère éminemment religieux, qui
s’accentuera encore lorsqu’il aura fait la jonction avec la collégiale de
Saint-Mexme et son cloître, c’est-à-dire les différentes demeures occupées par
ces chanoines qui n’étaient pas tenus à une vie commune en dehors des offices.
Pendant la seconde
moitié du XVe siècle, au cours duquel le royaume n’eut plus à subir
la présence de troupes ennemies, la ville de Chinon, tirant parti de ces
conditions favorables, ne cessa de s’étendre vers l’est et la collégiale
Saint-Mexme. Parmi les constructions les plus remarquables, il faut signaler les
halles (emplacement de l’actuel l’Hôtel-de-ville), l’hôtel-Dieu et son
cimetière (parking de la Brèche et place du théâtre, aujourd’hui, Place
Hoffheim).

Hôtel-Dieu devenu théâtre
municipal par James Richard (1966)
Ce bâtiment, propriété des
Augustines, a servi d’hôpital jusqu’à la Révolution.
Par ailleurs, se
développe une activité artisanale, dont des teintureries qui tirent parti de la
présence abondante de l’eau, dans les cours intérieures, en retrait des façades
sur rue (rue Jean-Jacques Rousseau). Ce faubourg, qui semble ne pas suivre un
plan préalablement établi, à en juger par les ruelles tortueuses qu’elle
conserve encore, contraste avec le quartier Saint-Etienne au plan rigoureux.
Chinon,
résidence royale (XVe
siècle)
En 1413, le Duc d’Anjou conclut
avec le roi Charles VI et la reine Isabeau de Bavière un accord de mariage
entre sa fille Marie et le troisième fils du couple royal, Charles, comte de
Ponthieu. La mère de Marie, Yolande d’Aragon, se charge d’élever le jeune
prince en Anjou, auprès de sa fille. En 1415 et 1417 respectivement, les deux
frères aînés du jeune Charles, le Dauphin Louis et son cadet Jean, meurent sans
descendance. A l’âge de 14 ans, le prince se retrouve donc héritier du trône.
Lorsque les Bourguignons se rendent maîtres de Paris (29 mai 1418), le nouveau Dauphin
s’enfuit de la capitale et s’installe de façon permanente en Touraine (Tours, Amboise,
Chinon et Loches) et Berry (Bourges et Mehun-sur-Yèvre). C’est de cette
position de repli qu’il va gouverner la partie du territoire qui continue à lui
prêter obéissance.
La reine de France
reçoit à titre de douaire le duché de Touraine. Le château et la châtellenie de
Chinon en fera toujours partie, excepté pendant une courte période entre 1425
et 1428. Pour cette raison et aussi à cause de la proximité de la ville avec
son Anjou natal, Marie fera de la forteresse une de ses résidences de
prédilection. Elle y fera réaliser des aménagements pour son confort et y
mettra au monde plusieurs de ses enfants, dont le dernier, Charles (1446).

Marie d’Anjou, épouse de
Charles VII, reine de France
En 1428, le Dauphin
parvient à reprendre Chinon, que s’était approprié la duchesse de Guyenne,
fille du duc de Bourgogne, et y installe la Cour. Cette année-là, il y réunit
les États de langue d’oc et de langue d’oil qui lui accordèrent des subsides
substantiels, de 500.000 et 400.000 livres tournois respectivement, mais qui
exigèrent l’abandon de la politique de dévaluation de la monnaie qui avait
prévalu jusque-là. La ville était directement concernée par ces mesures
financières, étant donné que, de 1418 à 1442, elle posséda un atelier de frappe
de monnaie, qui produisait, en particulier, les célèbres florettes.
Au mois de mars
1429, elle fut le théâtre d’un épisode célèbre de l’histoire de France. Une
jeune fille originaire des confins de la Champagne et de la Lorraine, prénommée
Jeanne et qui se fait appeler La Pucelle, se rend sur les bords de la Vienne avec
une petite escorte pour solliciter une entrevue avec le Dauphin. Se prévalant
de révélations qui lui auraient été faites miraculeusement, elle parvient à le
persuader de se faire sacrer roi à Reims et de lever une armée pour délivrer
Orléans. La rencontre entre Jeanne d’Arc et le Dauphin eut lieu dans le logis
royal du château de Chinon. Jeanne séjourna dans la ville le temps nécessaire au
déroulement de l’enquête dont elle fut l’objet. Elle y gagna de solides
appuis : Yolande d’Aragon, le duc d’Alençon. Puis, elle prit la tête de
l’armée chargée de libérer Orléans, assiégée par les troupes anglaises et
bourguignonnes. C’est donc à Chinon que débuta la courte mais glorieuse
destinée de Jeanne d’Arc ; en même temps s’écrivait une page glorieuse de
l’histoire de la ville, dont le nom devint familier à tous les Français.
En 1433, toujours
au château de Chinon, la reine Marie participe au complot ourdi par sa mère Yolande
d’Aragon en vue d’expulser du Conseil du roi l’encombrant La Trémoille. Ce coup
de force permet à la maison d’Anjou de recouvrer son influence à la Cour.
L’année 1444 marque
le début du « règne » d’Agnès Sorel, première maîtresse officielle
d’un roi de France. Elle est omniprésente, le roi ne pouvant supporter d’être
éloigné d’elle. Elle intervient dans la distribution des places et des rentes,
le plus souvent à son profit ou à ceux de ses parents et familiers. Elle se
fait offrir de luxueuses parures, car c’est elle qui dicte la mode. La reine
demeurant au château, le roi installe sa maîtresse en contre-bas, dans le
manoir du Roberdeau, dans lequel il pouvait se rendre par un souterrain dont on
devine encore l’entrée au pied de la Tour d’Argenton. Mais les murs de la
forteresse devaient paraître trop austères aux deux amants, aussi
préféraient-ils séjourner chez les seigneurs de Razilly, dans le Véron, à une
lieue de Chinon, pour y organiser leurs fêtes. Le Pas du rocher périlleux
ou Emprise du dragon y eut lieu, en juin 1446, en présence de la fine
fleur de la chevalerie française : le roi René d’Anjou, le comte d’Eu, le
comte de Foix, le duc d’Alençon, le comte de Tancarville, le comte de Nevers,
le comte du Maine, le comte de Clermont, le comte d’Angoulême, etc. Agnès mourut
très jeune et son « règne » ne dura que cinq années mais, grâce à
elle, la Cour connut une période particulièrement fastueuse malgré l’état de
guerre permanent que connaissait le royaume.
La Guerre de Cent
Ans achevée (1453), Charles abandonne Chinon pour Paris et les châteaux du
Berry pour lesquels il a une prédilection. Ses successeurs immédiats, Louis XI
et Charles VIII, investissent d’autres lieux du Val de Loire (le Plessis à Montils-lès-Tours,
Amboise, Loches) mais ne manquent pas de séjourner aux bords de la Vienne lorsque
l’occasion se présente. Ce retrait de la Cour n’a pourtant pas d’incidence
négative sur le développement de la ville ; celle-ci bénéficie encore de
l’élan de la paix retrouvée et voit se multiplier les belles demeures de
pierre, qui rivalisent désormais avec les maisons à pans de bois.
Le siècle s’achève
en apothéose pour Chinon. Le 18 décembre 1498, le roi Louis XII y reçoit César
Borgia, fils du pape Alexandre VI, qui vient lui remettre en mains propres
l’annulation de son premier mariage afin de lui permettre d’épouser Anne,
duchesse de Bretagne, veuve de son prédécesseur, Charles VIII.
Chinon aux Temps Modernes (XVIe-XVIIIe
siècles)
François Rabelais
En 1484 ou 1494 (le doute subsiste),
l’épouse d’un avocat du siège royal met au monde un enfant de sexe mâle, dans
la maison de campagne qu’il possède dans le village de Seuilly, sur l’autre
rive de la Vienne. Le fait est trop banal pour mériter qu’on s’y attarde. Mais
il se trouve que la sécheresse sévit cruellement cette année-là, et que, faute
d’eau, les hommes furent contraints de ne boire que du vin. On ignore si les
enfants aussi furent réduits à cette extrémité. Toujours est-il que ce concours
de circonstances extraordinaire donna naissance à un des plus grands génies de
son temps, dont le nom et l’œuvre sont universellement connus et admirés.
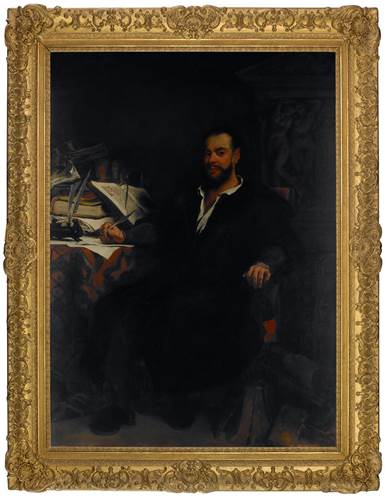
Portrait de Rabelais par Eugène
Delacroix, conservé au Musée de Chinon
François Rabelais
ne s’est pas contenté de naître à La Devinière d’un père et d’une mère chinonais.
Il a non seulement, à la façon des clercs de l’époque, mentionné ses origines
géographiques, comme en témoigne l’ex-libris f. francisci Ralelaisi
Chinonensis (« frère François Rabelais chinonais »), que l’on
peut lire dans les volumes de sa bibliothèque, mais il a initié ses lecteurs
aux subtilités de ce terroir. Quel meilleur guide, en effet, que ses écrits
pour découvrir notre région, se familiariser avec les mœurs de ses
habitants ? Qui, parmi les lecteurs de maître François, ne connaît les
Caves Peintes à Chinon, le théâtre de la Guerre picrocholine (Lerné, Seuilly,
La Roche-Clermault), la grotte de la Sibylle à Panzoult ou le site présumé de
l’abbaye de Thélème, du côté de Rigny ? Mais, au-delà de cet aspect, plutôt
anecdotique, Rabelais a eu le génie de transformer sa ville natale et sa
contrée en un personnage littéraire et mythique, comme la littérature
arthurienne l’avait fait avec la forêt de Brocéliande ou l’Ile d’Avalon, et
comme le fera (à son imitation ?) Miguel de Cervantès, avec la Manche
castillane. Grâce à lui, Chinon et sa contrée ont acquis une renommée
universelle.
Un chef-lieu administratif et économique
Mérite-t-elle un tel
honneur ? Disons qu’elle ne démérite pas et qu’elle assume dignement son
statut de ville royale ainsi que le rôle qu’elle ne cessa d’exercer, du XIIIe au XVIIIe siècles, comme capitale administrative d’un territoire
considérable.
En effet, jusqu’à
la Révolution, qui, en unifiant l’administration à tout le pays, supprima de
nombreuses institutions en même temps que les privilèges et la vénalité des
charges, Chinon fut le siège de nombreux corps d’officiers. En 1544, le
bailliage de Chinon devient autonome, après le démembrement de celui de Tours
et la ville chef-lieu d’une circonscription qui regroupe une centaine de
paroisses. Il est placé sous l’autorité d’un lieutenant et dispose de ses
propres locaux. Le corps de ville est constitué par un maire et trois échevins.
Leur principale mission est le maintien de l’ordre, mais ses prérogatives
concernent aussi l’organisation de l’enseignement ; ainsi, le roi François
II l’autorise, en 1578, à acquérir une maison située au-dessus du carroi
Saint-Etienne pour y établir un Collège royal, institution qui retire la
mission d’enseignement aux autorités ecclésiastiques pour la confier au pouvoir
civil et qui perdurera jusqu’aux réformes de la Troisième République.
L’exercice de la
justice mobilisait un personnel nombreux : lieutenant du bailliage, avocat
du roi, procureur du roi, juge des affaires civiles et criminelles, juges des
affaires spéciales, conseillers, greffiers, huissiers, procureurs notaires du roi,
avocats. La justice fiscale relevait de l’élection ou circonscriptrion
financière. Il y en avait six en Touraine et celle de Chinon couvrait un vaste
territoire, de Thilouze et Saché à Langeais et Cinq-Mars, en passant par
Sainte-Maure, Azay et La Haye. Elle était chargée de fixer l’impôt et de régler
les litiges. Enfin, la Touraine étant pays de grande gabelle, Chinon était
dotée d’un grenier à sel, dont la tâche première était de faire respecter une
réglementation d’autant plus contraignante que le Poitou voisin en était
dispensé et que les fraueurs étaient nombreux.
Le château était le
siège de la juridiction militaire, qui y entretenait une garnison et aussi la
prison. Par ailleurs, l’administration des Eaux et forêts veillait à
l’entretien et à l’exploitation de la forêt domaniale et des nombreux cours
d’eau navigables. Enfin, la jurisdiction ecclésiastique était confiée à un
prêtre dépendant de l’arcevêché. Par ailleurs, chacune des cinq paroisses intra
muros, Saint-Maurice, Saint-Jacques, Saint-Etienne, Saint-Mexme et
Saint-Martin, ainsi que les deux paroisses extérieures, Saint-Louans et
Notre-Dame de Parilly, avait son propre personnel ecclésiastique et autres,
placé sous l’autorité du chefcier de Saint-Mexme. Quant au clergé régulier, il
se composait de trois ordres masculins, Augustins, Franciscains et Capucins, et
de cinq maisons féminines, Calvairiennes, qui auront la charge de l’hôpital de
Saint-Michel (début du XVIIe siècle), Ursulines, Sœurs hospitalières
de saint Augustin, Dames de l’union chrétienne et Sœurs de la Charité.
La présence d’un
personnel administratif aussi nombreux, la circulation pécuniaire et la
création d’emplois qu’elle entraînait assuraient à ses habitants un niveau de
vie que les habitants des autres villes ou villages dépendant de sa juridiction
devaient leur envier. Un témoignage de cette vitalité économique est fourni par
les nombreuses cales dans lesquelles ont débarquait les denrées circulant sur
la rivière, ainsi que la tenue d’un marché hebdomadaire et de deux foires
annuelles, en avril et en octobre, qui furent instaurées au XIIIe
siècle.
Au temps de guerres de religion
La ville aurait pu être fortement
impliquée dans les Guerres de Religion, la forteresse présentant un intérêt
stratégique de première importance pour les deux partis Pendant ces guerres, Chinon
connut des concentrations de troupes catholiques et servit de prison au
cardinal de Bourbon, après l’assassinat du duc de Guise sur l’ordre du roi
Henri III. Malgré la proximité de places protestantes comme Loudun et Saumur,
les Chinonais surent, cependant, rester en marge du conflit, ce qui n’était pas
un mince exploit à une époque où chacun était tenu de se prononcer pour l’un
des deux partis. Les Réformés avaient plus à craindre des agents du pouvoir
royal que des catholiques chinonais, même s’ils eurent à subir quelques
tracasseries. Chinon ne connut qu’un épisode difficile, en 1562, lorsque, comme
plusieurs autres villes – Angers, Tours,
Châtellerault, Saumur et Loudun -, elle fut
prise par les Réformés qui, mettant à profit le fait que les garnisons aient
abandonné momentanément leur poste, entendaient riposter au massacre de Wassy,
perpétré par Henri de Guise. Ils occupèrent la ville du
24 mai au 11 juillet, en l’absence de son gouverneur, Tiercelin de la Roche
du Maine, qui reprit la place, peu après, « à la veue d’une seule
compagnie de gens d’armes » (Agrippa d’Aubigné, Mémoires), ce qui
atteste du courage du marquis mais aussi de la faiblesse des Réformés, qui
n’avaient réussi à s’emparer de la ville que par surprise.
En 1565, soit trois
années après cet épisode, la reine Catherine de Médicis, ses enfants et la
Cour, à l’occasion du célèbre voyage qu’ils réalisèrent à travers le royaume,
firent étape en septembre à Marçay et à Lerné (au château de Chauvigny), puis,
en novembre, à Bourgueil, Langeais et Amboise, mais pas à Chinon, comme s’ils
avaient voulu éviter de le faire. Faut-il y voir une conséquence de l’épisode
précédent ? Probablement plutôt, durent-ils se rendre à l’évidence qu’une
pareille expédition serait dans l’impossibilité de pénétrer dans la ville.
Faire emprunter, en venant de Loudun, le Pont à Nonnain à des carrosses, à de
lourds chariots, à une foule de gens à cheval n’était pas envisageable. Il
apparut plus commode de contourner aussi la rivière de Vienne par le nord,
quitte à emprunter dès que possible la rive droite de la Loire de Nantes à
Tours. Cet épisode témoigne assez bien de l’isolement dans lequel la
topographie allait condamner la ville de Chinon jusqu’à ce que la muraille qui
longeait la Vienne soit abattue et remplacée par les quais, dans la première
moitié du XIXe siècle.
La communauté
huguenote de la ville choisit de se dissoudre en 1565, ses membres préférant se
rattacher au Temple de L’Ile-Bouchard, placé sous la protection des La
Trémoille. Ils obtinrent, cependant, des autorités municipales, l’autorisation
de fonder un cimetière dans la paroisse de Saint-Etienne, et, selon toutes les
apparences, ne subirent pas de persécutions systématiques. Il n’y aura pas de
massacres lors de la Saint-Barthélemy (1572).
L’ambition de
Richelieu, ministre tout-puissant du roi Louis XIII, va modifier le destin de
la ville en la retirant en partie à l’autorité royale. L’édification, dans
l’ancien fief familial, d’un immense château et d’une cité attenante (actuelle
ville de Richelieu) ayant vocation à accueillir l’administration du royaume
conduit le cardinal à s’intéresser de près à Chinon. Il parvient à se faire
remettre certains droits qui s’apparentent à une seigneurie sur la ville :
droit d’exercer la justice ; possession du château ; droits
honorifiques. La couronne se réserve, cependant, quelques charges et répond
positivement à certaines requêtes du corps de ville et des officiers de
justice, soucieux de préserver certaines prérogatives du statut ancien. Cet
état de fait perdurera jusqu’à la Révolution.
Tandis que l’insatiable
cardinal cherchait à augmenter encore sa fortune, notre bonne ville donnait
naissance à un personnage attachant, malheureusement oublié. Claude Quillet est
l’auteur d’un immortel chef-d’œuvre, la Callipédie ou la manière d’avoir de
beaux enfants, long poème en vers latins, dans lequel il prétend démontrer
« par quels moyens on se fait des héritiers d’une figure aimable ».
Malheureusement notre bon Quillet était contrefait, ce qui inspira à une dame
peu charitable ce mot cruel : « Quel dommage que sa mère n’ait pas lu
son traité avant de le mettre au monde ! ». Alfred de Vigny, dans son
roman historique Cinq-Mars, en fait le gouverneur du héros et le
farouche ennemi du despotique cardinal.
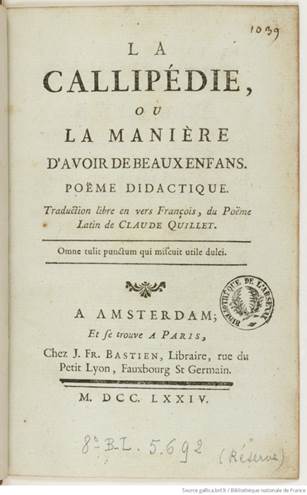
Page de titre de la Callipégie
de Claude Quillet,
Dans le domaine des
arts, Chinon a eu quelques illustres enfants. Le musicien Pierre Tabart
(1645-1716), maître de chapelle à la cathédrale de Meaux, a laissé plusieurs
pièces de musique religieuse, dont le Requiem qui fut chanté lors des
funérailles de Bossuet. Le plus célèbre de tous fut un mécène, Alexandre Le
Riche de la Pouplinière (1693-1762), fils d’un receveur du grenier à sel de
Chinon. Dans ses hôtels de Paris puis de Neuilly, ce fermier général accueillit
et protégea des écrivains et artistes de renom, tels Voltaire, Jean-Jacques
Rousseau, Quentin de La Tour et Van Loo. Grand amateur de musique, il
entretenait un orchestre et soutint activement Jean-Philippe Rameau, au point
de le loger dans son propre hôtel, ainsi que François-Joseph Gossec.
Chinon
pendant la Révolution
La Révolution fut favorablement
accueillie à Chinon. C’est alors une ville de quelque 5.500 habitants dont la
population entend profiter de la réforme politique et administrative en cours et
se défaire de l’autorité des ducs de Richelieu. Cette volonté, trop longtemps contrainte,
donne lieu au début à de nombreuses émeutes que les autorités ne peuvent
réprimer. Pendant toute la durée de la Révolution, la ville partage les grands
élans révolutionnaires, s’associant aux événements symboliques
principaux : fêtes révolutionnaires ; création de sociétés
populaires. Les Chinonais adoptent pendant ces années un républicanisme sincère
mais modéré et se montrent soucieux de ne pas créer de fossé entre les divers
partis, idéologie et comportement qui ne se sont jamais démentis au cours de sa
longue histoire. Ce trait de caractère les conduisit à quelques regrettables
compromissions ; ainsi ne surent-ils pas éviter le sort tragique que
connut un convoi de suspects saumurois, lesquels furent massacrés par leurs
gardiens sur le territoire de la commune.
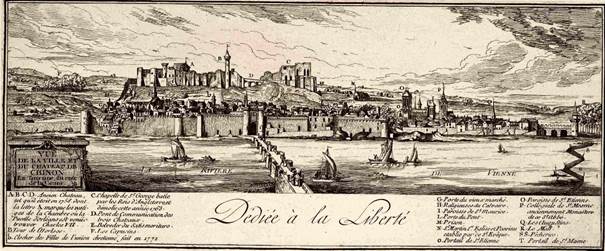
Gravure de Chinon réalisée en
1772, dans une reproduction de 1792.
Le graveur n’a pas représenté
l’île de Tours, en amont du pont.
Au moment le plus
fort de la Guerre de Vendée, Chinon constituait la base républicaine avancée
face aux troupes monarchistes. C’est pourquoi le conventionnel Tallien s’y
installa. L’armée dite « de Chinon » compta jusqu’à 15000 soldats,
placés sous le commandement d’un général de trente ans, Gabriel Venance Rey. Le
19 mai 1793, cette armée rejoignit le Maine-et-Loire et laissa la ville sans
défenses. Aussi, le 12 juin, après la chute de Saumur, Chinon fut investie par
une troupe de combattants vendéens mal vêtus et mal équipés. Les envahisseurs
se retirèrent, vingt-quatre heures plus tard, sans commettre la moindre
exaction, mais en emportant toutes les armes et provisions qu’ils purent
trouver ou extorquer aux autorités et aux habitants. Leur chef profita de cette
incursion pour se rendre chez sa cousine, comtesse de La Mothe-Baracé, au
château du Coudray-Montpensier à Seuilly.
Pendant la Terreur,
les tribunaux de Paris et d’Angers condamnèrent à mort et firent exécuter huit
Chinonais, dont l’avocat Poirier de Beauvais. Dans la ville-même, il n’y eut
qu’une seule exécution, celle d’un soldat volontaire appelé Jacques Payelle,
accusé d’avoir crié « Vive le Roi ! A bas la
République ! ».
Époque
contemporaine (XIXe-XX siècles)
Pendant tout le xixe siècle, Chinon,
paisible chef-lieu d’un arrondissement rural, semble vivre en marge de
l’histoire. La ville n’a pas connu de grands événements mais elle ne manque pas
pour autant de dynamisme, si l’on en juge par les transformations considérables
qu’elle a connues. La destruction des murailles médiévales a permis la création
des quais, qui dévient la circulation hors de la ville-fort et offrent un
espace pour de nouvelles habitations ouvertes au midi. Une ancienne prairie,
sur laquelle Jeanne d’Arc se serait entraînée à la joute avec le duc d’Alençon,
a été transformée en mail, puis en jardin, enfin en champ de foire (Place
Jeanne d’Arc).
Place Jeanne d’Arc, avec la
statue de la Pucelle, la gendarmerie et la prison ; en arrière-plan, la
gare et le pont Eiffel du chemin de fer qui desservait trois destinations sur
la rive gauche de la Vienne (Les Sables d’Olonne, Richelieu et Nouâtre).
Le long de cette
place est édifiée une caserne de gendarmerie dotée d’une prison, avec, non loin
de là, aussi la maison-close, équipement inévitable dans toute ville de quelque
importance. Au bout de l’avenue, la gare du chemin de fer est inaugurée en
1875. Enfin, sont érigées deux statues monumentales, celle de Rabelais (1882)
et celle de Jeanne d’Arc (1893). Moins visible mais tout aussi essentiel est le
traitement du bâti ancien : élargissement de la rue Rabelais, alignements
des façades et, surtout, protection des édifices les plus remarquables,
auxquels de bonnes âmes, au nom de la modernité, auraient bien aimé faire subir
le sort du château et du Fort Saint-Georges qui, eux, restèrent, pendant toute
cette période, à l’état de ruines.
La proclamation de
la Troisième République ne laissa pas les Chinonais indifférents et réveilla
les passions. Ils renouèrent avec le débat politique, confisqué sous le Second
Empire, et les républicains finissent par l’emporter sur les monarchistes. Il
reste certains signes de ces débats. Ainsi, « le baptême laïque auquel la
pauvre ville a dû se prêter », dont se plaint René Boylesve (Le Jardin
de la France), a multiplié les noms de rue à consonance
révolutionnaire : les trois tronçons de la Rue Haute célèbrent successivement
Voltaire, Rousseau et Diderot ; Hoche et Marceau montent parallèlement
vers Saint-Mexme ; la Parerie est devenue Place Mirabeau ; la rue Beaurepaire,
du nom du vaillant défenseur de Verdun (1792), longe au sud la nef de l’église Saint-Maurice ;
le quai Danton fait face à la ville sur la rive gauche. De même, il y eut débat
pour savoir qui de Rabelais ou de Jeanne d’Arc serait honoré le premier par une
statue. Le « grand satirique du XVIe siècle » fut choisi
contre l’avis des tenants de Jeanne et, comble d’ironie, l’inauguration de la
statue de cette dernière, célébrée par les autorités républicaines, sera boudée
par le député local monarchiste et par ses partisans.
Les années cinquante
et soixante du XXe siècle marquent un tournant décisif dont les
effets sont encore perceptibles aujourd’hui.
Les Américains
installent en 1951 aux portes de la ville, dans la forêt de Saint-Benoît-la-Forêt,
un camp militaire (Chinon Engineer Depot) couplé à un vaste hôpital
chargé de soigner les soldats en garnison dans toute l’Europe. Cette initiative
bouleverse les habitudes locales. Elle crée un millier d’emplois, ce que la
population apprécie.
Hôpital américain, sur la
commune de Saint-Benoît-la-Forêt, site sur lequel ont été édifiés l’actuel
hôpital de Chinon et la clinique Jeanne d’Arc.
Mais l’implantation
du jour au lendemain de 1500 officiers et soldats américains introduit
brutalement un corps étranger dans un organisme qui n’y était pas préparé. On
s’offusque de la façon dont on traite la forêt, à coup de bulldozers, pour y
construire le camp, ses bâtiments, ses allées pavées ; on déplore quelques
incendies que ces aménagements menés à la hussarde ont provoqués. Ce n’était
pas une armée en guerre, ni non plus une armée en goguette ; cependant, un
personnel bien payé et formé très majoritairement d’hommes célibataires fait
nécessairement naître quelques préventions contre lui. Certains chinonais
gardent encore le souvenir de ces cafés du centre-ville qui étaient réservés
aux consommateurs yankees, surtout les jours de solde (pay day), des
tournées de la Military Police, crainte autant par la jeunesse locale
que par les soldats américains. Ils voyaient, en outre, d’un mauvais œil
certaines de leurs jeunes concitoyennes céder au charme de ces nouveaux venus,
au point de les épouser et d’aller fonder une famille outre-Atlantique. Mais la
jeunesse chinonaise de l’époque se souvient aussi avec nostalgie des cigarettes
et des disques de jazz qu’elle parvenait à se procurer, plus ou moins
légalement, à la cantine du camp, le fameux PX. Les militaires
américains occupent le camp jusqu’en février 1967, lorsque le général De Gaulle
décide de retirer la France de l’OTAN. Avant d’abandonner les lieux, ils
détruisent l’essentiel des bâtiments qu’ils avaient construits, à l’exception
de ceux de l’hôpital militaire. C’est dans ses locaux que l’hôpital de Chinon,
jusqu’alors situé dans le couvent Saint-Michel, fut transféré après sa
destruction partielle par un incendie en avril 1980.
Le principe d’un
centre de production d’électricité est arrêté en 1954 et le site d’Avoine, à 7
kms de Chinon sur la rive gauche de la Loire, retenu en 1955.
Aux bords de la Loire, les
trois premiers réacteurs de la Centrale nucléaire d’Avoine dans les années
1980.
En arrière-plan, « la
Boule », qui cesse de produire de l’électricité en 1973.
La centrale
commence à fonctionner en 1963. Dans un premier temps, cette initiative est
accueillie favorablement, au point que certains viticulteurs n’hésitent pas à
reproduire son image sur leurs étiquettes. Ce centre d’abord expérimental (la
fameuse orange) est devenu peu à peu, au fils des tranches successives, un lieu
de production permanent et emploie directement 1350 personnes. La réflexion
écologique aidant, l’opinion des populations a évolué et cherche à concilier,
selon un principe de prudence bien chinonais, la prise en considération d’un impact
économique bénéfique, l’inquiétude latente devant certains effets supposés sur
l’environnement et la santé, et le refus d’une certaine opacité dans le
fonctionnement d’une énorme machine qui échappe aux non-spécialistes.
Chinon est une des premières
villes de France à avoir bénéficié des dispositions de la loi Malraux sur les
secteurs sauvegardés (4 août 1962). Les premiers travaux ont porté sur le Grand
Carroi. Depuis, beaucoup de bâtiments anciens ont été restaurés par leurs
propriétaires. L’image que présente la ville aujourd’hui est largement
tributaire de ce phénomène.
Conclusion
Au 88 de la Rue
Haute, est né et a vécu un des plus illustres chinonais, Eugène Pépin
(1887-1988). Ce fils de commissaire-priseur fit des études de Droit et soutint
en 1911 une Thèse sur Les basse et haute foreszt de Chinon, qui fait
encore autorité. Pendant la Première Guerre Mondiale, il expérimenta le procédé
de photographie aérienne, mis au point par le Professeur Poivillier, qui
contribua à révéler à l’Etat-major allié les mouvements des troupes allemandes,
ce qui entraîna la riposte des Taxis de la Marne. On a conservé une photo de
lui, prise en 1919 dans la Galerie des Glaces lors de la signature du Traité de
Versailles, alors qu’il présente un document à la signature d’un
plénipotentiaire français. Démobilisé, il se spécialisa dans le Droit aérien mais
vivra assez longtemps pour s’intéresser aussi de près au Droit spatial, ce qui
fit de lui le Directeur de l’Institut international de droit aérien et spatial
de l’Université de Mac Gill, au Canada, avant d’être le Président de l’Institut
International de Droit de l’Espace. Cet homme, d’une longévité certes
exceptionnelle, était donc passé de l’ère de la traction hippomobile à celle
des fusées, et avait su s’adapter à chaque innovation. Lorsqu’il se rendait de
Chinon au siège des instances internationales dont il était membre, il traversait
à pied sa ville natale médiévale, prenait une micheline à la gare de Chinon, un
train moderne pour aller de Tours à Paris, puis l’avion pour se rendre au bout
du monde.
Cette vie
extraordinaire tend à prouver qu’à Chinon, le temps ne s’écoule pas comme
ailleurs. Ici, l’hier côtoie l’aujourd’hui et lui donne du sens. Où que l’on
aille, le regard du visiteur rencontre un objet hérité d’un passé parfois
lointain, qui le met à l’abri de manifestations d’une modernité agressive. Rien
de plus salutaire qu’une cure de Chinon pour prendre la mesure exacte du monde
et ne pas se lancer dans un avenir incertain sans s’être assuré de solides
arrières.
Bibliographie succincte
– Andrault-Schmitt,
Claude, « Chinon, église Saint-Maurice », Société française
d’archéologie, Congrès archéologique de France, 155e session, 1997,
Touraine, p. 281-299.
– Carré de
Busserolle, J.-X., Dictionnaire géographique, historique et biographique
d’Indre-et-Loire et de l’ancienne province de Touraine, Tours, 1878.
– Cougny, Gustave de,
Chinon et ses environs, Tours, Imprimerie A. Mame et fils, 1898.
– Dufaÿ, Bruno, La
forteresse et la ville, projet collectif de recherche, sous la direction
de…, Rapports d’activité correspondant à l’autorisation PCR 07/0224. Tours,
Conseil Général d’Indre-et-Loire, Service de l’Archéologie du Département
d’Indre-et-Loire.
– Izarra, François
de, La Vienne à Chinon de 1760 à nos jours. Évolution d’un paysage fluvial.
Combleux, Éditions Loire et terroirs, 2007.
– Pépin, Eugène, Histoire
de Touraine, Paris, Ancienne librairie Furne Boivin & Cie éditeurs,
1935.
– Richault, Gabriel, Histoire
de Chinon, Paris, Éd. Jouve, 1926 [reproduction fac-similé de l’Office
d’édition du livre d’histoire, Paris, 1997, avec une préface de M. Garcia].