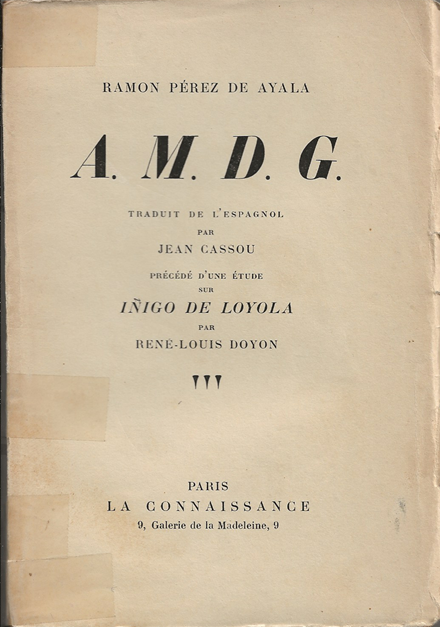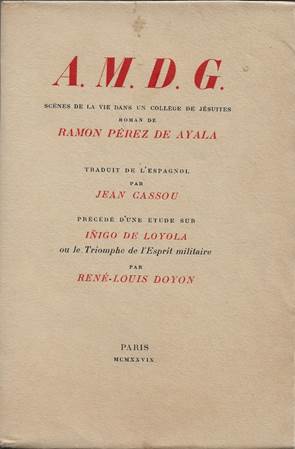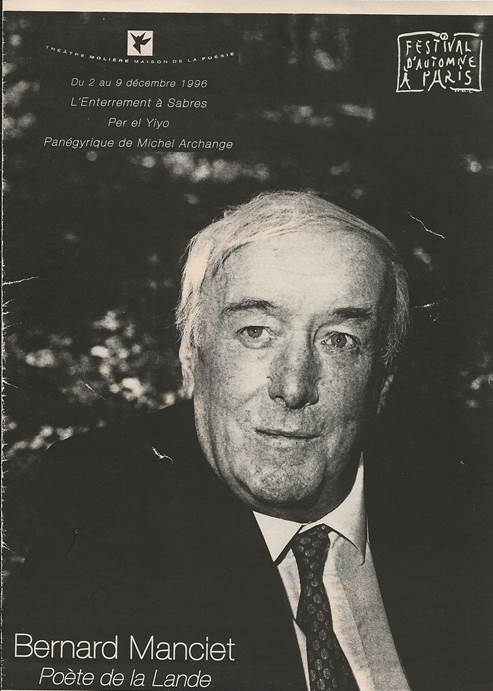Faciendo farina con perro e gallo e gato
Faciendo farina con perro e gallo e gato
XXXIV. Otrosi todo home fijodalgo pueda ganar rueda o molino en su heredad o en el egido aforandolo con abonadores fijosdalgo, e faciendo la presa con vidiganza, e pasando el agua al solar de la rueda o molino, e faciendo farina con perro e gallo e gato.
El artículo 34 del Fuero de Ayala concluye con una fórmula que ha hecho correr mucha tinta sin que haya recibido hasta la fecha, que yo sepa, una explicación satisfactoria. No pretendo proporcionar la clave de ese enigma, porque sería pretencioso rivalizar con mis entrañables y admirados colegas de Vitoria, sino solo contribuir modestamente a abrir alguna vía nueva de interpretación.
La fórmula no se lee en ningún otra colección legal de esta clase, ni siquiera en el Fuero de Vizcaya, a pesar de que los datos que componen este artículo son un breve compendio de las leyes I a V del Título XXIV de aquel.
Para entenderla, varios enfoques resultan posibles: 1) interpretación detallada /vs/ de conjunto; 2) interpretación literal /vs/ metafórica, con la posibilidad de cruzar uno con otro.
Si nos atenemos a cada uno de los elementos (perro, gallo, gato) por separado, debemos asegurarnos primero que no designan metafóricamente alguna parte de la maquinaria del molino, ya que bien se sabe que el vocabulario de la industria usa muchos términos que pertenecen a otros campos, en especial al de los animales y, dentro de este, a estos tres en particular. Con todo, la coincidencia de que esos elementos llevaran todos nombres de animales domésticos y no de otras clases merma mucho esa posibilidad.
Dentro de la interpretación literal, se ha intentado situar a cada uno de esos animales en relación con las condiciones de funcionamiento, material o legal, de un molino: el perro libra a supuestos ladrones de ser declarados culpables de una sisa que habrá que achacar al molinero (no se me escapa que la explicación resulta algo retorcida); el gallo canta al amanecer, lo que autoriza la puesta en marcha del molino, que no debe funcionar de noche; el gato ahuyenta a los ratones.
Es innegable que esos animales pueden ofrecer una contribución útil al buen funcionamiento de la molienda, pero su presencia no es un requisito suficiente en sí para facilitarla materialmente. Si bien el gato ha sido y sigue siendo inquilino imprescindible del molino por su instinto raticidio, los otros dos animales no presentan una especificidad tan congruente con esa actividad: el perro protege toda clase de moradas y el gallo, aparte de despertar al personal a horas indebidas (incluso a media noche), desempeña su papel principal dentro del corral a favor de su femenina población.
Por lo tanto, hay que descartar que la fórmula final del artículo del fuero se refiera a un funcionamiento habitual del molino. En cambio, se entiende perfectamente si remite a un acto específico y único. Ha sido Luis María de Uriarte Lebario quien me ha puesto sobre la pista de una posible explicación: “con la extraña condición […] de tener que hacerse por primera vez la harina con perro, gallo e gato”. Ese “por primera vez” se deduce del texto mismo del artículo, ya que prolonga el significado de “ganar rueda o molino”, lo cual no significa cualquier tipo de adquisición sino muy concretamente el derecho a crear ex nihilo un molino. En el fuero, el verbo “ganar” tiene ese significado muy particular, como se echa de ver en el artículo LXI:
Otrosi, todo ombre que ha de ganar exido ha se de abonar con cinco ombres fijosdalgo que lo ovo cerrado con enseas de roble y que estan plantados fasta seis manzanos, e lo tovo año y dia; pero el peon que asi ganare en el exido, es del señor.
Antonio Sáenz de Santa María percibe también el carácter único evocado por el artículo, sin embargo descarta rotundamente esa interpretación sin justificarla:
[…] la fórmula ya no querría decir que hubiese en el molino, y menos la primera vez, un gato, un gallo y un perro, sino que se están disponiendo unas cláusulas de seguridad para los usuarios del mismo.
En vano se buscará en el fuero un artículo que persiga al dueño cuyo molino no quede permanentemente acompañado por esos tres animales.
Bien es verdad que podría aducirse que esa cláusula establece una forma de obligación de perennidad en el funcionamiento del molino, al exigir su integración dentro de una edificación mayor no limitada al molino sino que suponga una presencia humana permanente con casa y dependencias. Pero sería forzar excesivamente el valor de un texto legal suponer que contiene cláusulas no explicitadas sino solo sugeridas.
Adelantaré, pues, la hipótesis de que la enigmática fórmula remita a un ritual, el que solía acompañar la toma de posesión de un bien mueble o inmueble. Consistiría, en este caso, en poner en movimiento por primera vez la rueda del molino en presencia de esos tres animales, en carne y hueso o representados en efigie. La contribución de estos al acto inaugural se apoya en una características propias que pueden ser las mencionadas más arriba pero consideradas desde un punto de vista simbólico. Así, queda exonerada la ceremonia del excesivo realismo sugerido por la interpretación literal del artículo del fuero. Además, demuestra que, en la época en la que se redacta, queda abierta la posibilidad de incorporar tradiciones propias de la comarca, pertenecientes a un fondo consuetudinario e ignoradas por las fuentes legales vigentes.
Anejos
e/o faciendo la prensa
Tanto Uriarte Lebario como Sáenz de Santa María transcriben “o faciendo la presa” en lugar de “e faciendo”. Es error evidente porque la localización del espacio en el que se piensa poner el molino y la edificación del mismo son dos operaciones distintas y sucesivas.
rueda o molino
Sin poder zanjar la duda que le asalta, Sáenz de Santa María se pregunta, después de otros autores, si molino y rueda, sistemáticamente asociados por los redactores del fuero, son términos equivalentes o si designan realidades distintas. Obsérvese que no se confunden ya que aparecen siempre unidos por la conjunción “o” (“rueda o molino”), lo que supone sino una oposición radical entre ellos por lo menos una diferencia significativa. Un fenómeno similar se da con molino y aceña. Según Adeline Rucquoi, son dos conceptos distintos. El molino, más antiguo, está dotado de una rueda horizontal y un árbol vertical exclusivamente de madera. La aceña, de creación posterior, consiste en una rueda vertical, con un sistema de engrenage metálico.
No parece descaminado suponer que, en el fuero de Ayala, “rueda o molino” deba interpretarse al igual que “aceña o molino”.
con vidiganza
En lo que atañe a la localización del molino, la redacción de este artículo es tan elíptica (e faciendo la presa con vidiganza e pasando el agua al solar de la rueda o molino) que, para entenderla, es imprescindible cotejarla con el texto correspondiente del Fuera de Vizcaya (Título XXIV, ley IV), mucho más detallado:
y algunos echan bidigazas en los rios y arroyos que passan por los tales exidos, y ponen assimesmo abeurreas (que son señal de Casa) para poner en aquel lugar do aquellas señales echan pressa de herrería o molino o rueda o la tal casilla, para edificar ende ferreria, o molino o rueda.
Son dos, pues, las señales colocadas: unas, – las vidigazas -, dentro de la corriente para señalar donde se edificará la prensa; otras, – las abeurreas -, en el lugar donde se piensa levantar la casa. El fuero de Ayala omite las segundas. Mi ignorancia del vascuence no me permite identificar los objetos así designados, y no puedo menos que observar que esa identificación no resulta tampoco fácil para expertos de dicha lengua. Supongo que las abeurreas serán una suerte de estacas para deslindar el solar en el que se pretende edificar en tierra firme, entre río y canal. En cuanto a la vidigaza, no estoy en condiciones de dudar de su identificación con la Clematis vitalba, pero su utilización “para hacer señales” me resulta algo difícil, teniendo en cuenta que debe mantenerse visible durante un tiempo largo dentro del agua “(año y día”). Aún si se trenza, tendrá que beneficiarse de un soporte fijo para que no se la lleve la corriente, lo cual se asemeja mucho a una prensa momentánea, cosa que no permite la ley. Por consiguiente, me quedo con la duda.
Bibliografía
– Rucquoi, Aline, “Molinos et aceñas au coeur de la Castille septentrionale (xie–xve siècles)”, Les Espagnes médiévales. Aspects économiques et sociaux, Mélanges offerts à Jean Gautier Dalché, Annales de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, n° 46, Nice, Les Belles Lettres, p. 104-122.
– Sáenz de Santa María, Antonio, “Alrededor del capítulo xxxiv del Fuero de Ayala”, Kultura. Cuadernos de Cultura, n° 9 (1986), p. 57-63.
– Uriarte Lebario, Luis María de El Fuero de Ayala, Diputación foral de Alava, 1974. Tesis de 1911, edición en el VI Centenario del Fuero de Ayala, con Introducción de D. Antonio María de Uriol y Urquijo, Presidente del Consejo de Estado.
– Villacorta Macho, Ma Consuelo de, González Díaz, Emiliano, Dacosta, Arsenio, Díaz de Durana, José Ramón, El Fuero de Ayala. Edición crítica y estudio del texto foral de 1373, el Aumento de 1469 y la Proscripción de 1487, Gijón, ediciones Trea, 2023.