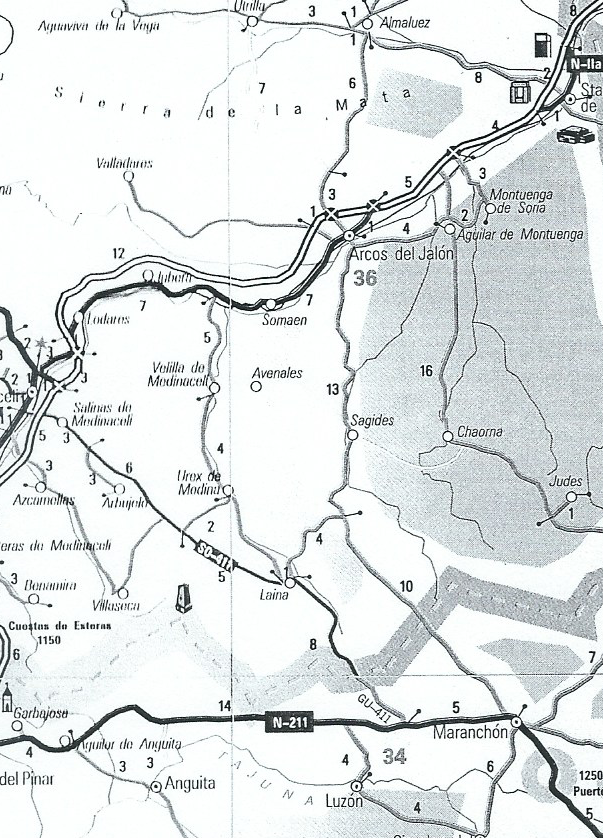Une mésaventure fréquente : la collaboration des spécialistes détournée par les médias
Une mésaventure
fréquente :
la
collaboration des spécialistes détournée par les médias
Le
samedi 5 avril 2008, la chaîne Arte diffuse une émission réalisée par Martin
Meissonnier, intitulée Vraie Jeanne – Fausse Jeanne, consacrée à Jeanne d’Arc.
Son visionnement m’a tellement scandalisé que je décide de prendre la plume
pour dénoncer ce qui m’apparaît comme l’exemple-même des excès auxquels peut
conduire la volonté de dénigrer les spécialistes de la part de gens incompétents.
Je rédige le texte ci-dessous, dans l’espoir de le faire parvenir à un grand
journal national pour sa publication dans ses pages Idées et débats. Je
l’adresse aussi à des historiens johannistes pour recueillir leur avis et
éventuellement engager une réflexion sur leur contribution à des entreprises de
vulgarisation qui les utilisent sans leur donner la possibilité de vérifier si
leurs propos n’ont pas été détournés de leur signification.
Les historiens
et les médias
____
La
récente diffusion par Arte de l’émission de Martin Meissonnier, Vraie
Jeanne – Fausse Jeanne (samedi 5 avril 2008), offre une occasion de
s’interroger sur le traitement de l’histoire dans les grands médias et sur la
contribution souhaitable ou non des historiens à ce genre d’entreprises. Le
réalisateur ne cache pas son intention de dénoncer la « version officielle »
de la vie de la Pucelle « en soulevant à chaque fois les points obscurs et
énigmatiques qui [la] contredisent » (document de présentation publié sur
le web). Dans ce but, il affirme s’appuyer sur un récent ouvrage de Marcel Gay,
du moins pour ce qui concerne « les points obscurs et énigmatiques »
que cet auteur aborde, pour la période qui va de Domrémy à Orléans puis pour
l’épisode de Claude des Armoises.
Il
saute aux yeux que le réalisateur privilégie M. Gay au détriment des autres
intervenants. Il a pourtant réuni un brillant aréopage d’historiens johannistes
– Ann Curry, Françoise Michaud-Frajéville, Colette Beaune, Claude
Contamine et Olivier Bouzy -, mais le déséquilibre entre cette cohorte de
spécialistes et M. Gay, qui revendique paradoxalement ne pas en être un, est patent.
À lui seul, pour les deux grandes parties de l’émission dans laquelle il
apparaît, il dispose d’un temps de parole supérieur à celui de tous les
historiens réunis ; très supérieur même, si on ajoute le commentaire du
narrateur qui épouse systématiquement son point de vue. De plus, alors que les
historiens sont filmés assis, dans une salle de lecture déserte et mal éclairée
(celle de la BN, rue de Richelieu, pour les Français), M. Gay, qui a
systématiquement droit à des gros plans, visite les monuments ou a droit à un
fond de tuffeau du meilleur effet (encore qu’il y ait lieu de se demander s’il
est vraiment médiéval). On a, par conséquent, d’un côté l’immobilité, de
l’autre le mouvement ; d’un côté, les idées reçues, de l’autre une vision
dynamique des choses ; bref, d’un côté la ringardise de l’universitaire
confit en érudition, de l’autre, le chercheur moderne « en prise avec le
réel ». Alors que les premiers polissent leurs phrases, cherchent à
nuancer leur propos, lui, est en mesure de toucher son auditoire avec un parler
simple, direct, sans fioriture : « C’est la raison pour laquelle elle
fiche une trouille pas possible à tous les Anglais… ». On sait combien ces
détails comptent pour attirer la sympathie d’un téléspectateur qui n’a ni les
moyens ni l’envie d’aller au-delà d’une écoute unique et relativement passive.
Enfin,
tandis que les historiens n’ont droit qu’à l’incrustation de leur nom et de
leur titre lorsqu’ils apparaissent à l’image, M. Gay a droit, en début
d’émission, à une présentation particulière de la bouche du narrateur. Celle-ci
mérite d’être reproduite littéralement : « Marcel Gay, grand reporter
(prononcer ‘reporteur’), travaille depuis 20 ans à décrypter les contradictions
de l’histoire de Jeanne d’Arc. [Puis, tandis que l’intéressé s’engage dans
l’escalier de la tour de Boissy à Chinon] Il enquête sur le terrain avec des
méthodes de journaliste d’investigation ». Cette formule, qui mérite de
figurer en lettres d’or dans le sottisier audio-visuel, prise littéralement,
signifie deux choses : 1) que l’analyse de certains faits historiques
relève du journalisme ; 2) qu’un bon historien doit aller sur le terrain,
en l’occurrence, sans doute pour interroger les survivants de la Guerre de Cent
Ans.
Les
auteurs de l’émission seraient bien en peine de définir cette vérité officielle
qu’ils prétendent dénoncer. S’ils avaient lu de plus près la littérature historique
récente sur la figure de Jeanne d’Arc, ils auraient constaté que les points de
vue peuvent diverger, qu’il est donc inexact de faire croire que les historiens
convoqués sont, sur tous les points, d’un avis identique ; encore moins,
que celui-ci est forcément hagiographique à l’endroit de la Pucelle. On
reconnaîtra aisément dans ce parti-pris du réalisateur et de son principal
informateur une manifestation de la « théorie du complot » si
pertinemment dénoncée par Robert Reckert (Le Monde dimanche 30-lundi 31
mars 2008, « Débats et dialogues », p. 15) : « vision
délirante selon laquelle la réalité, jusque dans ses détails, fait l’objet
d’une manipulation occulte dont la vérité est masquée à
l’humanité » ; vision qui cache « un ressentiment contre les élites
de la connaissance et [dans laquelle] se déploie une figure contemporaine de
l’anti-intellectualisme ».
Tout
au long de l’émission, on retrouve cette volonté de débusquer le mensonge de la
« version officielle » et de lui substituer une explication plausible,
c’est-à-dire apparemment rationnelle et, si possible, évidente. Cette démarche
se traduit par des formulations souvent péremptoires, fondées sur des
hypothèses qui, par un effet bien connu d’accumulation, finissent par créer
l’illusion d’une vérité, en faisant oublier que leur point de départ était
hypothétique. Les déductions abusives ne sont pas rares, non plus, souvent
fondées sur une mauvaise interprétation de la lettre des documents :
« le père de Jeanne louait (sic) au seigneur local une forteresse
(resic) », d’où on peut présumer qu’il est « un noble paysan
(reresic) », et on déduit « qu’il contrôle une forteresse ». Les
documents émanant de la cour du Dauphin sont systématiquement suspects, en
revanche, les écrits d’inspiration bourguignonne sont pris pour argent
comptant. On invente une littérature qui n’a jamais existé, tels ces
« poèmes épiques » qui, à partir de la levée du siège d’Orléans,
« commencent à propager la légende de la Pucelle ».
Quant
aux explications, elles prêtent souvent à rire, tellement elles privilégient la
plus élémentaire des vraisemblances. Dans ce domaine, la palme revient à la
transmutation des voix célestes que la Pucelle croit entendre en voix humaines
que les auteurs attribuent à des dames qui lui soufflent ses réponses. Même
dans sa prison de Rouen, « on s’aperçoit aussi que derrière les rideaux,
des tentures, il y a des gens qui se promènent et qui soufflent des réponses à
Jeanne ». La Pucelle est parfois empêchée de les entendre clairement,
aussi s’en plaint-elle : « De là où je suis, je n’ai pas très bien
entendu ma voix ». « ’Attendez que je consulte ma voix et je vous le
dirai’, ce qui veut dire que les voix sont dans son environnement
immédiat ». On ne sait que regretter le plus : que les juges n’aient
pas veillé à offrir à l’accusée des moyens de défense plus perfectionnés, ou
que les messagers divins n’aient pas su doser la puissance de leur organe.
J’arrêterai
là une énumération qui pourrait être plus longue. Mon propos n’est pas de
convaincre des auteurs, dont je sais par expérience qu’ils sont sourds à toute
explication dès lors qu’on touche à leur marotte. J’adresserai plutôt des
reproches aux producteurs qui n’ont pas pris la sage précaution de s’entourer
d’avis autorisés avant de commander des émissions de cette nature. Nul n’ignore
que certains faits de l’histoire de France ont le don d’exciter les
imaginations (le trésor des Templiers, le Masque de Fer, le prisonnier du
Temple, etc.). L’aventure johannique en fait partie. Il vaudrait mieux être prudent
dès qu’un de ces sujets est abordé. Sans cela, nous continuerons à voir se
manifester, à intervalles réguliers, des restaurateurs de la vérité vraie,
auxquels les médias font une publicité complaisante, qui croient dur comme fer
qu’ils sont les premiers à mener campagne contre le mensonge et la manipulation
de faits contenues dans les « thèses officielles ».
Laissons-les
à leurs illusions. Tournons-nous vers les historiens, qui ont le mauvais rôle
dans cette distribution. Ils se sont prêtés au jeu imposé par le réalisateur
(nature des questions posées, lieux de tournage, etc.), avec la générosité qui
caractérise nos universitaires, toujours disposés à prêter leur concours à une
entreprise culturelle (qui plus est, sous le label d’Arte, dont on sait qu’elle
a leurs faveurs). Ils proposent un discours à la fois cohérent et accessible
aux non spécialistes, car, en bons pédagogues, ils ont le désir de toucher le
plus grand nombre. Cet effort de clarté est mal récompensé, puisque leurs
propos (principalement dans les passages où ils sont en concurrence avec ceux
de M. Gay) sont tronqués et perdent donc leur cohérence. Plus grave encore,
pour mieux servir la thèse des auteurs, ils peuvent être contredits ou, pire
encore, carrément détournés de leur signification. Les réalisateurs, jaloux de
leur autorité, n’admettraient sûrement pas que les intervenants interfèrent
dans leur travail. De leur côté, ils exigent des historiens qu’ils renoncent à
tout droit de regard sur l’utilisation qui est faite de leurs paroles et les
exposent même à des critiques immérités, tant il est vrai qu’un discours sorti
de son contexte peut prêter à des interprétations erronées. Que faire ?
S’abstenir ? La mesure, si elle était prise collectivement pourrait être
salutaire. Imposer un ‘cahier des charges’ serait une meilleure solution
encore. Elle consisterait à associer les intervenants, quitte à en réduire le
nombre, à la préparation de l’émission et à ménager autant que possible la
continuité de leur discours. Les réalisateurs seraient conduits à réduire
quelque peu le recours à une image qui devient parfois inutilement envahissante
et à reproduire en parallèle les interventions, au lieu de les entrecroiser en
créant un discours artificiel et finalement peu compréhensible.
Il
faudrait surtout que les historiens se donnent collectivement les moyens de
faire connaître au public le plus large les ouvrages qui mériteraient son
attention, sous la forme qui leur paraîtra la plus appropriée, au lieu de se
soumettre aux exigences d’entrepreneurs de loisirs audio-visuels, quelle que
soit la notoriété dont ils jouissent. Tout plutôt que donner des verges pour se
faire battre.
Michel Garcia
Professeur émérite (Université
Paris 3)
________________
J’adressai
ce texte aux historiens qui étaient intervenus dans l’émission, en
l’accompagnant du message suivant en date du 8 avril 2008 :
Chers
Collègues,
Je
suis parvenu à surmonter ma répugnance et à regarder (avec de nombreux arrêts
sur image) le forfait de M. Meissonnier. Je ne veux pas laisser passer ça.
Aussi ai-je commis moi-même un texte que j’ai conçu comme une tribune libre à
publier dans la presse.
Je
vous le transmets en pièce jointe et vous demandant de bien vouloir : 1)
me dire si l’initiative vous paraît heureuse ; 2) dans l’affirmative, de
corriger les erreurs éventuelles ; 3) de me suggérer des modifications de
fond ou de style. Si vous pouvez vous concerter avant, ce ne serait que mieux.
Enfin,
pourriez-vous me dire par quel canal je pourrais communiquer ce texte à des
personnes fiables pour une éventuelle publication dans la page « Débats »
de certains journaux ?
Je
pense qu’il faudrait ne pas trop tarder et profiter de la proximité des
Journées johanniques pour obtenir une meilleure écoute.
D’avance,
merci.
Amitiés,
Michel Garcia
______________
Olivier
Bouzy, Directeur adjoint du Centre Jeanne d’Arc d’Orléans, qui
participa à l’émission, fut le premier à me répondre. C’est lui qui m’apprit
que la source principale du réalisateur était l’ouvrage de Gérard Pesme, Jeanne
d’Arc n’a pas été brûlée, dont le titre dit assez dans quel esprit l’auteur
aborde le sujet historique qu’il prétend traiter (chacun sait que Napoléon
n’est pas mort à Saint-Hélène ni Hitler dans son bunker berlinois). C’est à cet
ouvrage mémorable qu’est empruntée la référence à de prétendus « poèmes
épiques », formule qui désigne probablement le Mistere du siege
d’Orleans. Quant à la citation qui en serait tirée, selon laquelle Jeanne
d’Arc aurait été appelée « noble princesse », elle n’y figure pas, car
c’est une invention du même Pesme. M. Meissonnier prétend avoir commencé à
préparer son film avant la sortie de l’ouvrage de Marcel Gay.
Réponse
à Olivier Bouzy [8 avril 2008]
[…]
Notre ami Meissonnier est gonflé d’oser dire qu’il ne suit pas Gay, alors qu’il
le laisse parler tout à sa guise et que son propre commentaire prolonge en
l’amplifiant celui du ‘grand reporteur’.
Pour
ce qui est des Poèmes épiques, autant que je me souvienne, à l’image il y avait
de la prose latine. De même, si je ne me trompe, j’ai relevé qu’en marge du
récit concernant Claude des Armoises, qui est lu avec componction par l’acteur
de service, figurait un intitulé qui disait "fable de la fausse
Pucelle" (je suis sûr de « fable »).
__________
D’Olivier
Bouzy [9 avril 2008]
Au-delà
de l’ouvrage de M. Gay, le réalisateur s’appuie sur des théories qui sont loin
d’être nouvelles ; elles vont de Pierre Caze à Marcel Gay, en passant par
Gérard Pesme et autres auteurs révisionnistes.
À
la suite de la remarque de cet éminent spécialiste, je modifie la fin du
premier paragraphe de mon texte, dans lequel je me réfère au seul ouvrage de M.
Gay : « Dans ce but, il s’appuie sur les élucubrations d’une longue
lignée d’auteurs, dont le dernier en date est Marcel Gay, du moins pour ce qui
concerne « les points obscurs et énigmatiques » de la période qui va
de Domrémy à Orléans, ainsi que pour l’épisode de Claude des Armoises.
Il
saute aux yeux que le réalisateur privilégie ces « théories » au
détriment de l’avis des autres intervenants. »
_______________
Parallèlement,
j’adresse la lettre suivante à Yves Dauge, Maire de Chinon, qui connait bien
Jérôme Clément, Vice-Directeur d’Arte.
[9
avril 2008]
Cher
Yves,
La
corporation des historiens spécialistes de Jeanne d’Arc est très remontée
contre Arte, à cause d’un télé-film consacré à Jeanne d’Arc diffusé sur cette
antenne. Ils ont été piégés par un réalisateur qui les a pris pour servir de
caution par leur présence à la théorie délirante d’un prétendu
« journaliste d’enquête », qui dit les pires énormités en prétendant
restaurer une vérité bafouée.
Tu
trouveras ci-joint une libre opinion que j’ai rédigée en vue d’une publication
dans la presse nationale. Je sais que tu connais bien les responsables d’Arte,
aussi, je te serais reconnaissant de bien vouloir leur communiquer mon texte.
Cela les aidera, j’espère, à comprendre la colère des historiens et, on peut
toujours rêver, à être plus circonspects dans le choix de leurs auteurs pour
l’avenir.
J’espère
aussi que tu trouveras quelque intérêt à sa lecture.
Amicalement,
Miguel
_____________
[9
avril 2008]
Françoise
Michaud-Fréjaville m’informe qu’elle et O. Bouzy ont protesté auprès de la
productrice après avoir vu le CD de l’émission en avant-première. Elle
m’annonce que le téléfilm doit être projeté à Orléans le 5 mai au cinéma des
Carmes, dans le cadre des Fêtes johanniques.
Chère
collègue,
[…]
J’imagine
aussi votre colère lors de la projection du forfait de Meissonnier. J’ai lu
avec intérêt la réponse de C. Beaune, tout en déplorant qu’en ces temps de
consensus mou, on ne puisse plus publier dans la presse de vrais points de vue polémiques.
Il va falloir réapprendre à être méchants, sinon, on se fera bâillonner pour un
bout de temps, je le crains.
Qui
a pris la décision de projeter ce téléfilm le 5 mai ? Est-ce à dire qu’à
Orléans-même, les historiens johannistes ne sont pas consultés ? Dites-moi
à qui on peut adresser une véhémente protestation. À quoi cela va-t-il servir
de participer à la projection du 5 mai ? Croyez-vous que nos commentaires
pourraient contre-carrer l’effet que les images vont nécessairement produire
sur un public habitué à avaler tout ce qui bouge sur un écran ? J’en
doute. Il suffit de lire la réponse de C. Beaune pour constater que même des
gens lettrés ne sont pas à l’abri de ce risque. Personnellement, j’ai trouvé
très discutable le volet images de l’émission, plutôt mal conçu sauf pour ce
qui permet au réalisateur de tourner en ridicule la « version
officielle ». Voilà un beau sujet de discussion entre nous. […]
Je
vous suis très reconnaissant de bien vouloir transmettre mon texte à C. Beaune.
Je pensais le faire, ainsi qu’à Cl. Contamine (j’avais demandé leur e-mail à O.
Bouzy dans ce but). Si vous jugez utile de l’envoyer à Contamine aussi,
n’hésitez pas à le faire. À toutes fins utiles, je vous signale que j’ai
corrigé la mention de la tour de Boissy en « dans une tour du château de
Chinon ».
[…]
Vous
pouvez compter sur moi pour combattre, la lance à la main, tous ces faiseurs de
-mauvaises- fables.
Amicalement,
Michel Garcia
_____________
Dans
Le
Figaro du 9 avril 2008, Colette Beaune publie une tribune intitulée
« Jeanne et les impostures », que je reproduis ci-dessous.
Vous publiez dans votre page Télévision du Figaro
daté samedi 29 mars une critique particulièrement laudative à propos du film de
Martin Meissonnier « Vraie Jeanne, fausse Jeanne » projeté sur Arte
à 21 heures le même jour ; trois colonnes, photo et gros titre
accrocheur : « Et si Jeanne d’Arc n’avait pas été brûlée ? »
Si votre journaliste est tout à fait en droit d’avoir aimé
ce film (bonne mise en scène, bien rythmé), il est tenu par nature d’avertir le
lecteur quand des dérives sont avérées. Il donne ainsi la parole dans cet
article aux auteurs Marcel Gay et Martin Meissonnier dont les affirmations sont
tout à fait contestables.
Contrairement à ce qui est dit, il n’y a pas de « dogme »
aujourd’hui en matière d’histoire de Jeanne d’Arc ; sa qualité de bergère,
sa culture (illettrée ou non), l’étendue de son rôle militaire sont autant de
sujets qui ont été librement discutés et largement renouvelés par les historiens
ces dernières années. Nous n’en sommes pas restés aux manuels de la Troisième
République !
Implicitement, le film suggère l’origine royale de Jeanne
d’Arc et soutient clairement cette fois l’hypothèse selon laquelle Jeanne n’a
pas été brûlée à Rouen en 1431 mais a survécu sous la forme de la dame des
Armoises. Rien de nouveau dans tout cela et pas besoin de « cinq années de
recherches » puisque les théories survivalistes datent de Guillaume
Vignier au XVIIe s., lequel était soucieux de plaire à son
protecteur descendant de ladite dame. Quant à l’origine royale de Jeanne d’Arc,
elle découle des écrits d’un préfet napoléonien. Rien qui n’ait été déjà
plusieurs fois sérieusement réfuté.
Si votre journaliste n’était pas en mesure de déceler les
affirmations hasardeuses du film (le visage de Jeanne est penché et non
« caché », les « 800 soldats » ne sont que 80), ni même les
citations inexactes (que ne fait-on pas dire à la prophétesse Marie Robine ou à
ce malheureux Bourgeois de Paris ?), il aurait pu et même dû se rendre compte
que les interventions des historiens (au passage largement tronquées au
montage) n’étaient là que pour servir de caution intellectuelle aux
affirmations de M. Gay. Personne ne les avait d’ailleurs prévenus qu’il
participerait au film !
Il n’était quand même pas difficile de constater pourtant
qu’aucun de ces chercheurs n’intervient plus durant le dernier tiers du film
lorsqu’il est question notamment du survivalisme (qui est aussi le titre de
l’article : « Et si Jeanne n’avait pas été brûlée ? »),
hypothèse sensationnelle certes mais qui ne repose sur aucun fondement. La
vraie vie de Jeanne d’Arc qui a de quoi nourrir de très belles histoires, n’a
pas besoin de telles impostures.
______________
[10
avril 2008]
Dans
l’ignorance où il était de la participation de collègues sérieux à l’émission,
Jean-Pierre Chaline a renoncé à la regarder à la seule lecture des programmes
TV. Arte se déconsidère et il convient de le leur faire savoir par des
courriers de protestation.
Cher collègue,
Vous avez bien fait en vous
abstenant. Personnellement, j’ai dû faire un gros effort pour surmonter ma
répugnance et m’obliger à avaler ce tissu d’énormités en m’arrêtant sur l’image
pour noter littéralement les propos de M. Gay et du narrateur. Il y a de quoi
faire tout un collier de perles.
Mes collègues orléanais, qui
sont les plus affectés, sont prêts à m’aider à obtenir la publication de mon
texte dans la page « Débats » du Monde. Si, de
votre côté, vous connaissiez quelqu’un que l’on puisse toucher, je vous serais
reconnaissant de bien vouloir me le faire savoir. Il faut battre le fer tant
qu’il est chaud et les Fêtes johanniques arrivent.
Encore merci pour l’intérêt
que vous portez à mon initiative.
Bien cordialement à vous, Michel
Garcia
_______________
[10 avril 2008]
Claire Portier, directrice
du service Art et Histoire de Chinon, m’adresse ce commentaire très éclairant
sur les pratiques des réalisateurs de TV, en élargissant le propos à d’autres
réalisations que celle d’Arte.
Cher Miguel.
Sans pousser plus loin la réflexion,
j’avais également noté que le journaliste avait une place de choix par rapport
aux historiens. Par contre, je vous trouve un peu sévère dans la description de
la salle Labrouste, qui est quand même un très beau morceau d’architecture
métallique du 19e. Je trouve cependant très pertinente votre
remarque sur le fond statique derrière les historiens, alors que le journaliste
bénéficie des décors naturels. Si je ne me trompe, le mur en tuffeau auquel
vous faite allusion est un des murs du château de Chinon, on voyait à un moment
donné une perspective très explicite sur la vallée de la Vienne en crue.
Pour ajouter de l’eau à votre
moulin, j’avais trouvé très « limite » les soi-disant portraits de
Claude des Armoises montrés à la fin du documentaire : la très belle porte
sculptée, à demi-flamboyante, ne me paraît pas pouvoir avoir été réalisée avant
1490, puisque les portraits sont du type « médaille », genre de décor
qui ne commence à être répandu en France qu’au retour de l’expédition italienne
de Charles VIII. Enfin, le portrait peint sur la cheminée du château (dont je
n’ai pas retenu le nom) est très nettement une production du 19e
siècle : peut-être s’agit-il, au mieux, d’une restauration très lourde
d’un original ancien. Dans ce cas, le fait aurait mérité une mention.
Dans le même style, je ne
sais pas si vous avez regardé la semaine dernière Des racines et des ailes
consacré aux grands bâtisseurs. Le reportage consacré à Viollet le Duc était un
modèle du genre, démontrant ce qu’on peut faire au montage lorsque la
réalisation finale est confiée à des non spécialistes : sur Vézelay, le
rôle de Mérimée, pourtant primordial, était complètement effacé pour mettre en
valeur un Viollet le Duc omnipotent, architecte, sculpteur, menuisier, fondeur,
et j’en oublie. Comme d’habitude, le réalisateur s’était trompé de tympan et a
montré celui de la façade (une des choses les plus laides à mettre à l’actif de
VlD) au lieu de celui du narthex (qui est vraiment roman). Enfin, je vous avoue
avoir zappé de colère en fin de reportage en entendant une dame, éminente
propriétaire du château de Roquetaillade, restauré par Viollet le Duc, répéter
le bon vieux poncif comme quoi les lits au Moyen Âge étaient petits parce que
les gens dormaient assis, ayant peur de la position allongée qui est celle des
gisants. À quand l’huile bouillante du haut des créneaux et les charpentes en
châtaignier ?
Merci de m’avoir donné
l’occasion de « lâcher la vapeur », et à bientôt !
Claire.
Réponse, 10 avril
Chère Claire,
Entre autres vertus, mon
texte aura celui de m’attirer des réponses du plus haut intérêt. Vous ne pouvez
imaginer le plaisir que je prends à des courriers tels que celui que vous m’avez
adressé. Dire qu’on aurait pu se côtoyer, comme deux tâcherons entièrement
dévoués à nos obligations, vous à la Ville, moi aux Amis du Vieux Chinon, sans
échanger autre chose que des propos liés à nos occupations respectives !
Je conviens que la salle
Labrouste est fort belle (un peu haute de plafond peut-être, ce qui rabaissait
les lecteurs à un niveau peu glorieux), mais quand elle grouillait de monde et
qu’elle bruissait au rythme des pages que l’on tourne (sans oublier les toux
incessantes de vieillards catarrheux). Comme le réalisateur n’avait visiblement
pas le moyen de l’éclairer, elle fait sinistre.
Les portraits de Claude des
Armoises sont plus que limite : sur ce point, mes correspondants orléanais
sont catégoriques. Comme je garde les archives de tous les messages que je
reçois, je vous montrerai ce qu’ils disent à ce sujet. Vous êtes dans le vrai.
Ce que vous écrivez sur Des
Racines et des ailes est très intéressant, car tout à fait dans le droit
fil de mon propos, à savoir l’usage détestable que les télévisuels font de la
science des historiens. Vous n’êtes d’ailleurs pas la première à faire ce
rapprochement : Francis Deguilly m’a expliqué que c’est en se basant sur
une expérience analogue qu’il a renoncé à participer à l’émission que ce
producteur compte consacrer au site UNESCO du Val de Loire : échaudé par
une émission d’Arte sur la Loire en 2002, il a décliné l’invitation. J’ai
l’impression d’avoir touché un point extrêmement sensible et il se peut que ma
modeste démarche contribue à enclencher un vaste débat parmi les historiens.
Tant mieux si c’est le cas.
Dernière nouvelle : Yves
Dauge a accepté de transmettre mon texte au Vice-Directeur d’Arte.
Amitiés, Miguel
_______________
[10
avril 2008]
Je
reproduis le message, court mais pénétrant, que notre cousin Bernard Pichon m’a
adressé en réponse à mon texte que je lui avais adressé.
Mon cher Miguel,
J’ai lu sur le
mail d’Anne-Marie ton commentaire de l’émission d’ARTE consacrée à Jeanne
d’Arc.
J’avais également
regardé cette émission (peut-être en zappant un tantinet) mais la qualité des
intervenants et l’origine des assertions étaient totalement inconnues pour moi.
Je suis donc resté sur une impression de grand malaise, ne sachant plus à
quelle sainte me vouer.
Finalement le
passé est bien difficile à appréhender ; il est souvent déformé, exagéré,
magnifié, caricaturé, caché, bref, transformé.
Je ne crois pas
que, le temps passant, la crédibilité de l’HISTOIRE progresse.
Tant pis ou tant
mieux, je ne sais pas.
Bien à toi.
Bernard.
Mon cher Bernard,
Ton intuition a été la
bonne : il était très difficile de se faire une opinion. Par exemple, moi,
je n’ai toujours pas saisi ce que les auteurs voulaient qu’on pense de Claude
des Armoises. J’ai le sentiment qu’ils voulaient qu’on la prenne pour la
Pucelle, qui aurait échappé au bûcher ou aurait ressuscité (le mot a été dit),
mais qu’ils n’avaient pas tous les arguments pour nous convaincre.
Cette histoire est en train
de faire un certain barouf, parce que les historiens en ont marre qu’on les
sollicite et qu’après, on fasse n’importe quoi avec ce qu’ils ont dit. C’est
tellement facile au montage.
Moi, ce qui me gêne dans
l’attitude de M. Gay, c’est que, de toute évidence, il veut régler des comptes
avec l’ordre établi et surtout avec l’Église, ce qui l’aveugle. Cela m’embête
parce que c’est donner une idée fausse de gens qui, comme moi, ont les opinions
que tu sais en matière de religion, mais n’en sont pas fanatiques pour autant.
J’admets parfaitement que la Pucelle ait entendu (je dis bien
« entendu » et non pas « cru entendre ») ses voix. Je n’ai
aucune peine à la croire sincère. Je refuse de mettre en doute son témoignage
sous le prétexte que moi personnellement je ne crois pas à la possibilité de
ces révélations. Il est même probable que, si j’avais vécu à son époque, si
j’avais reçu son éducation, pareille aventure aurait pu m’arriver.
En revanche, je ne partage
pas ton pessimisme sur la crédibilité de l’histoire. Ce qui me semble en cause,
c’est plutôt la crédibilité des médias modernes en général, et de la télévision
en particulier. Je t’assure que, si tu participais à un colloque entre
historiens sur ce sujet, tu découvrirais que la part d’indécision n’est pas si
grande qu’il y paraît.
J’ai été ravi de ton message.
Cela nous change du rugby, mais l’un n’empêche pas l’autre.
Je t’embrasse,
Miguel
______________
[12
avril 2008]
Cher ami,
Je n’ai pas vu
l’émission, mais j’imagine. J’avais eu la même réaction devant une émission
récente des Racines et des ailes, consacrée aux châteaux de la Loire, ou
Jean Guillaume était vu quelques secondes dans les combles de la tour des
Marques tandis que la présentation était faite par une dame aussi photogénique
qu’incompétente.
Vous devriez
publier ce courrier !
Cordialement,
Alain Salamagne
Cher collègue,
Vous n’êtes pas
le premier à faire le rapprochement avec Des Racines et des ailes. Je
crois, qu’au-delà du cas spécifique du téléfilm sur Jeanne d’Arc, ce qui est en
cause c’est bien le sort que les médias réservent aux contributions des
historiens.
Le texte a été
transmis au Vice-Directeur d’Arte. Par ailleurs, nos collègues orléanais
cherchent le moyen de le publier dans Le Monde. Si vous y avez vos
entrées, n’hésitez pas à me le faire savoir.
Bien
cordialement, Michel Garcia
_______________
[12
avril 2008]
à
Éric Fottorino, Directeur du Monde
Monsieur le Directeur,
Je prends la liberté de vous
adresser un texte en vue de sa publication éventuelle dans les pages Débats
du Monde. Les collègues historiens intéressés l’ont lu et approuvé et
seraient, eux aussi, heureux qu’il soit publié. Au-delà de l’épisode du Jeanne
d’Arc d’Arte, on touche à un sujet beaucoup plus général, qui concerne l’usage
souvent inadmissible que la télévision fait de leurs propos. Personnellement,
j’y ai vu aussi une bonne illustration des thèses récemment exposées par Robert
Reckert dans vos colonnes et, plus généralement, des relations à sens unique
entre certains médias et les chercheurs.
Dans ma signature, je ne fais
pas état de la publication récente de mon ouvrage : Juan de Gamboa, La Pucelle de France. Récit
chevaleresque traduit du castillan et commenté par Michel Garcia. Éditions
Mazarine, 2007. Je vous laisse juge d’apprécier s’il convient de le
faire, car je ne cherche pas à faire de la publicité à mon livre (je ne sais ce
que penserait de ce que je vous dis là mon éditeur, Claude Durand…) et je ne
veux pas qu’on croie que j’ai écrit ce texte dans ce but. Mais, de fait, sa
préparation m’a conduit à me plonger dans la bibliographie johannique et m’a
donc sensibilisé à ces questions.
En espérant que vous voudrez
bien donner une suite à ma demande, je vous prie d’agréer, Monsieur le
Directeur, l’expression de ma considération distinguée, Michel Garcia
Courrier
resté sans réponse.
_____________
Je
reproduis ci-dessous l’échange que j’ai eu avec Jean Flori, Directeur de
recherche au CNRS (Centre d’Études
Supérieures de Civilisation Médiévale de Poitiers). Il aborde très directement
la difficile relation des universitaires, en l’occurrence des historiens, avec
les médias.
[16
avril 2008]
Cher
collègue et ami,
Votre
analyse est particulièrement éloquente et précise. Et la problématique que vous
posez est tout à fait pertinente. Pour ma part, face aux dangers bien réels que
vous soulignez, dus à la déformation « médiatico-journalistique »
presque systématique de ceux qui fabriquent et vendent les émissions relatives
à l’histoire, je me suis très souvent posé la question : que faire ?
Sachant que nos interventions ou nos propos seront presque toujours tronqués ou
réduits ou déformés ou dénaturés, ne serait-il pas plus sage de ne pas
participer, dans la mesure où nous n’avons pas le pouvoir d’imposer le contrôle
de nos propos ? Le problème est bien réel, mais je n’ai pas encore pu
trouver de réponse univoque.
Plusieurs
cas se sont présentés à moi à propos de ce genre d’émissions.
–
1er cas : le refus. J’ai été trois ou quatre fois invité à des
« plateaux » de télévision. J’ai chaque fois refusé lorsqu’il m’est
apparu que les autres participants ne me semblaient pas présenter les
caractères de « sérieux » suffisant (par exemple un
« savant » mélange d’universitaires et de journalistes peu sérieux,
voire d’humoristes ou présumés tels, ou de vedettes du show-biz). Il est clair
que ces gens-là ont, par leur métier et leurs antécédents, une très grande
habitude de l’usage des médias et une grande virtuosité qui les rend aptes à
capter l’attention sur leur personne, quelle que soit la niaiserie de leurs
propos. Dans ce cas, me semble-t-il, il vaut mieux s’abstenir car il y a fort à
parier que le sujet abordé ne sera qu’un prétexte à se faire valoir, au prix
des pires absurdités. L’histoire n’y gagne pas, les historiens non plus, sauf
ceux qui accepteront de « jouer le jeu » de l’absurde en faisant de
la surenchère, comme le fit un jour Jean d’Ormesson. Mais n’est pas Jean
d’Ormesson qui veut, et le bonhomme sait, lui aussi, capter l’attention sur lui-même.
C’est un publiciste né. Nous sommes là dans un autre registre. Pour ma part, je
ne me sens ni le goût ni la capacité de suivre cette voie.
–
2e cas : l’acceptation réticente. J’ai récemment été invité par
Stéphane Bern pour son émission « Secrets d’histoire » (à propos de
Robin des Bois et de l’origine historique du mythe). J’avais déjà vu deux ou
trois de ses émissions antérieures, et avais déploré, comme vous le faites,
certains « défauts » de l’émission (présence d’historiens
« maison » qui n’en sont pas, propension aux images douteuses et aux
reconstitutions, etc.). Les sujets traités sont de plus, à mon avis, à la
limite de l’histoire et du « journalisme people ». J’ai donc
longtemps hésité avant de donner mon accord, eu égard à la qualité historique
de plusieurs autres intervenants et à la bonne « tenue » d’ensemble
de l’émission. J’ai accepté en prenant mes précautions : je souhaitais
savoir à l’avance quel genre de questions me seraient posées et de combien de
temps je disposerais pour chaque réponse. Ayant reçu réponse favorable, j’ai
accepté, mais ai tout de même dû constater, en revoyant l’émission, que les
deux questions initiales que j’avais suggérées (qui me semblaient indispensable
pour bien poser le sujet dans son cadre historique réel) ont été escamotées,
très habilement, car on ne s’en aperçoit pas, mais le contexte historique
profond qui me tenait à cœur a disparu. Malgré cela, de l’avis de ceux qui ont
vu l’émission, l’ensemble était jugé « très intéressant », si bien
qu’en définitive, je crois que l’on y gagne car l’histoire est présente, ce qui
n’est pas rien, même si les sujets abordés sont presque toujours
« para-historiques », mais que faire d’autre dans un monde médiatique
gouverné par l’audimat ? Se retirer totalement est suicidaire pour
l’histoire : cela revient à se retrancher dans la tour d’ivoire de
l’érudition réservée aux seuls spécialistes. Il faut, je crois,
« composer » et aider les (rares) concepteurs d’émissions qui tentent
de mettre un peu d’histoire médiévale au menu. Notre « matière » a
tout de même plus à y gagner qu’à y perdre, rien n’étant pire que le silence et
l’oubli, à l’époque présente. Seule la TV amène à l’existence !! On peut
certes le regretter, mais c’est hélas une réalité « incontournable » !
–
3e cas : l’acceptation sans réticence. J’ai eu l’occasion trois
ou quatre fois (la dernière pour une émission qui, enregistrée il y a deux
mois, sera diffusée sur la 3 dans quelques semaines) de participer à une
émission toute entière consacrée à un sujet qui est à proprement parler dans
« ma » spécialité, et où j’interviens seul dans tout ou partie de
l’émission : en l’occurrence sur la croisade et sur les rapports
chrétienté-islam. Dans ce cas, le risque me semble particulièrement réduit, les
seules « dérives » possibles (on verra !) ne pouvant provenir
que de deux origines : ou bien j’aurai dit des bêtises, et je devrai alors
ne m’en prendre qu’à moi-même ; ou bien mes propos auront été tronqués ou
dénaturés au montage. Évidemment, ce risque demeure et nous n’avons aucun moyen
de contrôle. Je n’ai en effet aucun moyen de visionner l’émission AVANT sa
diffusion. La question se pose alors, me semble-t-il, sur le plan
juridique : lorsqu’une émission est en direct, pas de problème, mais si
elle est enregistrée, ce qui est le plus souvent le cas, il devrait être
stipulé que les participants donnent leur accord après avoir visionné le
document. Je crains malheureusement que cette règle ne soit pas applicable et
ne voie jamais le jour.
Il
reste évidemment quelques détails que vous soulignez, par exemple le
« traitement » plus ou moins favorable accordé à tel ou tel
participant. J’ai souvent noté, comme vous, que les noms des intervenants ne
sont pas toujours mis en valeur comme il le faudrait. Certains apparaissent à
chaque fois que l’individu intervient, d’autres sont seulement mentionnés à
leur première apparition. Que faire ? On est bien obligés de s’en remettre
à l’honnêteté intellectuelle du producteur de l’émission. C’est évidemment
aléatoire.
En
définitive, dans l’état actuel du niveau d’ensemble du public pour ce qui
concerne l’histoire et particulièrement l’histoire médiévale (niveau qui est,
hélas, très bas) et compte tenu du peu d’intérêt des producteurs pour des
émissions valables sur l’histoire (en France du moins, car c’est mieux en
Angleterre ou en Italie), je crois que nous, historiens, avons intérêt à ne pas
choisir de nous retirer dignement dans notre tente. Notre matière y perdrait,
et seuls, alors, les « pseudo-historiens » triompheraient, car eux n’ont
pas nos scrupules et nos prudences ! Il en va des émissions TV comme de la
biographie jusqu’à ces dernières années : seuls les
« pseudo-historiens » s’étaient investis en ce domaine, ce qui a
contribué d’une part à dénaturer le goût du public et à dégoûter les vrais
historiens du genre biographique, tant il était perverti par ces
pseudo-historiens, hommes politiques ou notables divers, vendant leur nom plus
que leurs travaux de recherches, souvent inexistants. J’ose me vanter d’avoir
contribué pour ma part, dans une certaine mesure, à la réhabilitation du genre
biographique, dans le sillage prestigieux de G. Duby, J. Le Goff, J. Richard et
quelques autres. Le public commence à s’intéresser à l’histoire vraie par le
biais de ce genre biographique « renouvelé ». On peut espérer une
reconquête du même ordre par le biais des émissions TV et en
« chasser » peu à peu les intrus, si possible. Il y en a tant encore,
que les journalistes flattent, car ils sont souvent des leurs, ou de leur monde
connu. Les historiens, en revanche, sont souvent pour eux des habitants d’une terra
incognita.
Cette
reconquête de l’histoire par les historiens sera sans doute lente et aléatoire,
difficile, car les « parasites » sont en place et le public préfèrera
encore longtemps entendre parler du trésor des templiers, des secrets cathares
ou autres mythes. Mais, après tout, Alain Demurger a su, dans plusieurs
émissions, remettre un peu d’histoire dans ce flot de délire (du moins
lorsqu’on lui en a laissé le temps) : on peut évidemment regretter que,
sur ce thème, les présentateurs aient laissé plus (trop) souvent parler ceux
qui n’en avaient rien d’autre à dire que du vent et du clinquant. Du moins
était-il présent, et avec lui, la vraie histoire.
Nous
en sommes là : il nous faut reconquérir dans les médias notre propre
matière pour qu’elle existe aux yeux du public. Pas simple !
Cordialement
à vous
Jean
Flori
[Réponse
à J. Flori, le 16 avril]
Cher
collègue,
J’ai
été très intéressé par votre réponse, si instructive pour ceux qui n’ont pas la
pratique des plateaux de télévision. Nul doute qu’elle fournisse matière à
discussion si jamais le débat s’engage entre historiens sur cette question. Il
semble que ce soit le cas, car j’ai reçu plusieurs messages qui portent des
jugements sévères sur des émissions qui touchent à l’histoire, parmi les plus
prestigieuses. Vos arguments en feront réfléchir plus d’un, tout en ouvrant la
perspective d’une position nuancée qui pourrait être partagée par le plus grand
nombre et déboucher sur une pratique commune. À toutes fins utiles, je suis en
train de constituer un dossier avec toutes les réponses reçues.
Mon
texte a été transmis au Directeur d’Arte. Il n’est pas impossible qu’il soit
publié dans les pages « Débats » du Monde (un droit de réponse
de Colette Beaune a, lui, déjà été publié par le Figaro). J’ai cherché à
le communiquer à Le Goff mais n’ai pas encore de réponse de la chaîne France-Culture
(« Les lundis de l’histoire ») à laquelle je me suis adressé. Si vous
avez le moyen de toucher notre grand aîné, veuillez me le faire savoir ou,
mieux encore, n’hésitez pas à lui transmettre le texte, si vous jugez la chose
utile.
Une
fois cette nécessaire médiatisation faite, il conviendrait peut-être d’ouvrir
un débat au fond et de le faire savoir. Pourquoi pas aux journées de
Blois ? Olivier Bouzy a déjà fait une démarche dans ce sens mais il
faudrait que les historiens se manifestent auprès des organisateurs pour leur
forcer un peu la main. C. Beaune, F. Michaud et O. Bouzy se sont concertés pour
contrer la diffusion du téléfilm d’Arte qui a malheureusement été programmée
dans le cadre des Journées johanniques. Il se trouve que je suis invité à
donner une conférence sur mon propre livre (qui n’a eu aucun écho dans la
presse, contrairement à celui de notre journaliste d’investigation), pour
l’ouverture de ces Journées à Orléans, le 25 avril. Je ne manquerai pas de
faire une mise au point à ce sujet.
Bref,
la riposte s’organise. Il revient aux historiens de ne pas en rester au vœu
pieux.
En
vous remerciant pour votre riche contribution et votre appui éventuel à une
initiative commune, je vous adresse mon bien cordial souvenir, Michel Garcia
[Réponse
de Jean Flori, le 16 avril]
Cher
Collègue,
Permettez-moi
de revenir un peu sur le sujet de fond. Je l’aborde chaque fois que je peux
avec les producteurs des émissions, aussi bien à la radio qu’à la TV (je n’y
suis pas invité très souvent, mais je ne rate jamais l’occasion d’en parler).
Et je commence toujours, bille en tête, par reprocher aux présentateurs et concepteurs
d’émissions de négliger la véritable histoire et les véritables historiens, au
profit des pseudo-historiens médiatiques, journalistes ou autres politiciens ou
« show-businessmen ». Et de « viser très bas » sur le plan
culturel. TOUS, ou presque, en sont d’accord, et se retranchent derrière
l’argument suivant : pour « passer » et avoir ainsi le droit, de
la part de la chaîne (tout est conditionné par l’audimat) de continuer de
telles séries sur l’histoire, il faut « accrocher » le public, et il
se trouve que le public est très majoritairement inculte (je crains hélas que
ce ne soit pas tout à fait faux). Il faut donc ratisser large… au détriment
parfois de la qualité. Ceci étant, ils attendent des historiens véritables,
lorsqu’ils les invitent, une prestation qui soit à la fois de qualité sur le
plan historique mais aussi et surtout (pour leur point de vue) qui
« passe » bien, donc qui soit accessible à « la masse »,
laquelle regarde avant tout les émissions qui parlent de sujet qu’elle connaît
déjà ou croit connaître – donc des sujets « alléchants » comme
les Templiers, les Cathares, les trésors, les mystères, les secrets d’alcôve
etc. -, et si possible des émissions où figurent des gens qu’elle connaît
déjà, donc des gens des médias, journalistes ou gens du showbiz, (Max Gallo
compris).
C’est
ainsi. C’est un fait que l’on peut déplorer, mais c’est hélas un FAIT.
Il
faudrait, pour en sortir, un historien (ou mieux, plusieurs ?) qui soit à
la fois un grand écrivain, un grand orateur et un grand homme de media, genre
Georges Duby. Malheureusement, on n’en trouve pas si facilement ! Il faut
« faire avec cette absence », donc… faire avec ce que nous sommes.
Il
faut donc que tous nous fassions un effort pour réussir la promotion de la
BONNE histoire, sans concessions excessives mais aussi sans repli frileux sur
nos territoires d’érudition où règne notre vérité (et encore), mais où nous
sommes seuls, ou en tout cas peu nombreux. Je crois que l’on peut faire de
relativement bonnes émissions avec de la relativement bonne histoire qui soit
aussi accessible. Certes, on n’est jamais satisfait des émissions d’histoire
que l’on voit ou auxquelles on participe, mais on n’a guère le choix : ou
bien on cherche à élever le niveau même sans grande illusion, ou bien on ne
participe pas pour ne pas ‘s’abaisser" outre mesure… et on laisse alors
la place aux pseudo-historiens qui eux, soyons-en sûrs, sauront occuper le
créneau et se montrer à l’aise dans leur prestation. Mais, dans ce cas, la
cause de l’histoire véritable devient désespérée, si même ses adeptes
abandonnent le terrain à l’adversaire ! Car l’adversaire, plus encore que
le public que l’on maintient dans le caniveau, c’est le faux historien
médiatisé qui dévalorise l’histoire et la confisque à son profit.
Je
crois, une fois de plus, qu’il faut lutter… mais pour cela il nous faut des
armes JURIDIQUES : quels sont les droits des participants aux
émissions ? Quel droit de regard, quel droit de contrôle ont-ils sur leur
propre prestation ?
Cordialement
à vous, Jean Flori
[Réponse
à Jean Flori, le 16 avril]
Cher
collègue,
Je
partage la plupart de vos analyses, à ceci près que je ne suis pas disposé à
suivre les producteurs et auteurs d’émission lorsqu’ils nous invitent à nous
mettre à la hauteur d’un public qu’ils estiment peu apte à recevoir notre
‘message’. Avec des raisonnements comme cela, on justifie l’injustifiable. En
tout état de cause, ce n’est pas en renonçant à soi-même que l’on favorise une
élévation du niveau culturel général, qui devrait être l’objectif principal de
tout chercheur. Cet argument relève de la facilité : on définit un public
qui soit conforme au message que l’on souhaite délivrer. Il s’agit aussi, de
leur part, d’un aveu d’ignorance déguisé. On pourrait multiplier les exemples
contraires. Faut-il parler ‘petit nègre’ à nos enfants ? Les politiques
qui pratiquaient un langage châtié voire érudit, à la façon de De Gaulle (ou
Mitterrand), étaient-ils moins bien entendus par le ‘bon peuple’ que les
ignorantins qui nous gouvernent aujourd’hui ? De toute façon, comment
pourrait-on, sans se désavouer, se ridiculiser et, par conséquent, manquer sa
cible, se muer en démagogues du savoir historique ? Moi, je ne saurais
pas, et vous non plus, sans doute.
Nous
avons là matière à de bonnes et saines discussions.
Je
vous suis très reconnaissant de bien vouloir dialoguer ainsi avec moi.
Bien
cordialement, Michel Garcia
Cher
collègue,
Croyez
bien que je suis TOTALEMENT en accord avec ce que vous écrivez, ce qui montre
en passant que j’ai dû mal m’exprimer dans mon message précédent. Car vous
exprimez tout à fait ce que je ressens moi-même.
Croyez
bien que je ne suis en aucun cas disposé à quelque concession que ce soit sur
le plan de la qualité historique, ni à "renoncer à soi-même" etc.
J’adhère
totalement à votre propre exposé. Il n’est pas question de "parler petit
nègre" (pardon: cela m’a échappé…et on va me taxer de racisme !),
ni "verlan", ni "banlieue" ni même
"journalistique". Je suis totalement intransigeant sur ce point. Il
faut rester soi-même, et si possible digne.
J’irai
même plus loin : je ne vois pas la nécessité de paraître
"débraillé" sur les plateaux de la TV, sous prétexte que « tout
le monde » y vient désormais en chemise ouverte (fût-elle immaculée et
largement échancrée comme notre BHL international), voire en blue-jeans ou en
débardeur. Pas question de donner dans le propos vulgaire etc. Pas question de
faire de l’histoire au ras du sol rien que pour "plaire" à un public
que l’on croit vulgaire, même si c’est hélas parfois vrai. Aucune concession
sur ce plan, ni sur la qualité formelle de l’exposé, ni dans l’expression qui
doit rester correcte, même s’il faut aussi rester simple et accessible. Aucune
concession non plus sur la qualité de fond du discours historique.
MAIS
Mais
il n’en reste pas moins que j’ai ressenti, chez quelques-uns au moins des
responsables d’émissions radio ou TV (pas chez tous, il est vrai, et pas
toujours chez ceux dont j’espérais beaucoup et qui m’ont déçu sur ce plan, tant
l’opportunisme et le carriérisme étaient chez eux patents), un très réel
partage des idées que je leur exprimais avant ou après l’émission, à savoir, je
le répète, un discours du genre suivant: Vous, hommes de média, avez une grande
responsabilité dans l’abaissement du niveau culturel en France. Dans le domaine
de l’histoire, vous privilégiez le superficiel, le clinquant, le "tape à
l’oeil". Vous préférez les "faux historiens" aux vrais, vous
n’éduquez pas le public, vous tapez au ras du sol, voire au-dessous de le
ceinture", etc. Bref, les reproches que tous les historiens comme vous et
moi faisons aux émissions françaises. Certains, donc, approuvaient, et
confessaient leur réel désir de "hausser le niveau"… tout en se
disant "coincés" par la nécessité de plaire au public… et ceux-là
avaient évidemment tendance à souligner que le public qui fait l’audimat est
généralement assez inculte…
J’ai
un grave défaut : je suis naïf et j’ai tendance à croire les gens
lorsqu’ils me semblent sincères. Et je reste donc convaincu que ce dernier
discours recouvre au moins une part de vérité.
Conclusion :
il nous faut AIDER ces producteurs-là, ceux qui, mal peut-être, tentent de
faire connaitre l’histoire. Les aider SANS renoncer à la qualité, et en faisant
à notre tour des efforts, non pas pour "abaisser le niveau" ou se
mettre au diapason du vulgaire, mais pour rendre notre message moins austère,
moins aride peut-être… je ne sais comment dire : tout simplement en
étant le plus possible simple et clair, sans pédanterie… (je n’accuse
personne que moi-même : il m’est arrivé, en revoyant telle ou telle de mes
"rares" prestations, de penser que j’aurais pu, ici ou là, être à la
fois plus clair, plus précis, plus complet, plus accessible, plus
"intéressant"…).
L’Histoire
a besoin de ces producteurs-là ; nous avons besoin d’eux si nous voulons
que le public de l’histoire ne se réduise pas à un cénacle d’initié. Je suis
convaincu que le public potentiel de la véritable histoire est plus large
qu’ils le croient, et qu’une assez large part du public n’est pas aussi inculte
qu’ils le disent (affirmation à prendre avec prudence, hélas !). Mais il y
a du pain sur la planche, et du travail en vue pour hausser le niveau !
Un
exemple pour illustrer tout ce que je viens de dire sur la manière dont les
media et nous-mêmes jugeons le niveau culturel du public (car c’est cela le
fond du problème): la perception des éditeurs à propos des notes des livres que
nous produisons. Le voici :
La
plupart des éditeurs, vous le savez, renâclent devant des notes abondantes.
J’estime qu’il ne faut pas reculer. Une bonne histoire s’appuie sur des
documents, et l’on doit, me semble-t-il, être intransigeant sur ce point :
prouver la véracité de ce qu’on écrit, citer ses sources, mentionner les
opinions que l’on partage ou que l’on conteste me semble indispensable pour
éviter le « flou », le « n’importe quoi ». C’est aussi, je
crois, un bon moyen de trier entre les vrais historiens qui fouillent les
sources et connaissent les travaux antérieurs et les débats présents, et les
historiens de pacotille qui se contentent d’un survol ou d’un plagiat. Pour ma
part, j’ai presque toujours réussi (parfois difficilement) à imposer les notes
et références que j’estimais indispensables. MAIS la plupart des éditeurs sont
convaincus que ces notes « font peur au public » et que c’est un très
sérieux handicap de vente.
Presque
tous exigent que ces notes soient reportées en fin de volume… quand ce n’est
pas en fin de chapitre (ce qui, dans ce dernier cas, le rend totalement
inutiles). Ce n’est qu’au prix d’âpres batailles et discussions que j’ai pu
obtenir parfois des notes en bas de page, infiniment plus utiles et plus
claires.
Telle
est donc l’opinion des éditeurs en France.
J’ai
eu la chance, au moins sur quelques-uns de mes livres, d’être traduit en italien,
en espagnol, parfois en anglais. Et j’ai pu constater que les notes, mises en
fin de volume en France, apparaissaient « spontanément », dans ces
pays-là, en bas de page, sans la moindre intervention ou demande de ma part.
Pourquoi ?
Lors
d’une réunion éditoriale à Paris, j’ai exposé cela et ai posé cette question :
pourquoi ce qui se fait d’office en Italie, par exemple, ne pourrait-il pas se
faire en France ? Le public italien serait-il plus « cultivé »
que le public français ?
La
réponse a fusé, unanime : « OUI ».
J’en
conclus ceci :
–
OU bien c’est faux, et il faut convaincre les éditeurs et les media de tout
faire pour élever le niveau de production (mais hélas, les tirage des livres
d’histoire, généralement très faible – sauf les Gallo, qui sont à peine de
l’histoire – démontrent que les historiens sont aujourd’hui, pour les
éditeurs, l’équivalent des « danseuses » pour les puissants du 19e
siècle : on les subventionne presque par charité, pour la galerie, pour un
reste de prestige… mais cela coûte… Combien de temps cela va-t-il durer ?
-OU
bien c’est vrai, et il faut absolument reconquérir le public en faisant de la
bonne histoire ET en aidant le plus possible ceux qui, hélas, ont seuls le
pouvoir d’en parler et de la faire connaître. Ces émissions ne sont certes généralement
pas bonnes, mais si on les tue, que restera-t-il ? Il nous faut les
améiorer, les « soigner », les « guérir » si possible des
virus qui les gagnent… mais pas les tuer, car l’Histoire en a besoin.
Je
ne sais si je me suis exprimé assez clairement.
Cordialement
à vous, et avec tout mon soutien pour la cause que vous défendez, et qui, j’en
suis certain, nous est commune, Jean Flori
Cher collègue,
Loin de moi l’idée de vous
attribuer les opinions que je dénonçais chez les acteurs des médias. C’est moi
qui ai dû mal m’exprimer. Nous sommes bien d’accord pour ne pas faire de
concessions à la facilité.
Personnellement, si je n’ai
qu’une maigre expérience en matière de collaboration avec les médias (TV et
radio), j’ai, en revanche, une longue expérience comme vulgarisateur. Pendant
20 ans, j’ai présidé une société d’histoire locale, organisé chaque année des
conférences et des visites commentées portant principalement sur l’archéologie
et l’histoire des hommes et des monuments de la région. J’étais le seul
universitaire de l’assemblée et m’adressais à un public plein de bonne volonté
mais ayant reçu une formation inégale et parfois modeste. Je vous concède que
ce public offrait l’avantage sur celui de la télévision d’être motivé, de faire
l’effort d’aller au-devant du savoir. Ce travail de vulgarisation, je l’ai fait
avec plaisir et je le juge indispensable, pour mon public d’abord, mais aussi
pour moi, car cela me forçait à m’évader souvent du Moyen Âge et donc à engager
des recherches dans des domaines qui m’étaient moins familiers. Je n’ai pas à
insister puisque vous avez assisté à une de ces réalisations. De même avez-vous
pu constater qu’en matière de publication, on s’imposait une rigueur que
pourraient nous envier bien des éditeurs universitaires. Les témoignages de satisfaction
de la part de ce public attestent que cette démarche les satisfaisait.
Je ne confonds pas cette
activité avec l’échange érudit. Pour satisfaire ce besoin-ci, qui est inhérent
à la qualité de chercheur, je comptais sur mon séminaire ainsi que sur des
colloques ultra pointus, organisés sur invitation et avec de longues plages de
discussion entre les communications. Je n’ai jamais confondu les deux activités
et j’ai toujours veillé à m’adapter à la tonalité de chacune d’entre elles.
J’admets très bien que la
télévision (ou la radio) se donne un objectif de vulgarisation (j’ose dire
« intelligente ») et je trouve normal que les chercheurs et savants
(pas seulement les historiens) y collaborent, si possible en cravate
(littéralement et métaphoriquement), comme vous le suggérez si justement. La
difficulté est de concilier leur définition de la vulgarisation avec la nôtre,
j’en conviens tout à fait. C’est là toute la question. Observons que, sur ce
chapitre, les médias n’ont pas la même doctrine. Je suis un auditeur assidu de
France-Culture, et je pense que le niveau qu’on y pratique conviendrait au
« grand public ». Mais je pèche sûrement moi aussi par naïveté. En
tout cas, vous montrez bien que, dans ce domaine, l’initiative ne nous revient pas,
pas plus que dans celui de l’édition, et qu’il nous faut donc composer.
Jusqu’où ? Il serait bon que nous ayons un ample débat entre historiens
pour nous accorder là-dessus.
En fait, les questions que
vous soulevez à propos des rapports parfois conflictuels que les auteurs
universitaires connaissent avec les éditeurs concernent toutes les Sciences
Humaines, et pas seulement l’Histoire. La question des notes est, en effet,
cruciale. Il faut des notes et elles doivent figurer en bas de page : on
ne doit pas transiger sur ce point. [Veillons, cependant, à ne donner que des
notes indispensables : pour les références bibliographiques, une
bibliographie en fin de volume avec un système d’appel dans le texte est bien
plus utile ; de même, un glossaire final peut rendre bien des
services ; des annexes bien conçues aussi (énumération non limitative).
J’ai trop vu de ces articles d’après Thèse avec une première note, dont l’appel
était inséré dans la première phrase quand ce n’était pas dans le titre, qui
couvrait le reste de la page et le début de la suivante : on y retrouvait,
retranscrite exhaustivement, une bibliographie élémentaire et bien connue de
tous].
Quant à l’argument qui se
fonde sur un niveau culturel comparé des peuples, il ne me convainc pas du
tout. Quand on connaît les systèmes d’enseignement des uns et des autres, on
peut avoir quelques doutes. Chacun de nos pays est capable de former une élite
mais peu se sont donné les moyens de fournir un bon niveau général à la
totalité de la population. Je sais bien que les choses changent et que je ne
suis plus aussi convaincu que je l’étais il y a 30 ans des vertus de notre
propre système, mais de là à conclure que le nôtre est à la queue du peloton,
il y a un grand pas que je ne franchirai pas. Encore une fois, j’interprète cet
argument comme de pure convenance, pour ne pas dire hypocrite. Pour tout dire,
je le trouve irrecevable, sauf si l’on me démontre le contraire avec des
chiffres. Pour ce qui est de la télévision, je ne crois pas qu’on doive envier
celle de l’Italie berlusconienne.
Un autre sujet mériterait
d’être abordé : les chercheurs ne sont-ils pas trop tributaires d’agents
extérieurs à la profession pour diffuser des travaux de leur discipline ?
Sont-ils à ce point dépourvus de moyens pour le faire eux-mêmes ? Si oui,
comment remédier à ce grave défaut ?
Encore merci pour votre
précieuse contribution.
Bien cordialement, Michel
Garcia
[17 avril 2008]
Cher ami,
Votre réponse est tout à fait
pertinente et convaincante. Je vous suis sur presque tous les points, sauf
peut-être sur le « niveau » culturel comparé de la France et de
l’Espagne ou de l’Italie. Certes, rassurez-vous, je ne soutiendrai pas que la
TV de Berlusconi est meilleure que la nôtre ! (Quelle horreur !
Peut-on faire pire ? Je crains que oui…). Pourtant, j’ai souvent eu
l’impression (mais je peux me tromper) que le niveau d’intérêt, d’écoute et de
compréhension des étudiants, en Italie et en Espagne, était supérieur à celui
des étudiants français. Je n’en tire aucune conclusion « politique »,
croyez-le bien. Je suis un fervent défenseur de l’enseignement laïc, et je
regrette, malgré tout, la disparition, en son sein, d’un certain état d’esprit
que j’idéalise peut-être….
Quant à la qualité d’écoute
du public, je suis comme vous convaincu qu’il y a un nombre considérable de
gens qui sont prêts à entendre de l’histoire de valeur… C’est évidemment ce « fond »
là qu’il faut développer et encourager, et vous avez très bien su le faire. Ce
fond-là existe. Mais il est malheureusement encore trop faible pour
"intéresser" les créateurs d’émissions qui ne peuvent vivre que de
l’audimat…
Nous voilà donc ramenés à la
question première : jusqu’où et comment aller ou ne pas aller à ce type
d’émissions, et comment faire pour ne pas s’y faire piéger ou servir d’alibi ?
Je crois qu’une partie de la
réponse est d’ordre juridique : il faudrait avoir le droit de visionner,
avant sa diffusion, l’émission à laquelle on a accepté de participer. Après,
cela risque d’être trop tard.
Je ne connais rien au droit
en ce domaine. Ne faudrait-il pas s’enquérir de ce point de droit ? Cela
éviterait, me semble-t-il, bien des déboires et bien des hésitations
préjudiciables.
Très cordialement à vous, en
en vous priant de m’excuser d’avoir été si long, Jean Flori.
_______________
Le
sénateur Yves Dauge avait bien voulu transmettre mon texte à Jérôme Clément,
Vice-Directeur d’Arte. Celui-ci m’adressa, par son intermédiaire, la réponse
suivante.
[29
mai 2008]
Monsieur
le Sénateur, cher Yves,
J’ai
bien reçu votre courrier du 15 avril 2008 ainsi que la lettre de Michel Garcia
qui nous fait part de ses critiques à propos du documentaire Vraie Jeanne,
fausse Jeanne, diffusé sur notre antenne le 29 mars 2008.
Je
vous remercie de nous avoir transmis ces remarques intéressantes.
Permettez-moi
d’y répondre en quelques mots.
L’objet
de ce film était de développer auprès d’un marge public certaines
interrogations relatives à l’extraordinaire parcours de Jeanne d’Arc.
Le
projet du réalisateur Martin Meissonnier était d’exposer diverses thèses
avancées sur ce sujet, en général ignorées du public, d’éclairer une aventure
humaine, historique, politique et mystique et de montrer que celle-ci avait
donné lieu à des interrogations, recherches et hypothèses qui méritent débat. Le
documentaire ne prend à aucun moment partie pour une version ou une autre,
comme le souligne d’ailleurs le titre de manière explicite.
Pour
finir, sachez que le CFRT (Comité Français de Radio-Télévision) a
co-produit ce documentaire qui a été également réalisé avec le soutien de la
BNF. Ces deux institutions, dont la crédibilité ne peut être mise en cause ont
rouvé ce programme d’excellente qualité.
En
espérant avoir ainsi répondu aux critiques de M. Garcia et en espérant
continuer à vous compter tous les deux parmi nos fidèles spactateurs, je vous
prie de croire, Monsieur le Sénateur, en mes sentiments les meilleur,
Amitiés
Signé :
Jérôme Clément.
[Chinon, 13 juin 2008]
Cher Yves,
Mon
avis est qu’il n’y a pire sourd que qui ne veut entendre et qu’il vaut mieux
que cet échange en reste là. Je m’estime d’ailleurs satisfait, grâce à ton
intervention, d’avoir pu faire prendre conscience à Jérôme Clément qu’il lui
sera désormais plus difficile d’obtenir la contribution des spécialistes pour des
émissions de ce type. J’admets aussi qu’il est de bonne guerre, de la part d’un
responsable de chaîne, de défendre les produits maison.
Cependant,
qu’il me soit permis de te dire, tout à fait entre nous, que son argumentation
est assez affligeante. Sa première phrase – « L’objet de ce
film… » – mériterait, elle aussi, de figurer dans un bêtisier.
J’espère, en tout cas, que ce n’est pas la définition qu’il donne de l’objectif
culturel d’une chaîne comme Arte. Qu’est-ce que ce « large public »
au nom duquel on décide que « l’extraordinaire »,
– c’est-à-dire, aux yeux du réalisateur, l’incompréhensible –
parcours de Jeanne d’Arc mérite des explications, dont toute l’émission
consiste à faire croire qu’elles ne figurent pas dans les travaux des
historiens ? On est en plein dans le fantasme du « on ne nous dit pas
tout ; on nous cache quelque chose », si nuisible (ce n’est pas à un
homme politique que je l’apprendrai).
Le
public ignore l’histoire des faits et gestes attestés de Jeanne d’Arc :
c’est probablement vrai. C’est à l’éclairer qu’une véritable démarche
culturelle doit s’attacher et non à diffuser les pires inepties sous prétexte
qu’il existe par ailleurs une hagiographie simpliste. L’auteur du téléfilm s’en
tient à ces deux thèses et néglige, de ce fait, celle que les intervenants
historiens lui proposaient, tout en essayant de leur faire endosser la seconde,
ce qu’ils n’ont pas apprécié.
Qualifier
de « documentaire » ce monument d’ineptie et de manipulation des
propos et des images, et affirmer que les délires du premier ignorant venu, qui
ne fait que répéter sans le savoir des sornettes cent fois entendues ou lues,
« mérite débat », il fallait oser le faire.
Enfin,
se prévaloir de la co-production est un argument (d’autorité) pour le moins
discutable. Je parierais que la BNF, dont je soupçonne que sa contribution
s’est limitée à prêter sa salle de lecture pour les enregistrements, s’est
engagée avant d’avoir vu la réalisation et sur la bonne renommée d’Arte. Mes
soupçons sont peut-être infondés mais pas moins que la référence au CFRT, dont
on ignore quelle fut la réaction après visionnement du film.
Le
rôle de « redresseur de tort » que j’ai endossé n’est guère
confortable : on passe au mieux pour un rigoriste, au pire pour un
emmerdeur. Étant partisan de l’excellence pour tous, je me fais sans doute une
idée trop haute de la culture mais je n’en ai pas d’autre à partager avec mes
concitoyens ; en outre, j’ai la faiblesse de penser que des interventions
de ce genre finissent par avoir à la longue quelque conséquence positive. Je te
remercie, en tout cas, d’y avoir contribué par ton intervention.
Avec mes remerciements renouvelés, je t’adresse, cher
Yves, mes amicales salutations, Michel
Garcia
_______________
Colophon
Françoise
Laîné, Professeur d’Histoire du Moyen-Âge à l’Université de Bordeaux, accepta
de publier mon texte sur son blog, ce qui donna lieu à quelques échanges. Je
reproduis ci-dessous les plus intéressants.
27-05-08
(13h55). Françoise Laîné (Poolzazoo).
Voici
un texte écrit par un collègue, Michel Garcia, professeur émérite de
littérature castillane à Paris III. Il a publié en 2007 la traduction d’un
roman castillan sur Jeanne d’Arc : Juan de Gamboa, La Pucelle de
France. Récit chevaleresque traduit du castillan et commenté par Michel
Garcia. Paris, 2007.
Intéressé
par le sujet, il a regardé une émission sur Arte qui l’a déconcerté (le mot est
faible). Michel Garcia dit très bien ce que j’ai souvent ressenti devant
certaines émissions.
[Suit
mon texte en 4 livraisons]
27/05/2008
14:23 (zzxyz)
Cela
rejoint les nombreuses émissions « historiques » diffusées sur les
chaînes spécialisées du satellite qui démontrent à chaque fois que le travail
du journaliste et celui de l’historien ne font pas bon ménage, le premier
« bouffant » systématiquement le second pour des raisons diverses
(ego, revanche de l’historien raté, volonté de « faire court » pour
« aller à l’essentiel », audimat, etc.).
Les
historiens s’embarquent de bonne foi dans une galère dont ils ne comprendront
qu’ils n’ont été que le dindon de la farce qu’après le montage et les coupures,
parce qu’ils s’estiment honorés d’avoir été choisis pour – enfin –
exposer leurs thèses au grand public.
C’est
une duperie sans cesse renouvelée.
Je
ne suis pas spécialiste de Jeanne d’Arc, mais suis assez au fait de la 2GM, où
l’on retrouve les mêmes poncifs, les mêmes phénomènes, sans que les dernières
thèses d’historiens pourtant réputés ne soient prises en compte.
27/05/2008
18:16 (Poolzazoo)
Les
formes d’expression des universitaires et des journalistes ne sont pas les
mêmes ; lorsqu’elles divergent complètement, l’échange devient difficile.
MG remarquait aussi une mise en scène dévalorisant systématiquement les historiens.
La
vulgarisation est un exercice délicat. Cela demande un gros effort de clarté,
la recherche d’une présentation attrayante, voire distrayante tout en restant
honnête !
27/05/2008
22:25 (zzxyz)
Il
est néanmoins incontestable que les historiens maîtrisent moins bien l’oral
audiovisuel que l’écrit : tendance à faire long, là où le journaliste
écourte le débat par des formules choc.
De
toute façon, ils sont toujours victimes des ciseaux du monteur.
Dans
les nombreux programmes consacrés aux grandes batailles aériennes (bataille
d’Angleterre, Pearl Harbor, Midway, etc.) que j’ai vus, les témoins sont soumis
au même traitement. Alors que l’on s’attend à ce qu’ils nous parlent de leur
état d’esprit, de leurs peurs, de leurs tactiques de combat, de ce qu’ils
pensaient de leurs adversaires, la seule chose que le réalisateur retient,
c’est la description de leur petit-déjeuner avant leur mission…
29/05/2008
14:17 (ajb66)
Bon
finalement, vive la lecture d’un bon livre…. de spécialiste.
Ça
peut être ch…. même si c’est utile comme la brique qui constitue le mur.
Il
y a deux types d’historiens : ceux qui prennent une loupe pour examiner
l’argile dont est faite la brique et ceux qui prennent la hauteur suffisante
pour examiner le mur dans son ensemble et le bâtiment dont il est l’un des
pans.
Quand
on met ces deux familles d’historiens ensemble pour faire une émission grand
public (cultivé quand même), l’animateur doit faire la balance entre ceux qui
brossent à grands traits un évènement dans son ensemble en essayant de lui
trouver un sens (le dessin de la mosaïque) et ceux qui détaillent la
fabrication et la pose des carrés de cette mosaïque, si vous suivez mon image.
Comme
chaque participant est un passionné, c’est normal pour quelqu’un qui a consacré
beaucoup de temps à un sujet, l’animateur doit ou devrait doser comme un
alchimiste les temps de passage entre le général et le détail qui vient
confirmer ou expliciter, pour que l’ensemble forme un tout compréhensible aux
téléspectateurs de bonne volonté soucieux de se cultiver (approfondir des
connaissances sommaires) sur un sujet donné.
[…]
29/05/2008
21:26 (Rebelote02)
Pour
avoir vu le documentaire, je trouve ces critiques assez dures quand même.
Il
était évident avant même de voir le docu que le postulat de départ était :
et si l’épopée johannique ne s’était pas passée comme on l’imagine d’habitude ?
Et si il y avait une main qui a aidé en secret derrière ? (en l’occurrence
c’est le nom de Yolande d’Aragon qui revient le plus souvent).
Du
coup, comme effectivement, c’était le sujet du livre de Gay, oui effectivement,
il est assez présent. Maintenant, en arriver à chipoter sur le fait que les
historiens sont présentés dans des bibliothèques sombres, comme pour souligner
leur côté archaïque, bof. Les téléspectateurs d’Arte qui regardent ce genre de
docu ne sont pas les beaufs staracadémisés de TF1.
Après
on peut discuter sur le fond du documentaire : par exemple, comment les
historiens expliquent que Jeanne d’Arc ait pu traverser plusieurs centaines de
kilomètres seule ou presque, en un temps record et en pays ennemi quasiment
tout le temps ? Chance ? Aide en sous-main ? (Toujours Yolande
pourquoi pas, vu le rôle important qu’elle a joué à l’époque).
De
toute façon, les infos restent sommaires et pour beaucoup de choses, nous en
sommes réduits aux conjectures, non ?
Brunissen
29/05/2008
22:42 (Poolzazoo)
Yolande
d’Aragon avait de l’énergie à revendre, le sens de l’intrigue, mais il faudrait
lui prêter une sorte de génie politique pour avoir suscité, téléguidé ou même
seulement manipulé lourdement le phénomène « Jeanne ». Or rien ne
permet de créditer Yolande d’Aragon de capacités exceptionnelles ; on ne
connaît pas non plus d’aigle dans son entourage.
30/05/2008
01:38 (ajb66)
le
postulat de départ était : et si l’épopée johannique ne s’était pas passée
comme on l’imagine d’habitude ?
L’épopée
de Jeanne d’Arc est quand même assez bien connue, et des cohortes d’historiens,
la plupart des pointures, l’ont décortiquée depuis très longtemps depuis au
moins le début du 19e siècle. Parmi ces spécialistes de l’épopée
johannique, Régine Pernoud qui n’est pas n’importe qui.
Enfin,
deux documents de poids existent, les minutes du procès de Rouen de 1431 bien
évidemment, mais également celles du procès en réhabilitation de 1455/1456, une
fois les anglois définitivement boutés hors du royaume de France, très
intéressant.
J’ai
ces deux procès dans ma bibliothèque, un héritage – Club du meilleur livre 1953
– directeur de publication Michel de Romilly – préface du RP Michel Riquet.
Dans
le second procès, in primis dicimus atque, justicia exigente, decernimus.
les juges font procéder à la lacération par le bourreau des pièces du premier
procès ayant abouti à la condamnation de Jeanne comme relapse.
Pour
le reste du procès, « disons, prononçons, décrétons et déclarons que
lesdits procès et sentences, entachés de dol, chalonge, iniquité, mensonge
erreur manifeste de droit et de fait, de même que ladite abjuration et toutes
leurs exécutions et séquelles ont été, sont, et seront nuls, invalides,
inexistants et vains… »
Les
juges du tribunal de l’Inquisition mandés par le pape Calixte III pour le
procès en réhabilitation ont interrogé, concernant la vie de Jeanne et le
premier procès
–
22 témoins à Rouen
–
35 pour l’enquête sur le lieu d’origine de Jeanne d’Arc
–
41 à Orléans dont le comte de Dunois, compagnon d’armes de la pucelle
–
15 à Paris dont Mgr le duc d’Alençon et l’évêque de Noyon
–
réentendu 19 témoins de Rouen qui avaient déjà déposé lors de l’enquête
préliminaire
–
joint les dépositions recueillies auprès de personnes trop âgées pour se
déplacer (le second procès a lieu 25 ans après le premier)
Pour
donner une idée, le livre du procès en réhabilitation fait en épaisseur au
moins le triple ou le quadruple du livre du premier procès. Cela fut un procès
fouillé.
Il
ne s’agissait pas de dire n’importe quoi puisqu’il s’agissait de remettre en
cause un premier procès tenu sous la conduite de Cauchon, évêque de Beauvais,
« procès en matière de foi – In Nomine Domini – instruit contre la
femme Jeanne communément appelée la Pucelle. »
Le
tribunal se composait de Mgr Pierre Cauchon, évêque de Beauvais etc (titres en
théologie et droit canon), conseiller de Très Serein et Très Chrétien Seigneur
le Roi d’Angleterre ; vénérable et discrète personne maître Jean
d’Estivet, chanoine de Beauvais, procureur général ; Scientifique personne
maître Jean de la Fontaine (sic), maître ès arts et licencié en droit canon,
examinateur du procès ; assistés d’un grand nombre d’abbés et de prieurs
de monastères fameux, de docteurs et professeurs en la Sainte Théologie et
cœtera… tous prêtres séculiers, moines ou religieux. »
Ce
sont donc ces gens que le second procès se propose de désavouer, d’où la grande
qualité de l’instruction.
Tout
ceci pour dire que des documents et des gens qui ont raconté, non pas devant un
tribunal royal mais devant un tribunal d’Église convoqué directement par le
pape, on en a suffisamment.
L’histoire
de Jeanne d’Arc n’est pas une histoire légendaire racontée par l’homme qui
connait l’homme qui a vu l’ours, mais au moins depuis qu’elle fut présentée au
roi à Chinon, tous ses faits et gestes ont été enregistrés jusqu’à son procès
ou plus exactement ses deux procès où les témoins encore vivants en 1456 ont
été interrogés minutieusement.
30/05/2008
18:15 (Rebelote02)
Ah
mais je suis bien d’accord et de toute façon, je ne dis absolument pas que Gay
a raison.
Ceci
dit, vous dites vous-même qu’on sait parfaitement ce qui s’est passé à partir
de son arrivée à Chinon. Mais quid de la période antérieure ? Pour Gay,
c’est là aussi que la question se pose.
Par
exemple, comment a-t-elle traversé si vite le pays et sans encombre, malgré les
dangers ? (Si on exclut l’aspect miraculeux bien sûr) La chance simplement ?
Et comment expliquer que finalement le capitaine à Vaucouleurs accepte
finalement de la laisser aller et la fait accompagner par plusieurs de ses
hommes ?
Ceci
dit, je ne connais pas bien l’histoire précise de la Pucelle, n’ayant pas lu
grand-chose sur le sujet à part La libération d’Orléans de Régine
Pernoud donc loin de moi l’idée de refaire l’histoire.
Brunissen
30/05/2008
20:11 (Poolzazoo)
Lors
du second procès, un vieil homme d’armes interrogé note comme quasi miraculeux
que la vue de Jeanne légèrement vêtue avant de revêtir son harnois ne lui
inspirait pas de pensées friponnes, alors qu’à cette époque, il était jeune et
fort gaillard ; ni lui ni d’autres en 1455 n’ont évoqué comme preuve de la
protection divine qu’elle ait mis 11 jours, fin février 1429, pour aller de
Vaucouleurs à Chinon. Ce point ne semble pas intéresser grand monde.
Le
capitaine de Vaucouleurs, Jean de Baudricourt s’est fait tirer l’oreille de la
mi-mai 1428 à la fin février 1429 pour laisser partir Jeanne et lui fournir une
escorte. Les habitants se sont cotisés pour son équipement.
À
ce moment, la population du secteur est harcelée par les troupes bourguignonnes
et Jean de Baudricourt a déjà dû passer un accord avec « l’ennemi »,
se rendre à terme ou rester neutre. C’est un type d’arrangement assez banal
dans le cadre d’une « petite guerre » de siège : celui qui est
susceptible de se rendre doit le faire s’il n’est pas secouru dans un délai
donné. Moyennant quoi, il se met à l’abri d’une accusation de trahison. On
n’est jamais trop prudent !
Baudricourt
en est probablement réduit au point où le plus maigre espoir, même en la
personne d’une jeune personne surprenante, n’est plus à dédaigner ; au
point où il en était, cela valait la peine d’être essayé. Cette équipée était
le moyen de faire passer le message à la cour, de se rappeler à son bon
souvenir et de faire savoir l’urgente nécessité de secourir des fidèles en
Lorraine ! Si c’est bien cela qu’il entendait faire, il a dû être déçu.
Une
lecture utile et très agréable : C. Beaune, Jeanne d’Arc, Paris,
2004.
31/05/2008
09:54 (hadesfr2)
Vous
avez bien raison !
Ne
pas regarder la télé, c’est la solution.
31/05/2008
18:25 (Poolzazoo)
Voui,
mais attention, mon collègue qui a pris la peine de râler ne s’est infligé le
pensum de regarder la susdite émission que pour avoir appris que les collègues
sollicités pour l’émission, qui l’avaient visionnée avant sa diffusion, étaient
scandalisés de l’utilisation qui est faite de leurs interventions ! Il a
donc voulu voir ce qu’il en était en réalité, et cela lui a valu plusieurs
heures d’écoute avec arrêts sur l’image et le son pour prendre des notes.
Les
universitaires sont des râleurs consciencieux !
02/06/08
02 :25 (hadesfr2)
« Les
universitaires sont des râleurs consciencieux ! »
On
ne saurait le leur reprocher.
________________________________________