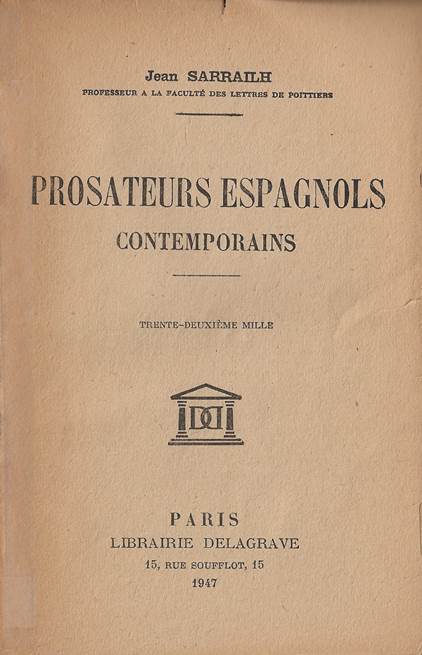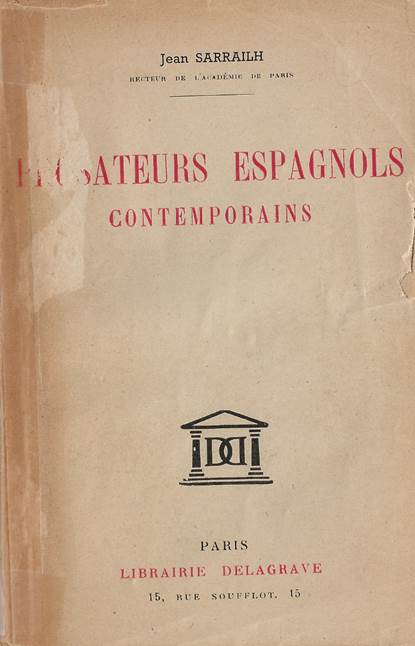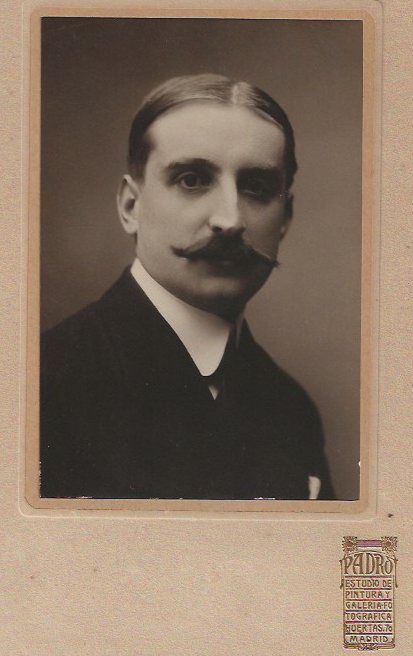Correspondance avec Olivier Biaggini, 1999-2021
Olivier Biaggini et moi nous sommes connus l’année où il préparait sa Licence d’Espagnol à l’UFR d’Études ibériques et Latino-américaines de l’Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris 3, dont les locaux se trouvaient rue Censier. Pour évoquer les circonstances de cette rencontre et ses travaux ultérieurs que j’eus le bonheur de diriger, je préfère m’en remettre à la mémoire d’Olivier, qui a bien voulu rédiger le résumé ci-dessous.
Élève en Première année à l’École Normale Supérieure de Fontenay – Saint-Cloud en 1989-1990, j’ai suivi les cours de Licence de l’UFR d’Études ibériques et latino-américaines de l’Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle. Dans mon parcours, j’avais opté pour une UV destinée aux étudiants souhaitant s’orienter vers les concours de l’enseignement. Cette UV comprenait un enseignement de littérature médiévale, assuré par Michel Garcia et consacré, cette année-là, au thème de la mort dans les textes poétiques castillans. En 1990-1991, je décide d’entreprendre une Maîtrise, sous la direction du Professeur qui m’a fait découvrir le domaine médiéval : mon mémoire s’intitule Le Lucidario castillan à travers l’étude du ms. 101 de la Real Academia de la Historia de Madrid (réalisé à Madrid, Salamanque et Paris ; soutenu en septembre 1991). Après une année consacrée à la préparation à l’agrégation externe d’espagnol, pendant laquelle j’ai suivi, à la Sorbonne Nouvelle, le cours de Michel Garcia consacré à La Célestine, œuvre alors inscrite au programme du concours, je retrouve mon directeur de recherche, en 1992-1993, pour mon année de DEA (première année de Thèse) : je soutiens mon mémoire principal, intitulé L’écriture féminine en Castille au XVe siècle : Teresa de Cartagena, en septembre 1993. Entre 1993 et 1999, années de recherche interrompues, en 1994-1995, par seize mois de mission de coopération à l’Ambassade de France en Espagne (au titre du Service national), je mène des recherches de Doctorat sous sa direction. Il m’a proposé un sujet qui a d’emblée suscité mon intérêt : la notion d’auctoritas. Centré dans un premier temps sur du XVe siècle, le corpus évolue et finit par se déplacer vers le mester de clerecía du XIIIe siècle. La thèse, finalement intitulée L’auctoritas en Castille au XIIIe siècle : l’exemple de Gonzalo de Berceo, est réalisée d’abord à Madrid et ensuite à Paris, alors que j’exerce les fonctions d’Allocataire Moniteur Normalien (1995-1998), puis d’Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (1998-1999) à la Sorbonne Nouvelle. Elle est soutenue le 8 janvier 1999. Depuis septembre 1999, je suis Maître de conférences en littérature et civilisation hispaniques médiévales dans cette même université. En 2009-2010, j’ai été membre de l’École des hautes études hispaniques et ibériques de la Casa de Velázquez de Madrid.
Flayosc, le 25 août 1999
Cher Michel,
Je pense au compte rendu que vous m’avez demandé sur Las éticas del exemplum de cette Eloisa Palafox (Université de México), livre très intéressant et qui rejoint mes préoccupations, puisqu’il conclut sur la notion d’autorité (même si je ne partage pas toutes ses analyses).
Septembre, à Paris, sera consacré au remaniement de ma Thèse [L’auctoritas en Castille au XIIIe siècle : l’exemple de Gonzalo de Berceo, soutenue le 8 janvier 1999], en vue de cette possible publication aux CLHM (Cahiers de Littérature Hispanique Médiévale) dont m’a parlé Georges Martin. Il va falloir trancher dans le vif, ce qui n’est sans doute pas si facile. À ce propos, j’ai décidé de ne pas aller à Santander, malgré le grand intérêt du colloque : mes pérégrinations suédoises m’ont laissé sur la paille et je ne suis pas certain d’être payé dès la fin du mois de septembre (je suis même certain du contraire, d’après le Ministère).
Olivier
Paris, le 28 mars 2003
Cher Michel,
Je sais que vous consacrez encore beaucoup de temps à vos activités habituelles (ah ! les Amis du Vieux Chinon !), sans compter les travaux hispaniques récemment engagés. Au fait, où en est votre Poncella ?
Quant à moi, j’ai reçu, ces derniers temps, les Actes de quelques rencontres auxquelles j’ai participé et vous adresse ci-joint deux tirés-à-part.
Dans l’avenir immédiat, j’ai décidé de laisser reposer quelque peu le mester de clerecia et commencer un nouveau cycle de recherches sur la fiction (non seulement à partir d’œuvres de littérature sapientielle, mais aussi, à plus long terme, la fiction telle qu’elle était utilisée par des textes historiques… au même titre que les autorités). Je sens que je vais tôt ou tard croiser le chemin d’un certain don Juan Manuel : vous vous rappelez quelle place de choix il occupait dans un de mes premiers projets de thèse, assez utopique comme il se doit. Il faut coire que je n’ai pas renoncé à étudier les textes de l’Infant, bien que j’aie l’impression trop souvent qu’ils ont une fâcheuse tendance à me glisser entre les doigts…
Olivier
L’Olive, le 30 juin 2005
Cher Olivier,
J’ai enfin eu le temps de lire ton article [« Quelques enjeux de l’exemplarité dans le Calila e Dimna et le Sendebar », Cahiers de narratologie, 12 (2005), publication en ligne : http://narratologie.revues.org/28]. J’en ai retiré, comme toujours, un grand plaisir. Tu sais donner des clefs lecture sans pour autant appauvrir les textes auxquels tu t’intéresses ; au contraire, tu les enrichis en les dotant de dimensions insoupçonnées. Le rapprochement que tu effectues entre les trois contes est très excitant. Il a pour première vertu de montrer que l’on n’épuise pas la portée de ces apologues en leur affectant une seule signification, mais que la lecture doit se faire à plusieurs niveaux -cela, on le savait-, mais surtout dans un contexte rendu sans cesse plus complexe au fur et à mesure qu’on reconnait des pratiques allégoriques (métaphoriques ?) de transfert entre les différents récits. Ce qui est central dans ta démonstration, c’est, bien évidemment, la notion d’instabilité. Je partage ce point de vue, à ceci près que je lui préférai peut-être celle de « plasticité » (je ne sais si le terme est bien choisi), dans le sens où ces apologues sont aptes à s’adapter à un nombre quasi infini de situations (j’exagère peut-être), bref qu’on peut leur faire dire à peu près ce que l’on veut. Il est étrange, à y réfléchir, que l’homme se soit doté en premier (si l’on veut bien admettre que le conte est une des premières et sans doute la plus universelle manifestation de la littérature) d’un genre qui s’apparente plus au système, à l’outil, bref au modèle mathématique, qu’à une praxis à signification unique. La raison en est sûrement que la morale n’avait pas atteint le degré de rigidité qu’elle connaîtrait plus tard, dans les monothéismes, qu’elle admettait l’interprétation, une certaine relativité dans la vérité (qui était loin d’être établie). Au fond, ces pratiques littéraires sont une transposition métaphorique des modalités toujours ouvertes de la morale. La seule exigence incontournable était que le rapport d’interlocution fût sans faille, c’est-à-dire que l’interlocuteur passif fût toujours disposé à entendre ce que l’on avait à lui dire. C’est le seul a priori de ce type de littérature et, sans doute, sa seule limite, si l’on veut bien admettre que la surdité à l’autre est la chose du monde la mieux partagée par tous les humains. Mais peut-être en allait-il autrement dans l’Inde ancienne.
Nous pourrions parler encore longtemps, mais j’ai eu une longue journée : pardonne-moi.
Amitiés, Michel
PS. Connais-tu la communication que je fis à La Corogne sur le Calila ? Mon regard était certes différent, mais puisque tu t’intéresses à l’apologue…
Paris, le 2 juillet 2005
Cher Michel,
Un grand merci, vraiment, pour votre lecture attentive et pour vos commentaires. Le terme de « plasticité » me plaît bien à moi aussi pour caractériser le système de lectures plurielles qu’offrent certains de ces contes orientaux. Vos remarques m’incitent à pousser plus loin la réflexion, ce que j’essaierai de faire à Lyon en décembre. Carlos organise une journée d’études sur l’hétérogénéité de l’œuvre médiévale : je remettrai ces questions sur le tapis, à partir des recueils orientaux, mais aussi du Conde Lucanor. L’idée que le système dépende avant tout d’une énonciation plus que d’un énoncé (et donc, comme vous le dites si bien, de la présence d’un interlocuteur, même passif) est fondamentale à mon sens : des collègues linguistes pourraient peut-être m’aider à approfondir l’analyse de ce point, qui fonde la morale toute pragmatique transmise par ces textes, une morale qui n’est pas réductible à des préceptes ni à aucune formulation verbale. Don Juan Manuel (DJM) le savait bien, qui avait prévu l’inclusion d’une miniature à la fin de chaque conte du Lucanor : l’image devait sans doute moins jouer un rôle illustratif qu’un rôle de confirmation par l’évidence visuelle (un sceau d’autorité). Les vers finaux, eux aussi, comptent moins par leur contenu et leur qualité expressive (DJM était un bien piètre versificateur) que par la validation qu’ils prétendent apporter : c’est parce que DJM a trouvé que l’exemple était bon (comme s’il n’en était pas l’auteur) qu’il a écrit les vers pour en ratifier la pertinence. L’effet de vérité provient alors, moins des mots eux-mêmes que de l’agencement de plusieurs pièces qui viennent providentiellement se corroborer les unes les autres sous l’autorité de DJM. Au fond, je n’ai pas quitté ma réflexion sur l’auctoritas, mais je l’envisage à présent d’un tout autre point de vue. J’espère que cela débouchera sur quelque chose de constructif. Je suis encore dans une phase d’exploration des exempla, mais peut-être est-ce là le début de mes recherches pour une future habilitation (à laquelle je pense sans y penser). À ce titre, le travail sur le LBA l’année prochaine arrive à point nommé (Jean-Pierre s’occupera du CG et moi du TD) : cela me permettra de faire une transition du mester de clerecía vers les narrations exemplaires. Je crois qu’il reste beaucoup à dire sur les exempla castillans, mais il me faut prendre connaissance de toute la bibliographie que j’ignore. Tout cela pour dire que je serais ravi de pouvoir lire votre communication de La Corogne sur le Calila !
J’espère que l’été a bien commencé pour vous. De mon côté, je suis presque en vacances : lundi devrait être ma dernière journée à la fac. J’enchaînerai, dans les jours qui viennent, avec l’harmonisation des premiers articles du dictionnaire qui viennent de me parvenir, tout en commençant un petit débroussaillage du LBA qui, ma foi, s’annonce fort agréable.
Amitiés.
Olivier
L’Olive, le 3 juillet 2005
Mon cher Olivier,
Je te suis bien dans ton raisonnement sur DJM, à ceci près que tu ne devrais peut-être pas limiter ta réflexion aux seules illustrations et sentences versifiées des apologues, mais l’élargir aux trois (voire quatre) livres suivants, ceux des sentences proprement dites. Je serais curieux de savoir comment tu caractérises cette démarche qui prétend, malgré tout, énoncer des préceptes moraux hors de tout contexte narratif, et donc avec une valeur ‘absolue’.
Comme promis, je te transmets le texte de ma communication de La Corogne, non sans te rappeler qu’elle fut prononcée dans un congrès dit de Los Jóvenes Filólogos, et qu’elle était, par conséquent, nécessairement assez éloignée de ta démarche actuelle. (De la mienne aussi, d’ailleurs, mais tu sais que j’ai toujours aimé expérimenter dans des domaines qui ne me sont pas forcément familiers). Cependant, la deuxième partie est susceptible de répondre mieux à ton attente.
J’attends avec intérêt le fruit de tes réflexions. M’en réserveras-tu la primeur ou devrai-je attendre que la Journée de Carlos soit passée ?
Profite de tes vacances. Amitiés, Michel
Paris, le 8 juillet 2005
Cher Michel,
J’ai lu avec grand intérêt et grand profit votre article de La Corogne. Il est d’une précision chirurgicale et la démonstration a quelque chose de mathématique. Bien que mon expérience soit très limitée en la matière, je crois moi aussi qu’il est toujours plus utile et fructueux d’interroger le texte tel qu’il est plutôt que de chercher à tout prix à corriger ses leçons, car ses « erreurs » l’individualisent et sont la marque la plus nette du processus d’écriture qui l’a produit (surtout, comme c’est le cas ici, lorsqu’il y a adaptation ou traduction d’une source unique). Votre développement sur « sauana » me fait songer au profit qu’il y aurait à travailler avec un arabisant pour pleinement apprécier le degré d’originalité de la version castillane. Et, surtout, je suis conquis par votre raisonnement sur le procès de Dimna qui montre cette hésitation entre le besoin de cohérence narrative et le désir de respecter les principes ou les usages juridiques en vigueur en Castille. Vous avez raison de souligner que, dès la version d’Ibn al-Muqaffa, la logique juridique n’est pas claire et que la sentence vient confirmer une conviction déjà faite, comme si les efforts rhétoriques de Dimna (pourtant efficaces contre le sanglier cuisinier et irréfutables en eux-mêmes) ne pouvaient être contrés que par la répression judiciaire (qui par moments s’apparente plus à la force qu’au droit rationnel, me semble-t-il). Ne serait-ce pas une confirmation en creux de l’extraordinaire efficacité argumentative des contes ? Car, pour confondre le conteur (Dimna est le seul à raconter des apologues dans ce chapitre), il faut le faire taire, par le droit ou par la force déguisée en droit. C’est aussi le sort de la femme du roi dans le Sendebar. À l’issue de quel procès ? À partir de quelle preuve décisive qui viendrait rompre la succession des contes ? Les contes de l’Infant ne s’attaquent pas au discours de la femme, pas plus que le procès de Dimna ne cherche à contrer sa parole, mais ils manifestent seulement la légitimité de celui qui parle avec autorité et nient, chez l’autre, toute légitimité à faire usage de la parole. L’énonciation vaut tout là où les énoncés sont indécidables ‑car tous également recevables- (Sendebar) ou carrément irréfutables (Calila). Dans le Calila, l’énonciation du roi-juge, pourtant peu respectueux d’une quelconque ordo juridique, écrase in fine les efforts rhétoriques de Dimna. La raison du plus fort est toujours la meilleure, mais cela n’enlève rien, au contraire, à la valeur du discours exemplaire : les contes sont si forts dans le champ de la parole que, pour les réfuter, il faut sortir de ce champ et couper le sifflet au savant discoureur. Votre article va sans doute apporter de l’eau à mon moulin. Pourriez-vous me donner ses références pour que je le cite dans mes futurs travaux ?
Un grand merci.
Amitiés,
Olivier
Paris, le 15 septembre 2005
Cher Michel,
Voilà septembre et j’ai repris depuis quelque temps déjà le chemin des écoliers ! J’espère que vous avez passé un excellent été et que tout le monde va bien.
J’ai appris avec plaisir par la liste des correspondants de Carlos, dans son message concernant la rencontre de Lyon sur l’hétérogénéité du texte, que vous y participiez. Je serai heureux de vous retrouver dans ce contexte tout à la fois universitaire et amical. Je me dis qu’il n’y a pas eu tant de colloques où nous parlions tous les deux (peut-être seulement ceux de Toulouse sur la translatio et celui de Caen sur le rêve ?… ou est-ce moi qui rêve ?) Dans la lignée des interrogations que je vous avais exposées, je pense présenter quelque chose sur le Conde Lucanor (c’est la première fois que je m’attaque à ce monstre sacré et il y aura d’autres monstres sacrés parmi les participants, ce qui est loin de me rassurer). Comme la plupart des intervenants ne sont pas francophones, je pensais parler espagnol, mais Carlos me dit qu’il vaut mieux parler français car des collègues ou des élèves de l’École non hispanisants se joindront sans doute au public. Et vous, sur quel sujet comptez-vous parler ? Nous avons encore quelques semaines pour réfléchir à cette épineuse question de l’hétérogénéité.
Par ailleurs, je me suis plongé dans le Libro de Buen Amor (LBA) avec beaucoup de plaisir (je suis chargé du TD sur le sujet à Paris 3), bien que j’aie dû momentanément le laisser de côté à cause des examens de septembre et autres corvées liées à la rentrée. L’année s’annonce rude avec le dictionnaire de littérature à boucler et, en plus, ma participation au jury d’agrég. (j’ai été « réquisitionné » par Alet Valero pour l’écrit et pour l’oral : ce sera sûrement très intéressant, notamment avec le LBA au programme, mais aussi très lourd).
Si vous le voulez bien, je vous demanderai de temps en temps votre avis sur telle ou telle strophe du LBA, telle ou telle interprétation, etc., car je crois qu’il serait absurde de travailler dans mon coin. La liste Rimar va peut-être reprendre du service à cette occasion, car je ne dois pas être le seul à espérer compter sur la solidarité des médiévistes cette année !
À bientôt. Amitiés,
Olivier
L’Olive, le 12 décembre 2005
Cher Olivier,
Comme promis, je t’adresse les trois rubriques du dico [Dictionnaire des Littératures hispaniques. Espagne et Amérique latine, Paris, Robert Laffont, Col. Bouquins, 2009].
Amitiés, Michel
Paris, le 12 décembre 2005
Cher Michel, vos articles, que je viens de lire rapidement, me semblent parfaits. Si seulement les autres collaborateurs m’envoyaient tous des textes aussi précis, concis et clairs, mon travail serait bien allégé ! Hélas, il n’est pas rare que je doive réécrire complètement les articles, en me mettant, en plus, dans une situation embarrassante vis-à-vis des collègues en question.
Je vous remercie très chaleureusement. Votre aide m’est précieuse.
Et maintenant, une demande que je vous fais à ce sujet, la dernière : vous laisserez-vous fléchir et accepterez-vous que votre nom soit finalement mentionné dans le dictionnaire ? Je serais heureux que ça soit le cas, même s’il va sans dire que je comprends aussi vos réticences et que je n’ai pas à discuter votre décision.
Encore merci et à bientôt.
Amitiés,
Olivier
PS : Avez-vous fini Pars vite et reviens tard de Fred Vargas, que vous lisiez à Lyon ? Un régal, non ?
Paris, le 15 janvier 2006
Cher Michel,
Avec bien du retard, je vous adresse mes meilleurs vœux pour 2006.
Le rythme est repris et j’essaie toujours d’intéresser mes étudiants au Libro de buen amor, avec des résultats inégaux au vu de leurs copies. Plus le temps passe et plus je me rends compte à quel point c’est une œuvre riche et difficile. Je vais aussi faire quelques interventions dans d’autres universités sur le. Puis viendront les travaux du jury d’agrégation, ce qui ne va pas être une partie de plaisir, je pense.
Je n’ai absolument pas eu le temps de reprendre mon intervention de Lyon [colloque « L’hétérogénéité du texte médiéval » (ENS de Lyon, décembre 2005, actes publiés en ligne dans Atalaya, 11, 2009, https://journals.openedition.org/atalaya/68], d’ajouter les notes de bas de pages, etc.
Amitiés,
Olivier
L’Olive, le 16 janvier 2006
Cher Olivier,
Nous aussi, nous vous souhaitons une bonne, fructueuse et joyeuse année 2006.
Crois-tu vraiment qu’il faille donner à nos communications une tournure écrite ? Je croyais que leur diffusion sur l’internet devrait suffire à satisfaire la curiosité de nos collègues à travers l’univers. C’est la première fois que je me vois et m’entends aussi longtemps et, à ma grande surprise, je ne me déteste pas autant que j’aurais pu le supposer, même si je me laisse aller à de coupables facilités de pédagogue. De là à tomber dans l’autocomplaisance…
Le LBA est un énorme sujet de perplexité pour qui se donne la peine de l’étudier sérieusement. C’est plutôt bon signe : on n’est pas près d’épuiser nos trésors médiévaux.
Amitiés, Michel
Paris, le 31 mai 2006
Cher Michel,
Je vous souhaite un très bon anniversaire ! D’après la radio, toujours bien informée pour les sujets anecdotiques, il paraît que l’on n’a pas vu un 31 mai aussi froid en France depuis 1970.
Cette petite pause me sera des plus salutaires : j’étais à Toulouse hier pour la réunion d’admissibilité d’agrég., repars à Madrid pour une table-ronde à la Casa la semaine prochaine (et je n’ai pas encore écrit une ligne), pour enchaîner avec les oraux toulousains jusqu’au 4 juillet.
J’espère que tout va bien pour vous.
Amitiés,
Olivier
L’Olive, le 31 mai 2006
Cher Olivier,
Moi aussi je te souhaite un joyeux anniversaire en si bonne compagnie. Je ne me souviens pas de la température qu’il a fait le 31 mai depuis que je le fête mais le souvenir que j’en garde est plutôt ensoleillé, sans doute parce que je suis d’un naturel optimiste. Depuis quelque temps, c’est moins gai parce que les perspectives d’avenir se rétrécissent : c’est la soixante-cinquième fois aujourd’hui, enfer et damnation ! J’entre vraiment dans l’âge de la retraite.
Bonne fête pour ce soir et mes amitiés pour toi et autour de toi. Michel
PS. Sur quoi porte la table-ronde de la Casa?
_________
Paris, le 13 juin 2006
Cher Michel,
Je rentre de Madrid. La table-ronde de la Casa était consacrée à un beau sujet : « La parole des rois (royaume de Castille et Couronne d’Aragon, XIIIe-XVe siècles) ». Je joins le programme, que je vous ai scanné. J’ai beaucoup apprécié cette rencontre à taille humaine, où nous avions vraiment le temps de nous exprimer et où les échanges n’ont pas été de pure forme. J’ai noué aussi des contacts avec des collègues que je ne connaissais pas ou que je connaissais à peine. Sans compter qu’il est toujours délicieux de passer quelques jours à Madrid pour rompre l’effrayante routine parisienne.
Je joins aussi un fichier nommé « sujets sur le Libro de Buen Amor et Agrég » : il s’agit des sujets que je donne au CNED pour la préparation à l’agrég. sur le Libro de Buen Amor l’année prochaine. Je pense que le sujet de dissertation vous fera sourire et vous rappellera de bons souvenirs.
Je vis avec le LBA en ce moment. D’ailleurs, je pars à Toulouse demain pour les oraux.
Bien amicalement,
Olivier
Préparation à l’Agrégation externe d’Espagnol 2007 Olivier Biaggini
Libro de buen amor
I. Sujet de composition en français (dissertation)
« fasta que el libro entiendas, dél bien non digas nin mal,
ca tú entenderás uno e el libro dize ál » (986cd)
À propos de ces vers du Libro de buen amor, Michel Garcia écrit :
« Cette affirmation, selon laquelle le sens du texte échappe, quoi qu’il fasse pour le découvrir, au lecteur le plus attentif, dépasse largement le champ auquel l’auteur entend ici l’appliquer, à savoir son interprétation morale. Elle concerne le sens même de toute littérature, qui ne saurait être épuisé par aucune tentative d’interprétation. Elle semble même affirmer que la recherche du sens est, par définition, vouée à l’échec, dès l’instant où l’on veut circonvenir celui-ci dans sa totalité. Il s’agit ici d’une considération qui concerne toute écriture. Son originalité – voire sa modernité – réside dans le fait qu’elle privilégie la production du texte sur sa réception. Tout se passe comme si l’auteur se ménageait un domaine dont il excluait son lecteur potentiel. »
Commentez et discutez ce jugement en l’appliquant à l’œuvre entière.
II. Sujet d’explication de texte en espagnol
Coplas 910-933 (L’entremetteuse).
L’Olive, le 31 août 2006
Cher Olivier,
J’ai retrouvé ce message adressé par moi à Valero, peu après ma conférence de Toulouse aux Agrégatifs. Je sais par Carlos que, depuis, vous avez changé de président du jury, même si je me suis empressé d’oublier son nom (ma mémoire devient de plus en plus sélective), mais je ne voulais pas que ce courrier, qui n’a pas mérité même un accusé de réception, se perde tout à fait. Je te l’adresse donc, comme contribution à l’histoire du jury de l’Agrégation d’espagnol, et à toutes fins utiles, puisque tu y es plongé jusqu’au cou.
J’espère que tu as passé de bonnes vacances.
Amitiés, Michel
[17-12-2005] Mon cher Valero,
Avant toute chose, je tiens à faire amende honorable, car les propos que j’ai tenus devant toi, en octobre dernier, lors de notre rencontre de Toulouse, sont largement injustifiées. Ils étaient inspirés par une bibliographie très imparfaite qui m’avait été communiquée, je ne sais plus par qui, et qui n’a rien à voir avec celle que le jury a publiée, laquelle est très complète. Donc, au temps pour moi.
Dans ces conditions, je me vois mal donner une leçon aux collègues qui ont fort bien fait leur travail, même si je ne partage pas entièrement leur démarche. Une bibliographie résulte d’un choix et tout choix est discutable, mais le mien ne serait pas nécessairement exempt de critiques.
Je me contenterai donc de quelques suggestions qui pourraient leur être soumises, si tu le souhaites.
Éditions
– Ajouter en Texte d’appui l’édition paléographique de M. Criado del Val et Eric W. Naylor, Madrid : C.S.I.C., 1972.
– Traduction française, chez Stock : est-elle anonyme ?
Catalogue bibliographique. Je recommanderais celui-ci :
– G. Orduna, G. Olivetto, H. O. Bizzari, “El Libro de Buen Amor. Cuaderno bibliográfico n°9”. Boletín bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, fasc. 8 (año 1994), p. 237-376 (1092 entrées). Consultable sur le site de la AHLM.
Présentation. Pour instaurer un minimum de hiérarchie selon l’importance des travaux proposés, il vaudrait mieux citer d’abord les ouvrages (collectifs ou non), puis les articles.
Ouvrages collectifs. Ajouter :
– Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, y el Libro de Buen Amor. Actas del Congreso Internacional del Centro para la edición de los clásicos españoles (Alcalá la Real, 9-11 de mayo del 2002), a cargo de Bienvenido Morros y Francisco Toro. Alcalá la Real : Ayuntamiento, MMIV.
– Les deux recueils parus cette année chez Ellipses et Le Temps.
Ouvrages
– Félix Lecoy, plutôt dans la réédition de 1974, chez Gregg International, à cause de l’Introduction d’Alan Deyermond et de la bibliographie mise à jour (à l’époque).
Articles
– La liste est un peu trop copieuse à mon goût et risque d’égarer les candidats au lieu de les guider, d’autant qu’ils disposent aussi des notes explicatives des éditions ; de plus, elle mériterait d’être actualisée en recourant aux bibliographies de certaines des contributions incluses dans les recueils collectifs récemment parus. Je m’exprime mal : au lieu de donner des articles anciens qui sont déjà exploités par l’éditeur du texte, il vaudrait mieux indiquer des articles récents qui peuvent apporter quelque chose de nouveau aux candidats. C’est mieux ainsi ?
J’ai été très touché par la présentation élogieuse que tu as faite de moi devant les étudiants, et je t’en remercie.
Bien amicalement à toi, Michel Garcia
Paris, le 1er septembre 2006
Merci, cher Michel, pour cette mise à jour de la bibliographie officielle : elle ne profitera pas à tous les candidats de France, mais au moins aux étudiants de Paris III. J’avais moi aussi signalé quelques bévues à Hélène Thieulin au moment où j’entrais au jury (« Eyerbe-Chaux » au lieu de « Ayerbe-Chaux ») car elle m’avait communiqué la bibliographie avant sa publication, mais les erreurs sont restées. Le président du jury a changé, vous êtes bien renseigné, et avec lui les dates du concours, reculées d’environ 15 jours, ce qui signifie que les oraux se termineront presque à la fin juillet, si j’ai bien compris (mais je crois que c’est le cas pour toutes les agrégations). L’expérience du jury a été pour moi somme toute profitable, malgré le rythme intense, car c’est une occasion d’apprécier le résultat de tout le travail que nous produisons en amont. Certaines prestations étaient un régal. C’est évidemment plus gratifiant que des oraux de deuxième année, avec l’idée aussi que les candidats sont suffisamment mûrs, parfois, pour rendre leur propos vraiment personnel, au-delà des connaissances communes.
Amitiés,
Olivier
Paris, le 6 février 2007
Cher Michel,
Voilà bien longtemps que je ne vous avais donné de mes nouvelles. J’ai le plaisir de vous transmettre un tiré-à-part d’un travail que j’avais fait sur la figure de l’homo viator (dans le cadre d’un colloque déjà ancien qu’Estrella Ruiz avait organisé à Caen). Je ne crois pas qu’il soit très novateur et je le considère plutôt comme un prolongement de ma Thèse un peu tard venu. Je pense être maintenant passé à autre chose en m’intéressant à la prose exemplaire et j’aurais préféré vous envoyer un tiré-à-part de mon article sur la parole des rois dans les recueils d’exempla (publié électroniquement dans le dernier numéro d’e-Spania) qui reflète bien mieux mes préoccupations actuelles en termes de recherche.
Bien amicalement à vous, Olivier
L’Olive, le 30 mai 2007
Mon cher Olivier,
Je viens de lire en détail ta contribution, que je n’avais fait que survoler lors de la réception du volume. Tu t’es parfaitement bien tiré du traquenard tendu par le thème du colloque : on sait, en effet, à quelles contorsions chacun est condamné pour faire coïncider peu ou prou (plutôt prou que peu dans ton cas) ses préoccupations du moment avec les exigences des organisateurs. Remarque bien que le sujet choisi était fédérateur et pas trop tiré par les cheveux, comme il arrive parfois lorsqu’on veut concilier des époques et des domaines différents.
Je retiens, quand même, que l’essentiel de ton propos concerne la fiction, son statut et ses modalités. Tu me diras si je me trompe, mais j’ai le sentiment que la feinte est avant tout un procédé et, si elle peut enrichir la fiction voire l’obliger à se redéfinir, elle n’appartient pas au même registre. J’ai relevé, à propos de la fiction, des formules vraiment bien venues, tant de Searle (que je n’ai pas lu) que de toi (au bas de la page 407, même si je ne partage pas l’équivalence posée entre feinte et fiction): l’un qui ignore la vérité de la situation tout en croyant la connaître, l’autre qui connaît la vérité de la situation tout en sachant qu’elle est fictive. C’est du grand art.
Justement, tu me dis gentiment que tu as lu ma Pucelle [Juan de Gamboa, La Pucelle de France, Fayard Mazarine, 2007]. N’as-tu pas été frappé par l’importance de la fiction et sa double (ou plus) finalité, au regard de la réalité historique française, et au regard du public castillan (d’hier et d’aujourd’hui), l’un et l’autre se croisant en diagonale (si j’ose dire), puisque la réalité historique ne concerne que tangentiellement un lectorat castillan, et que la fiction n’a de sens pour le lectorat français (d’aujourd’hui, et d’hier ?) que si elle reste dans les limites de la mythification du personnage. Je ne saurais mieux dire combien ces paramètres créent à mes yeux une situation confuse. Ce serait épatant si tu acceptais de t’y coller. Avec ta compétence en la matière, tu feras des merveilles ; en outre, tu ajouteras ainsi la Pucelle (qui n’est pas ma propriété) dans ta besace d’analyste du récit. Qu’en penses-tu ?
À propos de fiction, la lecture du dernier supplément littéraire du Monde, consacré au roman, m’a interloqué, dans la mesure où le point du vue adopté, en se limitant au seul roman, lui réserve l’exclusivité de la fiction. Comment peut-on négliger à ce point l’énorme production -orale autant qu’écrite- qui fait de la fiction sa raison d’être, bien avant l’invention du roman. J’ai tendance à penser que le langage (en tant qu’opération de l’esprit) et l’art de conter sont nés en même temps, et qu’il n’y aurait pas de société humaine sans cela. J’ai honte à le rappeler, après tant de mythologues.
J’espère que tout va bien pour toi et que les copies d’Agrég ne te prennent pas trop de temps.
Amitiés, Michel
PS. Pense à faire acquérir la Pucelle par toutes les bibliothèques que tu fréquentes assidûment (y compris celle du Colegio). Merci.
Paris, le 31 mai 2007
Cher Michel,
Je vous remercie beaucoup pour votre lecture (toujours aussi attentive) de mon article sur la fiction. Ces problèmes m’intéressent bien et je pense que si je me lance, tôt ou tard, dans une habilitation, ce sera sur les rapports de la fiction et de l’exemplarité. Vous emboîter le pas et travailler sur la Pucelle ne serait pas une mauvaise idée, je vais y songer ! Il faudrait d’abord que je lise sérieusement le texte dans sa version originale (ce qui me permettra, d’ailleurs, d’apprécier votre traduction d’une façon différente). Une question que je me pose : Gamboa, selon vous, a-t-il assumé pleinement sa « mise en fiction » ? Par là, je me réfère au pacte de lecture : attend-t-il de ses lecteurs qu’ils acceptent les événements décrits comme véritables, comme c’est le cas dans une chronique (dans ce cas, on aurait davantage une falsification qu’une fiction de notre point de vue), ou bien les références aux conventions chevaleresques, les multiples concessions au goût littéraire du public et autres arrangements repérables dans le texte sont-ils autant d’invitations à assumer la fiction qui s’empare de la matière historique ? Mais peut-être que la question même n’a pas grand sens du point de vue de l’écrivain médiéval. Ce qui peut nous mettre aussi sur les traces de la fiction, peut-être, ce sont les emprunts à d’autres genres que vous signalez dans votre postface (genre épistolaire, discours, arts de gouverner) : ces genres ne relèvent pas en eux-mêmes de la fiction mais leur présence plus ou moins diffuse pointe que la relation des faits est parfois, sinon un prétexte, du moins le support d’une recomposition qui les dépasse.
Les spécialistes du Zifar ont parfois insisté sur l’importance de la forme miscellanée dans l’émergence de la fiction romanesque. Il y aurait peut-être une piste dans cette direction.
Recevez mes amitiés.
L’Olive, le 31 mai 2007
Cher Olivier,
Je t’avais déjà envoyé mon message quand je me suis souvenu que tu fêtais aussi ton anniversaire aujourd’hui. Je pensais, pour une fois, te précéder, mais « el gozo en el pozo », tu m’as encore battu de vitesse.
Je répondrai plus longuement à ton message, mais je peux, d’ores et déjà, t’indiquer quelques indices d’un jeu sur l’écriture de la part de l’auteur. Cf. p. 78 et n. 1, p. 201, fin du 1er §, sans compter les aveux d’impuissance devant la lourde tâche du conteur. Il a bien conscience d’écrire une fiction, à moins qu’il ne se sente prisonnier de la matière fournie par ses informateurs français.
Amitiés, Michel
L’Olive, le 4 avril 2009
[Message adressé à tous les contributeurs de la traduction du Livre de Bon Amour, Stock/Moyen Âge, 1995, membres du séminaire du Centre de Recherches sur l’Espagne Médiévale de Paris 3 (CREM), qui s’est tenu au Collège d’Espagne de la Cité Universitaire de Paris jusqu’en 2001. Olivier Biaggini avait accepté, en outre, de m’accompagner dans l’ultime révision].
Chers amis,
Peut-être aimerez-vous savoir que notre traduction commune du Livre de Bon Amour m’a fourni la matière d’une communication devant un public de Ruizistes convaincus. Le sujet était peu orthodoxe, j’en conviens, pourtant il témoignait d’une intimité acquise de longue lutte avec le poète, qui me semblait convenir particulièrement à un exposé prononcé dans la ville où il est supposé être né [Alcalá la Real, province de Jaén]. J’espère que vous y retrouverez un peu de cette atmosphère chaleureuse et animée qui a accompagné notre travail. Sachez, que pour moi, ce fut un des meilleurs moments vécus dans notre Séminaire.
Recevez mon bien cordial souvenir. Michel Garcia
PS. Je vous signale qu’il me reste quelques exemplaires de notre traduction, certains un peu (à peine) défraîchis. Si, à l’occasion, vous passez par L’Olive, je vous en donnerai avec plaisir.
Paris, le 4 avril 2009
Cher Michel,
Merci beaucoup pour votre envoi ! J’ai parcouru votre communication (qui commence avec une référence – consciente ou inconsciente ? – à la carta liminaire de la Célestine) et je vais la lire attentivement, en quête de souvenirs. Les souvenirs de ce séminaire me sont chers… et je me rappelle aussi l’harmonisation finale, qui n’avait pas été une mince affaire, mais qui m’avait obligé à me poser des questions sur l’œuvre que je ne me serais sans doute jamais posées sans cette lecture maniaque du texte qu’exige la traduction. Je me rappelle aussi que vous m’aviez envoyé mon exemplaire alors que j’étais à Madrid et que c’était la première fois que je voyais mon nom écrit dans un livre. Ce détail me fait sourire, d’autant que j’ai une nouvelle à vous annoncer qui réunit elle aussi Madrid et le Livre de Bon Amour.
Recevez mes amitiés,
Olivier
L’Olive, le 4 avril 2009
Cher Olivier,
C’est à cause de coterráneo que tu penses à Célestine ? Cela m’avait échappé. En revanche, l’allusion au sermón jocoso et la formule por arte de birlibirloque ne sont pas involontaires. La seconde te parlera sûrement.
Je n’ai pas oublié non plus nos séances estivales de la rue Vergniaud. Confidence pour confidence, j’estimais que cet exercice, alors que tu n’étais pas encore sorti du nid, te serait très salutaire. Je vois que je ne me suis pas trompé.
Je suis très heureux que tu puisses passer une année à Madrid. Je trouve, cependant, que c’est bien court. Il te faudra mettre à profit la moindre minute mais, d’un autre côté, il serait bien dommage que tu ne transformes pas ce séjour en une aventure à deux, car l’occasion ne vous en sera peut-être plus jamais donnée. Or, je sais par expérience que ce genre d’expérience laisse des souvenirs impérissables. Merci, en tous les cas, de m’en avoir donné la primeur, ou presque. Il est rare que je sois informé aussi vite de ce qui se passe dans notre monde.
J’ai la nostalgie de Madrid. Mais j’appréhende d’y croiser trop de fantômes, car nous avons perdu les très chers amis que nous y avions. Je m’étais pourtant promis d’y aller cet hiver, mais je ne m’y suis pas décidé. Peut-être franchirai-je le pas, si mon projet de recherche sur la chronique d’Henri III de Castille prend corps.
Merci de ta fidélité.
Amitiés, Michel
L’Olive, le 2 octobre 2009
Cher Olivier,
Je viens de recevoir un exemplaire du Dictionnaire des Littératures Hispaniques. Je te remercie de cette généreuse attention. Grâce à lui, j’ai déjà comblé, à peu de frais, quelques graves lacunes de ma culture littéraire.
Nous serons très probablement à Madrid du 10 au 12 novembre.
J’espère que tout se passe bien pour toi et que tu avances à pas de géant.
Amicalement,
Michel
Madrid, le 2 octobre 2009
Cher Michel,
J’espère que le dictionnaire vous plaît. En fait, il contient quelques grosses bourdes (qui, pour la plupart, incombent à l’éditeur…), y compris dans les noms des coordinateurs et contributeurs. Un des points les plus graves, du point de vue déontologique, est que l’éditeur s’est permis d’ajouter un article qui n’était pas prévu (sur Carlos Zafón) sans en avertir le responsable scientifique : le but de la manœuvre est commercial, car cet auteur a été publié par le même groupe de presse… À part ça, la correctrice de chez Laffont n’a pas hésité à modifier beaucoup de choses (pas seulement quant à l’expression et au style, mais aussi sur le contenu, jusque dans les faits et des dates !) dans certains articles de collègues médiévistes : j’avais réagi au moment où j’ai relu les épreuves, mais mon avis n’a pas toujours été suivi. Bref, il y a beaucoup d’imperfections, mais je crois que, globalement, c’est un bel outil et je me suis plu, moi aussi, à vagabonder au fil des pages. En tout cas, je suis soulagé qu’il soit sorti, car il m’a vraiment fait suer sang et eau pendant plus de six ans.
Je serai content de vous voir à Madrid.
J’ai renoué avec la BN ces derniers jours et je travaille sur un très beau manuscrit illustré des Castigos de Sanche IV que vous connaissez sans doute (le MS. C, i.e. MS. 3995). Mon but est d’étudier le rapport entre l’image et l’exemplarité. J’aurai grand plaisir à en parler avec vous. Par ailleurs, en novembre, peu après notre rencontre (à partir du 16), j’irai à Valladolid quelques jours : la Casa m’a demandé de participer à un atelier de formation doctorale pour de jeunes médiévistes espagnols, français et portugais. J’ai pas mal d’autres projets dont je vous parlerai.
Et vous, sur quoi travaillez-vous en ce moment ? Allez-vous profiter de votre séjour en Espagne pour hanter les bibliothèques (sans doute pas à Madrid, car vous n’y serez que de passage) ? À part Madrid, où comptez-vous aller ?
Bien amicalement à vous,
Olivier
L’Olive, le 3 octobre 2009
Cher Olivier,
Il m’est difficile de prendre rendez-vous dès maintenant. Outre que nous avons beaucoup d’amis à voir, nous devrons ménager notre hôte [Enrique Toral Peñaranda] qui se fait une joie de partager des moments avec nous. Or, il a 90 ans et nous devrons nous adapter quelque peu à son rythme de vie. Il faudra donc improviser.
Je n’aurai pas le temps de visiter les bibliothèques mais je songe, en confidence, à me préparer un point de chute pour un séjour d’une certaine durée, car je veux travailler sur la version inédite de la chronique d’Henri III de Castille.
L’objectif principal de ce voyage est de renouer avec des amis que nous avons perdus de vue depuis plusieurs années, à Madrid et en Andalousie (Jaén, Séville et autres lieux) et, ce qui n’est pas négligeable, forcer Michèle à se reposer de ses travaux quotidiens.
Tes recherches m’intéressent toujours. Tu peux compter sur moi pour d’éventuelles lectures, si cela te chante.
Le monde de l’édition a un fonctionnement surprenant, vu de l’extérieur, mais pas tant que cela si on admet qu’ils fabriquent un objet destiné à la vente et susceptible de rapporter des bénéfices substantiels à l’éditeur. Le travail collectif ne fait qu’aggraver les choses en multipliant les ‘décideurs’.
Nous aurons beaucoup de choses à nous dire.
Vale, Michel
L’Olive, le 6 février 2014
Chers amis,
Le Comte Lucanor figure au programme de l’Agrégation d’espagnol 2015 et ma traduction, qui est épuisée, va être republiée à l’occasion (après un sérieux toilettage). J’aurai besoin qu’Olivier, qui sait tout sur ce sujet, m’aide à compléter la bibliographie, en y incluant les publications postérieures à 1994. Tu veux bien ?
À bientôt de vos nouvelles,
Amitiés,
Michel
Paris, le 7 février 2014
Cher Michel,
Merci pour vos messages !
El Conde Lucanor devrait, en effet, être au programme de l’agrégation 2015 : il reste un doute, cependant, car j’ai entendu dire (par Hélène Thieulin, qui est entrée au jury cette année) que le jury avait du mal à trouver une édition sérieuse qui ne soit pas épuisée : apparemment, celle de Serés, chez Crítica, n’est plus disponible, même dans sa version allégée, et les vérifications sont en cours pour celle de Sotelo, chez Cátedra. Si la bonne nouvelle de ce retour du Moyen Âge au concours est confirmée, les travaux sur El conde Lucanor vont se multiplier en France, ce qui est une excellente chose. La réédition de votre traduction inaugure ce bel élan ! Je vais vous préparer demain matin et vous envoyer une petite bibliographie d’études parues depuis dix ans : elle sera nécessairement subjective et reflètera mes propres préoccupations, mais vous ferez ensuite le tri en fonction de vos préférences. Je vous propose d’exclure les articles qui ne sont consacrés qu’à un seul exemplum car, sinon, la liste peut être vraiment très longue. En m’en tenant à ce critère, je pourrais me limiter à 20-25 titres : vous me direz si cela convient. Par ailleurs, une proportion importante des titres sera nécessairement en anglais, car c’est aux États-Unis et au Canada que les « études lucanoriennes » ont connu leur renouveau le plus spectaculaire ces dernières années (notamment grâce à deux livres importants, celui de Laurence De Looze, surtout, et celui de Jonathan Burgoyne, dans une moindre mesure).
Je vous récris demain !
Amitiés,
Olivier
Cher Michel,
Voici, en document joint, la petite bibliographie sur El conde Lucanor que je vous propose. Si vous avez besoin de quelque chose de plus substantiel, je peux, bien sûr, allonger la liste, notamment en ajoutant des études consacrées à des exempla individuels de la première partie. Vous me direz…
À bientôt !
Bien amicalement à vous, à Michèle et aux enfants,
Olivier
Aïe, j’aperçois une erreur au moment où je vous envoie ma bibliographie… Elle concerne un de vos articles (vous l’auriez corrigée sans moi, mais j’espère qu’il n’y en pas d’autres de ce type dans d’autres références) : votre article sur l’obéissance aveugle est bien de 2011 (et pas de 2001)…
Amitiés,
Cher Olivier,
C’est plus qu’il ne m’en faut. Merci infiniment. Je suivrai ton conseil sur les articles consacrés à un seul exemplum. D’ailleurs, mon édition n’a pas d’autre objet que de faciliter la compréhension des textes, d’éviter les contre-sens (même si j’en commettrai moi-même) et d’éclairer quelque peu la composition de l’ouvrage et sa distribution.
Je ne crois pas avoir ton article de Voz y Letra. Ce serait aimable à toi de me l’envoyer (en version numérique, cela m’irait très bien).
Aurais-tu les ouvrages de Burgoyne et De Looze ? Si tel était le cas, accepterais-tu de me les prêter ? Patrice passerait les prendre.
Je suis surpris d’apprendre que le Serés n’est plus disponible (j’ignorais l’existence de la version allégée). Je vais commander celle de Cátedra. Le président du jury m’a assuré que le texte serait bien au programme. Peut-être a-t-il obtenu des assurances de ce côté.
Je me réjouis des bonnes nouvelles de toute la maisonnée. J’espère que vous allez trouver bientôt la nounou dont vous avez besoin.
Merci de tout cœur pour ton aide.
Amitiés,
Michel
PS. Je viens de lire ton nouveau message. Ne te mets pas martel en tête, je ferai les vérifications qu’il faut. D’ailleurs, je n’avais pas l’intention d’inclure cet article de moi.
Paris, le 13 février 2014
Cher Michel,
J’espère que vous avez bien reçu ma bibliographie sur le Conde Lucanor. Pour une bibliographie plus systématique (et sans parti pris), j’ai pensé aux bulletins publiés régulièrement sur le site Parnaseo par l’université de Valence. Je vous les adresse ci-joint. Ils concernent toutes les œuvres de Don Juan Manuel, mais les titres relatifs au Conde Lucanor apparaissent dans une section à part. J’en profite par ailleurs pour vous envoyer un de mes nouveaux articles, publié tout récemment dans la revue Crisol (il est daté de 2013, mais, en fait, il est paru il y a quelques jours).
Amitiés,
Olivier
Paris, le 3 mars 2014
Cher Michel,
Je ne sais pas de quand date votre message. Vous n’y faites pas allusion aux documents que je vous ai déjà envoyés par mail la dernière fois et je me demande si vous les avez reçus. J’en doute d’autant plus, maintenant, que la réponse à vos deux dernières questions se trouvait dans ces documents.
1. Concernant le numéro du Boletín Bibliográfico consacré à la bibliographie sur Don Juan Manuel : les documents bibliographiques que je vous avais envoyés (et que je vous renvoie ci-joint) le citent, car ils ne font que l’actualiser. Les références sont précisées en introduction. Il s’agit de :
– María Jesús Lacarra y Fernando Gómez Redondo, « Bibliografía sobre don Juan Manuel », en Vicente Beltrán, ed., Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, 5, 1991, pp. 179-212.
D’après ce qui est précisé aussi, ce Boletín Bibliográfico avait été lui-même déjà actualisé dans Memorabilia, 2 (1998).
3. En ce qui concerne le livre de Salvatore Luongo, je l’avais inclus dans la petite bibliographie personnelle regroupant la vingtaine de titres (parus depuis 1994) qui me semblaient importants (je vous la renvoie également ci-joint). Je ne l’ai pas sous la main, mais je l’ai lu quand j’étais à Madrid il y a trois ans et j’ai trouvé que c’était un bon livre.
J’espère que tout cela ne vous parviendra pas trop tard. Dans tous les cas, s’il vous plaît, envoyez-moi un petit mot afin que je sache si vous recevez mes mails ou si nous avons un problème informatique (ce ne serait pas la première fois qu’internet jouerait un de ses mauvais tours).
Amitiés,
Olivier
Cher Olivier,
Je tiens à te rassurer tout de suite : j’ai bien reçu tes e-mails et en ai fait mon profit, comme n’aurait pas manqué de le dire Lucanor.
Mes questions portaient sur des détails. Je conclus que j’ai bien fait d’inclure Luongo.
Pour ce qui est du Boletín bibliográfico de Gassó et Cie, j’ai eu quelques doutes concernant le lieu de publication des deux premiers Bulletins, mais je viens de les repérer, grâce à toi dans Memorabilia. Donc tout est bien.
Merci pour ton aide.
Amitiés,
Michel
Paris, le 31 mai 2014
Cher Michel,
Je vous souhaite un joyeux anniversaire et une belle journée ensoleillée ! Sauf erreur de ma part, vous devez être en Espagne, au congrès sur le Buen amor : vous passerez donc cette journée dans une atmosphère chaleureuse, entouré de collègues et amis de longue date !
J’en profite pour vous donner quelques nouvelles.
Jean-Pierre m’a dit tout récemment que la nouvelle édition de votre traduction du Lucanor était sortie, mais je ne l’ai pas encore vue. Le Lucanor, vous vous en doutez, continue à bien m’occuper : on vient de me confier la préparation d’un manuel (à rendre pour la mi-juillet, c’est un peu de la folie…) à paraître aux PUF en coédition avec le CNED, dans la collection où Carlos avait publié le sien sur la Célestine. J’y travaille dès que j’ai un moment de liberté mais le temps a décidé de nous filer entre les doigts. Je compte sur nos futures journées à la BN pour bien avancer. Je ne vous parle pas de Paris 3, où une nouvelle réforme laisse notre filière au bord du précipice, car ce n’est pas un sujet décent pour un jour d’anniversaire.
Profitez bien de votre séjour en Espagne et transmettez mes amitiés à Michèle et aux enfants,
un fuerte abrazo,
Olivier
Cher Olivier,
J’ai trouvé ton message, hier soir, retour d’Espagne, ce qui explique que je te souhaite ton anniversaire avec quelque retard. Je ne doute pas que tu aies passé une belle journée en ta féminine compagnie, que tu salueras bien dévotement de ma part (et de celle de Michèle).
Je te répondrai plus longuement un de ces jours.
Je t’ai réservé un exemplaire de ma traduction du Conde Lucanor. Je te l’adresserai par la Poste, à moins qu’Ana Botella, qui vient passer ce week-end à L’Olive, n’accepte de te le remettre. Moi aussi, j’ai dû jouer serré, car on ne m’a laissé que trois semaines pour la révision. J’ai intégré l’approche numérique des livres de sentences et aussi du livre des exempla que j’avais publiée peu après la première édition. J’ai aussi revu la traduction, que je trouvais un peu trop « moyen âgeuse ». Mon but n’est pas de lucirme mais bien de fournir des clefs d’interprétation à un lectorat peu habitué au castillan du XIVe et au style de Don Juan Manuel.
Profitez de votre séjour à Madrid.
Miguel
Paris, le 19 juin 2014
Cher Michel,
Je viens de recevoir la nouvelle édition de votre traduction de El conde Lucanor, à la couverture blanche fort élégante. La nouvelle mouture de l’introduction, que je viens de lire, me paraît très réussie : les éléments provenant de votre article sur les nombres sont bienvenus et invitent à différents « parcours » au sein de l’œuvre (j’ai même pensé à Rayuela de Cortázar !). Un grand merci à vous pour cet envoi. Je suis sûr que votre traduction sera très utile aux agrégatifs cette année. Je me chargerai du TD à Paris 3 et le CM sera commun à Paris 3 et Paris IV (assuré par Jean-Pierre et Hélène). En ce moment, entre réunions et examens à Censier, j’essaie d’avancer dans la rédaction du manuel que j’ai accepté de faire pour les PUF, mais le temps presse (il me reste seulement un petit mois) et il est bien compliqué de synthétiser de façon pertinente tout ce que j’ai pu lire sur le sujet. Le Lucanor est maintenant une œuvre qui m’est familière et, pourtant, elle continue toujours à résister à un regard trop systématique : je me dis que ce caractère inépuisable est peut-être la marque des grandes œuvres…
Merci encore d’avoir pensé à moi.
J’espère que l’été se présente au mieux pour vous tous.
Amitiés,
Olivier
Cher Olivier,
Je me réjouis que tu aies reçu ton exemplaire. Grâce à toi, je suis informé que le service de presse a été envoyé par Flammarion, ce que j’ignorais jusque-là.
Si je peux me permettre de te donner un conseil, ne te mets pas martel en tête pour ton livre. Ce n’est pas parce qu’il a abandonné le format du polycopié, qui était celui des publications du CNED, pour adopter celui, plus noble, du volume imprimé, qu’il a changé de nature. Conçois-le comme un cours et rien de plus. Songe à ton public potentiel et tu verras que tu es très largement au-dessus de la gravité de la tâche. Conseil de – vieil – ami.
Nous ne bougerons pas de tout l’été. La perspective de devoir prononcer la conférence inaugurale du congrès Convivio à Rennes, en septembre, menaçait de gâcher mes vacances, mais cela va mieux depuis que je me suis rendu à l’évidence que je devais être modeste dans mes ambitions et surtout ne pas m’imposer une tâche au-dessus de mes moyens. Tu vois, je m’applique à moi-même les conseils que je donne à autrui.
Amitiés,
Michel
L’Olive, le 15 novembre 2014
Cher Olivier,
Je te trouve bien modeste lorsque tu qualifies ton Gouvernement des signes de « petit ouvrage ». Je suis bien placé pour savoir que délaisser l’érudition pure pour une vulgarisation exigeante n’est pas de tout repos. Tu as dû vivre des moments difficiles, d’autant que les délais d’écriture étaient bien réduits (les éditeurs ont bien de la chance de trouver des auteurs aussi complaisants). Le résultat rend bien compte de l’originalité de tes travaux personnels sans négliger la part de compilation qu’exige une préparation à l’agrégation.
Bravo et merci du beau cadeau.
Amitiés,
Michel
L’Olive, le 11 février 2015
Cher Olivier,
Mon petit compte rendu du livre d’Antonio Chas m’a valu de recevoir la dernière livraison du Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, dans laquelle j’ai découvert ton article sur Urraca et la Vierge. Je l’ai dégusté comme il se doit et je peux t’assurer que, malgré de mauvaises habitudes acquises à la lecture des travaux universitaires de mes élèves, du temps où j’exerçais encore, je n’y ai pas trouvé à redire. Bien au contraire, j’ai apprécié ta maîtrise du raisonnement et ta rigueur méthodologique, qui font de tes travaux l’expression idéale de l’esprit français tel que je l’entends. C’est très érudit mais cela ne tourne pas à vide, comme cela arrive trop souvent, non seulement dans la critique littéraire mais aussi dans les exposés philosophiques.
Cette nadería que je t’adresse en fichier joint porte aussi sur le Libro de Buen Amor [« Mas alto que la Mota (1229c). Divagaciones sobre un hemistiquio del Libro de Buen Amor.]. Elle vient d’être publiée dans les Actes du Congrès sur l’Arcipreste d’Alcalá la Real [Congreso homenaje a Alberto Blecua, MMMXIV], qui a eu lieu en mai dernier. Cela faisait longtemps que je souhaitais titiller nos spécialistes dont les cheveux se hérissent dès que l’on évoque la thèse de Criado del Val sur l’origine alcalaïne de Juan Ruiz. Comme tu pourras le constater, j’ai ménagé leur susceptibilité au-delà du raisonnable. Il est vrai que je ne suis pas non plus un très chaud partisan de cette thèse. Mais enfin, les gens de La Mota ont droit aussi à quelques satisfactions.
Je me mets aux pieds de ces dames et t’envoie un salut fraternel,
Michel
Paris, le 14 février 2015
Cher Michel,
C’est que vous me feriez presque rougir… Merci beaucoup d’avoir lu mon article : j’ai eu grand plaisir à l’écrire (ça se sent peut-être). Un grand merci pour votre article, sans aucun doute bien plus informé que le mien, que je lirai avec l’intérêt le plus vif. En cette année juanmanuéline, un peu de buen amor me fera le plus grand bien !
J’espère que vous vous portez bien, Michèle et vous.
Olivier
L’Olive, le 6 novembre 2018
Cher Michel,
Merci de partager la nouvelle de cette publication [Pedro López de Ayala, Traité de fauconnerie et d’autres oiseaux de vol, Traduction et commentaire de Michel Garcia. Genève, Librairie Droz, 2018]. Vous devez être heureux d’avoir mené à bien ce beau projet. Je vais demander à la BU de Censier de commander le livre. Vous devez être aussi sur le point de boucler votre nouvelle édition du Rimado, n’est-ce pas ? Ayala est décidément à l’honneur.
J’espère que tout va pour le mieux pour Michèle et vous.
Amitiés,
Olivier
Cher Olivier,
Le projet de traduction du Traité de fauconnerie tenait, en effet, de la gageure, étant donné mon ignorance crasse en matière de chasse, d’ornithologie, de botanique et d’art vétérinaire. Je n’avais pour moi que ma familiarité avec l’auteur, qui ne cesse de s’affiner avec le temps. Je suis parvenu à combler suffisamment ces lacunes criantes pour fournir un ouvrage qui, je pense, tient la route. Il faut dire aussi que j’ai bénéficié d’aides de qualité, à commencer par celle du directeur de la Bibliotheca cynegetica, Baudouin Van den Abeele, Professeur à Louvain la Neuve. Une autre de mes satisfactions a été de publier ma traduction à la Librairie Droz, 80 ans après l’édition de la Thèse de Félix Lecoy sur le Livre de Bon Amour. Enfin, ce qui ne gâte rien, le volume, relié en toile rouge, est fort beau.
À propos de mes autres publications, sache que ma Chronique de Jean II (années de la minorité) vient de sortir dans la collection Textos recuperados des Ediciones Universidad de Salamanca. C’est un travail énorme : deux volumes pour un total de 1000 pages, avec transcription, Introduction, Index et un double apparat de notes (variantes et notes explicatives). J’ai mené de front les deux ouvrages sur un peu plus de dix ans et ils sont sortis pratiquement la même semaine. Ce qui implique que j’ai dû corriger simultanément les jeux d’épreuves de l’un et de l’autre.
Sur ces entrefaites, au mois d’avril, par une indiscrétion d’un collègue espagnol, j’apprends que le Rimado est inscrit au programme de l’Agrégation. Or, je m’étais engagé auprès de mes collègues de Vitoria, lors de l’hommage solennel qui fut rendu à Ayala pour les 600 ans de sa mort, en 2007, à leur proposer une nouvelle édition. Jusque-là j’y avais travaillé de façon très irrégulière, dans les loisirs que me laissait la préparation des deux autres ouvrages, entre autres occupations. Si les textes étaient à peu près établis, il me restait énormément de travail encore à accomplir sur l’Introduction, les notes et les Index. Étant donné la date tardive de l’annonce, j’ai d’abord envisagé de continuer à œuvrer à mon rythme à la préparation du livre d’Ayala et de m’en tenir à la finition des deux autres ouvrages. À la réflexion, j’ai considéré que c’était dommage de ne pas offrir aux candidats le fruit de mes recherches, qui aboutissent à une édition qui rompt radicalement avec les précédentes, y compris celle qui a été inscrite au programme. Je me suis donc mis à la tâche d’arrache-pied, au point d’assister quasiment chaque jour depuis mon bureau au lever du soleil tout au long de l’été. Fin octobre, j’ai remis l’original à mes éditeurs. La publication est prévue pour l’année 2019. J’aimerais que ce fût au tout début de l’année pour que les candidats de cette session puissent en profiter. Mais je ne peux rien garantir. Espérons que ce ne sera pas l’édition des occasions perdues. Je dois à la vérité de dire que mon édition, dans la mesure où elle remet en question bien des préjugés sur le Poème, risque de compliquer sérieusement la tâche des Préparateurs et des candidats qui seront souvent confrontés à des choix difficiles. Mais je pense aussi que, loin de compliquer l’accès au texte, elle le facilitera grandement, tant il est vrai que j’ai pensé avant tout à un public d’étudiants qui ressemblent beaucoup aux candidats de notre Agrégation.
Amitiés,
Michel
Paris, le 3 mai 2019
Cher Michel,
Je me réjouis d’apprendre que votre nouvelle édition [du Rimado de Palacio] est publiée ! Je sens qu’elle va apporter du nouveau, ce que le titre retenu semble déjà annoncer. Je ne la trouve pas encore sur le site internet de l’éditeur ni sur celui des librairies en ligne, mais cela ne saurait tarder. Elle sera sans aucun doute très utile aux agrégatifs : l’édition au programme du concours, qui est celle d’Hugo Bizzarri, offre de bons outils de travail (notamment pour comparer la dernière partie de l’œuvre au texte des Morales), mais elle n’est pas exempte d’erreurs (le nombre de coquilles est assez élevé). Pour ma part, au terme de cette première année de travail sur le Rimado, je ne me sens pas encore à l’aise avec les questions de critique textuelle (on lit sur le sujet beaucoup de choses contradictoires), et je crois que nous attendons tous une édition qui présente des partis pris clairs à ce sujet. La plupart de nos étudiants ont bien « accroché » au Rimado, ce qui n’était pas gagné, d’autant qu’il m’a fallu du temps, à moi aussi, pour trouver du plaisir à fréquenter ce texte exigeant.
Amitiés,
Olivier
Cher Olivier,
Ton message me va droit au cœur et me console un peu d’un autre accusé de réception glaçant que j’ai reçu à cet envoi que j’avais adressé à tous les médiévistes de France et de Navarre.
Rassure-toi : les exemplaires sortent à peine de l’imprimerie et je n’ai pas encore reçu ceux qui me reviennent, mais j’ai voulu prendre les devants. Ce qui me réjouit, c’est que tu penses que cette nouvelle édition puisse être connue des agrégatifs, ce qui ne me semblait pas aller de soi. Une édition nouvelle, alors que les programmes du Concours sont déjà fixés pour deux ans, constitue un élément perturbateur que la machine administrative ne pardonne pas. Et j’ai eu la faiblesse de penser, contre toute raison, qu’on pourrait la recommander in extremis dans le programme de la session de 2020 comme texte complémentaire. Est-ce ma faute si l’inscription de l’œuvre au programme s’est faite sans même me consulter, comme si le fait d’avoir pris ma retraite m’avait rendu transparent, pour ne pas dire plus ? Sans doute a-t-on trouvé là l’occasion de faire une bonne manière à un collègue apprécié et ménager un de ces famosos qui aiment tant à être flattés.
Ce qui m’a poussé à refaire mon édition, c’est d’abord que la précédente (1978) ne me satisfaisait plus, mais c’est aussi que je voulais sortir d’une approche que je juge dépassée, celle que les disciples de Germán Orduna s’entêtent à considérer comme indépassable. Car l’édition de Bizzari a tout d’un culte rendu au maître disparu. À mes yeux, elle n’apporte rien de nouveau et néglige ce qui me paraît être essentiel, mais ce n’est pas nouveau chez nos collègues médiévistes, c’est-à-dire une réflexion sur le processus d’écriture, ce qui revient à inscrire une œuvre littéraire dans l’histoire de son auteur et, à travers elle, dans celle de son époque. C’est cela qui lui donne son sens véritable et, pour nous aujourd’hui, son intérêt principal, et non pas la considérer comme une relique à laquelle il faut rendre un culte.
Je suis navré que tu aies eu du mal à prendre la mesure du texte et que tu n’aies pas songé à te tourner vers moi. C’est bien volontiers que j’aurais tenté de répondre aux questions que tu te posais, comme je l’ai fait avec Carlos Heusch, avec qui j’ai eu des échanges passionnants. Je ne comprends pas cette réserve que mes anciens étudiants semblent éprouver à me solliciter. Est-ce timidité de leur part ou considèrent-ils que je ne m’intéresse plus à la recherche ? Je me perds en conjectures. En tout cas, dans l’avenir, n’hésite pas.
Je crois que tu vas être surpris lorsque tu découvriras ma version du Rimado, que j’ai d’ailleurs rebaptisé pour l’occasion. J’ai la faiblesse -ou l’outrecuidance- de penser que mon cher Pero López ne m’aurait pas complètement désapprouvé.
Sache aussi que je conserve dans mon grenier un nombre important d’exemplaires de mon Obra y personalidad…, que je mets gratuitement à la disposition de qui en veut, à condition que je n’aie pas à en faire l’expédition. Mais, comme je te l’ai souvent dit, notre maison est largement ouverte.
Amitiés,
Michel
Paris, le 17 juin 2019
Cher Michel,
Je reviens de Censier, où une belle surprise m’attendait. Un grand merci à vous pour l’envoi, par les bons soins d’Eric (Beaumatin), de votre nouvel opus ! Cela me touche beaucoup. Figurez-vous que je l’avais commandé à l’éditeur de mon côté et que je venais de le recevoir : c’est très bien ainsi, car j’aime avoir un exemplaire de travail, à annoter sans scrupule et sans remords, et un autre, moins manipulé, que je garde au chaud (il va sans dire que c’est la version dédicacée qui restera intacte). L’édition est visuellement très élégante… et je vais m’empresser d’aller la regarder de plus près dès que j’aurai un moment à moi. Je ne manquerai pas de vous faire part de mes impressions et, peut-être, de mes questions. Même si l’édition au programme de l’agrégation reste l’année prochaine celle de Bizzarri (qui offre de bons instruments de travail, mais un texte parfois peu fiable en raison des coquilles), nos étudiants ne pourront faire l’impasse sur la vôtre et je prendrai le temps de la leur présenter à la rentrée. Votre production est impressionnante ces derniers mois !
Je vous récris avant notre départ en vacances, prévu pour le 7 juillet. J’espère que l’été à venir se présente au mieux pour vous.
Encore merci pour ce beau cadeau !
Amitiés,
Olivier
Cher Olivier,
Tu m’as pris de vitesse. Je savais que je verrais Eric, aussi ai-je renoncé à t’expédier l’exemplaire par la Poste. Mal m’en a pris.
Le Servicio Editorial de l’Université du Pays Basque m’a gâté en matière de présentation.
Quant au contenu, tu constateras par toi-même que mon édition n’a plus grand-chose à voir avec les précédentes (y compris la mienne de 1978). Si tu le veux bien, on pourra le commenter au fur et à mesure de ta lecture. Tu sais que je suis un partisan enthousiaste des échanges érudits.
Je me remets peu à peu du surcroît de travail que je me suis imposé ces derniers mois. Mais j’aurais mauvaise grâce à me plaindre, tant les éditions sont belles.
Nous allons passer des vacances calmes à L’Olive, dont les murs épais nous protégeront des excès de chaleur.
Bonne lecture.
Amitiés,
Michel
PS. Je joins le bon de commande que m’a transmis l’UPV, même si je présume que tu l’as déjà puisque tu as commandé le volume ; mais tu pourras le communiquer à d’autres collègues chargés de la Préparation ou même au libraire de la Fac, s’il existe toujours.
Paris, le 6 juillet 2019
Cher Michel,
J’ai commencé à lire votre Libro del canciller et je suis séduit par le parti pris d’ensemble qui consiste à considérer le processus de l’écriture plutôt que son strict résultat. Pour l’instant, je me suis penché sur votre argumentation relative à la première partie de l’œuvre (au sens large : chansonnier inclus) et je trouve vos remarques fort stimulantes, ne serait-ce que parce qu’elles remettent sur la table des points un peu trop hâtivement considérés comme acquis par d’autres. J’y retrouve une méthode que je sais vôtre et que je vous ai vu pratiquer depuis longtemps : accorder toute l’attention possible aux indices formels et ne se risquer à l’interprétation qu’une fois épuisés les ressorts de cette première étape. Votre démarche n’a pas simplement pour but d’établir des faits, mais elle invite le lecteur à se poser des questions similaires aux vôtres, ce qui est peut-être aussi important, voire davantage. J’en profite donc pour vous poser quelques questions ou évoquer des points qui ont particulièrement retenu mon attention.
1. Concernant la datation de la composition de la première section (au sens strict : tout ce qui précède le chansonnier), vous mettez en valeur le rôle fondamental des strophes 716-718, pivot entre deux temporalités narratives et, sans doute, entre deux strates rédactionnelles. Pour autant, est-il nécessaire de penser que « Quando aqui escriuia » (717a) renvoie à l’intégralité de ce qui précède ? Cet « aqui », par ailleurs un peu incongru (on aurait pu attendre : « Quando esto escriuia » : l’adverbe de lieu renvoie à la page que le lecteur a sous les yeux et, pourtant, l’imparfait coupe le lien avec le présent), recoupe-t-il obligatoirement le poème depuis la strophe 1 ? Ne peut-on pas imaginer que la confession rimée (et, a fortiori, les toutes premières strophes de l’œuvre) ait été rédigée après la captivité d’Obidos ? Il est assez fréquent que la pièce d’ouverture soit composée en dernier même si, je vous l’accorde, dans le cas du Rimado, on n’a pas vraiment un prologue canonique.
2. En lien avec ce premier doute, vos remarques sur l’hétérogénéité de la première section ont suscité tout mon intérêt car, moi aussi, lorsque j’ai lu le Rimado pour la première fois, j’ai été surpris par la combinaison pas toujours harmonieuse des considérations sociopolitiques et de l’effusion de la prière. Vous suggérez (p. 21) que le développement consacré au Schisme ainsi que le discours sur les états de la société (le speculum mundi, en somme) pourrait être un ajout, le noyau primitif étant donc la confession rimée et la rogaría. Cette hypothèse vous est-elle suggérée par l’unité d’une tonalité lyrique qui serait commune à ce noyau et aux pièces du chansonnier ? Ne pourrait-on pas envisager cependant l’inverse : le discours sur le Schisme et sur les états du monde pourrait être premier et la confession (ainsi que les prières) auraient été ajoutées ensuite pour mieux souder tout cela au chansonnier ? Une piste pourrait être recherchée du côté de l’usage des sources. Par exemple, dans la satire des marchands, l’utilisation de la Summa de Guillaume Perault peut-elle se réduire à de simples réminiscences ou nous dit-elle qu’Ayala avait le texte latin sous les yeux ? Dans ce dernier cas, est-ce compatible avec les conditions de sa captivité à Obidos ? Je n’ai guère d’arguments, mais je n’ai pas bien compris non plus ce qui vous fait pencher dans l’autre sens.
3. Pour le chansonnier, j’ai été particulièrement content de vous lire parce que, de façon intuitive, je m’étais persuadé dès l’été dernier que c’est la seconde occurrence de la composition « Señora muy franca » (et non la première) qui est à sa place originelle. Vous donnez des arguments qui me convainquent tout à fait. Pour moi, empiriquement, c’était lié à une question de symétrie de l’ensemble du chansonnier : si on reproduit les deux occurrences de ce poème, le Traité du Schisme n’occupe pas exactement la place centrale ; en outre, si on ne retient que la seconde occurrence, un autre effet de symétrie se fait jour entre les deux compositions en cuaderna vía, qui se retrouvent respectivement en position 3 et en position 11 (le centre, en position 7, étant occupé par le Traité du Schisme). Enfin, « Señora muy franca » n’a pas recours au motif de l’emprisonnement, comme les autres poèmes situés avant le Traité du Schisme. Tous ces éléments ne font que confirmer, à mes yeux, votre parti pris.
4. Je suis un peu moins convaincu par la distinction thématique que vous établissez entre prières (avant le Traité du Schisme) et matière mariale (après le Traité), dans la mesure où certaines prières du premier groupe sont centrées sur la Vierge, comme vous le précisez vous-même, et où toutes les compositions mariales du second sont aussi des prières. Du point de vue thématique, je verrais plutôt l’évolution d’une piété fondée sur la requête (demande de libération, y compris en usant d’arguments proches du chantage, comme dans l’oraison narrative) à une piété fondée sur la louange : de plus en plus délié de sa fonction utilitaire, le poème peut exalter sa propre dimension esthétique (je souscris entièrement à vos remarques sur la dernière composition, qui est une pièce maîtresse, où ce n’est plus l’humble pénitent qui s’exprime, mais le poète conscient de son art, de ses « loores de grant valía », la humildança passant alors du côté de la Vierge). Je lis tout le cancionero comme un itinéraire de la voix orante qui parviendrait à dépasser la fonction instrumentale de la prière (afin que « la réponse précède la demande », pour reprendre la belle formule d’Olivier Boulnois). Qu’en pensez-vous ?
5. J’ai été un peu déstabilisé (tant mieux !) par vos remarques sur le Traité du Schisme. Le fait que la troisième pièce du Traité, la suplicaçión, renvoie à la concurrence entre les deux papes élus, comme les strophes 189 et suivantes, suffit-il à conclure qu’elle a été rédigée avant les deux autres ? Cette antériorité ne me paraît pas si évidente, d’autant que l’on s’explique mal, dans ce cas, pourquoi Ayala l’aurait placée en troisième position une fois rédigées les pièces datées de 1398 et de 1403. Dites m’en davantage, si vous voulez bien, sur ce qui vous a mis sur cette piste.
6. Enfin, un point qui n’est qu’un détail : pensez-vous vraiment que les vers des huitains du Traité du Schisme suivent le schéma métrique de l’alejandrino (p. 26) ? Il me semble qu’il faut fermer les yeux sur énormément d’irrégularités pour le soutenir. Je penche plutôt pour l’interprétation de Gómez Redondo, qui voit là un verso de arte mayor (qu’il appelle adónico doblado) déjà plein et entier, à savoir un vers plus du tout fondé sur le décompte syllabique mais sur la présence d’un schéma prosodique fixe, quitte à malmener les règles de l’accent tonique. Ces pièces tardives du Rimado seraient donc celles qui innoveraient le plus du point de vue métrique (conserve-t-on des cas de verso de arte mayor avant le Rimado ? Très peu ou pas du tout ? Je ne sais pas).
J’espère pouvoir me pencher bientôt sur vos raisonnements relatifs à la dernière section de l’œuvre, consacrée à Job. C’est la partie du Rimado qui est sans doute la plus complexe malgré sa forte unité thématique. Elle fait peur aux agrégatifs (… et à leurs préparateurs) plus que toutes les autres. Il faut dire que cela tient en partie aux éditions qui, jusqu’à votre Libro del canciller, juxtaposaient les parties finales des deux manuscrits sans trop s’interroger sur l’unité possible de cet ensemble artificiel. A priori (mais je suis loin de maîtriser encore tous les éléments à prendre à compte), il m’apparaît que votre choix éditorial radical a le mérite de rendre le texte praticable, mon scrupule immédiat étant tout de même que les strophes finales du Ms. E sont les seules qui offrent à mes yeux un colophon en bonne et due forme (même si on peut discuter ce point aussi…). Je n’aurai pas le temps de continuer ma lecture dans les jours qui viennent (j’ai deux articles pressants à finir et j’ai reculé d’une grosse semaine mon départ pour Saint-Malo pour les boucler…), mais j’emporterai avec moi votre Libro del canciller et je compte bien m’y replonger aux alentours du 20 juillet.
J’espère que l’été s’annonce serein pour vous. De mon côté, le transfert en Bretagne m’obligera heureusement à abandonner une cadence infernale qui me laisse au bord de l’épuisement. Or, bien des choses qui m’ont occupé dans les affaires courantes de la fac n’ont malheureusement qu’un intérêt bien limité…
Amitiés à vous, à Michèle et à tous,
Olivier
Cher Olivier,
Tu es un lecteur redoutable, ce dont je me félicite. Je voudrais que ma réponse fût à la hauteur de ton attente. Je sais que tu as d’autres chats à fouetter (à propos, quels sont ces articles pressants sur lesquels tu travailles ?) mais je n’attendrai pas le 20 juillet pour te répondre. J’espère que tu ne m’en voudras pas.
1. Je ne connais pas de moyen de savoir à quoi se réfère très précisément le vers 717a, mais on pourrait y voir un commentaire strictement limité à la strophe 716. Cette interprétation littérale me paraît même indiscutable. Il suffit d’observer que rien dans les strophes 715 et immédiatement antérieures peut justifier la précision qu’il fournit. L’appliquer au récit des malheurs de Fernán Sánchez n’a guère de sens. Ceci admis, le vers 717a mentionne très expressément une situation, celle de la captivité, qui, elle, appartient à une temporalité longue, dont rien ne permet d’affirmer qu’elle ne correspond pas à la durée de rédaction de la totalité des 716 premières strophes. Pourquoi ne pas l’admettre ? Sur quels critères mettre en doute une telle hypothèse ? Considérer que la confession rimée ait pu être composée plus tard, et que son insertion dans l’ouvrage répond à des pratiques fréquentes dans la littérature médiévale me semble un pari très risqué. Où mieux qu’à Obidos, alors qu’il craint pour sa vie, Ayala aurait-il pu rédiger sa confession ? Comment même ne pas envisager qu’il s’agit au contraire du premier texte qu’il ait rédigé ? L’interprétation qu’on adopte de ce vers 717a est directement tributaire de l’idée que l’on se fait de la nature de l’œuvre. Peut-on s’en remettre à une pratique plus ou moins avalisée dans la littérature médiévale, s’agissant d’un ouvrage aussi peu normatif ? La présence de la confession au début de l’ouvrage ne répond pas forcément à des critères esthétiques ou littéraires. J’y vois, pour ma part, la traduction d’une urgente nécessité imposée par de tragiques circonstances.
2. Est-il possible d’envisager que le premier texte qu’Ayala ait rédigé à Obidos soit une critique du gouvernement de l’Eglise ? Que la situation provoquée par le Schisme l’ait profondément affecté, comme elle devait affecter tout chevalier lettré de l’époque, c’est à n’en pas douter. C’est pour cette raison qu’il introduit ce fragment juste après sa confession personnelle. Dans la recherche des causes des épreuves auxquelles il est soumis par décision divine, dès l’instant où il entreprend de regarder au-delà de sa petite personne, il songe évidemment à la cause première, celle qui est la plus susceptible d’avoir provoqué la colère de Dieu, à savoir le Schisme. Faut-il s’en étonner ? Peut-être est-ce le moment de se demander si on ne commet pas un contresens en considérant le Livre comme un ouvrage conçu pour être diffusé, et soumis, par conséquent, à une organisation interne qui vise un public de lecteurs potentiels. Certaines des œuvres d’Ayala ont fait l’objet de nombreuses copies (Traité de fauconnerie, Chroniques). Ce n’est pas le cas du Livre dont j’ai tout lieu de penser qu’il a d’abord été pensé comme un écrit privé, et qu’une diffusion a pu être envisagée seulement à l’intention d’un public très limité, qui n’était pas considéré à proprement parler comme un récepteur de l’ouvrage mais plutôt comme un témoin de l’entreprise d’autojustification qu’Ayala a menée à la fin de ses jours.
3. Dont acte. Je pense que cette structuration du chansonnier devrait éclairer grandement tes étudiants et les empêcher de considérer cette anthologie comme une compilation fourre-tout.
4. Je partage ton analyse, à ceci près qu’elle ne trouve tout son sens que dans l’inscription temporelle des différentes séries. Les premiers poèmes dédiés à la Vierge relèvent du genre de la requête (au point que la promesse de pèlerinage à Quejana adopte la forme de la copla cuaderna), parce qu’ils ont été composés à Obidos, ce qui n’est pas le cas des derniers. De ce point de vue, cette différence est éclairante sur ce que l’on peut savoir de la genèse du Livre.
5. Je comprends que cette hypothèse te trouble, car elle paraît aller à l’encontre d’une organisation rigoureuse de l’ouvrage. Mais ne peut-on pas admettre que la nécessité de zurcir des fragments composés à des époques différentes a pu mettre Ayala (ou un compilateur tardif, après tout) dans l’embarras. Ce qui empêche d’insérer ces strophes à l’intérieur du premier fragment consacré au Schisme tient à des exigences formelles, les mêmes qui autorisent à le faire dans le Traité. Ce que je trouve intéressant, c’est que le rapprochement laisse entendre que les écrits d’Ayala sur le Schisme ont pu adopter une forme figée : le Traité proprement dit devait être complété par une adresse au roi à qui il était destiné, car c’est son statut de conseiller du roi qui autorisait Ayala à se mêler au débat du Schisme. Il n’avait pas qualité pour le faire à titre personnel. L’insertion de ce fragment ancien à ce moment du Livre a de quoi surprendre, en effet, mais on peut l’attribuer à un réflexe de compilateur qui ne veut rien laisser perdre. C’est un des points qui me fait penser que quelqu’un d’autre qu’Ayala a pu intervenir dans la touche finale (celle qui nous est parvenue). On peut élargir l’hypothèse à la constitution des deux codex E et N. Il y a là matière à réflexion.
6. Ma plume a fourché. Je voulais dire que les hémistiches du Traité du Schisme sont des hexasyllabes. Je n’aurais pas dû employer l’adjectif alejandrino, qui est malvenu. Par ailleurs, que le nombre d’accents et leur lieu d’apparition soient un élément aussi décisif pour la caractérisation des vers que la quantité syllabique est généralement admis depuis longtemps (je pense aux travaux de René Pellen).
Il est normal que la technique d’un poète aille s’affinant au fur et à mesure qu’il avance dans la maîtrise de son art, mais il me semble, en outre, à en juger par la grande variété des recours auxquels il soumet ses vers, tant dans l’agencement des rimes que dans la diversité de ces dernières, qu’Ayala était particulièrement enclin à la virtuosité, au point de ne pas proposer deux schémas formels identiques dans son anthologie finale. Je pense, en effet, que notre don Pèdre est un des premiers pratiquants de l’arte mayor, c’est-à-dire de la strophe de huit vers à hémistiches hexasyllabiques (pour ne pas s’en tenir au seul vers, comme tend à le faire Navarro Tomás), et peut-être un de ses « inventeurs » en Castille. Qu’il l’ait appliqué à un sujet aussi grave que le Schisme inscrit ce nouveau « genre » dans une conception savante de la poésie, dans le prolongement de la copla cuaderna.
J’espère ne pas être trop elliptique, mais c’est notre premier échange et je ne veux pas t’assommer de considérations de toute sorte. Je voudrais, cependant, que tu comprennes bien -et les autres Préparateurs avec toi, si c’était possible, que seule une vision d’ensemble fondée sur la démarche d’Ayala telle qu’elle se laisse percevoir en particulier à travers des apparents manquements à la cohérence du texte dans l’état où nous l’avons reçu, aussi bien dans les témoignages manuscrits que dans les éditions, peut nous éclairer sur la conception et sur la réalisation de l’ouvrage. C’est ainsi que tu as raison de considérer que les dernières strophes du codex E s’apparentent à une finida, même s’il y manque l’élément formel (reprise de rimes dans les dernières strophes) que l’on trouve dans l’autre finida, celle des coplas 1506-1507. Il faut l’admettre et s’interroger sur la présence de deux codas dans un même texte. Personnellement, je l’interprète comme la preuve d’une démarche au long cours à laquelle l’adaptateur songea plusieurs fois à mettre le point final. Ce qui est intéressant dans la comparaison entre ces deux finidas, c’est que celle du Ms E est d’une nature analogue au commentaire qu’Ayala insère à la fin de plusieurs fragments du Traité sur le Schisme, attitude dictée par son statut qui, du moins à ses yeux, ne l’autorise pas à se mêler de débats qui le dépassent. C’est une position habituelle et somme toute logique. Les strophes 1506-1507 n’ont pas été composées dans cet esprit. Ayala n’hésite pas à formuler ce qu’il estime être la leçon principale du commentaire de Grégoire. Ce changement d’attitude témoigne de ce qui sépare une adaptation du texte de saint Grégoire conçue sans autre perspective que celle de s’exercer à rendre compte du texte pour lui-même, de celle qui a pour but de prolonger une réflexion personnelle afin de lui donner une dimension plus large, voire universelle. Dans les deux cas, le texte support est le même mais l’usage qui en est fait est radicalement différent. Nous sommes victimes d’une illusion d’optique parce que nous confondons le matériau grégorien recueilli dans les deux codex avec l’adaptation spécifique et orientée qu’Ayala compose dans le but de l’incorporer à son Livre. Je pense que l’idée de composer une troisième Partie à son Livre, idée tardive au demeurant (postérieure à la composition des deux Premières, comme la deuxième le serait par rapport à la Première), l’a incité à considérer le commentaire de Grégoire autrement qu’il ne l’avait fait jusque-là. Ceci ne se fait pas au détriment des adaptations précédentes qui avaient leur justification, et c’est ce dont les deux codex témoignent dans leurs fragments finaux.
Il y aurait beaucoup à dire encore mais nous en reparlerons, si tu veux bien, lorsque tu te seras familiarisé avec ma Troisième Partie.
Amitiés,
Michel
Le 20 juillet 2019
Cher Michel,
Je vous suis vraiment reconnaissant pour vos réponses détaillées à mes interrogations, qui m’aident beaucoup à progresser dans la compréhension de l’œuvre tout en déclenchant de nouvelles questions (et c’est tant mieux).
Sur les points 1 et 2, vous me convainquez, sauf peut-être sur un point : j’ai beaucoup de mal à lire la confession comme une pièce « privée », motivée par le traumatisme de la captivité d’Obidos, et je crois qu’elle a d’emblée été conçue pour être diffusée ou, au moins, offerte au regard d’autrui (sinon, une confession auriculaire auprès d’un prêtre aurait suffi et elle aurait eu, d’un point de vue chrétien, une valeur sacramentelle à laquelle cette pièce littéraire ne saurait prétendre). Dès la strophe 7 (deux derniers vers), se manifeste le souci d’être compris par un destinataire qui n’est pas Dieu et, de façon constante ensuite, on observe une alternance entre une deuxième personne qui désigne Dieu et une deuxième personne qui désigne un destinataire humain qu’il s’agit d’inciter à se confesser lui-même. Le « yo » confessant devient presque alors un « yo » confesseur. Je ne partage pas non plus tout à fait le point de vue d’Erica Janin, qui pousse cette logique très loin en affirmant que la confession est un pur artifice et que le « yo » qui s’y exprime est totalement délié de la personne d’Ayala (son article est stimulant, même s’il pèche sans doute par un excès de systématicité). Je me placerais entre votre conception et celle de Janin, car l’implication du « yo » autobiographique dans la démarche confessionnelle est précisément donnée comme le gage de sa légitimité pour qu’il puisse assumer ensuite un discours de prédication (fonction en principe interdite aux laïcs : la reprise de la tradition formelle du mester dit déjà en elle-même qu’Ayala endosse le rôle d’un quasi-clerc) : reconnaître ses fautes donne le droit d’en accuser les autres. C’est la logique qui, me semble-t-il, permet de passer de la confession à la satire sociale (et c’est aussi ce qui me donnait l’impression que cette pièce ait pu être rédigée a posteriori, non seulement parce qu’elle est introductive ‑ jusqu’à un certain point ‑ mais aussi parce qu’elle s’emploie à accorder une autorité à une voix qui en est en principe dépourvue).
Concernant le point 5, qui continue de me troubler, je relirai l’ensemble du Traité du Schisme selon cette nouvelle perspective et je pense que de nouveaux effets de sens devraient se faire jour.
J’ai achevé ma lecture minutieuse de votre Introduction et je suis impressionné par la richesse des arguments que vous développez à propos de la troisième partie de l’œuvre. Il faut dire que c’est la partie que j’ai le moins travaillée et que je ne me suis pas moi-même plongé dans un examen direct des sources, m’en remettant exclusivement aux lectures critiques (vos propres travaux, ainsi que ceux de Coy et de Cavallero). Je trouve que vous livrez là l’examen le plus précis et le plus abouti sur la question. La mise au jour des caractéristiques techniques de l’adaptation de la prose grégorienne (« De la fuente a la copla », p.31-34) me paraît particulièrement probant (la comparaison de trois strophes, tirées chacune des trois sous-sections de la troisième partie, donne de très beaux résultats). De même, à plus grande échelle, vous montrez de façon irréfutable que les trois sous-sections obéissent chacune à une logique différente, même si chacune n’est pas non plus le résultat uniforme d’une formule qui aurait été mécaniquement appliquée. Le rapport du texte à sa source est crucial pour délimiter les contours d’un projet et, au-delà, les contours de l’œuvre elle-même. Vous ne tombez pas non plus dans le travers qui aurait consisté à relativiser les irrégularités qui apparaissent dans l’adaptation des « 35 livres » dans le seul but de justifier son intégration pleine et entière à l’œuvre et, ainsi, mieux disqualifier les fragments finaux de E et N. L’idée que l’adaptation des « 35 livres » elle-même montre des signes d’inachèvement (et qu’elle correspond peut-être encore à un état de « borrador ») me paraît elle aussi séduisante. Je suis convaincu, au bout du compte, par le choix consistant à écarter de l’édition les fragments finaux, qui obéissent chacun à leur propre logique (une sorte de glose linéaire pour E ; un commentaire beaucoup plus libre, presque dégagé de toute idée de paraphrase, pour N). Pour E, cependant, l’effort de clôture et de conclusion, dans la lignée de la tradition du mester et de ses topoï (la strophe 1934 pourrait presque être de Berceo !), montre que, à un moment où à un autre, le texte dont est issu ce fragment a été pensé lui aussi comme un œuvre. Une œuvre fondée sur un autre critère que la troisième partie du Rimado (vous le démontrez suffisamment), mais une œuvre tout de même et peut-être pas une simple anthologie, vous ne croyez pas ?
Un autre point me chiffonne depuis longtemps. Comme d’autres critiques, vous distinguez dans la troisième partie du Rimado ce qui relève de l’adaptation des Morales et ce qui relève de celle du Libro de Job, notamment lorsque vous dites que les strophes 897-967, fondée uniquement sur le Libro de Job, ont dû être rédigées après-coup, au moment où Ayala a voulu relier l’adaptation des « 35 livres » des Morales à l’ensemble cohérent formés par les deux premières parties du Rimado. Mais quelle version du Libro de Job sert de source à ce moment-là ? Aussi bien Coy que vous-même avez établi qu’il ne s’agit pas de la traduction indépendante contenue à la fin des manuscrits des Morales (et qui a été éditée par Branciforti) mais de la version du livre biblique contenue (de façon nécessairement segmentée) dans la version des Morales elle-même. En fait, votre position est plus nuancée, p. 105 : « se supone que es la que manejó prioritariamente el adaptador », ce qui laisse entendre que les deux sources auraient pu servir alternativement (ou simultanément), à moins que vous ne pensiez qu’Ayala ait travaillé directement aussi à partir de la version latine de la Vulgate au moment où il écrivait ses cuadernas ? En tout cas, si l’on admet que c’est la version du Libro de Job contenue dans les Morales qui sert de source non seulement aux strophes 897-967 mais aussi aux autres passages où c’est le livre biblique qui est adapté, je suis gêné que l’on dise qu’Ayala combine deux sources (le Libro de Job et les Morales). Je dirais plutôt qu’il n’a qu’un texte-source, qu’il utilise de façon sélective, tantôt ne retenant que le texte biblique tel que le cite le commentaire, tantôt adaptant l’ensemble (texte biblique + commentaire) qu’il trouve dans sa source, tantôt ne retenant que le commentaire. Ce point ne me paraît pas accessoire, parce qu’il montre bien comment Ayala donne l’illusion de manier plusieurs sources là où il n’en utilise qu’une, ce qui, à mon avis, peut constituer une stratégie pour exister en tant qu’auteur dans son adaptation du commentaire. En effet, cette illusion est encore plus troublante dans le cas où, dans l’adaptation, apparaissent des références bibliques autres que le Livre de Job. Sauf erreur de ma part (corrigez-moi si je me trompe, ce qui est fort possible, car je ne l’ai pas vérifié systématiquement), toutes ces autorités sont déjà citées par Grégoire dans les Morales et Ayala ne fait que les reprendre, là où elles apparaissent. Cependant, l’effet produit est parfois tout autre car le texte laisse entendre que c’est le « yo » énonciateur du poème qui cite ces autorités, de même que, par ailleurs, il cite nommément saint Grégoire : la perte de la hiérarchie des citations fait alors de ce « yo » un arbitre entre le texte de Grégoire et des autorités qui, tout en étant, de fait, transmises par la source (mais il faut aller à la source pour le voir), sont alors abusivement placées sur le même plan. J’ai eu l’occasion d’étudier ce phénomène dans des explications de texte proposées aux agrégatifs en cours d’année (c’est en me pliant à ces exercices scolaires que j’ai mis parfois le doigt sur des failles de ce genre… ) et il me semble suffisamment récurrent pour constituer une stratégie : assez systématiquement, ce glissement d’un niveau de citation à un autre (faire passer une citation rapportée par Grégoire pour une citation rapportée directement par le Rimado) s’accompagne d’un surgissement de la première personne du singulier dans le texte et, donc, d’un discours qui se distingue (voire se démarque) de celui de la source. Dites-moi très franchement si vous pensez que je fais fausse route…
J’espère ne pas abuser de votre temps avec mes questions, surtout si vous êtes plongé dans d’autres travaux ou si, tout simplement, vous prenez du repos loin des livres.
Bonne continuation dans votre été !
Amitiés,
Olivier
L’Olive, le 24 juillet
Cher Olivier,
Je reprendrai, l’un après l’autre, les éléments de discussion que tu soulèves dans ton message.
1. Confession initiale. S’agit-il d’une confession publique ou privée ? Cela revient à se demander ce qui différencie l’une de l’autre. Apparemment, la distinction est facile : l’une est faite pour être connue, l’autre pour rester, sinon secrète, du moins confidentielle, partagée uniquement par le confessant et le confesseur. Mais ce principe ne s’applique qu’à la confession auriculaire. Dès l’instant où elle est écrite et, à plus forte raison lorsqu’elle présente une dimension clairement littéraire, puisqu’il s’agit d’une confession versifiée, la distinction ne s’applique plus aussi nettement, puisque ce n’est plus la confession qui est seule en cause mais également son support. Or tout écrit s’expose à un regard extérieur, -peut-être même le sollicite-, ce qui implique un minimum de diffusion. Cette observation s’applique pour le moins à la totalité de la Première Partie de l’ouvrage. C’est donc de ce point de vue plus général qu’il faudrait envisager la question d’un public potentiel et non pas le limiter à la seule confession initiale. Je me demande pourquoi tu lui réserves un sort particulier. Est-ce pour la formule « en la manera qual / mejor se me entendier » ? J’y vois plutôt une promesse d’exhaustivité mais aussi de clarté expositive, qui prend appui sur un cadre partagé par tous les chrétiens, celui que propose le décalogue. Serait-ce que tu cèdes à la tentation de retrouver une convention d’écriture, -le prologue explicatif-, propre à tout ouvrage médiéval ?
[NB. J’espère ne pas énoncer une énormité à propos de l’écrit. On pourrait me reprocher d’avoir inventé, entre l’écrit et le non-écrit, une catégorie nouvelle, ‘ce qui aurait pu ne pas être écrit’. Tú dirás.]
– « Le « yo » confessant devient presque alors un « yo » confesseur ». C’est ainsi que tu interprètes l’apparition d’un « tu » qui s’ajoute, à partir du 5ème commandement, au dialogue jusque-là exclusif antre Ayala et Dieu. Faut-il prendre ce « tu » littéralement ou bien plutôt comme une extension de son usage dans la formule qui énonce traditionnellement le commandement (cf. 6ème commandement 45a) ? Dès lors, pourquoi l’emploi de la deuxième personne dans la strophe 45 ne serait-elle pas un prolongement de celle de 45a ? (« prolongement » n’est pas le bon terme). Disons que la deuxième personne de « Tu ne tueras pas » autorise les suivantes, puisqu’elle comporte une visée universaliste. Le commandement s’adressant à tous les chrétiens en particulier, pourquoi ne pas admettre qu’il en est de même pour le commentaire qu’on en fait, lequel s’inscrit dans le droit fil de l’injonction primitive ?
Je n’ai pas été non plus convaincu par l’article d’Erica Janin. Je l’ai lu tardivement, c’est pourquoi je ne le mentionne pas dans la bibliographie, mais je pense qu’il n’apporte pas grand-chose de nouveau.
– « car l’implication du « yo » autobiographique dans la démarche confessionnelle est précisément donnée comme le gage de sa légitimité pour qu’il puisse assumer ensuite un discours de prédication… » Ta démonstration est convaincante, mais il me semble qu’elle s’appuie sur un présupposé discutable, qui est qu’Ayala ne se considère pas légitime dans sa démarche. Cette modestie est à relativiser. S’il lui arrive de solliciter l’indulgence lorsqu’il entreprend de parler de certains sujets, comme par exemple du Schisme, cela ne l’empêche pas d’avoir une opinion et de tenir à la publier. Qu’il place alors son discours sous l’autorité de l’Église et du Prince relève d’une pratique obligée dans une société aussi hiérarchisée mais certainement pas d’un excès de modestie. Faut-il chercher des excuses à un seigneur de son importance, dont la culture tranche sur celle de ses pairs nobles lorsqu’il parle ex cathedra ? J’en doute. Un autre facteur à prendre en considération est le public auquel il est susceptible de s’adresser. J’en ai déjà fait état dans mon précédent message. Si c’est un public familier, qui lui est socialement soumis, comme le laisse supposer, entre autres, la très faible diffusion de l’œuvre (elle ne se conserve que dans deux codex dont on a tout lieu de penser qu’ils ont appartenu à des proches d’Ayala (son scriptorium ?), il n’y a pas lieu de s’étonner qu’il s’érige en autorité. Dans cette hypothèse, la confession serait un exercice d’humilité et de repentance adressé à son destinataire naturel, qui ne se confond pas avec le public potentiel, qui était, lui, déjà assez bien instruit des vices et des vertus de son auteur.
– « de la confession à la satire sociale ». Entre les deux est inséré le premier passage consacré au Schisme, ce qui est loin d’être indifférent. De toute façon, le passage du particulier au collectif mériterait d’être nuancé, la confession ordonnée étant une obligation commune à tous les chrétiens. Dès l’instant où elle suit strictement les préceptes comme dans ce cas, elle ne se limite pas à un exercice strictement individuel, comme on peut le déduire des commentaires qui l’accompagnent. Mais il faut être prudent, parce que les références aux Écritures qui illustrent chaque péché ou presque peuvent aussi bien servir à témoigner de la stricte orthodoxie du confessant qu’à éclairer un public potentiel.
2. Fragment final de E : « mais une œuvre tout de même et peut-être pas une simple anthologie, vous ne croyez pas ? ».
Ce n’est certainement pas une anthologie. Tu touches là au point essentiel qui permet de comprendre la coexistence des différentes adaptations des Morales.
Je n’ai pas voulu m’étendre sur les deux fragments finaux des deux manuscrits pour rompre radicalement avec l’interprétation traditionnelle qui veut que tout le matériel de l’adaptation des Morales conservé fait partie intégrante du Rimado. J’ai pris le risque de déstabiliser les lecteurs mais il m’est apparu évident que, si je m’étendais sur l’analyse de ces fragments finaux, on perdrait de vue l’essentiel qui est que l’adaptation des Morales qui doit figurer dans le Livre répond à un projet différent de celui qui consistait à considérer le commentaire de Grégoire pour lui-même.
Tout le matériel accumulé et conservé dans les parties finales des deux manuscrits semble prouver que la pratique habituelle d’Ayala (en dehors du Livre) dans son adaptation des Morales est sélective. C’est ainsi qu’il ne s’est jamais vraiment intéressé aux 8 premiers livres. Pour le reste, il a fait des choix qui sont très probablement inspirés par son intérêt pour telle ou telle partie du commentaire. Le début du fragment final de E fait un sort à la polémique que Grégoire entretint avec l’évêque Euticius de Constantinople (« La disputaçion que fue entre el obispo eutiçio e sant gregorio de la verdadera rresurecçion » dit la marginalia correspondante), sujet qui, thème à part, pouvait avoir retenu l’attention d’Ayala pour son originalité, parce qu’il rapporte un épisode de la vie du commentateur, ce qui introduit un élément historique dans un traité théologique. J’observe aussi que l’adaptation se poursuit au-delà de la controverse jusqu’à la fin du chapitre 14 des Morales, ce qui est une façon de compléter l’épisode. Ayala n’agira pas autrement lorsqu’il voudra compiler des chapitres du commentaire pour les insérer dans son Livre. J’en arrive à me demander si j’ai bien fait de supposer, dans mon édition de 1978, une lacune au-début du fragment. Le fait qu’il débute sur un verset du Job suggère le contraire.
Le corpus central de l’adaptation finale de E est également parlant de ce point de vue. Elle débute avec la réponse de Job à son troisième ami, Sophar (Job 12), dans lequel ce dernier soutenait la thèse des secrets desseins de Dieu, qui s’avère un thème central de la réflexion d’Ayala. Elle s’achève sur Job 19 dans lequel le patriarche répond à ses trois interlocuteurs. Ce n’est donc pas un découpage gratuit, ce qui induit à penser qu’Ayala a songé, à un moment donné, à en faire un petit traité autonome. Du reste, pour te permettre de te faire une idée du contenu du fragment et de la façon dont Ayala a opéré, je te communique, non pas le texte correspondant des Morales, qui aurait été trop lourd, mais les marginalia de ces quatre chapitres (11 à 14) du commentaire de Grégoire. J’indique entre parenthèses le numéro des strophes, lorsqu’il existe un emprunt direct, mais malheureusement à partir de mon édition de 1978. Pour retrouver la strophe dans l’Appendice de la nouvelle édition, il faut retirer 229 (l’ancienne 1793 est devenue 1564).
Il n’en reste pas moins que la finida de E semble ne pas tenir compte du fait que ce qui précède est composé de fragments indépendants les uns des autres. Que faut-il en conclure ? Sans doute qu’Ayala envisageait de transformer son adaptation lacunaire en un traité consacré à ses thèmes de prédilection. Pour créer l’illusion d’un ouvrage complet, il tablait sans doute sur l’ignorance que ses lecteurs avaient du commentaire de Grégoire, qui est une attitude envisageable dans une démarche vulgarisatrice.
Sa démarche est radicalement différente en ce qui concerne la Troisième Partie du Livre.
3. « quelle version du Libro de Job sert de source à ce moment-là ? ».
Quelle traduction castillane du Livre de Job Ayala a-t-il utilisée dans son adaptation ? Je pense qu’il n’est pas nécessaire d’entrer dans les subtilités de Branciforti et qu’on peut s’en tenir à une traduction du texte de la Vulgate, quelle que soit la tradition. La présence d’une version dans le dernier manuscrit des Morales (dans les deux séries conservées) ne manque pas d’être troublante, au point que l’on peut envisager de la considérer comme la version utilisée par Ayala lorsqu’il consultait le Livre de Job. Elle contient des archaïsmes de langue qui me font penser qu’elle est antérieure et j’irais chercher du côté du grand-oncle Barroso, le cardinal.
Ayala a eu sous les yeux une autre version, celle que le traducteur des Moralia propose dans les Morales. Les deux ne sont pas foncièrement différentes, surtout si on les envisage du point de vue de la mise en vers, qui oblige forcément à prendre des libertés avec le texte littéral. Deux détails cependant. Elles peuvent diverger sur des détails de rédaction, dont certains sont sans doute imputables au copiste de la version du Livre de Job qui est reproduite dans nos codex. Ci-dessous un exemple tiré du livre 31,38-39. Je l’ai choisi à dessein parce qu’il contient un terme rare « sulco » qui a induit en erreur le copiste du Livre du Chancelier (str. 1271-1272).
Morales :
(Res 295, f. 154 ra): Sy contra mi la tierra clama e con ella los sulcos della lloran / e asy como los frutos della syn auer e el alma de los labradores della atormente / nasca a mi cardo e por ordio espina.
Libro: Sy contra mi la tierra llama e con ella los sulcos della lloran / Si los frutos della comi syn aver e si el alma de los moradores della atormente por trigo nascame cardo e por ordio espina.
Enfin, un point à ne pas négliger est que la lettre de la citation peut varier d’une occurrence à l’autre. Tu n’ignores pas que Grégoire répète souvent le verset ou des fragments de celui-ci pendant son commentaire. J’ai observé quelques variantes d’une citation à l’autre. Pour reprendre le même exemple (Job 31,38-39, Morales 22), voici les différentes citations des mêmes versets.
1ère citation complète (voir ci-dessus)
Citations fragmentaires
– (f. 154 va): E con ella los sulcos lloran
– (f. 155va): Si comi los frutos della syn auer o syn los pagar
– (f. 156ra): E sy el alma de los que labrauan la tierra atormente
– (f. 156va): Por trigo nasca a mi cardo e por ordio espinas.
2ème citation complète (f. 157 ra): Si contra mi la tierra clamo e con ella los sulcos della lloran / Si los frutos della comi syn auer e el alma de los labradores atormente / por trigo nasca a mi cardo e por ordio espina.
Sans tenir compte de possibles erreurs de copie (e asy como pour sy comi), il paraît évident que le traducteur ne se soucie pas de reproduire avec exactitude sa première traduction mais qu’il traduit au fil du texte, en jouant probablement sur sa connaissance du livre biblique. Dans ces conditions, déterminer très précisément la lettre de la source de l’adaptateur est un exercice impossible et un peu vain, en fin de compte.
– « Je dirais plutôt qu’il n’a qu’un texte-source »
Je ne suis pas de ton avis. Il me semble que les choses sont plus simples. Lorsqu’il adapte les Morales, Ayala suit le texte de Grégoire, y compris dans les citations des versets du Livre de Job. Lorsqu’il rédige les -copieuses- séries de strophes à partir du livre biblique, il suit une version de ce dernier. Je te parle ici de technique. Je ne conçois pas que, pour le début de la Troisième Partie, il soit allé chercher les versets du Livre de Job dans les Morales. À mon avis, cela n’a pas sens. Mais peut-être ai-je mal interprété ce que tu écris.
– Références bibliques.
Oui, toutes ces autorités sont référencées en marge des manuscrits des Morales. L’effet dont tu parles provient du commentaire de Grégoire qu’Ayala ne fait que répéter. Le « yo » en question est celui de Grégoire, paraphrasé par Ayala. Ton raisonnement est brillant mais est contredit par la nature du texte adapté par Ayala. Je ne dis pas que ce dernier ait pu introduire un point de vue personnel, mais c’est rarissime et, lorsque cela arrive, je le commente en note. Je crois, en effet, que tu fais fausse route.
Je regrette que mon message se termine sur ce commentaire négatif, parce que tes suggestions sont d’une rare acuité. Je te remercie de me donner l’occasion de justifier mes partis-pris et je ne doute pas que, si nous avions eu cet échange avant, j’aurais apporté des modifications à ma rédaction.
Amitiés,
Michel
Le 28 juillet 2019
Cher Michel,
Un immense merci pour toutes ces précisions, qui fourmillent de pistes de réflexion en tout genre et qui, c’est certain, vont m’aider à mieux comprendre cette œuvre et à la commenter de façon un peu plus pertinente avec mes agrégatifs. Je n’ai pas grand-chose à ajouter moi-même, si ce n’est sur le point 1. Oui, ce « en la manera qual / mejor se me entendier », d’une part, et la multiplication des occurrences où le « tú » ne désigne pas Dieu, d’autre part, m’incitent à penser que la pièce initiale de l’œuvre n’est pas seulement une confession adressée à Dieu mais aussi un modèle de confession adressé au lecteur, si bien que le « yo » deviendrait un quasi-confesseur. Je retiens votre idée que ce « tú » humain soit une extension de la deuxième personne employée dans les commandements : elle me paraît très séduisante. Cela irait de pair avec l’évolution énonciative appliquée aux commandements dans la confession :
-les trois premiers commandements sont énoncés au moyen d’un « tú » qui désigne Dieu et qui adresse le commandement à un « nosotros » (destinataire collectif) ;
-le quatrième et le cinquième laissent apparaître un destinataire individuel du commandement, désigné par la troisième personne (« el que », 31b ; « omne », 36a et « quien », 36b), même si ce destinataire reste indéterminé. C’est aussi dans le commentaire de ce cinquième commandement qu’apparaît un « tú » qui n’est pas Dieu : « en Caín lo verás », 38c ; « si vieres tu cristiano », 42a) ;
-les trois commandements suivants sont cités au style direct (contrairement aux précédents), si bien que le « tú » humain y apparaît, à la nuance près qu’une première personne émerge aussi comme destinataire dans le sixième : « El sesto mandamiento me dize » (45a), comme si la loi universelle s’énonçait spécialement pour le « yo » individuel ;
-les deux derniers commandements reviennent au style indirect mais le « yo » est désormais le seul destinataire : « me viene defender » (55a) et « la muger de mi próximo » (58a).
Globalement, je crois déceler un entremêlement subtil de deux interlocutions (moi/Dieu ; moi/destinataire humain) qui, à leur intersection, mettent toujours plus en avant le rôle du « yo » comme médiateur entre Dieu et les hommes.
Je pense que vous avez raison de supposer qu’Ayala, en vertu de son prestige social, peut avoir d’emblée une légitimité énonciative… mais est-ce aussi le cas quand il adopte le rôle d’un prêcheur (rôle en principe interdit aux laïcs) ? Il me semble que, dans ce registre précis, il doit tout de même asseoir son autorité d’une façon ou d’une autre et que cela passe déjà, formellement, par l’adoption de la cuaderna vía, jusque-là exclusivement cultivée par des clercs (à une exception près : Sem Tob, mais c’est un rabbin et, d’un point de vue chrétien, il peut apparaître comme une sorte de clerc dans sa propre sphère confessionnelle). Par ailleurs, le contexte du Schisme, et le soupçon jeté sur l’Église en tant qu’institution, dont on ne sait plus au juste si elle est capable de mener les chrétiens au salut, favorise l’émergence d’une parole laïque dans le domaine spirituel. Mais j’essaierai de relativiser aussi mon point de vue en fonction de vos remarques et, en particulier, d’intégrer l’idée que la diffusion restreinte de l’œuvre change quelque peu la donne.
Sur les points 2 et 3, j’ai encore davantage à apprendre et vous m’aidez grandement. En particulier, le document relatif aux notes marginales que vous me transmettez est un outil de travail précieux et je suis à peu près certain qu’il va m’être utile, notamment pour une analyse de détail du texte telle qu’on doit la mener en explication de texte. Un grand merci pour cela aussi. Par ailleurs, je suis tout à fait convaincu par ce que vous exposez à propos du Livre de Job comme source. Dieu que ces questions sont complexes ! On voit bien que c’est une fréquentation assidue des manuscrits qui vous a permis de vous frayer un chemin au milieu de cette forêt apparemment inextricable.
Je ne manquerai pas de vous faire part de mes interrogations ou de vous soumettre des idées qui me viennent au cours de l’année universitaire à venir. Par ailleurs, j’ai présenté en avril dernier, au colloque coorganisé avec Paris IV et Nanterre, une communication sur « Pouvoir et impuissance du roi dans le Rimado de Palacio » (centrée sur le passage consacré aux neuf signes du pouvoir royal, 615-629, assorti de deux contrepoints) que je vais devoir transformer en article rédigé et, si ce n’est pas abuser de votre temps, il se peut que je vous consulte aussi à ce sujet à la fin des vacances.
D’ici là, profitez bien de votre été !
Amitiés,
L’Olive, le 31 juillet 2019
Mon cher Olivier,
Ton message précédent m’a inspiré quelques réflexions que je te soumets. N’y vois aucune volonté de harcèlement en pleine période de vacances. Tu n’es d’ailleurs pas obligé d’y répondre sans délai. En ce qui concerne ta communication sur « Pouvoir et impuissance du roi dans le Rimado de Palacio », sache que je serais très heureux de la relire avant publication. La consultation des collègues est chez moi une pratique constante depuis de nombreuses années. On a tort de ne pas y recourir systématiquement, comme savent le faire nos collègues anglo-saxons. Cela évite bien des erreurs.
1. Analyse des commandements (tú, nos)
La série des commandements inaugure les exposés systématiques qui vertèbrent la confession. On pourrait s’attendre à la répétition d’un cadre unique dont la structure la plus élémentaire serait : intitulé ou numéro du commandement ; contenu du commandement ; non-respect du même par le confessant ; insertion intermédiaire éventuelle d’exempla.
Pour se faire une idée précise de la façon d’opérer d’Ayala, je te suggère de considérer la façon dont le commandement est introduit.
Le premier adopte un schéma d’une grande orthodoxie (vers a) : « luego en el primero » (1er hémistiche du vers a) ; « Señor Tu nos mandaste » (2ème hémistiche du vers a). Référence à la position du commandement dans le décalogue ; Dieu nommément et doublement cité, par son « titre » et le pronom sujet ; et il est bien précisé qu’il s’adresse à la totalité des humains (« nos »). Rien n’est laissé dans le flou. Ce schéma est reproduit partiellement jusqu’au troisième commandement inclus. Chaque développement débute sur l’indication du commandement, ce qui sera le cas pour toute la série à l’exception du 4 et du 10, dans lesquels le chiffre apparaît dans le second hémistiche, ce qui ne prête pas à conséquence. En revanche, l’invocation au Seigneur et le pronom sujet qui va avec disparaît du premier vers, pour faire des apparitions éventuelles dans le deuxième ou le troisième, alors que le « nos » se maintient, soit dans la forme verbale soit en apocope. On devine donc le procédé. La formulation du premier commandement se caractérise par sa solennité, comme il convient à une première occurrence, laquelle disparaît dans les suivantes, même si les mêmes éléments sont conservés. Il en résulte que l’exposé des commandements adopte la forme d’un discours suivi, qui évite la reproduction de l’emphase initiale tout en conservant la syntaxe de départ.
Par la suite, le schéma radicalement diffère : ce n’est plus Dieu qui est le sujet mais le commandement, sauf dans le 5ème, dans lequel Dieu réapparaît et le commandement a valeur adverbiale. La personne du verbe qui concerne le pécheur présente une grande variété : 3ème personne pour le 4ème, 5ème et 10ème commandement (« el que » », « omne », « el que ») ; 2ème personne pour le 6ème, le 7ème, le 8ème (« me ») ; 1ère personne pour le 9ème.
Tu voudras bien me pardonner ces minucias, mais je trouve qu’elles témoignent bien du souci qu’a Ayala de varier les formulations, c’est-à-dire, en fin de compte que la préoccupation esthétique l’emporte, me semble-t-il, sur toute autre considération visant à l’efficacité du discours. Je ne crois pas qu’il faille voir autre chose dans la coexistence de ces différentes interlocutions. Il ne faudrait pas me pousser beaucoup pour y reconnaître même quelques maladresses d’écriture. Mais j’admets bien volontiers que ma longue pratique d’Ayala me pousse à une certaine forme de familiarité, voire de non-respect, que l’on pourrait me reprocher.
2. « de la cuaderna vía, jusque-là exclusivement cultivée par des clercs … »
Que la cuaderna vía ait été introduite et cultivée en Castille par des clercs est un fait. Faut-il pour autant en conclure qu’elle leur est exclusivement réservée et juger son usage par des non-clercs comme une revendication implicite de cléricalisme (ou de cléricalité voire de cléricature) avec ce que cela comporte ? Il semble que c’est ce que tu suggères, mais j’ai quelques doutes à ce sujet.
Qu’est-ce qui conduit Ayala à utiliser prioritairement cette forme poétique dans son Livre ? On l’ignore car il n’en dit rien, alors qu’il est plus explicite s’agissant d’autres formes poétiques. Faute de mieux, on peut poser que c’est principalement de la nature du discours que découle ce choix formel. Il y aurait une adéquation entre le mester et les sujets abordés. En quoi consiste cette adéquation ? La copla est une unité physique exigeante mais qui paradoxalement, malgré sa brièveté et sa clôture, se prête à des développements de grande extension. Elle représente une forme intermédiaire entre poésie et prose. Elle partage avec l’une ses contraintes formelles et avec l’autre l’équivalent d’une structure syntaxique élémentaire indéfiniment reproductible. Elle est par définition le moule idéal dans lequel le discours prosaïque peut se transformer en discours poétique. C’est d’ailleurs apparemment dans ce but qu’elle a été inventée. En tous les cas, c’est dans l’adaptation du discours poétique que le mester donne sa pleine mesure. Sa première raison d’être n’est pas l’invention poétique mais l’adaptation versifiée de discours en prose.
On comprend qu’Ayala l’ait retenue pour adapter les Morales. Il a fait ce choix très tôt, si l’on veut bien admettre que ses travaux sur l’œuvre de Grégoire occupent une grande partie de sa vie, compte tenu de l’énormité de la tâche et des différentes modalités qu’elle emprunte, de la traduction à la mise en vers, en passant par le compendium et le florilège. Tu remarqueras que, dans aucun autre ouvrage d’Ayala en dehors du Thème grégorien, si ce n’est dans la Première Partie du Livre, on ne trouve de mention des Morales, ce qui contribue à associer indéfectiblement le sujet et la forme.
L’adoption du mester pour rédiger cette Première Partie pourrait donc être une conséquence indirecte de la chronologie des travaux littéraires d’Ayala. Sa pratique assidue du mester l’a logiquement conduit à y recourir pour composer un texte qui, par bien des aspects, évoquait la thématique traditionnelle du genre.
Il faut prendre aussi en considération l’archaïsme du genre à l’époque où Ayala le pratique. Son adoption par un auteur de la toute fin du xive siècle semble traduire la volonté de se rattacher à une tradition castillane (penser à une possible dimension culturelle « nationale ») respectable. À quelle fin ? Peut-être est-ce là que l’on peut déceler le désir de « faire autorité ». Il paraît évident, en effet, qu’un poète, qui démontre par ailleurs sa capacité à se mêler à des échanges avec de plus jeunes que lui et à leur en remontrer en matière d’invention formelle, lorsqu’il reprend à son compte une pratique passée de mode, le fait pour se distinguer des autres et faire peser son autorité sur eux.
Enfin, compte tenu des nombreuses similitudes entre les deux ouvrages, comment ne pas envisager que le jeune tolédan que fut Ayala ait lu le Livre de l’Archiprêtre ? C’est vraisemblable. Il faudrait donc admettre en outre que le recours au mester relève aussi du désir d’imiter un modèle.
Trop de facteurs ont pu jouer concomitamment dans l’adoption du mester par Ayala pour en privilégier un.
Profitez de vos vacances.
Amitiés,
Michel
Le 31 août 2019
Cher Michel,
Je réponds bien tardivement à votre message éclairant (qui date déjà d’un mois !) et je ne puis que vous remercier pour ces nouvelles pistes d’interprétation. Je ne me suis pas encore replongé dans la préparation des TD sur le Rimado (pour les premières séances, je peux encore m’appuyer sur ce que j’avais présenté aux étudiants l’année dernière) mais toute cette matière, une fois que je me la serai un peu mieux appropriée, me sera d’une grande aide. Tout ce que vous dites sur la formulation des commandements répond à mes propres cogitations sur l’emploi des personnes grammaticales dans le poème, qui offre toute une déclinaison de procédés énonciatifs très habiles. Pour la cuaderna vía et les clercs, vos arguments sont convaincants : j’ai sans doute surévalué la dimension cléricale du discours, même si je suis toujours étonné, au cours de ma lecture, par l’accointance de certains passages avec les formes du sermon. En tout cas, nous sommes d’accord sur le fait qu’Ayala cherche à faire autorité et que l’adoption des vieilles recettes du mester (parfois subrepticement rénovées) y contribue grandement.
Je vais me remettre à mon article dans la première quinzaine de septembre, mais je ne vous embêterai pas avec cela aussi : d’une part, ce sera une bien petite chose (travail de circonstance, davantage lié au programme d’agrégation qu’à un effort de vraie recherche) et, d’autre part, je risque fort de le boucler au dernier moment (j’ai de plus en plus de mal à m’en tenir aux délais impartis…).
J’espère que, pour Michèle et vous, cet été se poursuit agréablement, sans doute entre moments de détente à Chinon et escapades variées. Le mois de septembre est idéal pour aller en Espagne : avez-vous prévu d’y faire un tour ?
Amitiés à vous et à tous,
Olivier
L’Olive, le 1er septembre 2019
Cher Olivier,
Je suis heureux que mes suggestions aient pu t’être utiles, et encore plus que nos avis soient convergents. Ce genre d’échanges m’apporte beaucoup puisqu’il me permet de poursuivre ma réflexion au-delà de l’édition, qui appartient déjà au passé.
J’ai fait une exception cet été en m’éloignant deux semaines de Chinon, alors que nous avons pour habitude de laisser les sites touristiques à ceux qui travaillent toute l’année. J’ai passé quelques jours avec mon fils et mon petit-fils au Pays Basque (Cambo-les-Bains), puis un séjour en compagnie de Michèle dans l’île d’Oléron. Finalement, ces deux coupures nous ont fait du bien. Il est vrai qu’en Touraine, la chaleur est forte et la sécheresse sévit durement, ce qui finit par être éprouvant, même dans une maison fraîche.
Il est prévu que nous passions la semaine du 6 octobre en Espagne pour la présentation de deux de mes ouvrages récents : le Libro del Canciller à Vitoria et la Crónica de Juan II à Salamanque. Je leur dois bien cela, tant ils se sont donné de mal pour la publication de ces deux éditions.
Amitiés
Michel
Le 3 novembre 2019
Cher Michel,
J’espère que votre tournée espagnole s’est déroulée au mieux et que la présentation de vos ouvrages a suscité tout l’intérêt qu’ils méritent. Ce voyage a dû aussi être l’occasion pour vous de revoir des collègues et des amis.
Je vous envoie ci-joint mon article consacré à la figure royale dans le Rimado (notamment aux neuf signes du pouvoir), publié en octobre dans e-Spania. Si je n’avais pas été aussi en retard pour le remettre, je vous l’aurais soumis avant publication afin qu’il puisse bénéficier de vos conseils : c’est bien dommage pour moi de ne pas avoir pu le boucler avec un peu d’avance. Si, dans les semaines à venir, vous trouvez un moment pour y jeter un coup d’œil et pour me dire ce que vous en pensez, ce sera très utile pour ma gouverne. Le PDF n’est pas agréable à lire dans sa mise en page et dans sa typographie (je ne sais pourquoi, les « z » italiques apparaissent en gras… ) et je trouve la version en ligne plus réussie de ce point de vue : https://journals.openedition.org/e-spania/31594 Sur le fond, j’ai bien conscience des limites de mon travail, davantage adressé aux agrégatifs qu’à la communauté des chercheurs, mais je me suis pris au jeu et, finalement, cela m’a permis d’explorer le versant politique de la première partie de l’œuvre. J’ai l’impression d’y voir un peu plus clair dans l’idéal prôné par Ayala, même si ma démonstration ne se fonde que sur quelques passages choisis.
À bientôt !
Amitiés,
Olivier
L’Olive, le 7 novembre
Cher Olivier,
Je souscris pleinement à ton approche de l’apport du Rimado dans son traitement du pouvoir royal ($ 4 et 5) : l’accent mis sur les aspects négatifs et sur la pratique plus que sur des principes, à l’exception de l’exercice de la justice. L’idée que le signe comme indice le cède au signe comme action, qui prolonge ce constat, me paraît une hypothèse intéressante et témoigne d’une volonté d’encadrer ton raisonnement dans de strictes limites. Mais je sais que tu n’aimes rien tant que t’imposer ce genre de contraintes, te refuser d’avance toute facilité. C’est tout à ton honneur.
Ce que nous propose Ayala, ce n’est pas une théorie sur le pouvoir mais une réflexion sur la manière d’en améliorer la perception, dis-tu. Tu t’appuies pour le prouver sur une étude du vocabulaire employé qui présente des termes dont la répétition ne saurait être fortuite. Je suis d’accord sur le principe, un peu moins sur le caractère systématique que tu prêtes à ce vocabulaire récurrent. J’aurais quelques objections à faire : la principale est que tu ne retiens pas de possibles nuances entre l’acception du temps d’Ayala et la nôtre ; par ailleurs, tu évacues les contraintes d’écriture qui ont pu provoquer chez lui un recours à la facilité, faute d’autres moyens à sa disposition ; enfin, tu ne sembles pas prendre en compte l’expérience propre d’Ayala dans cet exercice.
Ainsi, les trois qualités requises à l’extérieur du royaume intéressent au premier chef un ambassadeur comme Ayala, qui a eu une expérience à titre personnel dans ce domaine. C’est un véritable témoignage (je reviendrai sur ce terme) sur les conditions à réunir pour qu’une ambassade soit réussie. En l’occurrence, le paraître a une signification particulière, et je ne crois pas que les pratiques diplomatiques actuelles négligent cet aspect ostentatoire. De ce point de vue, la strophe 619 est très éclairante, car elle décrit le document (que je ne qualifierais pas de « charte ») que l’ambassadeur remet entre les mains du souverain étranger, ainsi probablement que les lettres de créance qui garantissent la qualité du messager. C’était d’autant plus crucial à une époque où les souverains ne se rencontraient que très rarement. Je crois que l’entrevue de Louis XI et Enrique IV sur la Bidasoa est la première (le futur Henri II a rencontré Charles V alors qu’il n’était qu’un prétendant aux abois).
Sur l’usage de l’adjectif « bueno », il faut aussi être prudent : buena ley e de omnes buenos sont de véritables lexies. Les autres occurrences sont peu chargées sémantiquement, -je suis bien de ton avis-, sauf à considérer que leur présence vaut autant comme refus explicite de la laideur ou même de la médiocrité.
Une des principales difficultés dans l’interprétation de ces termes est la priorité qu’Ayala donne aux adjectifs, de façon générale, mais plus particulièrement dans le cas de « onrado » de préférence à « onra » et « aconpañado » de préférence à « compaña ». La généralisation d’une seule forme nuit à l’expression de la nuance, pourtant nécessaire lorsque le terme a plusieurs acceptions comme « onra ». Je ne suis pas si sûr que le terme « onrados » de 627a prenne une certaine coloration à la lecture du vers suivant, qui découle plutôt de la ponctuation introduite par Bizzari. Pour moi, le dernier hémistiche du premier vers inaugure une énumération d’éléments autonomes et n’est pas glosé ou complété par le contenu du vers b. Ces « omnes onrrados » sont le sommet d’une pyramide sociale qui est déclinée de haut en bas, à l’exception peut-être des prélats, qui devraient venir au deuxième rang (mais la rime a ses exigences). La honra reste un distinctif du rico omne et l’attribut qui lui confère un statut social supérieur. J’en ai trouvé un exemple récent dans un testament de 1488, dans lequel on peut lire : « E mando e quiero que aya las dichas casas Juan Messia dEscauias, mi nieto, […] por seruiçios que me ha fecho, e porque es varon e sea mas onrrado e tenga casa suya en que more ». A propos de « onrrado », j’ajouterai que j’ai un doute sur la façon d’interpréter celui qui est à la rime de 629b : je l’interpréterais plutôt comme une métathèse de « orrnada », qui n’est pas rare à l’époque.
Entendons-nous bien. Je ne discute pas la pertinence de l’analyse poussée que tu fais du vocabulaire du passage. Mais je me demande si le système qui te guide dans cet exercice ne te fait pas perdre de vue certaines nuances qu’il faudrait ménager à l’intérieur d’un même terme. La polysémie est un trait caractéristique de la langue médiévale, bien illustré par paresçer, qui signifie autant « apparaître », « être » (cast. constar, resultar), que « sembler ». Or, tu ne retiens que la troisième acception (c’est moi qui les classe). Aussi ai-je de sérieux doutes sur ton interprétation de 625d. (Je pense que tu interprètes mal aussi « valdia gente », qui ne désigne pas le « commun des mortels » mais des gens oisifs et inutiles, des parasites, en quelque sorte).
Ce sont des points de détail, me diras-tu, mais, dans la mesure où tu défends une opinion très ferme, il vaut mieux ne pas prêter le flanc à la critique. Car, en somme, tu as l’air de dire que la royauté castillane, à l’époque où Ayala rédige son texte, n’a plus que l’apparence du pouvoir et que c’est cette apparence qu’elle doit viser à améliorer afin de regagner une crédibilité qu’elle a perdue. J’exagère peut-être mais c’est ce qui se lit en creux. C’est aller un peu loin et d’ailleurs il me semble que tu te contredis quelque peu lorsque, à la suite, tu insistes sur la solitude du roi. N’est-ce pas là, au contraire, la condition première d’un pouvoir non partagé ? Il me semble qu’Ayala nous invite plutôt à une réflexion sur l’impossibilité à maintenir le mythe d’un pouvoir solitaire qui s’incarne en une personne face aux réalités de son exercice. Ce faisant, il nous délivre un nouveau témoignage, car le « voir » s’applique d’abord à lui, le familier de la Cour.
Ton développement sur la possible utilisation par Ayala du texte d’Alvaro Pelayo est très bien venu et convaincant. Le fait que l’institutionnalisation du Conseil royal se concrétise en 1385-1387 constitue une excellente mise en contexte, encore qu’à cette époque, qui suit immédiatement la défaite d’Aljubarrota, Ayala n’y soit pas associé pour cause de captivité. Mais elle pouvait être dans l’air du temps.
Tous ces passages du Rimado prennent un autre sens si on suppose qu’Ayala a en tête l’exercice du pouvoir pendant une minorité royale. C’est un épisode de la vie monarchique qui se prête à la remise en cause de certains principes, et qui n’a pas lieu d’être lorsque le monarque est dans la plénitude de ses facultés. C’est le moment où la constitution du Conseil du roi et ses modalités de fonctionnement doivent être fixées ; celui aussi où le jeune monarque doit asseoir son autorité ; celui enfin où il doit se faire reconnaître comme digne de la fonction qu’il a reçue en héritage. Toutes les circonstances sont réunies pour que les vers d’Ayala prennent sens, sans qu’il soit nécessaire de remettre en cause l’institution proprement dite. Je ne sais pas ce que tu en penses. Évidemment, cela obligerait à imaginer que Pero López a repris son texte à une date postérieure à la captivité de Obidos, pendant une des deux minorités que la Couronne connaîtra après 1390 et après 1405, mais c’est bien ce que tu suggères en plaçant la réforme du Conseil en 1385-1387.
J’ai trouvé beaucoup d’intérêt à la lecture de ton article. L’éditeur a trop le nez dans le texte pour pouvoir observer certaines choses. Tu m’as bien éclairé mais, lo cortés no quita lo valiente, aussi, je te demande ne voir aucune intention maligne dans mes objections.
Con un fuerte abrazo de
Michel
Cher Michel,
Non seulement vos objections ne me froissent pas le moins du monde, mais elles me sont précieuses ! Je suis bien conscient que personne ne me lira avec une telle acuité et une telle précision. Un immense merci à vous pour cette lecture si rigoureuse et pour votre message qui fourmille d’idées. Vos remarques confirment le sentiment que j’avais de ne pas être allé assez loin dans mon analyse, notamment parce que j’accorde une attention insuffisante aux multiples nuances du texte (ma volonté de démonstration m’a sans doute poussé à sélectionner un peu abusivement les éléments qui allaient dans mon sens au détriment d’autres, tout aussi importants). Les données biographiques (expérience d’Ayala comme ambassadeur) auraient dû aussi trouver leur place dans mon travail. Je ne crois pas qu’Ayala, à travers la liste des neuf signes, affirme que la royauté en Castille se trouve dépourvue de pouvoir réel et soit seulement fondée sur l’apparence, même si je comprends que mon texte puisse le laisser entendre : mon but était plutôt de montrer que, pour Ayala, le pouvoir ne saurait tenir à la seule personne royale et que, par conséquent, le Rimado appelle de ses vœux une participation accrue des nobles (et des représentants des villes) au gouvernement. C’est surtout en ce sens que j’ai risqué cette idée du « décentrement » du miroir. Ainsi, je vous rejoins tout à fait quand vous dites qu’il s’agit de dénoncer « le mythe d’un pouvoir solitaire » : quand il ne partage pas son pouvoir et ne sait pas se faire représenter, le roi est isolé et impuissant. Quant à la contextualisation, j’ai été frappé par les échos entre les passages qui renvoient aux conseillers et les ordonnances relatives à l’institutionnalisation du Conseil royal en 1385-1387. Mon sentiment est que les passages en question auraient pu être écrits peu après la captivité d’Obidos ou, comme vous le suggérez, écrits pendant la captivité mais retouchés, voire remaniés, en fonction de ce nouveau contexte. Je m’apprête, avec les agrégatifs, à aborder les questions politiques dans le Rimado et toutes vos observations vont enrichir ce que j’aurais à leur dire !
Encore un grand merci à vous et à bientôt !
Amitiés,
Olivier
Cher Olivier,
Je suis très heureux de ta réaction. Elle m’aide à libérer ma parole, qui est la condition indispensable à un échange d’idées fructueux.
Une suggestion : n’excluons pas la possibilité qu’Ayala ait pu ajouter dans son texte initial un développement autonome comme les IX choses, à condition de ne pas toucher à l’exemplum d’Alaric, sans lequel la copla 716 (« No puedo alongar … ») n’aurait pas de sens.
Je me suis lancé dans la lecture du numéro d’e-Spania. Je suis très intrigué par la référence à un ouvrage récent de Sophie Hirel consacré à Ayala. Quelle cachottière !
Amitiés,
Michel
Paris, le 19 mars 2020 [début du confinement]
Chers tous deux,
J’espère que vous allez bien, autant qu’il est possible, et que vous ne cédez pas à l’angoisse qui plane. Nous n’aurions jamais cru vivre une telle situation, n’est-ce pas ? Prenez soin de vous.
Mes chaleureuses amitiés à vous, ainsi qu’à Gigi et Patrice,
Olivier
Cher Olivier,
En ces temps d’isolement forcé, ton message nous a fait bien plaisir.
En ce qui nous concerne, le confinement est plus que supportable. J’ai honte à l’avouer, nous n’en souffrons pas du tout. Nous disposons d’un grand espace autour de la maison, et sommes dehors dès que le soleil paraît, ce qui est le cas depuis deux jours. Nous faisons nos courses avec parcimonie mais sans empêchement majeur. En outre, Patrice est dispensé de ses voyages à Paris, depuis hier seulement car, pendant les premiers jours, il était requis dans son école de la rue Buffon qui accueille des enfants du personnel soignant de la Salpêtrière. Il serait donc indécent de notre part de nous plaindre. En revanche, nous compatissons sur le sort des citadins comme vous, qui ne peuvent guère sortir de leur appartement.
Tu as bien raison de dire que nous ne pouvions imaginer avoir à vivre pareille situation. En ces temps où la technologie semble tout nous permettre, y compris des pratiques inconsidérées, nous voilà rappelés durement à un ordre que nous avions un peu trop tendance à oublier. Saurons-nous tirer la leçon dans l’avenir ? Pour nous, ce sera facile, parce qu’un âge avancé s’accommode d’un périmètre réduit et d’activités routinières, mais pour les plus ou moins jeunes, cela risque d’être pénible. Le « toujours plus » ne devrait plus être permis. Comment se faire à cette idée dans une société comme la nôtre ? Ce qui est sûr, c’est que la solution dépend de chacun plus que de la collectivité ou des gouvernants. Le spectacle que ceux-ci nous donnent est pathétique. Quand un ministre de l’économie, acquis de tout temps aux idées néo-libérales, fait l’éloge de la relocalisation des industries, on croit rêver. Lorsqu’un président qui n’a cessé de restreindre les moyens des services publics s’inquiète de voir que l’hôpital pourrait ne pas pouvoir face à une pandémie, on s’interroge sur sa compétence et sur son degré de sincérité. On pourrait multiplier les exemples, mais ce serait cruel et de toute façon, guère réconfortant.
Comment occupons-nous nos loisirs forcés ? L’entretien de la maison exige beaucoup de temps et de soin, surtout lorsque la femme de ménage est absente (1 semaine de vacances et 1 semaine en arrêt maladie pour cause de grippe). Nous avons pu bénéficier à temps de l’intervention des jardiniers et n’avons donc pour quelque temps que de l’entretien régulier à faire. Nous avons pu même réaliser quelques semis de radis, de salades, de betteraves, de carottes et de fèves. Par ailleurs, nous lisons beaucoup et écoutons énormément la radio, France Musiques et France Culture principalement. En ce qui me concerne, l’académie de Touraine m’occupe pas mal. J’ai déjà préparé les textes qui paraitront dans les Mémoires 2020, qui sortiront au mois de septembre (ce sont les conférences qui ont été prononcées au cours de l’année civile précédente, 2019). De plus, nous avons créé une nouvelle série Les cahiers de l’académie, dont le premier volume est consacré aux Mémoires d’un instituteur tourangeau pendant la Seconde Guerre mondiale. L’auteur, Maurice Davau, est bien connu pour avoir collaboré avec le linguiste Marcel Cohen pour la préparation du Dictionnaire du français vivant et est connu par ici pour sa connaissance du parler tourangeau.
En outre, je travaille à enrichir le site web que mon petit-fils Julien vient de créer pour moi (l’adresse figure au-dessous de ma signature). Je voudrais y « accrocher », des textes inédits : conférences, causeries, des fragments du journal que j’ai tenu à certaines époques de ma vie, des correspondances, des traductions. La page comportera deux volets, un français, l’autre espagnol, avec, pour chacun, des textes en propre. Je m’amuse beaucoup. C’est un excellent exercice, qui exige de ne pas tomber dans la fausse modestie ni de dévoiler ce qui relève de l’intimité, chez les autres comme chez soi-même.
Après ces années d’intense travail en médiévistique hispanique, je prends plaisir à ne faire que ce qui me plaît. Il m’arrive néanmoins de m’intéresser à un thème médiéval lorsqu’on me le propose. C’est ce qui vient de se produire avec la découverte du testament de Pedro de Escavias. Je l’ai transcrit et commenté. Il sera publié, complété par deux études confiées à des chercheurs jiennenses, à Jaén. Le volume est quasiment prêt mais il faudra attendre la fin du confinement et un peu plus sans doute pour sa présentation.
Voilà nos dernières nouvelles.
Ne manquez pas de nous tenir au courant des vôtres. Nous y tenons beaucoup.
Nous vous embrassons,
Michèle et Michel
L’Olive, le 29 avril 2020
Cher Olivier,
Je continue à mettre de l’ordre dans mes papiers en veillant à ne garder que l’indispensable, ce qui fait quand même un gros volume. Cela me permet de retrouver des dossiers que j’avais complètement oubliés.
Tout se passe bien à L’Olive. Nous ignorons quel sera le sort de Patrice et s’il sera autorisé à effectuer quotidiennement ses déplacements entre Chinon et Paris, ce dont je doute fort. Pour Michèle et pour moi, puisque les seniors sont l’objet de toutes les attentions des pouvoirs publics qui tiennent visiblement à les conserver en vie encore quelque temps, nous devrons nous contenter d’évoluer dans un espace réduit, ce qui ne nous gêne pas outre mesure, mais avec un masque sur le bec, ce que j’ai du mal à concevoir. J’ai la phobie de l’étouffement.
Nous avons bénéficié de pluies abondantes, juste après avoir planté nos légumes d’été et semé un gazon. Cela ne pouvait mieux tomber, si j’ose dire. Nous attendons maintenant le soleil pour permettre aux cerises de se gorger de sucre. Ce matin, il fait frisquet.
Soignez-vous bien.
Amitiés,
Michel
PS. J’ai « accroché » sur mon site la traduction commentée d’une nouvelle de José López Pinillos (Rubans rouges). Si le cœur vous en dit…
L’Olive, le 11 mai 2020
Cher Olivier,
Mes inquiétudes à moi concernent principalement l’état de santé de la cohorte de vieilles personnes qui constituent l’académie de Touraine. Pour l’instant, nous avons été épargnés par le virus, mais nos activités sont exclusivement virtuelles, ce qui n’interdit pas heureusement l’activité éditoriale. Mais enfin, la présence physique nous manque.
Tu auras beaucoup payé de ta personne pour les concours (je me souviens du pensum du CAPES). Ne crois-tu pas que tu as assez donné ? Cela me rappelle une anecdote. J’avais coïncidé avec Maxime Chevalier dans des cours d’été organisés par l’Université de Saragosse à Panticosa. Au détour d’une conversation, je lui avais dit que je n’avais jamais participé à un jury de concours. Pourquoi ? Parce qu’on ne me l’avait pas proposé. Il n’en revenait pas et je voyais à son regard qu’il ne cessa d’y penser les jours qui suivirent cette conversation. Il faut dire que j’avais ajouté que, si on m’avait contacté, j’aurais probablement refusé, sauf si on m’avait proposé la présidence du jury. Mais, dans ce cas, j’aurais exigé de pouvoir réformer le concours. Tu devrais y songer aussi.
J’ai pas mal travaillé pour enrichir mon site. J’ai préparé un dossier sur chacune de mes thèses : la correspondance qui aboutirait à l’édition de ma thèse de 3ème cycle à Jaén ; le résumé, l’exposé de thèse et la conclusion de la Thèse d’État. Ce fut l’occasion pour moi de remuer de vieux souvenirs et de replacer certains faits à leur place véritable. C’est d’ailleurs la véritable raison d’être de ce travail que je m’impose. Je demanderai à Julien d’ajouter ces deux dossiers dans les jours qui viennent.
Amitiés,
Michel
L’Olive, le 10 septembre 2020
Cher Olivier,
Ci-dessous le rappel d’un courrier que j’ai reçu de notre Université. Je n’ai pas répondu à celui de juillet et ne répondrai pas à celui-ci non plus, tellement une conception aussi étroitement administrative de l’éméritat me fait froid dans le dos. Elle devrait émaner de la communauté scientifique et être accompagnée d’un minimum de considération, sans aller jusqu’à de la sympathie, ce qui serait beaucoup demander. L’éméritat est ainsi réduit à une dimension purement utilitaire, que les collègues encore en exercice sont invités à accepter ou non. La place qui revient à l’émérite est celle d’un postulant à un honneur qu’on ne lui offre pas. Quel paradoxe !
Je ne suis plus émérite depuis 2013. L’ai-je d’ailleurs été jamais, moi qui n’ai jamais été personnellement invité à aucune activité de mon ancien établissement (participation à des jurys de Thèse, colloques, conférences, séminaire ?
Cependant, j’ai toujours fait état dans mes publications de ma qualité de professeur émérite, même pour mes derniers travaux, alors que j’avais cessé de l’être. C’était le moindre hommage que je pouvais rendre à la Sorbonne Nouvelle à laquelle j’ai consacré les vingt dernières années de ma carrière. J’espère qu’elle ne m’en voudra pas trop de cette entorse au règlement.
Je ne sais pas pourquoi je te fais ces confidences aujourd’hui. N’y vois aucune aigreur, simplement l’effet d’une réaction épidermique face à une injonction aussi ferme à me manifester. De toute façon, à qui d’autre qu’à toi pouvais-je les faire ?
Amicalement,
Paris, le 31 mai 2021
Cher Michel,
Je vous souhaite un joyeux anniversaire et un changement de dizaine tout en douceur (pour moi, c’était l’année dernière) !
En guise de présent, voici, en avant-première, un fragment inédit d’une œuvre du mester de clerecía jusqu’ici inconnue, que j’ai eu la chance de débusquer tout récemment dans une bibliothèque dont je ne veux pas me rappeler le nom. Je pense que le manuscrit (papier) est du milieu du XVe : la copie, d’une seule main, est très lisible, sans être non plus particulièrement soignée. Je vous en dirai bientôt davantage sur les autres textes copiés dans le même codex. Le fragment occupe cinq folios recto-verso et compte 57 strophes, qui forment un tout cohérent (l’ordre des strophes ne semble pas avoir été altéré). D’après sa langue, je dirais qu’il est issu d’un poème composé dans la première moitié du XIIIe, si bien que son auteur est sans doute un contemporain de Berceo (mais ce n’est pas lui, ça j’en suis sûr). Il est singulier à plus d’un titre. On ne peut pas dire qu’il soit bien écrit mais, d’une part, il montre que des clercs castillans de cette époque s’intéressaient à la matière française et, d’autre part, il suggère une piste extraordinaire quant à l’identité de l’auteur de l’Alexandre. Il est probable que le poète de l’Apolonio et Juan Ruiz s’en soient inspirés : outre l’évidence de quelques expressions, voire d’hémistiches entiers, en commun avec leurs œuvres, son anecdote me semble de la même veine que la facétie des Grecs et des Romains du Libro de Buen Amor, même si, d’un point de vue stylistique, elle ne lui arrive pas à la cheville. Je l’ai transcrit à la va-vite pour vous le livrer à temps, mais je prépare une édition paléographique pour très bientôt.
Profitez bien de cette belle journée !
Avec mes chaleureuses amitiés,
Olivier
Mon cher Olivier,
J’ai pensé tout d’abord te répondre dans le même esprit que ton message, mais, pour ne pas m’exposer à une comparaison outrageusement défavorable, je préfère m’en tenir à un discours convenu, -entre amis, tout de même-, pour te souhaiter à mon tour un joyeux anniversaire. Tu as 51 ans, si je compte bien, et donc toute la vie devant toi et des projets exaltants.
La perspective de devenir octogénaire a gâché la dernière année de mes soixante-dix-ans. Maintenant que j’ai franchi le pas, j’espère être définitivement débarrassé de cette épée de Damoclès que j’avais moi-même suspendue au-dessus de ma tête. Je vais désormais faire abstraction de ces vaines considérations d’âge pour continuer à donner le meilleur de moi-même, dans les limites de mes capacités physiques et intellectuelles, cela va sans dire.
Michèle a fait de L’Olive un paradis et nous n’en sortons qu’en pensée. En revanche, les visiteurs y sont les bienvenus.
Donne-nous de temps à temps de vos nouvelles et dispense-nous tes trouvailles bibliographiques. Tu sais que j’en suis très friand, surtout lorsqu’elles atteignent ce niveau de qualité. C’est un petit chef-d’œuvre. M’autorises-tu à le faire connaître, par exemple sur mon site ?
À tous trois nos affectueuses pensées,
Michèle et Michel
Paris, le 1er juin 2021
Cher Michel,
Je suis heureux que ma petite fantaisie vous ait plu. J’ai pris bien du plaisir à l’écrire : une fois qu’on a enclenché la mécanique de la cuaderna vía, ça tourne presque tout seul et on est grisé comme sur un manège. Je suis fier que vous souhaitiez la publier sur votre site. J’en déduis que je peux la partager aussi avec mes condisciples, n’est-ce pas ? (d’autant qu’ils sont nommément visés…). Le temps de la thèse est loin, mais je pense qu’on n’oublie pas son intensité particulière, liée à la prise de risque et à la chance d’avoir une poignée de lecteurs ultra-savants qui décortiquent votre travail. Je me revois souvent dans la salle Bourjac…
Les mois écoulés depuis le printemps de l’année dernière ont été rudes pour tout le monde et j’espère que nous voyons le bout du tunnel.
Profitez bien des beaux jours dans le petit paradis de l’Olive !
Amitiés,
Olivier
ANNEXE
Fragment inédit d’un poème en cuaderna vía d’auteur inconnu, probablement du XIIIe (arrondissement ?)
1 En París la çibdat, de los sabios vergel,
avié ý un maestro, sienpre a Dios muy fiel,
de palabra sabrosa, más dulze que la miel:
si su nomne queredes, clámase don Miguel.
2 Vaso pleno de çiençia, de letras profundado,
más valié su saber que un rico condado.
Por oýr su sermón, acudían privado:
el que tarde llegava maldezía su fado.
3 Como ave liviana volava la su fama
por los pueblos christianos e fasta en aljama:
qualquier que dél oyé, fuesse varón o dama,
querié de tan buen árbol escoger una rama.
4 El onrado maestro de la barva florida
al derredor de sí, es cosa bien sabida,
avía de disçípulos una corte cresçida
que vinién demandar la su çiençia conplida.
5 De algunos los nomnes quiero versificar
maguer sea tardança para vuestro yantar:
si esperar quisierdes, puédovos segurar
que vos será sabroso aqueste buen manjar.
6 El catalán don Carles, moço de grant saber,
qué cosa es amor él querié contender,
si es onrar a Dios o cobdiçiar muger
–me serié fuerte cosa a mí de responder–.
7 Siquier de Aristótil o de sanctos varones,
buena glosa fazié de sus disputaçiones:
aprendié la dotrina, bien sabié las leçiones
daquel fijo de Venus, señor de coraçones.
8 Una apuesta dueña, Elena es nomnada,
non la que fue de Troya ocasión e maçada,
mas otra muy piadosa, sabia e tan letrada
que era maravilla de toda cosa nada.
9 Ella por ser muger non aprendié peyor
ca al maslo dio fenbra Dïos Nuestro Señor
de una misma carne, de onra non menor,
e nunqua le vedó que non fuesse dotor.
10 La dueña a los clérigos esponié su sabiençia:
más que bispo sabié de buena penitençia
e de la confisión, sin ninguna entençia:
fasta el mismo papa le pidié su sentençia.
11 De linaj de Artús, avié ý un bretón,
naçido en Bretaña –en Normandía non–,
Joan Pedro de la Huerta fue aquel infanzón:
entre todos los libros, amava cronicón.
12 Mas las estorias luengas, non las preçiava tanto
como las abreviadas e dizié: “Non aguanto
tal amuchiguamiento, que es fin e quebranto
de buena paçïençia e de todos espanto”.
13 De diez libros grüessos, él fazié una suma,
una chica cartiella que plaz e non abruma;
querié de mucha mar sacar poca espuma:
¡sepades que en vano non movié la su pluma!
14 Una dueña navarra, Amaia es clamada,
mejor que çient varones, como bien ensenyada,
sabié de Alexandre, el rey e la mesnada,
departir la estoria e la fin malograda.
15 De toda la fazienda del rey de grant valía
fizo ella un libro de nueva maestría,
el primero que fue por la quaderna vía,
mas su nomn’ ý non puso, por su grant omildía.
16 Si el rey Alexandre, varón de grant poder,
su leyenda sopiesse que la farié muger
tenplarié su sobervia, non serié referter
–e sin la buena dueña, non ternié yo mester–.
17 En Alacant naçida, otra dueña loçana
–si saber lo queredes, por nomn’ la dizen Ana–,
maguer que muger fue, en su memoria sana
de decorar estorias sienpre avía gana.
18 Cresçióle la dotrina, la çiençia general,
fasta que un perlado, muy alto cardenal,
la fizo coronista en su cort prinçipal:
¡las letras non se pierden en la dueña atal!
19 Del cardenal los fechos, ella bien los notava,
nada non eñadié, nin nada ý menguava:
la crónica movié a las gentes sin traba
¡más de una saeta tenié en su aljaba!
20 Otro de menos seso, dízenle Olivero,
moço de gran sinpleza, de saber tardinero,
mas con toda femençia, obrando con esmero,
dezía: “Desta grey yo quiero ser cordero”.
21 La mengua del juïzio, con afán la llenava;
leyé los actoristas, sus libros repasava:
como omn’ en la cal que perdido andava,
quantas puertas veyé les movié el aldava.
22 Del estudio mayor él sofrié la fatiga,
maguer que una paja le semejasse viga;
como fue provençal, sin caer en nemiga,
fazié del gran pesar una triste cantiga.
23 El noble don Miguel bien veyé su sudor:
sienpre lo castigava, poniendo ý dulzor
ca sabié que con fuerça non se vençe error
sinon con paçïençia de adotrinador.
24 Estos e otros muchos que non serién contados
de don Miguel el sabio reçibién los dictados
e en letras de oro los guardavan notados
en los sus coraçones, ca non en sus tocados.
25 A todos el maestro dio en don armadura
e espada tenplada por que de grant ardura
sopiessen se guardar, mantener conpostura
e de fuerte batalla sofrir la calentura.
26 Mas sepades que estas non fueron de azero:
la armadura rezia, de fe era vozero;
en la buena espada, sotileza ver quiero,
arma de escolar, ca non de escudero.
27 A todos don Miguel enseñó defensión
que ante otros sabios sopiessen su razón
aduzir firmemientre en la disputaçión
–“thesis” dizen en Greçia, en latín “posiçión”.
28 Cada uno sabié retórica usar,
de fermosas colores sus palabras pintar,
salvo don Olivero: non era de rebtar,
que la su boca torpe adur podié graznar.
29 Don Miguel castigava a cada alumniello,
para que fues’ dotor, maguer era chiquiello;
él metié gran saber en pequeño saquiello:
de la omilde casa querié fer un castiello.
30 En escuelas de Françia pusieron nueva ley
sobre aquesta thesis –otorgólo el rey–,
que non osase nadie, toro, vaca nin buey,
defenderla señero, saliendo de la grey.
31 Los buenos escolares, cada qual su consejo,
ayuntados en uno, só un mismo pellejo,
devrían a los sabios, juntados en conçejo,
responder su pregunta, como faz el espejo.
32 De thesis defender quando el tienpo vino,
el sabio don Miguel, maestro de buen tino,
dio a los sus disçípulos castigo paladino
–ellos como apóstoles bevieron el buen vino–
33 que quando estoviessen ante el tribunal
de los altos maestros de saber tologal,
que guardassen la onra de la corte atal,
que la respuesta dada non le sopiesse mal.
34 Aún les dio consejo que fuessen bien catados
que respuesta fiziessen sin ser arrebatados,
mas con dichos abiertos, bien espaladinados,
ca es loco quien fabla entre dientes çerrados.
35 El día de la thesis, de grant solemnidat,
se ayuntan diez sabios de grant actoridat,
los mejores que son en toda la çibdat,
de luengas barvas canas –non mançebos, ¡pensat!
36 En sus siellas sentados, con sus nobles vestidos
de seda e de oro rica miente texidos,
con los sus pargaminos e libros escogidos,
están ý los maestros atan esclareçidos.
37 Llegan los escolanos, sepades, con temor,
con ellos don Miguel, de dotores dotor:
mançebos e mançebas catan a su señor,
semejan ovejiellas enpós el buen pastor.
38 Estonçes don Miguel a los sabios saluda
e diz: “Nobles maestros, qui pecado non muda,
tornad contra mis moços vuestra cara barvuda,
que su thesis respondan a pregunta aguda.”
39 El mayor del conçejo, filósofo ançiano,
–si oviesse cabello, bien lo avría cano–
lenta mente levanta la su derecha mano
e dize: “¡Bien me oiga cada qual escolano!
40 Preguntar vos queremos una cosa sotil,
que la non soltarié omne nesçio nin vil,
mas de alta çïençia, apuesta, doñeguil:
¡bien devredes del seso ençender el candil!”
41 Los disçípulos todos, la cabeça baxando,
por perdidos se tienen, de los cuerpos tenblando:
quien antes esforçava agora finca blando,
mas sabe don Miguel acabdillar el bando:
42 “¡Avivad vuestro seso”, dizles, “e non temades!
¡De un mismo convento sodes buenos cofrades!
¡Cada uno de vós, mejor que çient abades,
sabrá de aquel riebto sacarle las verdades!”
43 En esto el ançiano, de los sabios mayor,
fabló en esta guisa, fue buen preguntador:
“Entre todas las cosas que Dios Nuestro Señor
nos dio por la su graçia, ¿quál será la mejor?”
44 Desque ovo fablado, a los moços paresçe
que con estas palabras la su vida fenesçe,
mas el firme saber tan pronto non fallesçe:
todo el buen obrar les val, ca non enpesçe.
45 Don Carles muy aína dio la su responsión:
“Amor es, sine dubda, de Dios el mayor don”.
E de doña Elena se oyó el buen son:
“Los siete sacramentos son mejor galardón”.
46 Estonçes don Joan Pedro fabló en esta guisa:
“Brevedat, según creo, val tanto como misa
porque de Dios proçede toda obra conçisa”.
–Cada qual su cuydar, cada qual su divisa–.
47 Luego doña Amaia, non lo quiso tardar,
dioles la su respuesta, non era de vagar:
“Para que la sobervia sepamos abaxar
omildad del Señor es regalo sin par”.
48 Doña Ana en esto aduxo su asmança:
“Mi cardenal lo muestra, sin ninguna dubdança,
nuestra Sancta Eglesia, del çielo semejança,
esta es de don Christo la mejor remenbrança”.
49 Don Miguel, en oyendo tan apuestos sermones,
por muy bien enpleadas dava las sus leçiones;
tener dicha pregunta diversas responsiones
non es de estrañar: ¡de Dios son tantos dones!
50 Los diez sabios en uno otorgar semejavan
los dichos de los moços segunt los escuchavan,
mas agora al último, oírlo esperavan:
era don Olivero – a quien pocos alaban.
51 En tan noble conçejo, al torpe, con vergüença,
de los sus pensamientos se’l desata la trença,
ya non sabe quién es, en su tierra comiença
de asmar, dó nasçiera, e responde: “¡Provença!”.
52 ¿De Dios serié Provença el mejor donadío?
En París lo dezir es cosa de sandío.
A don Miguel le pesa: “¡Ay, Olivero mío,
es perdida tu thesis, segunt lo que yo fío!”
53 Pero los sabios todos, non nueve sinon diez,
semeja que otorgan la respuesta rafez
assí como las otras; luego dizen:“¡Pardiez!
¡Quántas thesis preçiosas oýmos esta vez!”
54 Con la grande vegez, piérdese la potençia.
Maguer que sieden ellos en buena audïençia,
son todos medio sordos: en la dicha sentençia,
en logar de “Provença”, oyeron “providençia”.
55 Los buenos escolanos fiziéronse dotores,
fasta don Olivero pierde los sus temores,
don Miguel del grant gozo da saltos bailadores,
las escuelas resuenan de flautas e tanbores.
56 Destajar vos queremos aquí nuestra estoria,
que luenga es assaz e gira como noria.
Al noble don Miguel, guardatlo en memoria,
que por la su doçençia se ganó tal victoria.
57 El saber que maestro vos dio en buen amor,
mançebos e mançebas, tenetlo por señor
e demás por amigo, ca lo diz un actor:
“De soledad la çiençia es buen remediador”.