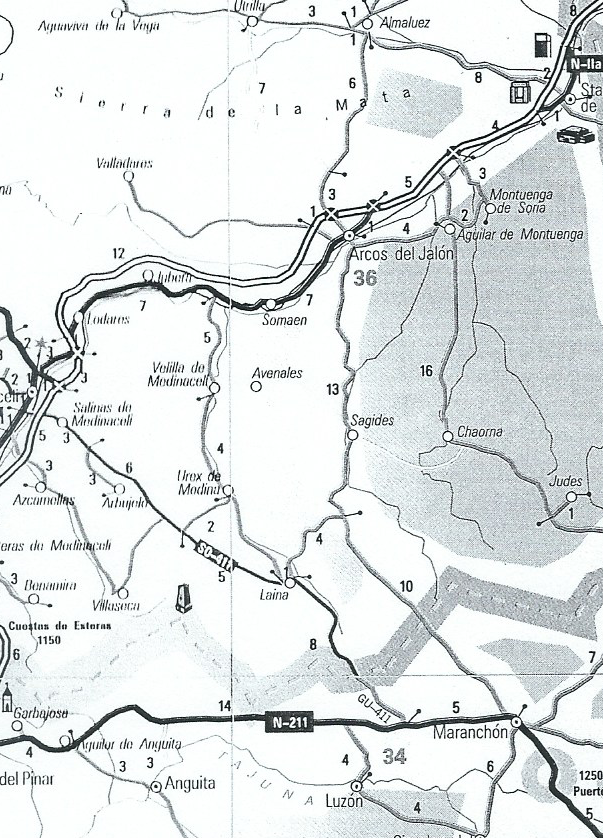Ma famille maternelle
Chapitre 1er
Nos ancêtres les Gaulois
Ce n’est probablement pas en ces
termes que mes maîtres de l’école primaire m’ont inculqué le fort sentiment
d’appartenance à une « nation gauloise » qui est propre à notre
génération. Mais, si les mots furent différents, l’idée était la même.
Je l’ai adoptée sans
arrière-pensée et je puis assurer que le Vercingétorix de ma collection de
figurines offertes avec les paquets de café Bonifieur
était traité par moi avec autant d’égards que ses illustres suivants, dans
l’ordre, Clovis et Charlemagne. Peut-être aurais-je dû m’assurer que, ce
faisant, je ne trahissais pas mes vrais ancêtres, les Ibères, et qu’il n’y
avait pas, dans le pays de mes origines, un héros tout aussi chevelu, tout
aussi rebelle à la civilisation romaine, auquel j’aurais pu m’identifier. Si je
l’avais fait, j’aurais constaté que l’histoire de l’Hispanie romaine n’est pas
plus avare que la nôtre en héros de ce genre, voués à connaître la gloire pour
prix de leur échec et que, dans ce domaine, Viriathe, le chef des Lusitains,
avait sur Vercingétorix des avantages certains : il l’avait précédé de
près d’un siècle, avait vaincu deux armées romaines et n’avait cédé que sous
les coups d’un traître recruté par les infâmes colonisateurs. Si j’y avais
songé, j’aurais donc parfaitement pu remontrer ainsi à mes concitoyens de
circonstance, les Français, que ce n’est qu’avec beaucoup de réserves et de
nuances que je me considérais un des leurs.
Il paraît que c’est ainsi que
certains raisonnent aujourd’hui. De notre temps, il en allait bien différemment
et, à la réflexion, je ne crois pas avoir été abusé de quelque manière que ce
fût.
L’histoire que j’entreprends
d’écrire ici, aussi exactement que me le permettra la rareté des sources dont
je dispose, contribuera peut-être à éclairer une attitude partagée par toute
notre famille et une situation qu’aucun de ses membres, que je sache, n’a
ressentie comme une frustration, encore moins comme une humiliation.
À dire vrai, si j’avais eu ce
doute originel, je n’aurais trouvé aucun secours du côté de mes parents. Bien
que nés outre-Pyrénées, ils déployaient de louables efforts pour adopter les
savoir-faire des Français qu’ils côtoyaient dans le quartier et au travail. Ma
mère cuisinait « à la française », c’est-à-dire qu’en l’occurrence,
elle utilisait largement l’huile d’arachide, la graisse de canard et le
saindoux, jamais l’huile d’olive. Elle savait faire sécher la ventrèche et
préparait comme personne le pâté, préparation inconnue de ses cousines
espagnoles qui se contentaient de faire frire le foie du porc. Mon père avait
initié ses fils au rugby depuis leur plus jeune âge, et portait fièrement le
béret, dont il entonnait l’hymne à chaque occasion quelque peu arrosée. Un de
ses dictons préférés était « il faut suivre la mode ou quitter le
pays ». N’avions-nous pas assez fait allégeance aux mœurs locales ?
Il restait bien quelque reliquat d’une nostalgie
espagnole, comme le redoutable attachement de notre mère à Luis Mariano et à
son répertoire, ou les noms d’oiseaux dont mon père gratifiait rituellement son
ennemi intime, le général Franco, dès que le sujet revenait sur la table, ce
qui était fréquent, étant donné qu’il comptait parmi ses amis beaucoup de
combattants antifranquistes. Mais bah ! Que pesaient ces écarts au regard
du déploiement de francitude qui les caractérisait et auquel ne
contribuaient pas peu les succès scolaires de leurs enfants. Comment les premiers
de la classe auraient-ils pu se distinguer de leurs camarades sans s’exclure
d’une communauté dont ils étaient l’un des fleurons ? Les aurait-on même
laissé faire ?
C’est que, dans ces années
d’après-guerre où la France n’avait guère de héros à offrir au reste du monde,
après la retraite de De Gaulle, la mort de Leclerc et celle de Marcel Cerdan,
il était de fort mauvais goût de galvauder les gloires, même locales. On
n’était donc pas très regardant sur les origines. Quant à moi, n’ayant connu du
pays de mes ancêtres que ce que j’avais pu recueillir de la bouche de ceux qui
en venaient, gens de ma famille puis républicains vaincus et exilés, je ne sentais
à l’égard de cette patrie des origines qu’un vague sentiment de curiosité. S’y
ajoutait le goût de la musique de sa langue, que j’avais appris à percevoir à
travers le sabir franco-castillan qui se pratiquait allègrement autour de moi.
Mais revenons à nos Gaulois. Afin
de préserver au mieux l’exactitude de cette histoire, je dirai que, si l’on
m’avait demandé, étant enfant, à brûle-pourpoint, de me définir sous l’angle de
la nationalité, tout Garcia que j’étais, j’aurais répondu sans hésiter « français ».
Je n’avais à vrai dire pas d’autre réponse à offrir. Cependant, elle ne me
satisfaisait pas complètement ; je la trouvais trop vague, et les horizons
qu’elle ouvrait devant ma petite personne étaient trop
vastes à embrasser. Tout compte fait, j’aurais mieux aimé
« landais », puisque, si je vivais au sud de l’Adour, c’est-à-dire
quasiment dans les vertes collines de la Chalosse, j’avais le privilège de
fréquenter assidûment l’autre moitié du département, sur la rive droite, à
savoir la grande lande des pins, au milieu de laquelle habitait ma grand-mère
paternelle. Mais, pour le coup, cette revendication était trop étroite et, à
mes yeux, manquait de lettres de noblesse ; elle était donc peu
susceptible d’universalité. J’aurais finalement choisi de me considérer
« gascon ». Physiquement, avec mon crâne rond apte au port du béret,
je pouvais donner le change. De plus, mon accent pouvait me servir de passeport
dans un vaste espace qui englobait, au-delà du triangle landais dans lequel
j’étais né, une partie du pays basque (le gascon n’est-il pas aussi vascon ?), du Lot-et-Garonne, du Gers et du Béarn.
Cette aire géographique suffisait à mon bonheur, en m’offrant deux vraies
capitales, Bordeaux au nord et Saint-Sébastien au sud, la plaine et la
montagne, la mer et la campagne, le sable sec et le riche limon, le vent, la
pluie et le soleil dans d’harmonieuses proportions, et une certaine image
littéraire, entre troubadour et mousquetaire. Avec pareil bagage, je pouvais
m’estimer comblé.
Chapitre II
La cousinade
Je me faisais ces réflexions en
contemplant la joyeuse assemblée que formaient mes cousins réunis dans une
salle de fêtes de quartier de notre ville de Dax, dans laquelle ils résident
pour la plupart d’entre eux. L’idée de nous réunir nous était venue lors de
l’enterrement de notre mère. Après le cimetière, nous nous étions retrouvés
dans l’auberge la plus proche et avions renoué une relation depuis longtemps
distendue.
Pour la
plupart, mes cousins habitent dans les Landes, département d’arrivée de la famille
lorsqu’elle a émigré, quelques-uns dans les départements voisins de Gironde et
des Pyrénées Atlantiques. Quelle que soit la consonance de leur nom, rien
ne les distingue les uns des autres, ni non plus des français « de
souche » avec lesquels ils coexistent harmonieusement. L’éventail des
métiers exercés est des plus vastes : employés, artisans, entrepreneurs,
commerçants, professions libérales, fonctionnaires. Cette énumération
conviendrait parfaitement à une famille française de même importance. On recherchera
aussi vainement dans ce groupe des comportements communautaires. Les cousins se
rencontrent plus souvent par hasard et au gré des circonstances que de façon
concertée, comme tous les cousins d’une nombreuse famille, car nous sommes
vingt-trois au total. Il serait plus exact d’écrire que nous étions
vingt-trois, parce que certains sont malheureusement déjà décédés.
L’attrait
pour la patrie d’origine, l’Espagne, n’est ni plus ni moins fort que celui que
ressentent en général les habitants de cette région frontalière. La relation
plus étroite que certains d’entre eux entretiennent avec ce pays tient à des choix
professionnels, dans laquelle l’ascendance hispanique a moins influé qu’une
familiarité avec la langue espagnole acquise dans leur petite enfance, qui a
orienté un choix de spécialité. D’autres ont cédé à la curiosité et ont tenu à
visiter le lieu de naissance d’un de leurs parents, ce qui les a conduits à
nouer une relation avec des cousins espagnols. Ceux qui ont une relation suivie
avec l’Espagne sont la minorité. Ils la vivent comme un plaisir ou une richesse
supplémentaire, certainement pas comme une revendication d’identité.
Dans ces conditions, parler
d’assimilation ou d’intégration paraît sans objet. L’appartenance à la nation
française est évidente, et s’offre même le luxe d’une identité gasconne
assumée, dans le mode de vie, le parler, les loisirs, etc., ce qui conforte
encore cette appartenance, en lui donnant une assise concrète. Bref, rien ne
différencie ce groupe de la population locale.
Cette apparente indifférence aux
origines familiales m’a toujours paru naturelle. Mais elle me laisse perplexe, alors
que notre société est agitée des débats que l’on sait dès l’instant où l’on
traite du sujet de l’immigration. Notre génération aurait-elle « trahi ses
origines » ? A-t-elle été contrainte à renoncer à son identité, comme
condition nécessaire à son intégration ? Aurait-elle été la victime consentante
d’une illusion ou la dupe d’une manipulation ? Dans ma propre expérience,
j’avoue n’avoir rien perçu de tel, et je ne me souviens pas d’avoir entendu
chez mes cousins des témoignages allant dans ce sens. L’hispanité de nos
parents n’était pas perçue comme un handicap ; bien au contraire, elle
nous dotait d’un caractère supplémentaire qui pouvait nous valoriser aux yeux
de nos camarades français « de souche ».
Si nous avons « joué le
jeu » de l’assimilation, c’est sans doute que cela n’imposait pas de
contrainte excessive, encore moins de renoncement douloureux. C’est surtout que
ce jeu « valait la chandelle ». Il nous offrait des perspectives
enviables, que nos lointains cousins d’Espagne étaient loin de connaître :
un niveau de vie qui éloignait définitivement le spectre de l’indigence ;
l’accès à une instruction riche de débouchés ; une liberté de pensée et
d’expression, dans le travail comme dans la vie publique ; surtout l’occasion
d’adhérer à un système de valeurs apte à favoriser l’accomplissement des
individus que nous étions. Le bénéfice que les membres de notre famille ont
tiré de cet état de fait en seulement deux générations est patent et montre
qu’il ne s’agit nullement d’une illusion.
Aussi positif soit-il, ce bilan
sommaire s’applique d’abord à notre génération, celle des enfants d’émigrés. Il
ignore ce qui l’a précédé et rendu possible. Nous sommes plusieurs, parmi les
cousins, à nous être demandé comment et à quel prix on était parvenu à ce
résultat. Il aurait pu aussi en être autrement : l’application stricte de
la politique en vigueur aujourd’hui dans notre pays aurait refoulé nos
grands-parents et leurs enfants, qui réunissaient tous les handicaps : manque
de qualification, ignorance du français, regroupement familial. Il y a là, pour
le moins, matière à réflexion.
Chapitre III
Questions de méthode
Le récit que j’entreprends
d’écrire ici, aussi exactement que me le permettent les sources dont je
dispose, retrace les circonstances qui ont poussé mes grands-parents maternels à
abandonner l’Espagne et à s’installer dans les Landes, où ils sont morts et où
leurs enfants et petits-enfants ont définitivement « fait souche ».
J’ai suivi de près la documentation, principalement des documents d’état-civil,
que j’ai pu réunir. J’ai aussi recueilli des témoignages, mais je ne les ai
inclus qu’après vérification. Enfin, j’ai revisité les lieux concernés, dont
beaucoup m’étaient déjà familiers, en Espagne comme en France, pour ne pas
commettre d’erreur. Je fais d’ailleurs référence à mes enquêtes dans le cours
de mon récit. À cette documentation s’ajoutent les souvenirs que j’ai pu garder
de certains épisodes de cet exil, lorsqu’ils étaient évoqués devant moi ou
m’ont été transmis par des témoins dignes de foi.
La proximité géographique fait
que la plupart de mes cousins se voient avec une certaine régularité. À leurs
yeux, mon frère et moi faisons figure d’exilés, puisque les hasards de notre
vie et de notre carrière nous ont menés très au nord de la Garonne, dont le
cours forme la frontière indépassable de ces fanatiques du terroir sud aquitain.
Après bien des années, nous nous sommes retrouvés lors de l’enterrement de
notre mère à Dax. À la fin de la cérémonie, pour éviter une dislocation trop
brutale, nous avons organisé une réunion dans une auberge familière et renoué
une relation depuis longtemps distendue. La visite des cousins prodigues fit
naître l’idée d’une rencontre, la plus large possible,
ce qui incluait la génération de nos enfants, que nous ne connaissions guère et
qui avaient encore moins de raisons de se connaître entre eux.
J’avais eu beau me remémorer tout
ce que je savais encore de mes cousins, de leurs conjoints, de leurs enfants,
de leur métier, il n’empêche que j’eus à souffrir d’une relative marginalité
lors de cette rencontre. Faute de pouvoir partager pleinement le ludisme
ambiant, j’entrepris de porter sur les présents un regard plus objectif
qu’affectif, à la manière d’un ethnologue face à un groupe humain dont il
cherche à saisir les relations internes. Au terme de mes réflexions, je parvins
à quelques conclusions d’apparence banales mais susceptibles de déboucher sur
des développements ultérieurs.
L’éventail des âges était très
large puisque près de vingt années séparaient les plus âgés des plus jeunes,
les premiers étant nés bien avant la guerre, les derniers, passé le
« baby-boom ». Rien que de très normal à cela, puisque cet écart étant
du même ordre que celui qui séparait l’aînée de la génération de nos parents du
petit dernier.
Je retrouvais aussi entre les
cousins des différences qui reproduisaient des clivages déjà perceptibles dans
la génération précédente. Nos parents respectifs appartenaient à deux groupes
bien distincts, selon qu’ils étaient les enfants du premier mari de notre
grand-mère ou du second, qu’elle avait épousé après son veuvage. Du premier,
quatre filles survécurent ; du second, elle eut deux filles et un garçon.
Pendant notre enfance, nous avions pu observer que ces sept enfants s’étaient
constitués en deux groupes distincts. Les plus jeunes, qui avaient hérité de
leur père un redoutable sens de l’humour, ne cessaient de se moquer des
« grandes », cependant que celles-ci considéraient les
« petits » avec une tendresse indulgente. Les aînées ne parlaient
entre elles que de leur état de santé, autant dire de leurs douleurs ; des
salaires de leur mari, qu’elles n’hésitaient pas à gonfler ; des succès
scolaires de leurs enfants : chacune voulait l’emporter sur ses rivales.
Les petits, en revanche, entretenaient des relations beaucoup moins guindées et
se comportaient plutôt en complices.
Le clivage entre les deux groupes
se manifestait aussi dans les patronymes. Les enfants des quatre filles du
premier lit portaient un nom espagnol ; ceux des deux filles du second
lit, un nom français. Toutes ces demoiselles s’étaient pourtant mariées en France.
Le choix des plus âgées, qui était à vrai dire surtout le choix de leur mère,
démontrait que le cercle de leurs relations était resté intimement lié aux
milieux de l’émigration, tandis que les plus jeunes avaient connu un degré
d’assimilation beaucoup plus grand.
Les cousins, nous ne semblions
qu’indirectement concernés par ces différences. Pourtant un trait commun nous réunissait,
lequel nous séparait radicalement de la génération antérieure. Nous tous étions
nés en France, alors que tous nos parents, y compris le plus jeune qui émigra
tout bébé, étaient nés en Espagne. Cette évidence suffisait à me faire
comprendre qu’un fossé nous séparait d’eux, et que le lien qui paraissait unir nos
deux générations, prises dans leur ensemble et non plus comme la somme des
individus qui les constituent, était plus subtil qu’on aurait pu le penser.
Il me sembla que le meilleur
moyen de jeter une passerelle entre nous et nos parents consistait à
reconstituer les circonstances qui les conduisirent à venir dans les Landes et
à s’y installer. Cette recherche, pensé-je, en nous obligeant à considérer
notre famille, non plus comme un simple lieu d’échanges et de convivialité se
suffisant à lui-même mais comme un objet d’histoire, nous fournirait des
informations utiles sur la nature des rapports que nous entretenions avec nos
parents, avec nos cousins, avec l’Espagne, avec les Landes, bref avec les êtres
et les lieux qui nous étaient tellement familiers que nous finissions par ne
plus les voir. J’escomptais que ce récit nous obligerait à nous interroger sur
notre propre destin, sur son originalité ou sa relative banalité et, peut-être
aussi, qu’il éclairerait notre jugement sur des phénomènes contemporains
analogues.
Mais un récit nécessite un noyau
autour duquel les destins particuliers pourront s’agglutiner et prendre sens au
contact les uns des autres. Pour des raisons évidentes, ce lieu géométrique appartenait
à notre grand-mère, parce que nous l’avions tous connue, mais aussi parce que
son personnage était le seul à même de donner corps à un passé dont certains
témoins prématurément disparus ne pouvaient rendre compte. C’est donc d’elle,
de sa famille, que je partirai et à elle que j’aboutirai au terme de ce récit.
Chapitre IV
Berceau familial
À peu près à mi-chemin entre
Madrid et Saragosse, la grande route qui mène à Barcelone traverse un paysage
lunaire, dominé par des éminences à la cime arasée et dont les flancs semblent soigneusement
découpés par la fine lame d’un patient démiurge. Tout autour et à perte de vue,
règne une sorte de désert, seulement interrompu, de ci-delà, par quelques
conques de terre arable. À l’exception de ces minuscules îlots de végétation, le
paysage est baigné dans une couleur qui oscille entre l’ocre et le rouge brique.
La route sinue entre ces hautes falaises puis, tout à coup, la vue s’élargit sur
un horizon pétrifié sans limites perceptibles.
Telle était à peu près la vision
qui s’offrait, à l’approche de Medinaceli, au
voyageur des années cinquante du siècle dernier, époque à laquelle il me fut
donné de traverser pour la première fois la contrée où étaient nés mes
grands-parents maternels, et qui conservait quasiment intact l’aspect qu’ils en
avaient connu. On ne pouvait imaginer ruralité plus contrastée avec celle qui
m’était familière, faite de doux vallonnements, de la présence constante de
l’eau courante et d’une végétation qui n’abandonne jamais, même au plus fort de
l’été, ses touches de verdure. Je mesure aujourd’hui le choc à rebours que
durent ressentir nos Castillans lorsqu’ils découvrirent, à travers les vitres
de leur wagon, les pentes ombrées des Pyrénées françaises puis ces champs, ces
haies, cette présence humaine permanente qui caractérise nos régions à
l’habitat dispersé. Ils furent sans doute également saisis par ce sentiment
d’étrangeté qui m’étreignit alors, à ceci près qu’eux n’avaient d’autre
perspective que de devoir s’en accommoder coûte que coûte, en renonçant à
jamais à un cadre de vie qui leur était familier, alors que pour moi, ce
n’était qu’une expérience sans lendemain.
Au débouché d’un de ces passages
encaissés, un modeste poste à essence signalait l’existence d’une agglomération
qui ne pouvait se limiter aux trois maisons qui bordaient la route à cet
endroit. En levant les yeux, on devinait sur une de ces éminences quelques
vestiges d’un habitat qui se distinguait à peine de la roche sur laquelle il
était édifié. Le voyageur curieux, préférant abandonner la grand-route, empruntait
alors une voie étroite et bombée à l’extrême qui le hissait, au terme de 3 kms
de virages serrés, au sommet d’un escarpement qui ne livrait le secret de ses
habitations que lorsqu’on l’avait atteint. Auparavant, il pouvait apercevoir en
surplomb les vestiges d’anciennes murailles dont le parement avait depuis
longtemps disparu et que quelques maisons ruinées couronnaient de loin en loin.
Puis on frôlait une magnifique porte de ville, qui ressemblait à s’y méprendre
à un arc de triomphe romain, non sans remarquer, juste en face, de l’autre côté
de la route, une chapelle baroque ouverte sur l’extérieur. Au bord de la
falaise, vous saisissait un air vif et frais en toute saison, même en été quand
le soleil est au plus haut. À perte de vue, un moutonnement de collines pelées
séparées par d’étroits vallons voués à la culture des céréales.
Le spectacle qu’elle offre
aujourd’hui n’est plus exactement le même. Les maisons du bourg ont été
restaurées, mais on a conservé leurs murs en moellons d’une couleur ocre tirant
vers le rouge, réunis par des joints épais. Elles sont à un étage ; sur le
pignon, un toit de tuiles en contrebas abrite une modeste dépendance, écurie ou
autre. Le seul décor extérieur est constitué par le linteau des fenêtres,
réalisé en pierres étroites posées obliquement avec comme clef une pierre taillée
en triangle. La collégiale Renaissance de Sainte-Marie-la-Majeure contraste
singulièrement avec l’austérité architecturale des maisons. Sa haute nef unique
débouche sur un chœur et un chevet moins élevés et est
prolongée de part et d’autre par des chapelles. Elle est surmontée d’une tour
carrée couronnée par un petit édicule à clochetons. Elle s’ouvre au nord sur
une belle porte Renaissance et Baroque à pilastres. On contourne l’église pour
déboucher sur la place principale, dont la disposition surprend, car elle ne
semble obéir à aucun projet préétabli. Tout un côté de cet espace de forme
irrégulière est occupé par la longue façade d’un palais néo-classique entourée
par des maisons à arcades. C’est le palais des ducs de Medinaceli,
que ses propriétaires ont renoncé à restaurer, et qui cache derrière cette
façade apparemment bien conservée un bâtiment qui menace ruines.
Ce vaste espace, dépourvu de la
moindre végétation, ouvert à tous vents, offre toujours l’image de l’abandon et
du délabrement, mais conserve, malgré tout, cet air d’austère grandeur qui est
le propre des cités anciennes délaissées.
Telle est encore Medinacéli, dont la probable étymologie arabe (« médine de Sélim ») s’est romanisée en Medinacœli, littéralement la « médine ou ville du ciel », ce qui est pour le moins
présomptueux. Cette bourgade à demi abandonnée peut se targuer, cependant,
d’avoir connu au long de deux mille ans d’histoire trois civilisations :
romaine, musulmane, chrétienne. Ces mérites expliquent qu’elle ait été, à la
fin du Moyen Âge, érigée en siège du plus ancien duché de Castille, dont les
titulaires, de sang royal, descendaient en ligne directe d’Alphonse le Savant
(deuxième moitié du 13e siècle). À elle seule, elle résume l’histoire
riche et mouvementée qu’avait connue cette contrée avant d’entrer en déshérence.
Mais on sait que la mémoire des peuples est persistante, surtout lorsqu’elle
est entretenue par les vestiges architecturaux d’un passé révolu. Le moindre enfant
berger qui accompagnait ses moutons sur les maigres pâturages des alentours
était familiarisé avec ses ruines et, à leur ombre, devait ressentir même
confusément la tentation de s’évader d’un présent sans gloire vers un passé
peuplé de guerriers à cheval. Même s’il n’était pas allé à l’école, pas assez
du moins pour dépasser le stade des connaissances rudimentaires, il ne pouvait
ignorer que le héros fondateur de la Castille, le Cid Campeador,
avait traversé ces parages sur la route de l’exil et qu’il avait abreuvé son
cheval dans l’eau du Jalón dont on aperçoit au loin l’étroite coulée verte.
Dans les Landes où ils avaient
fini par s’installer, il arrivait sans nul doute parfois à ces paysans exilés
de leurs terres et de leurs habitudes de songer à leur contrée natale.
Peut-être même en parlaient-ils à leurs enfants. Mais ce qu’ils pouvaient transmettre
était bien maigre comparé à ce qu’ils devaient ressentir au fond d’eux-mêmes, leur maigre bagage linguistique et culturel
ne leur permettant guère de construire un vrai récit de leur jeunesse. Ce
fragile édifice de sensations, d’images, de sons, d’espaces qui contribue à la
formation de la personnalité devait se lézarder chaque jour d’avantage, au fur
et à mesure que le souvenir s’en estompait et que les destinataires de ces
confidences devenaient de plus en plus incapables de les déchiffrer.
Deux générations plus tard,
certains d’entre nous ont revisité ces lieux, avec des intérêts divers et une
connaissance préalable inégale de leur histoire. Passé l’effet du dépaysement
et un sentiment de condescendance inévitable à l’égard d’une économie notoirement
arriérée, la plupart ont perçu, avec plus ou moins d’acuité, qu’il ne leur
serait probablement pas possible de refaire en sens inverse le voyage de leurs
grands-parents. Ils comprirent vite que le déplacement durable de cadre de vie
entraîne des conséquences irrémédiables et qu’il est vain de vouloir les
assumer comme une expérience personnelle. Il faudrait, pour cela, jouir du don
d’ubiquité, ce que même un bilinguisme de fait ne permet pas.
Chapitre V
Détour par Velilla
Medinaceli
constitue le centre historique de la contrée où nos grands-parents sont nés et
ont vécu jusqu’à l’âge adulte. Mais le village natal de notre grand-mère et de
son second mari se situe à 30 kms de là, vers le nord-est, et s’appelle Utrilla.
Avant d’atteindre ce berceau
familial, abandonnons quelques instants la route, et bifurquons sur notre
droite pour faire une visite rapide a Velilla de Medinaceli, où naquit mon grand-père Eusebio
García Martínez, premier mari de ma grand-mère. À en
juger par la discrétion et l’ancienneté du panneau indicateur, le village n’est
guère fréquenté. De fait, on ne l’atteint qu’au terme d’une rude montée de 4
kms qui nous conduit à plus de 1000 m d’altitude, par une route étroite et
sinueuse au revêtement négligé, sans y avoir croisé le moindre véhicule, fût-ce
un modeste tracteur. Le village lui-même s’étage sur une pente abrupte dont le
sommet est occupé par la modeste église paroissiale. Il ne compte aujourd’hui
qu’une trentaine d’habitants. Je dois à la vérité de dire que je n’en ai
rencontré qu’un durant ma courte visite, et que j’ai eu toutes les peines du
monde à comprendre ce qu’il me disait, pour une raison que je n’arrivais pas à
m’expliquer. Ce n’est qu’au terme de cet échange difficile que j’ai su que
c’était un ouvrier roumain occupé à creuser une canalisation dans la rue, ce
qui me rassura sur ma capacité à comprendre le parler local.
Ayant renoncé à une information
orale sur le village, je l’ai parcouru autant que me le permettait le chantier
en cours. Une chose ne pouvait manquer de retenir mon attention en une contrée
aussi désertique : l’abondance d’eau courante, qui alimentait jadis un
moulin et dont le bruit réconfortant remplit sans peine le silence régnant sur
ce paysage abandonné. Est-ce une raison suffisante pour expliquer que les
parents de mon grand-père, tous originaires de la vallée, aient émigré quelques
années ici, le temps d’y concevoir plusieurs de leurs enfants ? Je
l’ignore, mais cet exil temporaire me laisse encore perplexe.
Le retour à la grand’ route et à Somaén s’apparente aujourd’hui encore à un passage de la
nature la plus hostile vers la civilisation. Le bourg est construit sur
l’étroite bande de terre qu’enserre un méandre du Jalón au pied d’un à-pic au
sommet duquel veille le donjon d’une ancienne forteresse. Il conserve de beaux
vestiges de sa muraille ainsi que quelques maisons suspendues du plus bel
effet. C’est de ce village que sont issus les parents de mon grand-père
maternel, Eusebio.
Lors de notre premier voyage dans
ces contrées, dans les années cinquante, notre mère nous y mena à la découverte
de cousins plus ou moins proches dont elle venait d’apprendre l’existence.
J’avais renoncé à comprendre les liens de parenté exacts qui unissaient ma mère
à ces inconnus. Je n’éprouvais d’ailleurs qu’un médiocre intérêt à leur endroit,
si grande était l’ignorance dans laquelle nous avions été tenus de nos
ascendants et collatéraux. Avec les enfants, lorsqu’il y en avait, les
relations n’étaient guère plus chaleureuses. Nous nous sentions trop étrangers
les uns des autres et tellement persuadés que ces rencontres seraient sans
lendemain que toute tentative de rapprochement nous semblait vaine.
La langue n’était pas le seul
obstacle à l’établissement de relations normales entre nous ; il y avait
aussi l’apparence extérieure. À notre époque où tout tend à s’uniformiser, non
seulement l’habillement, mais aussi l’alimentation et même la gestuelle, on
n’imagine pas quel contraste flagrant avec nos habitudes françaises offrait le
spectacle de la population espagnole, dès la frontière d’Irun franchie. La
couleur dominante était le brun, dans toutes ses nuances, du kaki au bronze,
comme si la dictature était parvenue à imposer des goûts de caserne dans
l’habillement des civils. Les petites filles portaient des boucles d’oreille,
ce qui ne se faisait plus en France et étaient vêtues comme des princesses, ou
des Vierges à la moindre occasion ; les culottes des garçons descendaient
jusqu’au genou en se resserrant comme des fuseaux, alors que nous montrions nos
cuisses. Ce sentiment d’étrangeté pouvait prendre aussi une tournure gustative.
Je garde en mémoire les effluves de friture d’huile d’olive mal raffinée, qui
envahissaient l’espace et même les rues. L’occasion nous était également
souvent donnée de goûter aux pâtisseries locales. Dans chaque maison visitée, on
nous offrait généreusement des sablés à l’huile, parfumés à l’anis, dont la
pâte se défaisait en miettes minuscules dès qu’on y mordait, mais qui avaient
l’avantage de se gorger de café au lait lorsqu’on les trempait. Mes cousines
espagnoles en fabriquent encore et les conservent dans de vieilles boîtes à
biscuits. Je suis toujours surpris par cette texture et ce goût d’huile
prononcé qui ne sauraient se confondre avec l’idée que je me fais d’une
pâtisserie. Ce goût ne m’est plus inconnu, il n’en reste pas moins étrange à
mon palais. On ne peut appartenir absolument à deux cultures à la fois et cette
petite expérience me le rappelle chaque fois opportunément. En revanche, ma
mère prenait plaisir à ces visites, qui l’aidaient à retrouver les saveurs
d’une petite enfance, enfouies dans sa mémoire mais non complètement effacées.
Chapitre VI
Utrilla
Si Somaén
est dominée par sa forteresse, Utrilla l’est par son
église, ce qui en fait une exception dans ce territoire qui, plus que tout
autre, rend justice au nom du royaume, la Castille (le pays des châteaux). Le
village occupe une légère dépression, barrée à l’ouest et au sud par deux
lignes de crêtes, la Muela et la Mata, aujourd’hui
couronnées d’indiscrètes éoliennes. En contrebas, vers le sud, courent deux
filets d’eau tout juste suffisants à arroser les potagers.
L’existence de ce bourg remonte,
pour le moins, au 12e siècle. Il constitue un parfait exemple de cet
habitat rural castillan propre aux zones frontières entre les états chrétiens
du nord de la Péninsule ibérique et les états musulmans du sud, qui vise à
concilier l’exploitation agraire, activité pacifique, avec une activité
guerrière, à savoir la protection contre des incursions ennemies toujours
possibles.
Le principe de la ferme isolée
étant inviable, les habitants se regroupent dans des villages plus ou moins
sommairement fortifiés. Le matériel agricole et les troupeaux sont conservés
soit à l’intérieur de l’enceinte, faisant de chaque maison une ferme en
réduction, soit dans des bergeries proches de façon à pouvoir facilement mettre
sa population animale à l’abri du bourg, en cas de besoin.
Dans ces conditions, le vestibule
de chaque maison est un lieu de passage commun aux hommes et aux animaux de
traits ou de charge, ânes et mulets. Une fois passé ce sas obligatoire, chacun emprunte
son parcours singulier. Les bêtes rejoignent l’écurie, en contournant la
cuisine ; les hommes empruntent l’escalier qui mène aux chambres du
premier étage et au grenier du second. Dans ce dernier, divisé en compartiments
par des parois de bois mal dégrossi, sont conservés les grains et les légumes
de consommation courante, pommes de terre, pois chiches, ail et oignon.
Face à la porte de l’écurie, une
courette sert d’abri aux poules et poulets qui s’y ébattent en semi-liberté, se
nourrissant des déchets de cuisine, de quelques graines, et de déchets moins
avouables, car la maison n’offre pas d’autre lieu pour le soulagement des
besoins naturels de ses habitants. Le cochon y occupe une soue, à moins qu’il
n’ait été exilé dans la périphérie du village, en bordure des aires de battage.
S’il s’agit d’un verrat, la monte étant une source de revenus appréciable, on
peut lui offrir un gîte dans une annexe sans fenêtres du vestibule, sans doute
pour le distraire avec les bruits de la rue.
L’essentiel de la cuisine se
résume à son âtre, vaste et surmonté d’une hotte assez haute pour qu’on puisse
s’y tenir debout. Tout autour, quelques sièges, dont une chaise si basse qu’on
y est assis à croupetons, réservée à la cuisinière. Quelques chaises et une
minuscule table basse de bois, dont les pieds ont pu être empruntés à un grand
fauteuil ancien, attendent les commensaux. La pile d’évier, l’étagère à poêles et
à fait-tout en terre, enfin le placard à vaisselle où l’on conserve aussi la
récolte de miel constituent l’essentiel du mobilier. Mais ce qui retient le
plus l’attention, c’est le plafond de la cuisine, d’où pend une cochonnaille
variée, jambons, chorizos, saucisses, estomac farci.
Cette pratique traditionnelle se
traduit par le rustique spectacle de ruelles empierrées, ornées de déjections
de toute sorte, par lesquelles transitent hommes et bêtes, en particulier les
chèvres, population animale privilégiée qui est autorisée à passer ses journées
hors du village : chaque matin, la trompe du chevrier les convoque en un
lieu immuable hors du village, où elles se rendent seules, sans y être
conduites ; le soir, à l’heure de la traite, elles rentrent dans leur
étable par le même chemin. Une odeur de suint envahit tout l’espace et même le
nez étranger le plus fin finit par s’en accommoder.
En ce samedi de mi-octobre, le
village est pratiquement désert. Après avoir interrogé les rares personnes que
nous croisons dans la rue ou frappé aux portes des maisons visiblement
habitées, nous finissons chez une très vieille dame, dont la tâche principale
consiste apparemment à préparer les repas du curé du village, ce qui suffit à consommer
le peu d’énergie qui lui reste. Elle a entendu parler de mon grand-père
Alejandro, second mari de ma grand-mère, ce qui confirme ce que je savais, sans
y croire vraiment, à savoir qu’il a laissé un souvenir impérissable en ces
contrées. Elle me révèle l’existence d’une petite nièce d’Alejandro qui habite
à Madrid mais qui, par extraordinaire, n’a pas encore abandonné la maison du
village dans laquelle elle passe ses étés.
Ildefonsa
Carretero Gonzalo (Fonsa pour les intimes) et son
mari Pedro nous reçoivent à bras ouverts, visiblement émus et s’empressent de
nous inviter à partager leur frugal repas : une purée de légumes en guise
de potage, du chorizo frit, un fruit et un café.
Leur maison est tout à fait
typique, mais la destination des pièces a été bouleversée, à l’exception de la
cuisine, selon une pratique qui s’est généralisée dans ces villages après
l’abandon de l’exploitation des terres. Désormais, le vestibule sert de salle à
manger, l’ancienne salle commune de salon de télévision. Les étages sont
destinés aux salles de bains et aux chambres à coucher, l’objectif étant de
réunir sous le toit familial le maximum d’enfants et de petits-enfants lors des
retrouvailles rituelles, semaine de Pâques et mois d’été, principalement. À l’image
de ces maisons réaménagées, le village est devenu un décor conçu pour un usage
qui n’a plus aucun rapport avec son passé.
Du coup ma démarche me paraît
saugrenue. J’étais censé retrouver le passé d’une branche de la famille
transportée dans un autre lieu et une autre culture. Je me vois désormais
exposé à reconstituer aussi celui de la souche familiale qui s’est
définitivement éloignée de son propre passé sans avoir eu à abandonner son pays
d’origine.
Mes interlocuteurs sont pleins de
bonne volonté et éprouvent visiblement du plaisir à évoquer le temps de leur
enfance, mais leur contribution à ma recherche reste très modeste :
quelques anecdotes, quelques noms, des souvenirs souvent confus. Bref, un
matériau dont le plus novice des historiens sait qu’il faut l’aborder avec
prudence. Faute de mieux, il me reste l’état-civil.
Chapitre VII
État-civil
Notre grand-mère,
Luisa López Rangil, est née
à Utrilla, le 9 août 1881. Son père, Pedro Lopez
Pascual, vient du village de Condemios de Arriba, province de Guadalajara, à peu de distance d’Utrilla (voir la carte reproduite en annexe). Sa mère, Joaquina Rangil, « se
consacrait aux occupations de son sexe » selon la jolie formule espagnole,
qui vaut mieux que notre cruel « sans profession ». Elle était née à Utrilla. Le couple habitait 40, rue de la Ombría. Cette appellation, que l’on retrouve dans la
plupart des villages de la contrée, reste pour moi énigmatique : la
végétation absente ne contribue guère à la rendre ombragée. C’est dans cette
maison à étage, de fort belle apparence, qu’est née notre grand-mère, le 9
août, à 5h du matin.
Son grand-père paternel, qui
s’appelait Juan López, et était originaire de Gotor, village de la province de Saragosse, limitrophe de
celle de Soria à laquelle appartient Utrilla, était
déjà mort à cette date. Sa grand-mère paternelle, Manuela Pascual, originaire
de Morés (province de Saragosse), habitait encore à Gotor ; mais la formulation de l’acte est quelque peu
ambiguë : il se pourrait tout autant qu’elle résidât à Morés.
Je mentionne ces villages parce que leur nom reviendra plus loin dans le récit.
Les deux grands-parents maternels, Juan Rangil y
María Antonia García, étaient tous deux d’Utrilla. La
grand-mère était décédée lorsque naquit sa petite-fille.
Notre grand-mère a reçu le prénom
de Luisa. Elle était la deuxième d’une fratrie de six, et l’aînée des trois
filles. Je n’ai pas connu ses frères mais j’ai rencontré ses deux soeurs, étant
encore enfant, lors de notre premier voyage en Espagne (1955). Elles
s’appelaient Juliana et Salustiana. Juliana
ressemblait beaucoup à son aînée : même corpulence, même teint, même
regard, une certaine réserve dans la conversation. Salustiana,
en revanche, était très différente : elle était devenue sèche et fripée,
mais se montrait vive et chaleureuse.
À la naissance de Luisa, la
profession déclarée du père est charretier (arriero). C’est celle qui figure lors de chaque
déclaration de naissance, à l’exception de celle du quatrième enfant, dans laquelle
il se proclame boutiquier (tendero). Pendant
une brève période, Pedro López a donc tenu un magasin
de village, chargé de procurer, à côté des denrées de première nécessité que
l’agriculture locale ne fournissait pas – huile, sel, olives, poisson séché,
etc. -, quelques produits manufacturés, principalement des textiles et des
chaussures courantes. Le passage d’une activité à l’autre paraît assez naturel
et marque un progrès apparent : du transport des denrées à leur
commercialisation ; de l’itinérance à la sédentarité. Cependant, l’expérience
a tourné court et le bonhomme a dû revenir à sa première occupation. Mais il
n’est pas interdit de penser que la petite Luisa y puisa un certain goût pour
le commerce, qu’elle pratiquera plus tard à Arcos et
qu’elle transmettra à ses enfants, puisque les deux plus jeunes se consacreront,
à Dax, à l’épicerie de gros ou de détail.
À en juger par le métier de son
père et des deux témoins de l’acte de naissance, tous deux propriétaires
exploitants (labradores), Lucas Chamarro et Domingo López Ágreda,
le milieu dans lequel notre grand-mère est née était résolument paysan. On peut
ajouter, sans crainte de se tromper, qu’il était plutôt modeste, eu égard à la
qualité des terres de la région et à la minceur de l’héritage que la petite
fille allait recueillir.
Chapitre VIII
Premier mariage
Luisa n’a pas
encore vingt ans lorsqu’elle se marie, le 12 juin 1901. Elle épouse, dans
l’église paroissiale Nuestra Señora del Valle, Eusebio García Martínez déjà
nommé.
Son mari est
né le 5 mars 1872 et a donc près de dix ans de plus qu’elle. Il a vu le jour,
comme nous l’avons déjà signalé, dans le village de Velilla de Medinaceli, à
quelques kilomètres d’Utrilla. Ses parents, Gregorio García et Dorotea
Martínez, et grands-parents (Eusebio Garcia et Maria Gutiérrez du côté du père ;
Pedro Martínez y Jacoba García du côté de la mère) sont tous de Somaén, à
l’exception de la grand-mère paternelle, qui est d’Avenales, tout près de là.
J’ai
longtemps ignoré la profession du père. La raison en est que la création du
Registre d’état-civil étant postérieure à 1872, nous ne disposons pas de l’acte
de naissance de notre grand-père mais seulement d’un acte de baptême, nettement
moins complet. Je dois à mon amie Rosalía Calzado d’avoir pu me procurer l’acte
de naissance d’un petit frère de notre grand-père, Venancio. Le domicile de ses
parents à cette date (1879), était un ancien hameau abandonné
(« despoblado » dit le document) au bord du Río Blanco, modeste
affluent du Jalón, où le père travaillait dans un moulin à foulon, dont le
système était activé par le courant du ruisseau qui est assez fort en cet
endroit. Ce lieu est tout près de Somaén, d’où est originaire toute la famille
ou presque, et le séjour à Velilla, où naquit mon grand-père, semble n’avoir
été que passager. Cette découverte m’a tout d’abord amusé, parce que c’est un
moulin à foulon qui a inspiré à Cervantès un des chapitres les plus cocasses du
Quichotte (Première Partie, chap. XX). Mais cette découverte me remplit
par ailleurs de tristesse, parce qu’elle témoigne des conditions de vie
précaire de mes grands-parents, occupés à une tâche archaïque et qui les
isolait du monde (sur la toile, on peut voir un édifice en torchis qui a
peut-être été la maison qu’ils habitaient).
Lorsqu’il se
marie, c’est un homme mûr, qui a déjà effectué son service militaire, dans des
circonstances qu’un document des Archives générales militaires de Ségovie, lui
aussi déniché par Rosalía Calzado, nous révèle incidemment. Conscrit de la
classe 1891, il est incorporé en 1892. Son régiment est affecté à Cuba, où il
débarque le 7 septembre 1895. Trois ans après son incorporation, il est
toujours un soldat sans grade. Il est hospitalisé en deux occasions, ce qui
nous fournit quelques dates précieuses sur cette période. Du 3 au 15 février 1896,
il est soigné à l’hôpital de Remedios pour un accès de fièvre jaune. Entre le
17 juin et le 10 juillet 1897, il est à nouveau hospitalisé, toujours à Remedios,
pour une bronchite pulmonaire. Sachant que la guerre prit fin le 18 août 1898,
il est possible que notre grand-père ait été rapatrié avec les dernières
troupes espagnoles encore dans l’île.
Il a un
métier, celui de herrero, terme équivalent à ferronnier ou forgeron,
mais, étant donné qu’il travaillera dans un milieu exclusivement rural, on peut
tout aussi bien le traduire par charron ou maréchal-ferrant. Il est déclaré
comme tel, lors de son incorporation dans l’armée, à l’âge de 20 ans.
Il ne nous
reste que fort peu de choses de ce grand-père. Sa fille Louise a conservé et
transmis à ses enfants une pince à feu, forgée par lui, avec laquelle, dit-on,
il saisissait des braises pour allumer sa cigarette. On a également un portrait
photographique, réalisé par les studios Corrales de Madrid (calle Río, 13 y 15)
pendant son service militaire.

Il y apparaît
« en petite tenue », c’est-à-dire sans armes, couvre-chef ou cape. Pour
autant que le laisse deviner la photo sépia, l’uniforme est celui d’un
fantassin des années 1890, qui se compose à l’époque d’un pantalon garance et
d’une vareuse turquoise. La vareuse, qui monte jusqu’au cou, est fermée par
huit boutons et comporte deux poches à la hauteur des aisselles (mais
apparemment pas sur les hanches) ainsi que deux épaulettes. Aucune décoration
n’est visible. Cependant, on observe une chaîne attachée à gauche du deuxième
bouton, qui descend le long des trois suivants avant de repasser à
l’intérieur : sans doute une montre. L’a-t-il empruntée pour
l’occasion ?
Le bras droit
est appuyé sur une colonne surmontée d’une corbeille de faïence sur laquelle on
peut lire clairement « Viva Asturias », peut-être parce qu’elle
appartenait à une série chargée d’illustrer les productions de chaque province
du pays. La main retombe nonchalamment, un cigare non allumé glissé sous
l’index. Le genou est plié de façon à permettre à la jambe droite de chevaucher
la gauche, au-delà de laquelle elle repose sur la pointe du soulier. Le buste
est bien droit. Le poing gauche repose sur la garde d’une courte épée passée au
côté. La pose est conventionnelle ; du moins avons-nous pu constater que
notre autre grand-père (paternel) prendra exactement la même lorsqu’il se fera
tirer, lui aussi, le portrait autour de 1910. Le cigare sera aussi présent, tout
aussi intact, mais il aura changé de main ; le photographe devait le
fournir pour l’occasion à chaque client. Il y aurait beaucoup à dire sur la
signification de ce cigare : gage de virilité pour la nouvelle
recrue ? Signe du statut avantageux du militaire dans la société de
l’époque ? Moyen de souligner de façon solennelle l’événement que
représentait en soi la réalisation d’un tel portrait ?
La signature
du photographe montre, en tout cas, que notre grand-père séjourna à Madrid
pendant son service militaire et non à Saragosse, où les conscrits originaires
de la province de Soria étaient généralement appelés sous les drapeaux. Faut-il
y voir l’indice d’un engagement hors norme, comme le laisse croire la tradition
orale familiale, selon laquelle il aurait effectué un double temps, celui qui
lui revenait et celui qu’il fit en lieu et place de son frère, ce qui l’aurait conduit
à combattre à Cuba, pendant la Guerre d’Indépendance qui prit fin en 1898 ?
Sous les
cheveux coupés ras, le crâne est large, les oreilles grandes mais non décollées
malgré la coupe peu avantageuse. Un front haut surmonte deux yeux petits et
rapprochés. Le nez, photographié de face, ne semble pas très proéminent. La
bouche, plutôt petite, est surmontée d’une fine moustache. Le menton est bien
dessiné, sans exagération. Eusebio était assez court de taille, si on rapporte la
longueur de ses jambes à l’ensemble du corps. On les devine fortes sous le
pantalon, à la mesure d’un buste qui remplit pleinement la vareuse, et d’un
tour de taille avantageux qui cache l’arrondi des hanches. Le jeune homme est
râblé, ses mains larges. Tous ces détails anatomiques s’accordent bien avec son
métier qui exige force et résistance. Cet inconnu ne nous est pas étranger,
tant il est aisé de retrouver dans son visage bien des traits visibles chez
telle ou telle de ses filles et qui, de toute évidence, ne renvoyaient pas à la
physionomie de leur mère : une implantation capillaire dense qui
descendait bas sous les tempes, l’ovale peu prononcé du visage, le coin des
yeux légèrement incliné vers le bas, ce qui confère au regard un certain air de
tristesse. La nature avait eu à cœur de perpétuer sur elles, à leur insu, le
souvenir d’un père et grand-père appelé à disparaître prématurément.
Je me prends
à regretter aujourd’hui de savoir si peu de choses sur lui, sur sa vie, sur son
caractère. Mais sa fille aînée, qui avait 14 ans lorsqu’il est mort, était peu
à même de communiquer une information de cette nature et les autres étaient
trop jeunes pour l’avoir vraiment connu. Par ailleurs, ceux d’entre nous qui
étions ses petits-enfants, n’avons guère sollicité le témoignage de notre
grand-mère à son sujet, non par souci de convenances ou pour lui éviter de se
remémorer des souvenirs douloureux, mais parce que son second mari, le
grand-père Muñoz, était beaucoup plus qu’un simple grand-père de substitution.
Nous le considérions tous comme un grand-père à part entière, et de ce fait
n’avions pas de vide à combler et donc aucune raison de chercher à mieux
connaître le père de nos mères respectives. Ce n’est qu’aujourd’hui, face à la
nécessité d’effectuer cet exercice de mémoire privé, que je regrette de ne pas
en savoir plus sur ce grand absent.
Il nous est
resté la crainte de la maladie qui l’a emporté, dont on attribuait la cause
principale à un malencontreux coup de rasoir, qui trancha sur la nuque un
bouton réputé inoffensif et qui visiblement ne l’était pas. Depuis, j’ai
toujours veillé à m’éviter pareille mésaventure en pareille circonstance :
que mes coiffeurs successifs veuillent me pardonner mes objurgations, qui
mettaient injustement en doute leur professionnalisme et leur sens de
l’hygiène. Elles manifestaient une peur inavouable, en fin de compte, le seul
héritage tangible que j’aie reçu de mon grand-père, mis à part son portrait.
Chapitre IX
Une vie d’errance
L’acte de naissance de leur fille
aînée, en date du 30 avril 1906, situe le couple à Gotor
(province de Saragosse). Il s’est écoulé cinq années depuis leur mariage. Rien
ne permet de préciser s’ils se sont installés à Gotor
dès leur mariage ou plusieurs années après, et même s’ils n’ont pas résidé
ailleurs, entre temps. Ce que l’on peut affirmer, en revanche, c’est que le
choix de ce village, relativement éloigné de leur lieu de naissance à tous
deux, n’est pas fortuit, puisque les grands-parents paternels de Luisa y
étaient nés et que, selon toute vraisemblance, la grand-mère y vivait encore. La
famille entretenait sans doute des relations avec des habitants de Gotor (cousins ou autres), qui ont pu les informer de la
possibilité pour notre grand-père d’y exercer son métier.
Un autre fait qui mérite d’être
signalé est que l’aînée des enfants vient au monde près de cinq ans après le
mariage, ce qui est relativement tardif à l’époque, surtout pour un couple qui
a démontré par la suite être plutôt fécond. Il semble que Luisa ait eu
plusieurs grossesses avortées avant la naissance de Catherine (comme sans doute
après aussi), et que toutes correspondaient à des garçons. Certains d’entre
nous se souviennent de l’avoir entendu dire par les plus âgées de ses filles.
Le séjour d’Eusebio
et Luisa à Gotor est de courte durée, puisque, à la
naissance de leur deuxième fille, le 29 octobre 1910, soit 4 ans plus tard, ils
résident à Oseja (province de Saragosse). Le
séjour à Oseja est également bref ; à la
naissance de la troisième fille (15 janvier 1913), ils habitent à Viver de la Sierra (province de Saragosse), village où
naîtra également la suivante (25 septembre 1914).
À quoi attribuer ces trois
déménagements en à peine plus de 10 ans, entre 1901, date du mariage, et
janvier 1913? Bien évidemment, les documents
d’état-civil n’apportent aucune information à ce sujet. On en est donc réduit
aux hypothèses. Observons que le couple voyage, certes, mais reste dans une
aire géographique limitée (voir la carte). Ceci pourrait s’expliquer par
l’absence de ferronnier dans le secteur, ce qui pousse Eusebio
à une certaine migration, mais aussi par la faible population de ces villages,
incapables de fournir un travail permanent de longue durée à un homme du
métier. Une fois remis en état ce qui pouvait l’être, ou une fois forgées les
pièces dont les paysans avaient besoin, il n’y avait plus assez de travail pour
un artisan à demeure. Mais, comme Eusebio s’était
fait une certaine renommée, il était sollicité par les villages alentour. Je
résiste à la tentation d’attribuer ces changements à un caractère aventureux ou
instable, parce que les distances étaient trop courtes entre les différents
villages pour qu’on puisse parler vraiment de changement. J’y vois plutôt une
adaptation forcée aux circonstances.
J’ai pris la peine de refaire le
périple du couple. Le déménagement d’Utrilla à Gotor est le plus conséquent. Il faut parcourir quelque 70
kms jusqu’à Calatayud (par la route nationale, il est vrai), à quoi s’ajoutent
36 kms d’une route tortueuse qui remonte la rivière Jalón. De toute évidence,
ce déménagement avait été programmé. Le village d’Oseja
se trouve à quelque 12 kms au nord de Gotor et de la
Sierra de la Virgen. Celui de Viver
de la Sierra est situé, par rapport à Oseja, de
l’autre côté de la Sierra. Pour rejoindre leur nouvelle résidence, la famille
emprunte en sens inverse la même route qu’à l’aller sur 18 kms en direction de
La Almunia de Doña Godina,
traverse Gotor, et, à Morés
(lieu de naissance de la grand-mère paternelle de Luisa), s’engage dans le
chemin qui va butter sur la Sierra de la Virgen et
dont Viver marque le terme, à 9 kms de là. Tout ceci
confirme que seul le déménagement d’Utrilla à Gotor s’apparente à une vraie mutation. Les suivants
semblent obéir à des raisons de convenance ou à la recherche de meilleurs
profits.
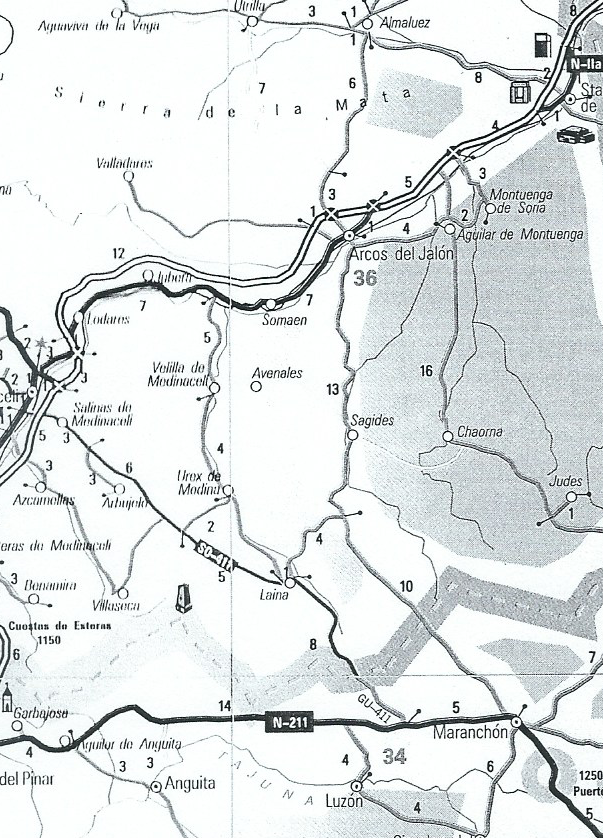
Foyer des trois familles.
Chapitre X
Noël tragique
Peu après la naissance du
quatrième enfant survient la mort du père. L’acte de décès établi à cette
occasion nous apprend qu’il était hospitalisé depuis « le 20 décembre
1914, à l’Hôpital Provincial de Madrid, où il occup[ait],
dans la sale 17, le lit numéro 9 de chirurgie, dans lequel il est décédé a cinq heures et trente minutes [le 28] à la suite d’un
carcinome diffus au cou ». Le document officiel, dans sa froide
rhétorique, laisse percer la tragédie vécue par le couple.
Eusebio
meurt donc huit jours à peine après avoir été admis à l’hôpital, ce qui laisse
supposer qu’il y est entré à la dernière extrémité et qu’il a dû souffrir des
mois durant avant d’en arriver là. L’internement à Madrid laisse perplexe,
parce que Saragosse était plus proche de Viver. Ce
choix était-il déterminé par la gravité de l’état du malade ou par le fait
qu’il avait été militaire et qu’il avait pu contracter sa maladie à Cuba ?
Sa femme, avec quatre jeunes
enfants, dont un bébé de 3 mois, n’a pas pu suivre son mari à Madrid.
Disposait-elle d’ailleurs de moyens financiers suffisants pour effectuer le
voyage et se loger dans une ville où elle n’avait pas de parents, pour un
séjour dont elle ignorait combien il durerait ? La mort d’Eusebio a donc atteint le malade dans une solitude complète.
Les deux témoins qui ont signé l’acte de décès sont de parfaits inconnus, sans
doute des infirmiers de l’hôpital (il est précisé qu’ils résident à Madrid). Le
corps est enterré au cimetière de la Almudena de
Madrid, c’est-à-dire loin de tout caveau familial.

Pendant ce
temps-là, Luisa se morfond à Viver. Connaissant
l’état de son mari, pouvait-elle espérer autre chose que l’annonce de l’issue
redoutée ? On imagine les jours d’angoisse puis de désespoir qu’elle a dû
connaître, isolée dans ce pauvre village de montagne, en plein hiver, portant à
elle seule tout le poids d’une maisonnée. Combien de jours dut-elle
attendre le courrier de l’hôpital ? Comment en a-t-elle eu connaissance,
elle qui ne savait pas lire ? Le maire est-il venu le lui remettre en
mains propres ?
Il m’arrive de penser que, si un
de ses petits-enfants avait eu l’idée de l’interroger sur le sujet, il aurait
reçu une rebuffade pour toute réponse. Cette sorte de confidences lui aurait
semblé déplacée, tant il est vrai que, dans le monde rural dans lequel elle
avait été élevée, le seuil de l’indécence était bien vite atteint lorsqu’on
était dans le cas d’exprimer des sentiments intimes. Je me garderai donc de
tracer un tableau de ces tristes moments, de peur de trahir à distance cette
pudeur ancienne.
Je retiendrai seulement l’idée
que notre grand-mère connut, sans doute sans le savoir, la tragique expérience
de bien des femmes de France, un pays dont elle ne soupçonnait pas encore qu’il
pourrait un jour être définitivement le sien, qui, à la même époque, recevaient
un courrier de même nature pour les informer que leur mari avait été tué,
quelque part dans une tranchée de la Grande Guerre. A-t-elle
jamais songé à cette fraternité involontaire ?
Chapitre XI
Retour à Utrilla et second mariage
Que pouvait faire Luisa, sans
revenus et avec quatre filles à charge, si ce n’est revenir à son village
natal ? Sa mère, Joaquina Rangil,
vivait encore, puisqu’elle sera mentionnée dans les actes de naissance de ses
trois futurs enfants. On ignore, en revanche, si son père était encore vivant
mais il est mentionné comme défunt à la naissance de la première d’entre elles (31
août 1918). Même
si la jeune veuve ne pouvait compter que sur le secours de sa mère, cet appui
restait appréciable. À une date inconnue mais,
selon toute vraisemblance, peu après le décès de son mari, Luisa s’installe
donc à Utrilla. Cependant, même dans un milieu
favorable, il lui fallait subvenir aux besoins de ses quatre enfants.
La situation d’une veuve ayant
charge d’enfants n’est jamais enviable, encore moins à une époque où il
n’existe d’aides familiales publiques d’aucune sorte, et où on considère d’un
mauvais œil une femme en âge de prendre mari ayant fait le choix de vivre
seule. Le mariage s’impose donc comme une solution inévitable, tant
économiquement que socialement. Nul doute que Luisa ait tenu ce raisonnement,
et que son milieu l’ait incitée à franchir le pas.
Toujours est-il que, le 22
novembre 1916, soit moins de deux ans après le décès d’Eusebio,
elle épouse, à Utrilla, un célibataire de 41 ans
(alors qu’elle en a 35), Alejandro Muñoz Camacho. Le
mariage a lieu, cette fois encore, dans l’église Nuestra Señora del Valle.
L’acte de mariage ne fournit
aucune précision sur le métier de l’époux, mais dans les actes de naissance de
ses deux filles, il est déclaré comme propriétaire exploitant (labrador),
au même titre que son père, Vicente Muñoz Gonzalo. Ce
dernier et sa femme, Jacinta Camacho, sans
profession, étaient tous deux originaires d’Utrilla,
où ils habitaient au 1, rue de la Puerta Encima (Porte d’En-haut). Étaient aussi originaires
d’Utrilla les grands-parents paternels, Santiago Muñoz (décédé à la naissance de son petit-fils) et Dominica Gonzalo. Les grands-parents maternels, Calixto Camacho (labrador) et Manuela Mora, (sans
profession) venaient d’un village proche de Medinaceli,
Lodares de Medinaceli. À Utrilla, ils habitaient au 24, rue del
Horno (du Four).
La légende familiale veut que le
curé de la paroisse d’Utrilla ait joué un rôle
décisif dans le remariage de notre grand-mère. Il s’appelait don Bartolomé (Barthélemy)
et a laissé un souvenir impérissable, transmis aujourd’hui encore par les
anciens du village. C’est Pedro Carretero Esteban, qui me l’a rapporté. Cependant que Fonsa s’affaire
dans sa cuisine pour honorer ses hôtes, Pedro, qui n’a pourtant rien d’un
bouffe-curé, dresse un portrait pour le moins sévère de l’impétrant :
« Don
Bartolomé era más bruto que un cerrojo
(Dom Barthélémy était une vraie brute de forge) ».
Et d’appuyer son propos à l’aide
de cette anecdote plutôt édifiante.
Il se trouve
que le patron du village est saint Barthélemy, ce qui fait que le jour de sa
fête, on célébrait aussi celle du curé. Cette coïncidence ne faisait que rendre
celui-ci plus intransigeant quant à l’assistance à l’office. Cette année-là, la
récolte avait été retardée par les intempéries et le 24 août, qui est le jour
de la fête en question, elle n’était pas encore rentrée. Les grains avaient
bien été battus mais on attendait le moment favorable pour vanner à la fourche,
comme cela se faisait à l’époque (et comme cela se ferait encore jusqu’aux
années 1960). Or, le hasard voulut qu’un petit vent se levât en début
d’après-midi et, bien que ce fût dimanche, tout le monde rejoignit les aires de
battage pour en profiter. La chose déplut au curé qui convoqua le maire et lui
intima l’ordre de convoquer tous les paroissiens à l’église. Le maire obtempéra,
car, en ce temps-là, les curés étaient les patrons (los curas mandaban). Bien entendu, le curé ne fit rien pour
abréger l’office et le malheur voulut qu’un orage de grêle éclatât et mît à mal
toute la récolte qui se trouvait sur les aires. La population dut se contenter
cette année-là du peu qui avait déjà été entreposé dans les greniers et qui fut
partagé entre tous.
Tel était le personnage qui
présida à l’union de ma grand-mère et de son second mari. Imaginons la scène.
Chapitre XII
Alejandro Muñoz Camacho
Don Bartolomé sort de son
presbytère pour aller célébrer sa messe quotidienne à l’église paroissiale
Notre-Dame du Val. Au moment où il débouche sur le parvis, il aperçoit franchissant
la porte de ville une forme humaine à contre-jour mais qu’il identifie
immédiatement à sa démarche hésitante. Cet homme qui marche à côté de sa mule,
appuyant son épaule contre la tête de l’animal pour plus de sûreté, ne peut
être qu’Alejandro Muñoz Camacho qui s’en revient
d’une tournée nocturne trop arrosée.
Cet Alejandro n’est pas un mauvais
bougre. Sa sœur Leonarda et lui sont les enfants de
Vicente Muñoz Gonzalo, laboureur, et de Jacinta Camacho, sans profession. Devenu veuf, Vicente
s’est remarié et a eu deux autres enfants, Indalecio
et Francisca. Les deux aînés sont donc orphelins de
mère.
Alejandro n’est pas sot non plus.
Ayant fréquenté l’école, il y a non seulement appris à lire et à écrire (pas à
compter, au grand désespoir des siens) mais y a contracté de plus un goût pour
la lecture et un étrange talent pour la versification. Cela lui valut le surnom
de « poète », qui ne le lâchera plus, ni après son départ ni même longtemps
après sa mort, comme ont pu le vérifier tous ses petits-enfants qui se sont
rendus à Utrilla et qui s’y rendent encore. Il vous
trousse un couplet plein d’esprit à la demande, et l’interprète, en
s’accompagnant de la bandurria, la mandoline locale, sur l’air et le
rythme de la jota.
Il ne nous reste que de très
rares témoignages de son talent :
Cuatro cosas tiene Utrilla
que no las tiene Aragón
la plaza y la plazuela
la puerta Encima, la Hondón.
Quatre
choses a Utrilla
que n’a pas tout l’Aragon
sa place et sa placette
sa porte Haute, celle du Fond.
Le poème qui suit nous a conservé
heureusement une preuve plus flatteuse de son art. À un conseiller municipal
qui lui reprochait de ne pas lui avoir consacré de vers, il répliqua du tac au
tac :
El señor Esteban Nemecio
hombre sin ningún principio
hace la burla del pueblo
y come del municipio.
Le sieur Esteban Nemecio
homme sans aucun principe
se moque des villageois
et mange aux frais du municipe.
Un talent, si rare dans un milieu
rural, lui valait de nombreuses invitations à boire qu’il honorait avec une
constance digne d’éloge. En contrepartie, ce grand dévouement à la cause
poétique lui réservait des retours difficiles à la maison familiale.
Heureusement, il avait su dresser sa mule à palier ses insuffisances
momentanées, aggravées par le handicap d’une semi-cécité car il était borgne et
que sa vue se troublait d’autant plus facilement ; il pouvait désormais
s’en remettre à elle pour rentrer au bercail.
Cet esprit rebelle, sinon
revendicatif car il se contentait de peu pour lui-même, qu’il manifestait à
l’occasion, contribua à lui conférer la stature d’un mythe populaire. Les
communautés espagnoles, très largement issues des classes populaires, qui
s’étaient reconstituées en France après la Guerre Civile, avaient emporté avec
elles un corpus de fables et d’historiettes qui finirent, peu à peu, par se substituer
aux souvenirs d’une réalité qu’elles préféraient oublier. Le héros en était souvent
le grand écrivain et satiriste Francisco de Quevedo, ou
plutôt son reflet populaire, à qui on attribuait toute sorte de bons mots
purement imaginaires, passablement scatologiques ou franchement anticléricaux, un
peu comme si notre bon peuple français attribuait ses propos d’après-banquets
non à un quelconque Toto mais à François Rabelais en personne.
Or, il est avéré que notre
grand-père était parvenu, dans notre cercle familial, à rivaliser avec le grand
Quevedo. À titre d’illustration, et toujours pour
satisfaire à l’exigence de vérité que l’auteur de cette histoire poursuit avec la
rigueur que lui impose la gravité du sujet qu’il a entrepris de traiter, j’en
rapporterai une, « particulièrement significative », comme disent les
universitaires en mal d’adjectifs. Alors qu’il rentrait à l’aube d’une de ces
expéditions nocturnes qui lui étaient coutumières, Alejandro croisa sur son
chemin deux religieuses. En le voyant, elles se signèrent et l’une d’entre
elles laissa échapper une exclamation peu charitable à son endroit :
« La journée s’annonce mal : la première personne que nous voyons
aujourd’hui est un homme borgne. » Les brumes qui enveloppaient l’esprit de
notre bon Alejandro ne l’empêchèrent pas de réagir avec un remarquable à
propos : « Pour voir des p., un œil suffit ».
Tel était notre grand-père ou
telle est, du moins, l’image que nous aimons conserver de lui. Après tout, la
différence n’est pas si grande et chaque collectivité a autant besoin de mythes
que de vérités établies.
Chapitre XIII
Promesse de mariage
C’est à peu près dans cet état
que Don Bartolomé intercepta notre poète dans la rue. Maîtrisant à grand peine son
hilarité, car Alejandro avait aussi le don de faire rire à ses dépens, il lui
enjoignit d’attacher sa mule. Le brave homme obtempéra puis, le béret à la
main, s’apprêta à recevoir la semonce prévisible, en maintenant tant bien que
mal une verticalité qui s’entêtait à lui échapper.
– « Alejandro, sais-tu
encore servir la messe ? Ne me regarde pas avec ces yeux effarés, je ne te
demande pas la lune. Oui ou non ? ».
Le curé interpréta le vague
mouvement de la tête comme un acquiescement.
– « Très bien, alors
suis-moi ». Puis il se dirigea d’un pas ferme vers la sacristie, suivi par
son nouvel acolyte, qui traînait fâcheusement les pieds.
La messe se déroula sans incident
majeur. L’assistance se contenta de manifester discrètement sa surprise en
voyant notre Alejandro en tenue de ville servir la messe à une heure aussi
matinale. Quant aux deux enfants de chœur, condamnés à l’inaction par ce
recrutement inattendu, ils eurent mainte occasion de pouffer en se poussant du
coude, chaque fois que le curé rappelait à l’ordre d’un coup d’œil sévère son acolyte
d’occasion.
À la fin de l’office, Alejandro,
qui avait peu à peu repris ses esprits, accompagna le curé dans la sacristie où
il l’aida à retirer les vêtements liturgiques, puis le suivit, à sa demande, jusqu’au
presbytère. Le curé avait été, quelques années durant, vicaire dans une cure urbaine
et y avait contracté l’habitude de prendre un chocolat pour rompre le jeûne
quotidien, en lieu et place du pain grillé au lard (las migas)
qui constituait le petit-déjeuner ordinaire des paysans. Il invita Alejandro à
l’imiter. Lorsque les deux estomacs furent lestés, le curé se rejeta en arrière
sur son siège, regarda fixement son hôte lequel, embarrassé, détourna les yeux,
puis lui tint à peu près ce discours :
– « Alejandro, quand te
décideras-tu à devenir raisonnable ? Trouves-tu décent, à ton âge, de
continuer à mener cette vie de bamboche ? Tu ne crois pas qu’il serait temps
de fonder une famille ? Je connais tes défauts mais tu as aussi quelques
qualités, même si tu t’évertues à les cacher. Tu as bon cœur et tu aimes les
enfants. [Après un silence qui parut très long au pauvre Alejandro] Tu connais
Louise, la fille de Pedro et Joaquina. Tu sais dans
quelle triste situation elle se trouve : contrainte d’élever seule ses
quatre petites. Elle est encore belle malgré ses trente-cinq ans, elle vient
d’une famille honorable, et je crois bien que tu ne lui es pas indifférent. Qu’en
penses-tu ?
…
Veux-tu que je lui parle ?
….
C’est bon, j’y consens. En
attendant, fais de ton mieux pour la mériter en te conduisant dignement. »
C’est ainsi qu’Alejandro Muñoz Camacho épousa Luisa López Rangil, veuve García.
Chapitre XIV
Noces de larmes
Le mariage fut
célébré le 22 novembre 1916. Les fiançailles n’avaient pas duré plus que ne
l’exigeait la publication des bans, les deux ans qui s’étaient écoulés depuis
le décès d’Eusebio Garcia pouvant passer pour un
deuil décent. Les formes avaient donc été préservées malgré l’urgence.
De la cérémonie il ne nous est
rien parvenu d’autre que l’acte signé par le juge municipal, don Faustino Ejido Sanchez, à l’issue de l’union religieuse bénie
par le curé dans l’église de Notre-Dame du Val. On peut supposer qu’elle fut
modeste. Les témoins sont deux inconnus, Manuel Sancho et Clemente
León. Plutôt que par la magnifique façade baroque, on imagine que le maigre
cortège entra dans le temple par la porte latérale réservée à l’usage
quotidien.
L’esprit n’était pas à la fête,
surtout pour notre grand-mère. Dans le cadre familier de l’église paroissiale,
comment n’aurait-elle pas songé à la cérémonie de son premier mariage ? Elle
avait dix-neuf ans alors et toutes ses illusions de jeune fille ; elle
s’unissait à un homme qu’elle avait vraisemblablement aimé et qui, plus âgé
qu’elle et pourvu d’un vrai métier, lui assurait la perspective d’une sécurité
relative. Elle en avait désormais trente-cinq et portait sur ses épaules le
poids de plusieurs années de malheur. L’avenir ne s’annonçait pas
particulièrement rose non plus, même si la perspective de ne plus être seule et
de sortir de la maison paternelle la consolait quelque peu. Elle n’oubliait pas
non plus ses quatre enfants restés au logis avec leur grand-mère, qu’il
faudrait élever avec les maigres moyens dont disposerait le couple. Elle ne se
faisait, en effet, aucune illusion sur la capacité de son nouvel époux à
exercer avec quelque constance un métier suffisamment rémunérateur.
Cette noce eut des accents de
tragédie grecque, tant étaient contrastées les humeurs de chacun des deux
époux. La mariée passa sa nuit en prières, enfermée dans sa chambre, devant la
photo de son défunt mari. Pendant ce temps, Alejandro faisait honneur à la
compagnie de ses amis, transformant ce repas de mariage en un enterrement de
vie de garçon. La légende raconte qu’il fut particulièrement gai et inventif,
jusques et y compris dans le chant qui clôt toute fête villageoise castillane,
cette despedida en forme de jota
aragonaise, que mon père, qui l’avait recueillie de sa propre bouche, me chanta
plusieurs fois mais dont je n’ai malheureusement pas noté le texte. En
revanche, la mémoire orale de la famille a conservé certain couplet qui, s’il
ne révèle pas un goût considérable, démontre qu’en toutes circonstances,
Alejandro conservait son talent d’improvisateur. Le marié l’aurait chanté en
pleine nuit à notre grand-mère :
Luisa, esposa querida
enciende candela y mira
que quiere mear
la Laura
y quiere cagar
la Elvira ».
Louise, mon
épouse chérie
allume la chandelle et vois :
Laure veut
faire pipi
et Elvire faire caca.
On a pu constater, depuis, que le
couplet appartenait aussi au répertoire collectif du village d’Utrilla, au point que les deux bébés cités n’étaient connus
des habitants que par cet épisode nocturne autant qu’intempestif. J’ai ainsi pu
comprendre pourquoi la dénommée Elvire, notre mère, n’a jamais voulu retourner
à Utrilla : sans doute voulait-elle éviter le
rappel d’une affaire si peu flatteuse pour son image.
Chapitre XV
D’Utrilla à Arcos
Le couple resta
quelques années à Utrilla, où naquirent leurs deux
filles, successivement le 31 août 1918, et le 11 février 1920. La naissance de
la première fut saluée d’un bon mot de son père que m’a rapporté Pedro Carretero. Il aurait dit à la cantonade : Ma femme, cinq
du premier coup (Mi mujer, del
primer parto, cinco).
Sans tomber dans le ridicule de l’exégèse d’une brève de comptoir, je me
permettrai de souligner tout le sel de cette remarque : outre qu’elle
exprime de façon cruelle le changement radical que l’existence de cette nichée
d’enfants impliquait pour ce célibataire endurci, elle dénote chez lui une
prise de conscience, peut-être un peu tardive, de la gravité de sa nouvelle
situation.
De fait, il y a lieu de se
demander comment le couple parvenait à subvenir aux besoins d’une famille aussi
nombreuse. Les revenus des terres devaient à peine suffire, avec les produits
du potager et de la basse-cour, à couvrir les besoins alimentaires. On a du mal
à imaginer d’où était tiré l’argent nécessaire à l’entretien des enfants, de la
maison, des bêtes et de l’outil de travail. Les grands-parents survivants étaient-ils
en mesure d’y contribuer ? Ce n’est pas certain, car nous n’avons pas affaire
à des rentiers : une fois qu’ils avaient cédé leurs terres à leurs
enfants, les vieux étaient plutôt une charge qu’un soutien.
Toujours est-il qu’après la
naissance de la deuxième fille du couple, la famille se transporta à Arcos de Jalón, simple bourgade que la construction
d’ateliers liés à l’exploitation de la voie ferrée Madrid-Barcelone avait
transformée en une petite ville active. La décision était mûrement réfléchie et
le départ d’Utrilla, définitif. À preuve, le fait
qu’Alejandro vendit, avant de partir, à sa sœur Leonarda,
les terres qui lui étaient revenues de l’héritage de leur mère. Muni de ce
pécule, il pourrait faire face à toute éventualité en attendant un salaire
régulier.
Le père décrocha à Arcos un emploi de facteur. Ce fut sans doute la seule
occasion de sa vie où sa relative maîtrise de l’écrit lui fut de quelque
secours. Il faut savoir lire, et même parfois déchiffrer, pour pouvoir
distribuer le courrier et cette faculté n’était pas si commune dans la
population locale de l’époque.
C’est à Arcos
que naquit le petit dernier, le 26 novembre 1923. Cette naissance fut un
événement parce que, pour la première fois, Luisa put mener à terme une
grossesse dont le fruit était un garçon. Ce ne fut pas sans mal. Le bébé, prématuré,
était très petit et, comme on le suppose, peu gaillard. La mère et ses six
sœurs aînées ne le quittaient pas d’un pouce, l’enveloppant de coton et le
soignant avec l’acharnement qu’on imagine. Il présentait certains symptômes que
des personnes naïves ne surent pas interpréter. C’est ainsi que l’on crut qu’il
était borgne, un de ses yeux ne s’étant pas encore ouvert, et qu’il avait
hérité ce handicap de son père. Or, le père était devenu borgne par accident,
ce qui rendait irrecevable l’hypothèse d’une hérédité supposée, même si le
hasard avait voulu que, dans les deux cas, ce fût l’œil droit qui se montrait
défaillant. La grande sœur qui avait été chargée ce matin-là de s’occuper du bébé
eut la stupeur de lui voir un deuxième œil ouvert, qui par contraste avec la
situation antérieure, paraissait beaucoup plus grand que l’autre. Elle poussa
un tel cri que la mère se précipita, croyant qu’elle avait laissé tomber le
bébé. Toute la maisonnée fut heureuse de constater que le petit dernier était
un faux borgne.
Le séjour à Arcos
fut de courte durée, sans doute parce que les perspectives économiques
n’étaient guère mirobolantes : comment faire vivre une famille de sept
enfants sur le modeste salaire d’un facteur ? La mère tenta bien de
compléter ces maigres émoluments en installant un petit commerce. À cet effet,
elle se procura une petite jument afin de livrer dans les villages alentours. Mais
l’expérience tourna court, principalement parce que le père, qui tenait la
boutique lorsque sa femme était en tournée, appliquait à cette activité des
principes incompatibles avec une saine pratique commerciale. Il avait une
fâcheuse tendance à faire crédit et à oublier de garder trace des sommes qui
lui étaient dues. La nouvelle de sa générosité se répandit bientôt, ce qui
incita les acheteuses à choisir le moment où il était seul derrière son
comptoir pour faire leurs emplettes. Les supplications de ses clientes
impécunieuses, ou qui feignaient de l’être, l’émouvaient tellement qu’il ne
savait rien leur refuser. On comprendra que cette tentative ne dura guère.
L’aventure postale ne connut pas
une fin plus heureuse. On raconte que le nouveau facteur aurait vidé un jour sa
sacoche de lettres dans le Jalón, sans doute pour voir si les lettres chargées
flottaient mieux que les autres. L’expérience ne donna pas les résultats
escomptés, en revanche, elle entraîna la mise à pied du chercheur audacieux.
L’idée du départ vers l’étranger apparaît
donc comme un ultime recours, toutes les autres possibilités ayant été
épuisées. Mais l’idée d’émigrer en France ne naquit pas comme par enchantement
dans l’esprit des deux parents. Elle devait être dans l’air. En effet, à Arcos, la famille Muñoz eut l’occasion
de côtoyer d’autres familles qu’elle finirait par retrouver en France. Ainsi la
famille Donoso, qui était celle de mon père et qui
venait du village voisin de Judes (à 4 heures de
marche d’Arcos), émigra quelques semaines avant elle
(novembre 1924), elle aussi, vers les Landes. La coïncidence est assez
frappante pour que naisse le soupçon qu’il existait des filières de recrutement
au profit de certaines entreprises françaises, soit directement financées par
elles, soit par l’intermédiaire des consulats de France en Espagne. Le manque de
main-d’œuvre consécutif à la saignée de la Grande Guerre se faisait cruellement
sentir. Il était aggravé par l’ouverture de débouchés nouveaux pour les
produits du pin maritime : traverses de chemin de fer, poteaux en tous
genres (mines, électricité et téléphone) ; mais aussi les sous-produits de
la résine. En outre, il ne faut pas négliger l’attrait que représentait, pour
les futurs émigrants, une région française proche de la frontière, ce qui
permettait d’entretenir l’illusion d’une rupture moins radicale et d’un retour
toujours possible. On verra qu’il n’en fut rien.
Chapitre XVI
Le grand voyage
Le grand-père
partit en éclaireur. Après son installation dans les Landes, il connut divers
emplois : bûcheron, manœuvre dans une fabrique d’allume-feu à Labouheyre
puis dans une fabrique de caisses à Ychoux. Il finit par se fixer à Richet,
près de Pissos, et jugea, dès lors, qu’il était en mesure d’y accueillir sa
famille. Il semble qu’il ait accompagné son invite d’une lettre très élogieuse
sur le point de chute proposé. On verra que sa vision poétique du cadre de vie
qu’il comptait offrir à sa famille n’avait qu’un très lointain rapport avec la
réalité. Peut-être cherchait-il aussi à s’abuser lui-même.
Le voyage d’Utrilla
(Espagne) à Richet (par Pissos, Landes), aux dires des enfants, fut une
véritable odyssée. Le groupe était constitué par deux adultes, la mère et le demi-frère
de son mari, Indalecio, dont la trace s’est perdue
(peut-être est-il reparti, une fois la belle-sœur et les enfants arrivés à bon
port), et les sept enfants, qui avaient respectivement, 18 ans, 14 ans, 12 ans,
10 ans, 6 ans, 4 ans et 1 an. La durée du voyage en train fut de trois jours,
avec une étape à Madrid et une autre à la frontière, où le père alla les
attendre. Par manque d’argent il fallut choisir des hébergements très bon
marché, ce qui valut une attaque de puces et de cancrelats dans une pension
madrilène, recommandée par on ne sait qui, peut-être par un de ces voyageurs de
commerce qui rendaient visite de loin en loin aux habitants d’Utrilla. À ces difficultés inhérentes aux migrations de
pauvres gens, s’ajoute l’ignorance complète dans laquelle tous nos voyageurs
étaient des moyens de locomotion modernes. On se demande encore comment la
totalité des bagages préparés par la grand-mère, qui incluaient des matelas, a
pu arriver à bon port, et au prix de quelles contorsions ce volumineux équipage
put trouver place dans des wagons de Troisième classe. Mais comment laisser sur
place des effets et des objets que l’on ne reverrait plus ? La grand-mère
était trop lucide pour penser à un possible voyage de retour. Je doute même qu’elle l’ait jamais souhaité. Je ne me souviens pas de l’avoir
jamais entendu manifester le désir de revenir à Utrilla,
ne serait-ce que par boutade.
L’accueil réservé par les
hôteliers de la frontière a laissé une blessure qui ne s’est jamais tout à fait
refermée, même pour les plus jeunes. On les prit pour des « bohémiens »,
ce qui ne pouvait que froisser des paysans castillans peu portés à l’indulgence
à l’égard des « gens du voyage », mais, ce qui est plus grave encore,
en faisant des difficultés pour les héberger on se comportait à leur égard
comme on le faisait chez eux à l’égard de gitans. Cette déchéance
sociale jugée injustifiée fut cruellement ressentie.
Heureusement, le terme final de
cette odyssée n’était pas trop éloigné, une fois la frontière atteinte :
guère plus de 150 kms, qu’un omnibus de l’époque devait parcourir en un peu
plus de deux heures. Mais il fallait auparavant changer de train à Ychoux, sur
la ligne Irun-Paris. Là, on prenait une desserte locale à voie étroite, qui
passait par Lipostey et Pissos et dont le terminus
était à Moustey. Aujourd’hui encore, un voyageur attentif observera sur sa
droite les restes de cette voie, à la sortie de la gare d’Ychoux dans la
direction de Bordeaux.
L’arrivée en gare de Pissos eut
lieu en fin de journée, le 15 janvier 1925. Cette date n’est inscrite dans
aucun document conservé par la famille, mais elle était restée gravée dans la
mémoire de notre mère qui ne pouvait l’oublier, car elle fêtait ou aurait dû
fêter, ce jour-là, ses douze ans.
La nuit tombe tôt à cette époque
de l’année dans les Landes, et le maigre éclairage de la gare ne donna guère
d’éclat à la scène, d’autant que le déchargement des encombrants bagages
requérait l’attention de tous, grands et petits. En outre, il pleuvait, comme
il sait pleuvoir en hiver dans la Haute-Lande, une pluie drue, constamment
agitée par le vent venu de l’océan, qui détrempe les chemins et vous couvre de
boue jusqu’à la cheville, si vous égarez vos pas sur les fougères fanées des
bas-côtés fangeux. Cette omniprésence de l’eau est une autre des images qui se
grava dans la mémoire des enfants.
On attendit vainement le muletier
que le patron de l’usine avait chargé de transporter les arrivants et leurs
bagages. Il était en retard. Pis, lorsqu’il eut rattrapé le cortège qui, en
désespoir de cause, avait entrepris de franchir à pied les 7 kms qui les
séparaient de leur future demeure, effrayé par le nombre de personnes à
transporter et peut-être aussi par le spectacle qu’elles offraient, il fouetta
son attelage de mules et s’en fut au galop pour ne plus revenir.
Chapitre XVII
Point de chute
La maison que le
père avait louée pour y loger sa famille et qu’il occupait déjà se trouvait,
selon les témoignages recueillis, au beau milieu de la forêt, dans un hameau de
la commune de Richet (La Frênaie en gascon), à 3 kms du bourg (Richet a
cessé d’être une commune autonome dans les années 1970 et est désormais
rattachée à Pissos).
Richet se compose de trois
hameaux, dont la désignation a évolué avec le temps mais qui sont désormais
connus sous l’appellation suivante : le Vieux Richet ; le
Brous ; le Haut-Richet.
Au bord de la Grande Leyre, le Vieux
Richet posséda une verrerie qui puisait son sable dans une carrière proche mais
fut abandonnée à la fin du 19e siècle ; la cheminée du four
subsiste encore. L’ancienne église
paroissiale y est édifiée, ce qui explique sans doute que ce hameau soit aussi
appelé « le bourg ». Ce bel exemple d’architecture romane a heureusement
échappé à l’enthousiasme constructeur qui, au temps de l’Ordre Moral, a
substitué tant d’églises neuves aux vieux temples jugés, comme à Pissos, à la
fois encombrants et sans qualité, car « édifié[s] à des époques
différentes, sans plan et sans harmonie aucune » (délibération du conseil
municipal de Pissos du 22 février 1894).
Placée à l’écart des quelques maisons qui constituent le hameau, elle a fort
belle allure. Son chœur et son chevet semi-circulaire, curieusement percé d’une
fenêtre au milieu de son contre-fort central, couronnés
d’une corniche ornée de modillons sculptés, dominent d’un bon mètre la toiture
de la nef. Celle-ci, faiblement éclairée par deux étroites baies au sud et une
seule au nord, aboutit à un clocher-mur en encorbellement sur la façade. À la
fin du 15e siècle, une chapelle dotée de deux belles fenêtres à
meneaux a été ajoutée au sud du chœur, cependant qu’au 17e siècle
(1681 précise une inscription), un porche a été construit en avant du portail.
L’intérieur présente des vestiges de peintures murales. Tout le mur sud de
l’église jusqu’au chevet est bordé d’un vaste et touchant cimetière, dont les
tombes anciennes sont dépourvues de pierre tombale. Au nord, une fontaine
miraculeuse disparaît sous les hautes herbes d’une propriété privée. C’est dans
ce beau monument que l’aînée des deux filles du couple a fait sa communion.
Dans les années 1920, l’originalité
du Brous tenait au fait qu’il regroupait la principale industrie, à savoir la
tuilerie, et le principal équipement collectif, sa mairie-école. La disposition
de ce hameau est curieuse. Elle épouse la forme de deux cercles concentriques
séparés par une chaussée circulaire, à la manière d’une ancienne motte
médiévale dont la butte centrale aurait été arasée. À l’intérieur, on devine
plutôt qu’on ne les voit, des constructions, certaines imposantes, closes et
cachées à la vue sous une végétation débordante, ce qui confère à l’ensemble
l’aspect d’un lotissement privé, comme il s’en construit désormais, impénétrables
au visiteur. De l’autre côté de cette voie, des maisons d’apparence plus
modeste offrent généreusement à la vue la diversité de leur bâti.
L’école-mairie constitue
l’édifice le plus remarquable. Bien que transformé désormais en gîte rural, il
reste accessible, car dépourvu de clôture. Sa structure n’a pas été modifiée,
aussi est-il aisé d’y reconnaître la mairie à droite, la partie dévolue à
l’école à gauche. Chaque partie se compose de deux salles au moins, une en
façade, l’autre à l’arrière. Du côté école, un escalier permettait d’accéder à
l’étage, où se trouvait l’appartement de l’instituteur. La salle de classe et
les toilettes donnaient sur la façade latérale dans une petite prairie qui
devait servir de cours de récréation. À l’arrière du bâtiment, un auvent de
bois soutenu par des colonnes évoque un possible préau chargé d’accueillir les
jeux des écoliers par temps de pluie ou de servir de salle à manger à ceux qui
habitaient trop loin pour rentrer chez eux prendre leur repas de midi.
Le Haut-Richet ne possède pas
d’équipement collectif. On peut donc le considérer comme un simple écart
du village. Mais paradoxalement, venant de Pissos, on y accède directement par
la route de Sore, les deux autres sites, plus au nord, étant desservis par des
chemins vicinaux à partir d’une patte d’oie.
Chapitre XVIII
La maison primitive
Le recensement
de population de 1926, réalisé par conséquent à peine plus d’une année après
l’installation de la famille, aurait pu nous fournir une information précieuse
sur ses membres présents et sur leur lieu de résidence ; malheureusement
les recensements d’alors ne prenaient pas en compte les familles étrangères, ce
qui en dit long sur le cas que l’on faisait d’elles. Tout se passe comme si
officiellement on considérait qu’elles étaient appelées à ne pas rester. Nous
sommes donc contraints, pour en savoir de plus, de tirer parti des souvenirs
des uns et des autres.
Compte tenu des indications de
distance fournies par les témoignages des anciens, il y a tout lieu de penser
que la maison se trouvait au Haut-Richet. Une visite sur place effectuée en
2007 nous offrit quelques pistes possibles dans l’identification des lieux
évoqués, sans nous donner l’assurance d’avoir trouvé l’exact emplacement de
cette première résidence de la famille Garcia Muñoz
dans les Landes.
Le Haut-Richet se présente comme
un vaste airial (clairière de la forêt landaise où poussent les chênes
et autres arbres utiles à feuilles caduques, dans laquelle se regroupait
l’habitat) composé de quatre maisons anciennes et de leurs dépendances. Deux de
ces maisons ont fière allure. Elles se présentent sous la forme d’un
parallélépipède recouvert d’un toit à quatre pentes, dont la partie arrière se
prolonge vers l’ouest, du côté des vents dominants, donc de la pluie, à la
façon d’un auvent qui prolonge l’ensemble. Le corps principal est à deux étages
dont la façade à l’est, très largement éclairée par quatre ouvertures à chaque
niveau, est ornée d’une corniche à motifs à chevrons. Sous l’enduit qui
s’écaille, on observe que le bâtiment est construit en briques pleines de pays.
Les deux autres maisons sont plus modestes et conformes à la métairie landaise
traditionnelle, avec leur toit à deux pentes et les colombages visibles sur la
façade.
Les différentes maisons étant
dépourvues de terrain particulier matériellement clos, les circulations à
l’intérieur de cet airial restent énigmatiques, sauf à imaginer qu’il
fallait emprunter le chemin de terre qui le longe et le contourne pour
atteindre les maisons les plus retirées. Cette disposition, propice à des
échanges quotidiens entre les habitants, a dû contribuer à atténuer le
sentiment d’isolement que ressentent nécessairement les nouveaux venus dans un
cadre qui leur est étranger et dont ils ignorent la langue. Quant à deviner
quelle maison attendait précisément les nouveaux venus, c’est devenu impossible,
mais il ne s’agit pas forcément d’une des plus modestes car, aux dires des
témoins, si elle était délabrée, elle n’en avait pas moins belle allure.
Lorsque la troupe eut atteint le
terme de son voyage, il fallut improviser. Les adultes firent un grand feu dans
l’âtre de la pièce principale et l’on s’accommoda comme on put autour du foyer
pour la nuit. La mère ne dormit guère, occupée à reboucher avec des moyens de
fortune les nombreuses gouttières du toit.
Rien n’était prévu pour
accueillir une aussi nombreuse nichée, aussi, dès le lendemain, notre
grand-mère s’appliqua à fabriquer des sommiers à l’aide de lattes de bois plus
ou moins bien équarries. Comme celles-ci n’étaient pas clouées entre elles,
elles avaient une fâcheuse tendance à se séparer et il n’était pas rare pour
les enfants de se retrouver en plein sommeil sur le sol, où, en désespoir de
cause, ils trouvaient plus commode de finir la nuit.
Les jours qui suivirent furent
occupés à acquérir les ustensiles et denrées indispensables. Le commerce du
village était tenu par monsieur Lagardère, tailleur de son état, dans une
maison bourgeoise du Brous qui existe toujours à l’entrée du chemin de Berdoy. Son établissement servait d’hôtel, désignation que
le bâtiment a conservée encore aujourd’hui parmi les habitants du hameau. Il
possédait une cabine téléphonique et une épicerie –le mot est peut-être un peu
fort- où l’on pouvait se procurer des produits de première nécessité.
Notre grand-mère ne connaissant
pas un traître mot de français, eut toutes les peines du monde à se faire
comprendre d’un commerçant pourtant complaisant. Pour surmonter cet obstacle
linguistique, elle eut recours à un stratagème. Elle se fit accompagner de
toute sa petite troupe, qu’elle lâcha dans la boutique avec mission de dénicher
les produits dont elle avait préalablement dressé la liste. Ainsi, devant les
yeux du commerçant ébahi et vaguement inquiet, on voyait tel ou tel des enfants
brandir triomphalement qui des bougies liées en faisceau, qui un paquet de riz,
et le reste à l’avenant.
Chapitre XIX
Au travail
Du côté de Pissos,
dans la haute lande, de nombreuses entreprises, généralement de petite
dimension, exploitaient les produits du terroir. La résine était transformée en
essence térébenthine dans des huileries dont les effluents dispensaient
un parfum entêtant en s’écoulant dans les caniveaux. La plus importante
jouxtait la gare de Pissos. Nos voyageurs n’ont pu manquer de voir, en
descendant de leur train, ses vastes hangars, sa haute cheminée et son
entassement de fûts. Le bois de la forêt de pins alimentait les scieries mais
aussi de plus modestes industries chargées de fabriquer des caisses, voire des allume-feu. Le sable était traité dans les tuileries, qui
fournissaient aussi des briques, également dans des ateliers de verrerie. Il y
avait aussi des poteries. Selon Félix Arnaudin,
Richet en posséda quatre au milieu du 19e siècle, mais elles avaient
disparu en 1925.
Ces industries à faible valeur
ajoutée recherchaient du personnel non qualifié. Elles offraient aussi des
emplois aux femmes, ce qui constituait une véritable aubaine pour une famille dans
laquelle l’élément féminin était très largement majoritaire, comme c’était le
cas de celle qui nous occupe.
Les grandes filles trouvèrent donc
tout de suite un emploi, d’autant que le père avait su négocier leur engagement
au préalable. Les deux aînées (18 et 14 ans), furent engagées par la tuilerie
de Richet. La troisième (12 ans), jugée trop chétive pour entrer en usine, fut
placée chez un boulanger-pâtissier de Pissos. La plus jeune des aînées (10 ans)
fut chargée de la garde de son petit frère, pour permettre à la mère
d’effectuer l’après-midi quelques heures en usine.
En somme, tous ceux qui étaient
en âge de travailler furent mis à la tâche. L’énumération qui précède se
traduit en éléments chiffrés qui ne laissent aucun doute sur les véritables
motivations qui avaient poussé une famille telle que la nôtre à l’émigration. De
fait, ses membres se sont organisés, dès leur arrivée, en une machine à générer
des revenus sonnants et trébuchants. Si l’on transpose cet état de fait en
termes comptables, on constate que cette maisonnée de neuf personnes, en
comptant les trois petits, percevait cinq salaires soit plus d’un salaire pour
deux bouches. Les gains n’étaient certainement pas mirobolants, mais, pour ce
qu’on en a su, ils n’étaient pas non plus misérables parce que chacun était
payé « à la pièce » et qu’aucune des filles ne lambinait à son poste,
trop heureuse, compte tenu de son jeune âge, d’accéder à une situation qui lui
conférait un statut d’adulte reconnue.
À supposer que celui des trois
filles ait été juste suffisant pour couvrir leurs propres frais, cela
signifiait que le père et la mère, tous deux salariés, n’avaient plus que quatre
jeunes enfants à nourrir, au lieu de sept, outre eux-mêmes. Ainsi, du jour au
lendemain, notre grand-mère se trouvait à la tête de rentrées financières non
négligeables, qui permettaient d’améliorer sérieusement l’ordinaire, mais aussi
d’effectuer des achats, meubles, ustensiles divers et vêtements, qui éloigneraient
définitivement le spectre du syndrome du gitan et du traumatisme qui
l’avait accompagné.
Notre grand-mère ne laissait à
personne le soin d’administrer ce pactole au point de se comporter en véritable
chef d’entreprise, avec les abus que cela peut entraîner. Nous avons quelques
échos selon lesquels elle se fit rabrouer par certain employeur, peu disposé à
lui remettre le salaire d’une de ses filles et préférant le donner directement
à l’intéressée. Celle-ci avait beau remettre la totalité de la somme à sa mère,
le plus souvent à la porte de l’usine, son amour-propre et sa fierté étaient
saufs. Hommage soit rendu au tact de ce patron.

Portrait de ma
grand-mère, Luisa, peu après son arrivée en France.
On mesure sans
peine la différence entre cette situation et celle que connaissait la famille
en Espagne. Elle était passée sans transition de l’économie propre à une
société rurale passablement archaïque, dans laquelle l’essentiel de la
subsistance provenait de la terre, certaines tâches annexes produisant le
numéraire nécessaire à la satisfaction des besoins autres qu’alimentaires, à
une économie fondée exclusivement sur la rémunération de la force de travail.
Le traumatisme découlant de cette révolution copernicienne dans le mode de vie
familial était compensé par l’impression d’abondance que produisait la présence
de l’argent, dans des proportions jusqu’alors inconnues. On était passé d’une
économie tributaire des maigres revenus, toujours aléatoires, rapportés par le père
ou la mère, à une économie collectivisée, qui assurait une certaine sécurité à
la cellule familiale et laissait entrevoir des possibilités d’investissements à
moyen terme. Bref, l’avenir n’était plus une source d’angoisse, mais offrait,
au contraire, quelques perspectives encourageantes.
Chapitre XX
Premier bilan
Indéniablement, l’installation
en France a représenté un choc pour ces émigrés ; les plus jeunes s’en
sont fait l’écho dans leurs vieux jours, mais il dut être ressenti comme tel
par tous les intéressés.
Sans doute était-on préparé aux
difficultés du voyage. On n’entreprend pas un tel déménagement vers un lieu
dont on ne connaît rien ou le peu que nous en disent les courriers du père
parti en éclaireur, sans s’attendre à de rudes difficultés, les premières
d’entre elles, et pas les moindres, étant d’avoir à parcourir une distance
énorme dans un moyen de transport inconnu. Mais une bonne dose d’imagination
permet d’appréhender les obstacles matériels qui se dressent devant vous et
vous prépare à supporter les écarts que la réalité oppose infailliblement au
schéma préconçu. Le voyage sera plus ou moins long, selon ce qu’on en attendait ;
le confort des wagons, différent de ce que l’on supposait ; les paysages
traversés, plus exotiques que prévu. Mais plus rude est la découverte d’une
réalité inattendue, surtout lorsqu’elle remet en cause vos convictions les plus
intimes. Cette réalité, c’est la façon dont les gens vous perçoivent et, par
leur comportement, vous rejettent.
De ce point de vue, notre groupe
fut gâté. Il y eut d’abord le refus de les admettre dans certaines pensions et
le mépris manifesté par ceux qui les traitaient de gitans. La réaction
du muletier de l’usine de Richet, pour anecdotique qu’elle soit, va dans le
même sens : la vue de la troupe l’effraie et il en oublie les ordres et
les plus élémentaires devoirs de solidarité. L’état de la maison dans laquelle
ils auraient à se loger, le manque de contact avec les voisins et les
commerçants accentuent encore cette impression de rejet, d’autant plus cruelle
qu’elle émane de personnes qui appartiennent aux mêmes couches de la population
qu’eux-mêmes : ouvriers, employés, petits commerçants (n’oublions pas que
la mère avait aussi été épicière à Arcos). Tous
perçoivent ainsi plus ou moins confusément que l’on n’abandonne pas impunément
son milieu originel et que l’on s’expose à être reçu dans le milieu nouveau
avec toute la méfiance que suscite un corps étranger, que l’on n’est pas
préparé à accueillir.
Ils prirent tout à coup
conscience de leur dénuement. « Nous étions très pauvres », comme le
disait une de nos tantes sur ses vieux jours pour résumer l’impression qu’elle
avait gardée de cette lointaine expérience. La famille n’était pas plus pauvre
à Richet qu’elle l’était à Utrilla et à Arcos, mais il lui suffisait de comparer sa situation
économique avec celle de la population landaise avoisinante pour percevoir le
fossé qui séparait le niveau de vie d’un prolétaire castillan avec celui de son
homologue landais. Ce fut le premier choc ressenti. L’enthousiasme mis au
travail fut la réponse la plus appropriée : il fallait accumuler le
maximum d’argent pour sortir de cet état.
Le second choc résulte de
l’accueil reçu. Nous en savons, à vrai dire peu de chose, et certains détails
comme le comportement de l’épicier Lagardère ou du pâtissier de Pissos indiquent
plutôt qu’il ne fut pas systématiquement désagréable. Mais nous devons nous
placer au-delà des faits, dans le domaine des impressions ressenties. La tante
déjà citée avait une formule qui donne beaucoup à réfléchir : « Nous
n’aimions pas le pain français ». Elle le trouvait trop
« aigre », revivant, sans le savoir, la triste expérience du pain
amer de l’exilé. On sait que certains aliments de base, non seulement le pain,
mais aussi d’autres denrées, telles que le tabac, le café, la charcuterie,
etc., sont étroitement liés à une référence gustative commune dans une société
donnée. Rien d’étonnant donc à ce que des castillans, habitués au pain ferme et
dense, pétri à la farine d’un blé soumis au rude climat du plateau, et cuit
dans des fours chauffés à la sapine résineuse, n’aient pas apprécié le pain
landais, plus léger et souvent ramolli par l’humidité ambiante. Peut-être le
palais de nos espagnols étaient-ils agressés par un excès de levain. Mais on
comprend bien que ce n’est pas seulement cela que dénonçait notre petite fille,
mais plutôt le refus d’admettre qu’il faudrait renoncer à des certitudes qui
paraissaient définitivement acquises pour se soumettre à une nouvelle loi, qui
n’avait pas d’autre légitimité que celle du fait accompli.
Chapitre XXI
Déménagements successifs
Cette situation
se prolongea six années durant. Elle ne connut que des changements mineurs qui
renforcèrent sa rentabilité sans affecter l’économie de l’ensemble. La famille
n’abandonna pas Richet mais, pour plus de commodité, se rapprocha du Brous en
profitant de la maison libérée par une autre famille espagnole près de la
tuilerie. Par ailleurs, les grandes filles connurent de nouvelles affectations
plus rémunératrices : la deuxième rejoignit la fabrique d’allume-feu de
Labouheyre. La troisième avait eu la plus mauvaise part puisqu’elle avait été
d’entrée de jeu séparée du groupe familial. Elle n’eut pas à se plaindre du
comportement des ses patrons pâtissiers de Pissos qui la traitèrent fort bien,
la laissant se gaver de gâteaux et lui donnant les premières notions de
français. Ils firent plus : ils lui prêtèrent une bicyclette pour
rejoindre sa famille le dimanche, ce qui, par parenthèse, lui valut le titre de
plus ancienne cycliste de la famille et peut-être même l’exclusivité de cette
pratique parmi ses sœurs du premier lit, car je ne me souviens pas en avoir vu aucune
sur ce moyen de locomotion. Lorsqu’elle fut jugée assez forte pour occuper un
emploi en usine, elle réintégra le bercail. Dès lors, avec sa sœur plus jeune,
elle travailla dans la fabrique d’allume-feu de Labouheyre puis la fabrique de
caisses d’Ychoux.
Au terme de ces six années, la
famille se transporta à Labouheyre où elle séjourna un an, puis à Ychoux pour
une nouvelle année. Signe d’une exigence née d’une situation plus aisée :
on préférait habiter et travailler dans des petites villes qui comptaient plus
d’un millier d’habitants que dans le modeste village de Richet, qui n’en
comptait que 275 habitants lors du recensement de 1912. Mais, quant au fond,
rien n’était changé. On restait fidèle à la Haute-Lande et à ses industries
dominantes et le type de travail restait substantiellement le même.

La famille au grand complet à l’occasion du mariage de
la fille aînée, Catherine.
Les deux aînées épousèrent des
compagnons de travail qui appartenaient tous deux à la même vague récente
d’émigration espagnole. L’un venait d’Alconchel de Ariza, village
voisin d’Arcos de Jalón, l’autre de Nerpio, dans la province d’Albacete. Le lieu d’origine des
deux époux montre la diversité des foyers d’émigration espagnols : à côté
du plateau castillan des Garcia Muñoz et de leur
futur gendre Escolano, on trouvait aussi la façade méditerranéenne,
aux confins de La Manche la plus orientale et de la province de Murcie. Comment
ne pas s’étonner que ce manchègue ait choisi de rejoindre pour émigrer une
région de France diamétralement opposée à la sienne, alors qu’il lui aurait été
si simple de se rendre en Languedoc ou en Provence ? Un argument de plus à
ajouter à l’hypothèse de filières de recrutement landaises.
Cette diversité géographique ne
doit pas cacher que ces émigrés avaient en commun d’être des paysans et de
venir de zones particulièrement déshéritées de la Péninsule. De ce point de
vue, le village de Nerpio n’est pas moins perdu, près
de la source du fleuve Segura au milieu de la sierra de Las Cabras, que ne l’étaient
Oseja ou Viver de la
Sierra. Ces hommes et leur famille avaient connu aussi la faim et une totale
absence de perspectives dans des régions inhospitalières et dépeuplées.
En bons ruraux, ils n’aspiraient
pas à s’installer dans une ville, où ils auraient eu du mal à se loger et où
ils auraient trouvé difficilement un travail rémunérateur par manque de
qualification. S’installer à la campagne leur convenait mieux : ils se
sentaient moins dépaysés et s’intégreraient plus aisément dans des fabriques au
fonctionnement peu sophistiqué, plus proches de l’atelier que de l’usine. Ils
pouvaient aussi cultiver un potager grâce auquel ils amélioraient l’ordinaire
et retrouvaient des gestes acquis depuis leur plus jeune âge.
À travers ces mariages entre jeunes
gens qui avaient partagé la même expérience de vie, on perçoit les carences
d’une assimilation inaboutie. Il est vrai qu’il ne s’est écoulé qu’un petit
nombre d’années entre la rupture de l’exil et cette nouvelle étape de la vie du
groupe familial. Il n’en reste pas moins que ces mariages « entre
soi » attestent que la mutation vers une complète assimilation n’est pas
complètement achevée. Même si la structure familiale de départ donne les
apparences d’une implosion irréversible, il aurait pu advenir que les jeunes
couples s’agrégent au noyau initial, celui de la mariée ou celui du marié, au
moins pendant un certain temps. De fait, connaissant l’autorité naturelle de
notre grand-mère, on soupçonne qu’elle tenta, sans succès, de maintenir sur les
jeunes couples une autorité analogue à celle qu’elle exerçait sur ses filles
célibataires. Mais on est obligé de constater que les deux filles mariées
choisirent un relatif éloignement de la cellule de départ.
Le mariage de ces deux aînées
est-il compatible avec un éventuel retour vers l’Espagne ? On l’ignore.
Notre père nous a souvent dit qu’il avait envisagé cette hypothèse mais que
l’éclatement de la Guerre Civile en 1936 (soit deux ans après le mariage de nos
parents) lui en avait fait abandonner l’idée. Les deux filles mariées et leur
mari ont-elles eu la même idée ? On peut en douter. Il est plus logique de
penser qu’en fondant un foyer, l’une à Ychoux, l’autre à Labouheyre, les deux
aînées envisageaient de s’installer à demeure dans une région qui leur était
devenue familière et où elles savaient pouvoir mener une vie décente bien que
laborieuse.
Les deux aînées étant « casées »,
les deux suivantes, qui avaient fêté leurs vingt ans, envisageaient à leur tour
le mariage comme une proche éventualité. La plus âgée des deux avait même déjà
un soupirant attitré, qui était de surcroît considéré d’un bon œil par la mère,
condition indispensable à la concrétisation de l’union. Les deux familles,
celle de la fiancée et celle du fiancé, se connaissaient, sans se fréquenter
vraiment, depuis Arcos de Jalón, qu’elles quittèrent
à quelques semaines de distance, comme il a été dit plus haut pour des
destinations très proches, Richet pour l’une, Trensacq puis Morcenx pour
l’autre.
Chapitre XXII
Dislocation
La décision de
s’installer à Dax, prise en 1933, traduit un bouleversement dans la stratégie
familiale. La véritable rupture se concrétise lorsque le groupe familial
s’éloigne en laissant derrière lui à leur destin particulier deux de ses filles
désormais engagées dans une nouvelle aventure avec mari et enfants. Les deux premiers
nés de la nouvelle génération, Pierre et Eugène Escolano,
virent, en effet, le jour au début des années trente. Symboliquement, la
manifestation lo plus évidente de ce changement
radical est la célébration dans la nouvelle résidence de la famille, à Dax, le
28 décembre 1934, du mariage de la troisième des filles, qui avait été projeté
et arrêté entre Labouheyre et Morcenx.
Economiquement parlant, le choix de
l’abandon de la Haute-Lande est discutable. Notre père gagnait plus largement
sa vie à abattre et traiter le bois de pins, que n’importe quel ouvrier en
poste dans une usine. Il lui arrivait d’arrêter sa semaine le samedi à midi et
d’avoir assez d’argent pour passer la fin de semaine à Arcachon en aimable
compagnie. Du côté de Saint-Symphorien, le sauternes était appelé « vin
des gemmeurs », tant les résiniers en consommaient d’abondance.
Il semble que ce changement fût
imposé par les filles aînées, qui souhaitaient un autre mode de vie. En
rejoignant une vraie ville, elles pensaient pouvoir mener une vie moins rude et
aussi mieux y scolariser leurs enfants à venir. Ma mère nous a toujours dit
qu’elle désirait avant tout que ses enfants aillent à l’école.
Pourquoi avoir choisi Dax et non
Mont-de-Marsan, pourtant plus proche de la Haute-Lande ? Probablement à
cause de la perspective d’une embauche à l’usine Boulart.
Cette nouvelle et importante fonderie, récemment construite au bord de la voie
ferrée, près de la halte de Peyrouton, succédait aux
forges historiques d’Abesse, à Saint-Paul-lès-Dax. Elle
venait compléter le pôle industriel du quartier de La Torte, au sud de la
ville, déjà constitué autour de la mine de potasse et de l’usine de traitement
du sel gemme (les Salines). Lors de l’inauguration de son nouveau site, elle
avait lancé une grande campagne de recrutement qui eut des échos jusque dans la
Haute-Lande. Le père, les deux filles aînées et le futur mari de la première,
notre père, répondirent ensemble à cet appel et furent embauchés.
La fonderie Boulart
avait construit le long de l’usine une cité ouvrière. C’est là que la famille
trouva à se loger dans un premier temps. Puis notre père, ayant été mis à pied
pour avoir menacé de mort le contremaître qui l’avait traité de « sale étranger »
(lui qui était belge !), dut quitter l’usine. Il trouva un nouvel emploi
dans les Salines voisines où son beau-père le suivit, par solidarité ou par
obligation. Les grands-parents perdirent leur droit au logement mais emménagèrent
à peu de distance de là, en contrebas de la route de Saint-Pandelon, dans une
petite bâtisse, la ferme Largileyre, qui maintenait
dans ce faubourg industriel de la ville un témoignage, désormais saugrenu, de
l’habitat rural chalossais, avec ses colombages, sa
treille et son toit de vieilles tuiles qui touchait presque le sol. Pour les
petits-enfants, cette maison présentait l’indéniable avantage de se trouver à
deux pas d’un petit bois au centre duquel poussait un chêne imposant, dont les
branches se prêtaient aux escalades des plus jeunes.
Chapitre XXIII
Une vie d’errance
Si l’on fait le
compte des lieux de résidence, villes ou villages, de notre grand-mère entre la
date de son premier mariage et celle de son installation à Dax, on aboutit au
chiffre conséquent de neuf : Gotor, Oseja, Viver, Utrilla,
Arcos, en Espagne ; Richet, Labouheyre, Ychoux,
Dax, en France. Neuf déménagements en 30 ans, de 1901 à 1933. Cette vie
d’errance cadre mal avec l’image que l’on se fait habituellement de l’immigré,
surtout lorsqu’il provient d’un milieu rural. On l’imagine plutôt quittant son
village natal pour rejoindre sans transition son nouveau lieu de résidence.
Peut-être cette vision nous est-elle inspirée par certaines migrations
intérieures, comme celle qui pousse des habitants des départements et
territoires d’Outre-Mer à rejoindre la métropole où les attend un point de
chute généralement préparé par des parents déjà installés, mais elle dénote
surtout une méconnaissance profonde des modalités variées que connaît le
phénomène de l’émigration.
Il faut, cependant, faire une
différence entre les déménagements effectués en Espagne et ceux de France. Les
premiers semblent imposés par des échecs répétés et s’apparentent à une fuite. Il
faut beaucoup de complaisance pour trouver le moindre signe d’une réussite dans
les changements successifs qu’Eusebio Garcia imposa à
sa famille. Aboutir à Viver ne représente pas
précisément une apothéose. Il serait d’ailleurs injuste d’en rendre responsable
ses talents de charron ; peut-être subissait-il déjà les effets du mal qui
va l’emporter et n’avait-il plus la force requise pour accomplir pleinement un
métier particulièrement dur. En revanche, la malheureuse expérience d’Arcos est sans doute imputable à l’incapacité du grand-père
Alejandro à subvenir aux besoins de sa famille. Le départ en France apparaît donc
comme une suite logique, même s’il représente un saut dans l’inconnu. Ce saut
dans l’inconnu équivaut à la reconnaissance tacite d’un échec.
Les changements de résidence en
France sont d’une toute autre nature. On y décèle les marques d’un progrès continu.
Richet représente le point le plus bas de cette ascension, mais offre des
perspectives intéressantes pour l’avenir. Sa ruralité a dû rassurer les
nouveaux venus. Elle leur a ménagé une transition vers d’autres lieux plus
contraignants en matière d’intégration sociale. La cellule familiale, encore
complète, assure une stabilité appréciable dans cet environnement humain et
professionnel nouveau, dans lequel les tentations sont rares. Pendant ces six
années, la situation du groupe comme celle des individus qui la composent
s’améliore. L’argent rentre, les enfants grandissent. Les aînées atteignent
l’âge adulte, les plus petits se socialisent peu à peu, prémisse d’une
intégration future et réussie. Les étapes ultérieures démontrent que ce cadre
initial ne suffit plus, c’est-à-dire, en fin de compte, que le groupe ne subit
plus, que ses membres s’offrent même le luxe de projets d’avenir plus ou moins
ambitieux. Que cette ambition soit modeste, que la réussite touche inégalement
les uns et les autres importe peu. Il ne faut retenir que le saut qualitatif
que la nouvelle situation entraîne.
Il existe une seule ombre au
tableau. Si chacun des enfants profita, à des degrés divers et selon une
chronologie différente, de cette évolution favorable, les parents, eux, font
figure de laissés pour compte. L’éclatement du groupe familial finit par leur
être fatal. Livrés à eux-mêmes lorsque leurs enfants eurent « pris un état »,
ils perdirent leur autonomie. Notre grand-mère ne s’accommoda jamais pleinement
de cette situation d’assistée.
Chapitre XXIV
De la constance dans
la difficulté
On aurait pu
penser que l’installation en ville, après dix années ou presque de ‘galère’
dans la forêt, se serait accompagnée d’un changement dans la vie du groupe
familial et peut-être aussi d’une amélioration des conditions de vie grâce à
l’argent accumulé. Ce ne fut vrai qu’en partie.
Dans les deux premières années
dacquoises, les deux filles aînées se marièrent et quittèrent à leur tour le
noyau familial pour créer leur propre foyer. Désormais, la famille se réduisait
au couple des parents et à ses trois enfants. Bref, on se retrouve uniquement
entre Muñoz, puisque les filles Garcia ont pris leur
envol. Les salaires perdus du fait de l’éloignement des grandes a créé un
manque à gagner apparemment insupportable. Ce vide sera donc compensé par l’apport
des deux petites qui, pour cette raison, furent retirées de l’école. Ce
traitement, qui reproduit à l’identique celui qu’avaient subi les aînées,
semble avoir été, cette fois, mal accepté par les intéressées, qui s’étaient
sans doute faites à l’idée de mener une vie plus conforme à celle des petits
français de leur âge. D’où ce sentiment d’une fatalité qu’exprimait l’une
d’entre elles, dans ses vieux jours : « nous étions très
pauvres ». Une pareille constatation n’était pas de nature à faire oublier
que le chemin d’une assimilation véritable et profondément souhaitée risquait
encore d’être long, que, d’une certaine façon, elles n’y parviendraient que lorsque
le moment serait venu où chacune pourrait choisir sa propre voie, à l’image des
aînées qui, peu ou prou, semblaient avoir dépassé, grâce au mariage, un statut aussi
peu enviable.
En attendant, il fallait
travailler ferme. Le benjamin lui-même ne fut pas épargné, bien que sa mère lui
eût porté une affection particulière du fait de sa difficile survie à la
naissance, et aussi parce que c’était le seul garçon et qu’il était le dernier.
À peine avait-il obtenu le certificat d’études primaires, qu’on l’engagea dans
l’épicerie de gros du Friand. Or, il était si chétif que certains des
transports qu’on lui confiait dépassaient ses forces. Une fois devenu, du fait
de son seul talent, le gérant de cette importante entreprise, il aimait à
évoquer la terrible épreuve, consistant, pour un enfant de son âge et de son
gabarit, à transporter un bidon d’huile posé sur le porte-bagages avant d’une
bicyclette, de toute façon trop grande sur lui. Il devait s’appuyer de toutes
ses forces sur la selle afin d’éviter que le tout ne bascule vers l’avant sous
l’effet du poids du bidon. Tout le long du chemin, il serrait les dents et
pleurait à chaudes larmes, de fatigue, de rage et d’humiliation mêlées.
Pour les petits-enfants, le
souvenir de nos grands-parents est définitivement associé à cette image de la
pauvreté. Tout au long de leur vie active, ils ne durent de s’en sortir qu’à
l’absence d’ambition et de désirs autres que ceux qu’implique une stricte
survie, et, sur leurs vieux jours, à l’aide de leurs enfants, du moins de ceux
qui étaient en état de leur en apporter.
Chapitre XXV
Les étapes vers
l’assimilation
À l’occasion des débats autour de l’immigration, il arrive que l’on entende
remettre en cause les principes de l’assimilation ou de l’intégration, au nom
de la conservation d’une identité d’origine. J’ai déjà dit plus haut que, pour
les cousins, c’est-à-dire la génération qui est née en France, la question ne
s’est guère posée ; pour la génération précédente, soit les enfants du
second lit, apparemment pas non plus. Pour les plus âgées, un certain clivage
semble avoir existé entre les deux aînées, qui sont restées dans la Haute-Lande
et ont continué à vivre dans un milieu à dominante espagnole et les deux
suivantes, qui ont vécu leur vie d’adulte en ville. Avant de traiter des
facteurs qui ont le plus contribué à cette assimilation, je voudrais faire état
d’une expérience qui a beaucoup contribué à me faire comprendre la mentalité de
nos parents à ce propos.
C’est à une confidence de notre
mère que j’ai compris combien l’adhésion de mes parents à leur patrie d’accueil
était sincère. Lors d’une de mes visites, je fus étonné de la voir enjouée et
diserte, ce qui contrastait radicalement avec cet air absent et las qui fut le
sien pendant ces longues années d’hypocondrie qui précédèrent sa mort. Elle se
flattait d’avoir eu assez d’appuis dans les services de la mairie pour obtenir
à son profit, et accessoirement à celui de notre père, une entorse à la règle
qui imposait d’enterrer désormais les défunts dans une annexe suburbaine du
cimetière communal. Je découvris alors que la perspective de cet exil définitif
la chagrinait et je crus, un moment, que ce pouvait être la cause de sa
tristesse habituelle. Toujours est-il qu’elle « avait fait des pieds et
des mains » pour obtenir une concession dans « le cimetière de la
ville », non loin du centre et, pour ainsi dire, à quatre pas de sa
maison. Elle n’était pas peu fière de son succès car les démarches lui avaient
valu des manifestations de respect de la part des responsables du service qui
lui donnaient un avant-goût de tout le bien que l’on dirait d’elle, une fois
qu’elle serait partie. En somme, elle avait eu la joie d’entendre, de son
vivant, prononcer son éloge funèbre par des gens dont la compétence était
indiscutable. Mais, plus que tout, elle avait acquis droit de cité dans le
quartier où, seuls, résident ceux qui forment l’élite de la communauté. On ne
pourrait rêver plus complète assimilation.
Chapitre XXVI
L’école
Une seule
institution se montra accueillante, l’école. Dans un pays où on ne prenait même
pas la peine de recenser les nouveaux venus, elle seule fit une place à ces
étrangers et, en leur donnant la possibilité d’acquérir la langue française,
leur permit d’envisager qu’un jour, ils ne seraient plus considérés comme des
intrus.
Une fois la famille installée à
Richet, les deux petites, âgées respectivement de 7 et 5 ans à leur arrivée,
furent scolarisées à l’école du Brous. Elles furent les premières de la fratrie
à bénéficier d’une scolarisation régulière, car les aînées en avaient été
privées. Un changement d’attitude aussi radical chez des personnes qui avaient
vécu jusque là dans un pays où la scolarisation des enfants n’était pas
universelle démontre, s’il en était besoin, combien les principes énoncés par
les lois laïques – enseignement primaire gratuit et obligatoire de 6 à 12
ans – étaient entrés non seulement dans la législation mais aussi dans les
mœurs de la France d’alors. Il était exclu que quiconque y échappât.
Pour en avoir souvent parlé avec
nos parents, nous pouvons témoigner de la satisfaction que leur produisait le
fait d’avoir pu offrir à leurs enfants une instruction qu’ils auraient
eux-mêmes voulu recevoir. Une des raisons de leur attachement à leur pays
d’accueil tenait principalement à ce fait qu’ils considéraient comme le critère
premier pour apprécier le degré de civilisation d’un pays : il y avait
ceux qui fondaient l’ascension sociale sur le mérite acquis dans des écoles
ouvertes à tous et ceux qui le réservaient à une élite du sang ou de l’argent.
En somme, le principe de ‘l’école pour tous’ jouait, à l’époque, un rôle
équivalent à celui qu’on accorde aujourd’hui, non sans quelque confusion, à
celui de démocratie.
Si les trois petits eurent droit
à une scolarité, celle-ci fut interrompue pour les deux filles. Elles n’eurent
pas le loisir d’aller jusqu’au terme de l’école primaire. Dès avant le
déménagement à Dax, la plus grande dut quitter l’école pour travailler à la
fabrique de caisses. Une fois la famille installée à Dax, elle sa cadette
furent placées à l’épicerie Le Friand, puis dans une fabrique de balais. Seul
le petit dernier put poursuivre jusqu’au certificat d’études, qu’il obtint
d’ailleurs brillamment. Faut-il attribuer ce traitement de faveur au fait que
c’était un garçon ou à une intégration plus forte ? Les deux facteurs ont
sûrement joué. Mais les parents n’avaient ni les moyens ni probablement même
l’idée de lui permettre de poursuivre ses études au-delà. Il faudra attendre
l’évolution des mentalités et de la politique d’éducation pour que cette
possibilité soit offerte aux enfants de milieux aussi modestes. La génération
suivante sut en profiter pleinement.
Chapitre XXVII
Apprentissage et pratique du français
Les bienfaits de
la fréquentation scolaire se mesurent facilement au degré de maîtrise que ses
premières bénéficiaires acquirent du français. Les deux plus jeunes des filles
ignoraient la langue tout autant que leurs parents et que leurs sœurs aînées,
mais elles apprirent à la manier sans enseignement spécifique, au simple
contact de leurs camarades de classe et à l’écoute de leur maître, pendant leur
courte scolarisation. Ce bain linguistique a creusé un véritable fossé entre
les plus jeunes et leurs aînés, que nous, enfants de la génération suivante,
avons pu apprécier directement.
Nos grands-parents parlaient
assez le français pour se faire comprendre mais cette connaissance se limitait
aux mots indispensables à la communication et excluait de fait la maîtrise de
la phonétique et de la syntaxe. Chez eux, nulle concurrence entre le système du
français et celui de l’espagnol, ce dernier restant dominant. Pour illustrer ce
fait, on raconte une anecdote sur notre grand-mère. Elle aimait marchander, y
compris dans les magasins à prix affichés, à la grande honte de ses filles
chargées de l’accompagner dans ses achats. Un jour, elle s’arrêta devant un
étal, prit un air intéressé et s’adressa à la vendeuse : « Combien
ça ? Trente ? ». « Non, madame, quatre-vingts ». Elle
se pencha pour scruter le chiffre, se redressa puis, s’éloignant avec un port
de reine, asséna à son interlocutrice un méprisant : « Oh, quel houit más mal fait »
(littéralement : « quel huit plus mal fait »), reproduisant
ainsi une construction superlative du meilleur effet en castillan, mais qui dut
paraître incompréhensible à la marchande française.
Les deux aînées étaient arrivées
trop âgées pour acquérir un bon français, d’autant que, une fois mariées,
l’essentiel de la communication avec leurs voisines campagnardes se ferait en patois
local. L’emploi occupé par la troisième, notre mère, chez des patrons français
la plongea dans un bref bain linguistique dont elle sut tirer parti. Seules
quelques associations de phonèmes lui résistèrent jusqu’au bout, tels le sp– initial (« espécial »
pour « spécial »), le –x- intervocalique prononcé –ts– (« tatsi » pour
« taxi »). En outre, certains noms propres se refusaient à elle, au
grand bonheur de ses petits-enfants chez lesquels ses tentatives toujours
vouées à l’échec provoquaient une hilarité irrépressible, qu’elle partageait
d’ailleurs volontiers avec eux. C’était le cas de « Chaban-Delmas »
et de « Servan-Schreiber » et, plus généralement, de l’association
entre sifflantes, palatales (chuintantes) et nasales.
Sa cadette connut une autre sorte
de bain linguistique en épousant un français, mais finit par se remarier avec
un combattant de la Guerre Civile qui se montra toujours embarrassé par la
pratique de la langue de son pays d’accueil. Ainsi, les quatre sœurs aînées
subirent, en quelque sorte, le handicap de vivre avec des conjoints espagnols.
Leur meilleure connaissance du français leur conférait un statut de
porte-parole du couple, du moins tant que leurs enfants ne furent pas en état
de s’en charger, mais la pratique quotidienne d’un espagnol de plus en plus
approximatif avec le temps ne leur permit pas d’atteindre la qualité
d’expression auxquelles elles auraient peut-être pu prétendre si elles avaient
vécu dans un contexte exclusivement ou majoritairement français.
Les trois plus petits enfants du
couple ne connurent pas ce handicap. Ils avaient émigré assez jeunes pour
acquérir un bon niveau de langue française ; de plus, ils se marièrent à
des conjoints français, dont aucun ne pratiquait l’espagnol. Pour eux, le
système du français déplaça celui de l’espagnol qu’ils avaient reçu dans leur
petite enfance et finit par se substituer à lui. Même s’ils continuaient à
pratiquer l’espagnol avec leurs parents, leur connaissance de cette langue
s’appauvrit irrémédiablement. Que je sache, ils n’ont jamais cherché à l’employer
avec leurs enfants, contrairement à leurs aînées qui, à la maison, utilisaient
spontanément leur langue maternelle, contraignant leurs enfants à une très
salutaire gymnastique linguistique et intellectuelle.
La cassure déjà signalée entre
les enfants des deux lits s’est donc perpétuée, sous l’article de la langue,
dans la génération suivante. Cette différence entre cousins n’entraîna aucun
clivage entre nous, mais elle compliqua quelque peu la communication entre les petits
cousins ‘français’ et leur grand-mère. Leur connaissance de la langue de
Cervantès (et accessoirement de celle de leur mère) se limitait à quelques
formules péremptoires que la mémé assénait d’entrée de jeu pour éviter tout
excès, à ses yeux du moins, de la part de ses petits-enfants. « Siéntate y estate quieto » (« Assieds-toi et reste
tranquille ») ; « come, calla y no te manches »
(« mange, tais-toi et ne tache pas tes vêtements ») représentaient à
peu près tout le bagage linguistique espagnol qu’ils avaient reçu de leur
grand-mère. Ils en riaient. Nous qui avions une meilleure connaissance de la
langue espagnole et pouvions, de ce fait, dialoguer avec notre grand-mère, ne
pouvions nous empêcher de considérer cette lacune de nos petits cousins exclusivement
francophones avec un certain sentiment de supériorité.
Chapitre XXVIII
De l’usage des prénoms
Un autre trait
d’assimilation lié à la langue, et qui semble avoir peu intéressé les
spécialistes jusqu’ici, concerne l’usage des prénoms. Contrairement à
l’exécrable tendance actuelle qui consiste à donner à ses enfants des prénoms
sur le seul critère de la « joliesse », alors qu’il ne s’agit, le
plus souvent, que de céder aux injonctions d’une mode, souvent télévisuelle, à
l’époque, on veillait encore à fournir au nouveau-né l’occasion de s’identifier
à une tradition géographique ou familiale, à un lieu ou à un ancêtre proche ou
lointain, lui fournissant ainsi un « repère » fort utile pour sa
socialisation et pour la formation de sa personnalité. L’inconvénient de ce
système, qui a, par ailleurs, infiniment d’avantages, est qu’il n’est pas
toujours exportable en l’état. La culture anglo-saxonne, à dominante
protestante, affectionne les prénoms bibliques. Les cultures latines, marquées
par le catholicisme, lui préfèrent des noms tirés du martyrologe.
Le passage de la langue espagnole
à la française se fait généralement par une traduction pure et simple du
prénom : ‘Antonio’ donne ‘Antoine’ ; ‘Catalina’, ‘Catherine’ ;
‘Gregorio’, ‘Grégoire’, etc. Les cas d’homonymie obligent à apporter quelques
aménagements à cette règle. Pour distinguer le fils du père, notre grand-père
était désigné par le prénom, Alejandro, et son fils par le diminutif, Alejandrito. Rien que de très naturel. Plus intéressant est
le fait que notre oncle ait eu droit à la traduction, Alexandre, alors qu’il ne
nous serait jamais venu à l’idée d’appeler son père autrement qu’avec la forme
espagnole. Seule concession à la francisation, nous appelions nos
grands-parents, à la mode landaise, « pépé » et « mémé »,
ce qui marquait une évidente rupture avec la pratique espagnole. En revanche, nos
grands-parents paternels avaient conservé la désignation espagnole : abuelito et abuelita.
J’ignore pourquoi, mais je suppose que ce fut un choix de ces derniers, alors
que mes parents maternels n’eurent aucune exigence de ce point de vue.
Cependant, nos deux cultures
présentent certaines différences. L’exemple le plus flagrant concerne les
prénoms féminins. Si, dans nos deux pays, les petites filles portent souvent le
nom de Marie, en France celui-ci est associé à un autre prénom, alors qu’en
Espagne il est associé à un avatar de la Vierge. De ce côté des Pyrénées, on a
des Marie-Louise, Marie-Anne, voire Marie-France, alors que, de l’autre côté,
on trouvera des María de la O, María de la Concepción, María de los Dolores.
Ces différences, lorsqu’elles
sont perçues comme incompatibles avec les pratiques de la langue d’accueil,
font l’objet d’une substitution pure et simple, selon des modalités variées. Le
premier prénom peut disparaître au profit du second. Le phénomène existe dans
la première génération : ‘Victoriana Luisa’
devient ‘Louise’. On le trouve aussi dans la suivante, celle des cousins, mais
il est vrai qu’elle concerne l’aîné parmi les cousins, c’est-à-dire le plus proche
de la tradition d’origine (il est né en 1929) : Gregorio Pedro n’était connu
de nous que sous le prénom de Pedro (ou Pierrot). En cas de prénom féminin
composé, l’avatar de la Vierge disparaît : ‘María de la Consolación’ devient ‘Marie’ tout court ; il peut
aussi se maintenir au prix d’une transposition, ‘Consuelo’. C’est le cas d’une
de nos tantes. La première solution est réservée à ses neveux (‘tatie Marie’)
ou à ses sœurs, lorsqu’elles lui adressent la parole en français (‘Marie’). En
revanche, lorsqu’elles s’adressent à elle en espagnol, elles l’appelleront
‘Consuelo’.
Ces subtilités, qui font tout le
charme d’une conversation, dénotent le refus de sacrifier sur l’autel de la
facilité en généralisant une formule unique. Elles démontrent aussi que le
‘biculturalisme’ n’a pas complètement disparu dans ces familles d’immigrants,
puisque l’on tente de faire coexister des pratiques différentes en tenant
compte du contexte de leur réalisation. Reste la substitution pure et simple
d’un prénom jugé inadaptable à la nouvelle réalité. C’est le cas de ‘Saturnina’ qui s’est traduit par ‘Aline’, dans le but, sans
doute, de ménager une similitude à travers une terminaison traitée à l’instar
d’une rime.
Ce traitement du prénom est assez
généralisé pour que nous ayons pu aussi l’observer dans notre famille
paternelle. Ce qui est plus surprenant, c’est que, dans la famille maternelle,
il n’est pas absent non plus de la génération des petits-enfants, dans laquelle
on trouve certains écarts surprenants entre l’état-civil et le prénom
d’usage : Eugène pour Eusebio (qui était pourtant
le prénom de son père), Antoinette pour Consuelo, André pour Antoine.
Il est vrai que tous ces exemples, et il n’y en a pas d’autres, sont
circonscrits aux enfants des deux filles aînées, c’est-à-dire celles qui ont
conservé, du fait de leur âge lors de l’émigration mais aussi de la nationalité
de leurs conjoints, la plus grande proximité avec le passé espagnol.
Il n’en reste
pas moins que nous n’avons pu percer à quel moment ni sous quelle forme s’est
réalisée cette conversion des prénoms. S’est-elle faite de façon concertée, par
exemple sous l’influence d’un parrain ou d’une marraine ? À la demande des
enfants ? À la longue, par l’usage ? Il est fascinant de constater qu’un phénomène, somme toute, aussi courant conserve encore
son mystère, et réjouissant de voir combien les relations sociales, par leur
seule dynamique, peuvent s’enrichir, pour peu qu’elles ne soient pas laminées
par une ‘mondialisation’ fondée sur une inculture généralisée.
Chapitre XXIX
Portraits
Notre grand-mère
était aussi coquette que notre grand-père Muñoz était
négligé. L’une inspirait le respect et parfois même la crainte ; l’autre
attirait la sympathie et une certaine commisération. L’une était habile de ses
mains ; l’autre, inapte aux travaux manuels. Elle avait le sens de
l’autorité ; lui, en était dépourvu au-delà de l’imaginable. Ce couple apparemment
aussi mal assorti, imposé par les circonstances, reste pourtant dans mon
souvenir indissolublement lié.
Le grand-père Muñoz
n’était pas armé pour faire face aux dures réalités de la vie. On doit à la
vérité de dire qu’il ne se plaignait pas du triste sort que cette incapacité
congénitale entraînait pour lui. Il se contentait de peu et savait tirer parti
de ses handicaps. Son fils nous racontait que, malgré le mal qu’il se donnait,
il n’est jamais parvenu à allumer la cuisinière avant de partir, aux aurores,
au travail et qu’il a donc, par tous les temps, pris son café au lait froid. La
perte d’un œil l’empêchait de voir le côté négatif des choses, mais ne lui
laissait rien perdre de ce qui méritait être vu. Une atrophie congénitale
l’avait à peu près privé du sens du goût. Il en profitait pour ingurgiter les
bas morceaux et les parties les plus grasses des viandes, qu’on lui réservait
systématiquement. Il poussait la complaisance jusqu’à faire mine de les apprécier
et de les préférer aux meilleurs morceaux. Il était, par ailleurs, assez
discret pour ne pas manifester publiquement la peine qu’il pouvait éprouver à
voir les conséquences que ses carences entraînaient pour les siens. Il
essayait, tant bien que mal, d’en compenser les effets en se montrant toujours
aimable, gai, quitte à s’interposer lorsque notre grand-mère, qui était douée
d’un caractère peu porté à l’indulgence, prétendait sévir contre tel ou tel de
ses enfants, au risque de prendre au passage quelque réprimande ou même quelque
bourrade égarée.
Notre grand-mère avait les
qualités requises pour supporter dignement un sort aussi difficile. Elle
jouissait d’une résistance physique à toute épreuve, même si, sur ses vieux
jours, elle abusa de l’aspirine qui était, à l’entendre, le seul remède avec
les infusions de tilleul capable de lui faire oublier ses rhumatismes et ses
maux de tête. Elle ne manquait pas de talent ni de ressources dans le domaine
pratique. On raconte qu’il lui suffisait de voir un pull-over sur une personne
croisée dans la rue, quitte à se retourner pour mieux la voir de dos, pour en
tricoter un semblable à son retour à la maison. Grâce à ces dons, les enfants
étaient habillés à peu de prix. Elle n’avait pas d’états d’âme, ce qui lui
conférait un moral de fer. On ne se rappelle pas l’avoir vu pleurer, peut-être
parce qu’elle avait connu, en ce funeste Noël 1914, le malheur dans sa réalité
la plus cruelle et qu’elle avait pris l’habitude, depuis, d’apprécier les coups
du sort en les rapportant à cette référence indépassable. Son sens des réalités
lui épargnait les illusions et lui faisait apprécier, dans toute leur étendue,
le moindre bienfait accordé par les circonstances.
Elle comptait aussi sur le
recours d’une foi religieuse et d’un panthéon très personnel pour la protéger
des menaces extérieures. C’est ainsi qu’elle ne s’endormait jamais sans
adresser à haute voix une prière à sainte Monique, que notre cousine qui hérita
ce prénom a retenue :
Santa Mónica gloriosa
madre de san
Agustín,
a Dios
le entrego mi alma
cuando me voy
a dormir.
Si me duermo, despertadme,
si me muero, perdonadme
« Sainte
Monique glorieuse
mère de saint Augustin
je remets mon âme à Dieu
lorsque je vais m’endormir.
Si je
m’endors, réveillez moi,
si je meurs, pardonnez-moi ».
Ceux de ses petits-enfants qui
partageaient occasionnellement sa chambre ou même son lit, craignant de la
trouver morte au réveil, ajoutaient leurs propres prières à Dieu, afin qu’Il
eût la bonté de repousser l’inévitable échéance à une date ultérieure.
Il est vrai qu’elle passait pour
ne pas dédaigner certaines forces occultes auxquelles elle croyait. Les plus
grands le savaient. On leur avait rapporté certaines scènes s’apparentant à des
crises d’hystérie collective mal faites pour les rassurer sur ce chapitre.
Épilogue
À la fin des
années trente, à peine plus de dix ans se sont écoulés depuis cette pluvieuse
soirée de janvier 1925, où la famille au grand complet débarquait sur le quai
de la gare de Pissos. Pourtant il ne subsiste plus rien ou presque de la
situation de départ. La cellule familiale primitive a éclaté et s’apprête à se
vider du reste de sa substance, puisque les deux filles du couple Muñoz se seront mariées au début de la Seconde Guerre. Seul
le petit dernier restera auprès de ses parents. Notre grand-mère, qui avait été
choisie comme l’élément central de cette histoire, a cessé d’en être la
protagoniste principale, ce qui nous oblige à mettre un point final à ce récit,
tant il est vrai qu’on ne pourrait le poursuivre au-delà sans en changer
fondamentalement le sens et la portée, puisqu’il était consacré à l’étape
migratoire de l’histoire de la famille. La suite, si jamais elle est écrite,
sera une autre histoire.
On ne peut, cependant, clore ce
bref récit sans évoquer la Guerre Civile espagnole qui eut une influence
considérable sur tous les immigrés espagnols installés si près de la frontière.
La victoire du franquisme dissuada nos « exilés de la faim » des
années 20 de retourner en Espagne. Les nouvelles de l’arbitraire qui s’était
abattu sur ce pays et de la misère qui y régnait convainquirent ceux qui
caressaient encore l’espoir d’y revenir qu’il valait mieux renoncer. Si ce
tragique conflit n’avait pas eu lieu et si la République avait pu continuer à
réaliser ses réformes, il est possible que certains retours auraient eu lieu.
C’était désormais inimaginable.
Une autre conséquence de la
défaite des armées républicaines fut de créer entre les émigrés déjà installés
et ceux qui venaient d’arriver une solidarité de fait qui ne se démentira jamais
par la suite. Il en résulta une politisation des premiers qui, pris jusque là dans
l’urgence de cette économie de subsistance que j’ai déjà évoquée, n’avaient,
sauf exception, guère manifesté d’intérêt particulier pour la chose publique.
Cette politisation s’accompagna
aussi parfois d’un abandon ou d’une mise entre parenthèses de la pratique
religieuse. Tous les enfants du couple avaient été baptisés. Les mariages
furent tous célébrés à l’église. Ces manifestations de foi ne dépassaient,
cependant pas, sauf peut-être pour la grand-mère, une approche purement
‘sociologique’ de la religion, proche de celle que pratiquait la population
locale. Bref, la religion ne faisait pas débat, comme on dit. L’arrivée des
combattants républicains exilés dont une bonne proportion était résolument
athée, l’effet de repoussoir produit par le régime franquiste, une meilleure
familiarisation avec la laïcité à la française firent que, dans certains des
jeunes couples, le lien avec la religion se distendit nettement, au point que
certaines cérémonies telles que baptêmes et communions n’étaient plus que
prétextes à des retrouvailles joyeuses entre frères et sœurs géographiquement
séparés. Mais c’est dans la génération des petits-enfants devenus adultes que
la déchristianisation se manifesta le plus clairement, au point de conférer un
caractère exceptionnel à une pratique active chez certains d’entre eux.
Un autre effet de la Guerre
Civile fut de conduire la population d’anciens émigrés, au moment où
paradoxalement elle était en train d’acquérir une certaine maîtrise du
français, à renouer au quotidien avec la pratique de l’espagnol, afin de
communiquer avec les nouveaux venus qui ne parlaient que leur langue maternelle.
Cet aller-retour entre les deux langues, pratiquées, qui plus est, à un faible
niveau, du fait de l’analphabétisme régnant, donna lieu à un sabir
hispano-franco-gascon, dans lequel le calque et l’emprunt d’une langue à
l’autre jouent un rôle prépondérant, avec les effets les plus réjouissants qui
soient.
Le grand-père ayant atteint l’âge
de la retraite au début des années 1940, nos grands-parents traversèrent les
années de la Guerre Mondiale tant bien que mal, grâce à l’aide active de leurs
enfants. À la Libération, ils intégrèrent un modeste appartement du quartier
Saint-Pierre, rue de la Croix-Blanche, au centre-ville de Dax. C’est là que la
majorité d’entre leurs petits-enfants avons le plus de souvenirs : le goût
du pain perdu que confectionnait la grand-mère ; les parties de billes sur
le plancher passablement pentu de la cuisine ; l’image aussi de notre
oncle, à la Libération, revêtu de l’uniforme, avec son bonnet de police
crânement posé sur le côté. C’est là que notre grand-père mourut le 1er
août 1951. Après sa mort, notre grand-mère, percluse de rhumatismes et
dépourvue de ressources suffisantes pour conserver son autonomie, vécut avec
son fils, désormais marié, puis avec une de ses filles, chez qui elle mourut le
25 juin 1958.
Elle, qui avait tant donné de
force et d’énergie aux siens pour les tirer de la misère, acceptait mal de
devoir dépendre de l’aide de ses enfants. Elle s’en vengeait en manifestant
souvent une certaine humeur. Aussi, jusqu’à son dernier jour, jusqu’à son
dernier geste, au moyen duquel elle prit congé de la vie, elle chercha à
préserver l’apparence d’une indépendance qui lui avait paradoxalement définitivement
échappé au moment où ses enfants avaient conquis la leur.
Postface
Lettre à mes cousins
J’ai écrit le récit qui précède en pensant à vous.
J’ai cru que, comme moi, il vous plairait de mieux connaître dans quelles
circonstances nos parents respectifs étaient venus de leur lointain pays
d’origine vers les Landes où nous tous sommes nés, et où la plupart d’entre
nous avons choisi de vivre, de nous marier et d’y élever nos enfants. Il serait
excessif de dire que cette question nous taraudait, il n’en reste pas moins que
cette histoire commune a contribué à maintenir entre nous un lien que le temps
n’a pas rompu. L’âge venant, nous avons plaisir à nous retrouver, même lorsque
nos relations ont été interrompues pendant de longues années. Or, ce que nous savions
de ce passé désormais lointain était très partiel et tenait souvent plus de la
fiction que de la réalité. Il s’agissait donc de rétablir autant que possible
les faits, tant qu’il était encore possible de recueillir certains témoignages
de première main.
J’ai écrit ce petit livre en pensant à nos enfants,
pour qu’ils ne nous reprochent pas de les avoir laissés dans l’ignorance d’un
passé qui les concerne aussi. Certains s’en désintéresseront ; d’autres,
au contraire, seront heureux de découvrir des personnages et des événements
qu’ils n’ont pas connus ou dont ils n’ont qu’une vague idée. Peut-être
souhaiteront-ils en savoir plus et envisageront-ils autrement leur relation
avec leurs propres parents.
Si j’ai écrit ces pages en pensant à vous, je tiens à
préciser je ne les ai pas écrites en votre nom. Aucun d’entre vous ne doit se
sentir engagé ni par la forme que j’ai donnée au récit ni par son contenu. Si
telle avait été mon intention, je vous aurais soumis le texte. Je ne l’ai pas
fait pour plusieurs raisons. La principale est que je ne voulais pas m’exposer
à devoir y introduire des éléments discordants, tant il est vrai que chacun, en
donnant son avis, aurait orienté dans un sens particulier un récit qui, de ce
fait, aurait perdu toute sa cohérence et, par conséquent, une grande partie de
son intérêt. Au reste, j’ai veillé à ne pas trop m’écarter de la documentation,
principalement des documents d’état-civil, sur laquelle je me suis appuyé. J’ai
aussi recueilli des témoignages, mais je ne les ai inclus qu’après
vérification. Enfin, j’ai revisité les lieux concernés, dont beaucoup m’étaient
déjà familiers, en Espagne comme en France, pour ne pas commettre d’erreur. Je
fais d’ailleurs référence à mes enquêtes dans le cours de mon récit.
Vous pourrez me reprocher de n’avoir pas tout dit
mais, je l’espère du moins, pas d’avoir travesti la vérité. Vous observerez que
je ne m’étends guère, ayant choisi à dessein une formulation synthétique. J’ai
fait une exception pour certains chapitres dans lesquels j’ai cédé à la
tentation de la littérature. J’espère que vous ne m’en voudrez pas, mais, outre
qu’il est toujours difficile de renoncer à sa vocation profonde, je me voyais
mal ne pas tirer parti de certains personnages et certaines situations qui se
prêtaient à un traitement de cette nature. C’est ainsi qu’il vous arrivera
aussi de sourire parfois, comme aimaient à le faire nos parents eux-mêmes quand
ils évoquaient en commun certains épisodes de leur vie passée.
J’ai voulu aussi apporter une contribution, très
modeste au demeurant, à un débat qui agite notre pays, depuis que l’État a
choisi de se défier de toute personne étrangère désireuse de venir travailler
chez nous pour fuir la misère. Du fait de notre histoire, nous ne pouvons pas
rester indifférents au sort de ces personnes et nous empêcher de penser que, si
on avait appliqué alors la législation d’aujourd’hui, nos grands-parents et
leurs enfants auraient été refoulés à la frontière : le manque de
qualification, l’ignorance du français, le regroupement familial, autant de
raisons pour renvoyer tout ce beau monde d’où ils venaient. Il y a là, pour le
moins, matière à réflexion.
Enfin,
je ne vous cacherai pas que je reste perplexe devant le comportement de
certains immigrés récents. Leur réticence à adopter les mœurs de notre pays,
bref de se fondre dans ce creuset qui, depuis des siècles, façonne une identité
française à partir de minerais d’origine diverse, me trouble, au point de me
demander si notre génération n’a pas été la victime d’une illusion ou la dupe
d’une manipulation. On lui aurait fait croire, par intérêt bien senti, que seul
le renoncement à une histoire ancestrale lui donnerait le droit de se
reconnaître français et qu’en agissant ainsi, elle perdait sa véritable raison
d’être, que seules ses « racines » étaient susceptibles de lui
donner. J’ai plutôt le sentiment que cette revendication des origines comme
critère d’identification nous détourne de l’essentiel, à savoir de l’adhésion à
un système de valeurs applicables à tous les êtres humains, quelle que soit la
région où ils vivent, qui lui permettent de se réaliser tout en contribuant à
un véritable progrès de l’humanité toute entière. Le bénéfice que les membres
de notre famille ont tiré de cet état de fait en deux générations montre qu’il
ne s’agit nullement d’une illusion. Cette conviction ne nous éloigne d’ailleurs
pas de notre histoire ; bien au contraire, elle s’en nourrit, car toute
expérience humaine est source d’enrichissement. Je souhaite que celle que je
rapporte ici nous aide à mieux nous orienter dans la confusion idéologique
ambiante.