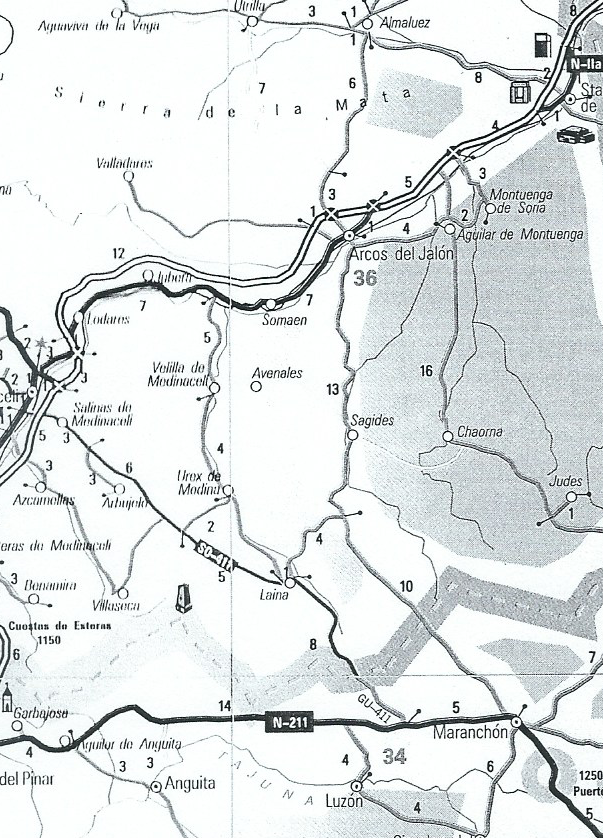José LÓPEZ PINILLOS (PARMENO)
(Rubans Rouges)
Nouvelle publiée dans
la collection La novela corta, 14 octobre 1916
Édition, traduction et
commentaire de Michel GARCIA
AVANT-PROPOS
Pour la très modique somme de 5
centimes de pésète, la « Revue hebdomadaire littéraire » La Novela
Corta, fondée à Madrid au début de l’année 1916 par José Urquía, proposait,
chaque samedi, dans un fascicule d’une trentaine de pages, le texte inédit d’un
auteur reconnu. Le samedi 14 octobre, le fascicule n° 41 publie Cintas Rojas
(Rubans Rouges), de José López Pinillos, qui figure parmi les
collaborateurs exclusifs de la revue sous la rubrique des « journalistes
illustres ». Imprimés sur du mauvais papier, y compris la couverture,
illustrée par le visage de l’auteur qui déborde des limites de la page, le tout
retenu par une seule agrafe centrale, ces textes n’étaient pas appelés à
survivre aux manipulations des lecteurs auxquels ils parvenaient. Aussi furent-ils
souvent repris dans des recueils ultérieurs de leurs auteurs, voire, pour les
plus illustres d’entre eux, dans leurs Œuvres complètes.
José López Pinillos (1875-1922) mourut trop jeune pour avoir pu réserver une
fin aussi honorable à ses créations ; c’est donc au hasard, qui est la
providence des lecteurs curieux, que je dois d’avoir trouvé, il y a fort
longtemps déjà, dans une boîte de bouquiniste de la Cuesta de Moyano, à Madrid,
un exemplaire encore en état d’être lu, provenant sans doute des invendus du
fonds éditorial.
La lecture de ces pages m’impressionna profondément et durablement, car elles
dressaient avec une remarquable efficacité le processus qui mène un individu
« normal » aux pires excès criminels.
Ce parti-pris d’objectivité,
c’est-à-dire de curiosité sans complaisance, un observateur de la nature
humaine tel qu’André Gide ne l’aurait pas désavoué. De fait, il y a lieu de
penser que López Pinillos s’est inspiré, non seulement d’un fait-divers déjà ancien
(1890), qui eut pour théâtre une orangeraie des environs de Cordoue, mais aussi
d’un fait-divers récent à l’époque où il rédige la nouvelle (l’affaire
Redureau), qui intéressa au plus haut point l’écrivain français, encore
impressionné par son expérience de juré d’assises. Pareille coïncidence
méritait d’être soulignée et commentée, car l’assassin français a fourni
plusieurs traits au protagoniste Rubans rouges.
Cette nouvelle sortit de son
complet oubli lorsqu’il fut établi qu’elle avait inspiré pour une part non
négligeable le roman de Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte
(1941), ce que son auteur et futur Prix Nobel (1989) reconnaissait volontiers.
Cette révélation aurait dû susciter un regain d’intérêt pour ce texte,
pourtant, il n’a fait l’objet que d’une seule réédition, tardive et
relativement confidentielle, parmi d’autres nouvelles du même auteur.
Il n’a jamais été traduit en français. Qu’un écrit de si modeste apparence,
publié dans des conditions aussi précaires, ait pu, tant soit peu, influencer
l’œuvre qui marque un tournant décisif dans la création romanesque espagnole du
xxe siècle, ne devrait
pourtant pas laisser indifférent.
Si, de surcroît, des
rapprochements s’imposent avec la prose narrative française contemporaine du roman
de Camilo José Cela, ce texte cesse d’être l’illustration d’un fait-divers
purement espagnol, pour inspirer une réflexion sérieuse sur le traitement
littéraire d’un phénomène qui, deux guerres mondiales et une Guerre civile plus
tard, a débordé les frontières nationales et touche tant l’Espagne que la
France : la violence des individus dans ses manifestations les plus
irrationnelles.
NOTE À LA
TRADUCTION
La langue de López Pinillos
associe des registres contrastés, à l’image de la diversité de sa création :
journalistique, dramatique, littéraire. Notre traduction cherche à les rendre
perceptibles, sans pour autant les exacerber, tant il est vrai que la fidélité
au style de Parmeno ne vaut pas adhésion à ses partis-pris esthétiques, comme
la fréquente recherche de l’effet pour l’effet ou la facture exagérément
dramatique des dialogues, avec la récurrence quasi systématique des termes
échangés.
La principale difficulté pour le
traducteur réside dans la langue des personnages rustiques. López Pinillos
affectionne dans ses œuvres la transcription du parler populaire andalou,
jusques et y compris dans sa phonétique. La substitution du « c »
interdental par « s » (« Sintas » pour
« Cintas ») ; celle du –l- par –r- (« er arma » pour
« el alma ») ; la chute du -r final de l’infinitif, remplacé par
un accent (« ayudá » pour « ayudar ») ; la chute du -d-
à la terminaison des participes (« tenío » pour
« tenido »), mais aussi dans la catégorie du nom ou de l’adjectif
(« testarúos » pour « testarudos »), ou de l’adverbe ou
adjectif (« to » pour « todo ») ; la substitution du
« b » initial par « g » (« güeno » pour
« bueno ») ; celle de l’aspirée par « j »
(« ajogo » pour « ahogo ») sont quelques traits parmi les
plus fréquents. Pareille option est inaccessible au traducteur, sauf à choisir
de faire parler ses personnages en un français patoisant. Mais, dans ce cas, sans
vraisemblance aucune, sachant que toutes les références géographiques renvoient
à Cordoue et à ses environs. On a donc choisi de prêter aux personnages rustiques
une langue parlée, telle qu’un lecteur français d’aujourd’hui puisse
l’identifier et la distinguer de celle du narrateur.
Nous explicitons en note ce que
nous n’avons pu rendre exactement ou ce qui pourrait paraître obscur à un
lecteur peu familier avec la pratique langagière andalouse.
Rubans Rouges
Nouvelle inédite
de
José López Pinillas (Parmeno)
_______
A Don Francisco Vigueras
I
Dès que le jeune valet fut parti, Rafael Luarca, qui
le surveillait, les yeux mi-clos, se redressa et sauta de sa couche. Le soleil
enfonçait déjà la roseur de ses épées matinales dans la chaumière, teignait de
pourpre le grabat et se glissait dans le tunnel sombre qui menait à l’écurie.
Au-dehors, les coqs se lançaient des défis, les deux mules grognaient de
plaisir au frais, sous le dais d’un vénérable chêne-liège, les hirondelles
folâtraient, se balançant dans le vent, et les abeilles sortaient de leurs
laboratoires obscurs pour entreprendre leur tâche mirifique.
Rafael roulait consciencieusement sa cigarette,
lorsqu’il entendit la voix de son oncle.
¬Eh, Alguazil !
Bien le bonjour. Tu pourrais me saluer, je ne suis pas le loup.
¬Mille pardons, je ne t’avais pas
vu. Bonne et sainte journée à toi.
¬Tu vas à Cordoue ?
¬A la foire, acheter un jeune
mulet.
¬Bonne chance.
¬Que Dieu te protège. Je te ramènerai
Rubans Rouges couché dessus, occupé à cuver son vin.
Alguazil éclata de rire et l’oncle, tout en riant lui
aussi, répliqua :
¬Pour le coup ! Si Rubans
ne trouve pas une mine d’or pas plus tard que ce matin, m’est idée que tu ne
verras pas le bout de son oreille.
Luarca, très irrité, protesta, comme si on pouvait
l’entendre :
¬Sûr qu’il la trouvera, cette mine
d’or. Et même cinquante s’il le faut !
Puis, tremblant d’impatience et de colère, il écarta
le montage rustique de la couche, fait de bouts d’olivier avec leur écorce,
ouvrit le coffre qu’il recouvrait et en tira le costume qu’il exhibait dans les
grandes occasions : le chapeau sévillan aux bords étroits et très
brillant, le pantalon d’une panne aussi fine que du velours, la veste de lainé
bleue, les bottes de cuir safran, les chaussettes aux motifs verts, le caleçon
de coton blanchâtre, si serré que le roi lui-même n’en devait pas porter de
tel, et la chemise à plastron brodé, qui ne pouvait être repassée que dans les
ateliers des artistes cordouanes. Il s’habilla en un tournemain ; il prit,
par coquetterie, une montre à savonnette
de nickel qui ne marchait pas depuis le jour où, afin d’éprouver la solidité du
mécanisme, il l’avait écrasée sur le nez de l’horloger ambulant à qui il venait
de l’acheter ; il glissa dans sa ceinture le compagnon d’Albacete,
puis se montra à la porte. Son oncle, le filiforme monsieur Joseph, qui
déjeunait assis près des mules, ne put cacher son admiration.
¬Te voilà beau comme un astre, nom
d’un petit bonhomme ! s’exclama-t-il en clouant sur lui ses petits yeux.
Rubans Rouges
gratifia l’éloge d’une moue méprisante.
¬Un astre ? articula-t-il.
Tout au plus une chandelle ! Je n’ai pas les sous qu’il faudrait pour être
un astre.
¬La bonne mine vaut plus que l’or.
Je suis bien placé pour le savoir, mon petit Rafael.
¬La bonne mine, la bonne
mine ! Elle n’est pas née celle qui me donnera un sou sur ma bonne
mine ! Je vous en ficherai, des bonnes mines !
Le vieillard répondit en souriant :
¬Ouvre les yeux, aiguise ton flair
et tu en trouveras.
Il aurait sûrement pu trouver quelque bonne fille,
séduite par son allure, prête à lui ouvrir les bras, si son parler rustique et
grossier et son caractère rude et sauvage ne faisaient fuir les mieux
disposées. Il était bien charpenté et musclé, bâti en hercule, sujet à des
colères, provocateur et fort en gueule. Il avait un regard insolent, un nez
agressif, une bouche énergique, les sourcils fournis et broussailleux, propres
à souligner ses expressions furibondes, et il se vantait d’être plus vigoureux
qu’un bœuf et plus têtu qu’un mulet.
¬Assez causé, dit-il après
quelques instants d’hésitation-, vous voulez bien me prêter quelques
sous ?
Le vieux remua la tête avec mélancolie, soupira et se
mit à parler sans le regarder :
¬Faut-il que tu sois entêté, saint
Rafael de mon cœur ! Mon ventre sonne creux… Et tu me demandes des
sous !
Il se frappa la poitrine du plat de la main, comme
s’il était furieux, et ajouta :
¬Tu trouves que je ne t’en ai pas
donné assez ? Je ne t’ai pas nourri et logé tout l’hiver ?
¬À me tourner les pouces,
peut-être ? demanda le rustre, avec une lenteur menaçante.
¬Tu parles d’un travail !
Est-ce que j’avais besoin d’ouvriers pour cultiver ce mouchoir de poche ?
Je ne regrette pas le pain que tu manges et je ne t’en fais pas reproche. Mais,
nom d’un petit bonhomme, il faut dire ce qui est, si on ne veut pas que les
mots vous restent en travers de la gorge.
¬C’est bon, mon oncle.
Ils se turent, et le vieux, qui était à la torture,
sous l’effet conjugué de la misère et des tentations de la générosité, rompit
le silence, pour formuler avec difficulté une question :
¬Deux réaux, ça t’irait ?
¬Deux réaux ? Deux réaux,
rien que ça ?
¬C’est mieux que rien, mon petit
Rafael.
¬Je dirais même plus, c’est une
grosse somme, mon oncle. Avec deux réaux, à Cordoue, j’achète la mosquée et une
voiture attelée à quatre chevaux, une redingote, on me nomme gouverneur et vous
ne me revoyez plus. Non, je n’en veux pas de vos deux réaux.
¬Fichtre, quelle dégelée !
¬Je sais… et je m’en vais pour ne
pas vous en flanquer une autre. Salut.
Il franchit d’un saut la terrasse,
coupa par l’oliveraie, délaissant le chemin et, quelques instants plus tard, il
traversait en courant les champs des Merinales, vers le manoir du marquis,
certain que ce dernier s’y serait réfugié pour fuir le tohu-bohu de la foire.
Rafael avait travaillé à la ferme, où l’on payait largement et où on traitait
avec humanité les journaliers et, comme il était parti sans avoir eu de conflit
avec les régisseurs du marquis, il espérait qu’on l’engagerait à nouveau. Dans
ce cas, qui les empêcherait d’accéder à une modeste requête ? Il avait
besoin de dix douros. Ces dix douros, on les prélèverait peu à peu sur son
salaire, et personne ne subirait le moindre préjudice. Le marquis les lui
refuserait, alors qu’il avait des millions ? Bah ! Le marquis, s’il
était étrange, taciturne et grognon, on ne pouvait pas dire qu’il était avare.
Décidément non, il ne les lui refuserait pas.
Par chance, le maître des Merinales, qui venait
d’arriver à la ferme, accepta de le recevoir, et, après quelques hésitations,
dans son désir de s’exprimer avec élégance, Rubans Rouges entreprit
d’exposer sa requête :
Monsieur le marquis se souvient que
j’ai été deux annéess à la ferme des Salas… De braves gens, sauf le respect que
je dois à monsieur le marquis, même si Luis fait le crâneur, à croire qu’il a
du sang bleu.
¬Au fait.
¬J’y vais. J’ai dû partir en
novembre, parce qu’il y avait tellement de ramasseurs d’olives, que moi, qui
suis pourtant bon gauleur,
je n’ai pas touché à la gaule. Rendez-vous compte : tout un saint hiver
dans la chaumière de mon oncle, chez qui même les araignées ne mangent pas à
leur faim, et sans un sou.
¬Au fait, au fait, Rubans
Rouges.
¬Mais j’y suis, monsieur le
marquis. Tout ce que j’ai dit, c’était pour dire qu’à cause du chômage de cet
hiver, ¬qui est le moment où je mets des sous de côté¬, me voilà dans l’eau
jusqu’au cou et à m’agiter dans tous les sens pour ne pas me noyer. Pour tout
dire, je me noie si monsieur le marquis ne me donne pas un coup de main.
¬De quelle manière ?
¬En me prêtant dix douros et en me
reprenant.
¬C’est que –affirma-t-il avec
gravité¬ je ne suis pas un usurier.
¬L’idée ne m’en serait pas venue,
monsieur le marquis. En me faisant un prêt, vous le faites à un de vos valets,
et pas pour lui faire du tort mais une faveur.
¬Mais voilà, tu n’es pas un de mes
valets.
¬Donc, vous ne voulez pas me
reprendre.
¬Je ne veux pas te reprendre.
La froideur
sèche et blessante de la réponse troubla le rustre.
¬On peut savoir pourquoi vous ne
voulez pas me reprendre, don Salvador ?
¬Tu vas le savoir. Parce que tu es
un insolent et un m’as-tu-vu.
¬Ben, mon chrétien. Ne vous fâchez
pas, ou vous pourriez avaler votre dentier. Ce sont les dents d’un mort ?
Don Salvador, sans se troubler, ouvrit un tiroir, en
tira un pistolet et, menaçant Rafael, qui haussait les épaules en signe de
mépris, articula lentement :
¬C’est toi qui vas avoir les dents
d’un mort, si tu ne files pas.
¬Allons donc ! marmonna-t-il
sous la menace. Je parie que vous ne tirerez pas et que, si vous tirez, vous ne
m’atteindrez pas. Alors, ils viennent ces dix douros ?
Le marquis abaissa le browning et Luarca se mit à
rire.
¬Je vous avais bien dit que vous
ne tireriez pas. Réservez vos tirs aux perdrix, vous leur ferez sûrement peur.
Adieu.
Il lui tourna le dos et se retira en feignant un calme
exagéré, tout en crachant des blasphèmes et en lançant des regards de côté aux
domestiques du patron ; puis, dans le vestibule du manoir, dans un geste
de provocation, il s’arrêta et alluma une cigarette. Le contremaître, qui
arrivait à cet instant, l’interpella sur un ton moqueur :
¬Quel bon vent, Faël ?
Attends, tourne-toi, que je puisse t’admirer ; maudit sois-tu, on dirait
un général en grande tenue.
¬Plutôt deux fois qu’une,
s’exclama Rubans, tournant sur lui-même en se pavanant.
¬Comme ça, tu vas à la
ville ?
¬Pas de foire sans moi. Le cocher
du gouverneur m’attend.
¬Tu as bien de la chance, mon
petit Rubans. Quant à moi, je me contenterai d’y faire un saut demain, si on
m’y autorise. On se voit aux arènes.
¬Pour sûr.
Sûr qu’ils s’y verraient ! Ce n’était pas pour
épater les grives et les moineaux qu’il s’était fait beau. Avec ces bottes, ce
chapeau, ce costume et tout ce luxe, cela faisait six années qu’il allait à
Cordoue, depuis le jour où il avait vu pour la première fois Guerrita et avait
été ébloui par la beauté sans égale des combats de l’arène ; et il
comptait y aller à nouveau pour protester, la crête dressée, pour distribuer
des coups comme un tigre en défense de son héros, pour l’encourager de ses
hurlements et le gratifier de ses applaudissements. Quel grand toréador que ce
cordouan ; quelle fête magnifique et exaltante que celle du taureau !
Ces hommes qui entraient dans l’arène avec un geste de défi, qui s’injuriaient
ou se saluaient à grands cris ; ces taureaux qui mugissaient sous l’effet
de la barbare piqûre du fer, et qui donnaient de la corne, saisis d’une colère
infernale ; ces chevaux qui fuyaient en hennissant toutes dents dehors,
tout en piétinant leurs entrailles déchirées ; les taches brunes dans le
sable ; les cadavres de chevaux encore tremblants ; et, pour
compléter le tableau, cette odeur de ventres ouverts et de sang, ces visages
exaltés par la témérité ou pâles d’épouvante ; ces propos qui claquaient
comme des coups de fouet et mordaient comme des vipères, et poussaient les
combattants à rechercher le triomphe dans le danger.
Rubans Rouges,
qui était sorti de sa première corrida à demi fou d’émotion et prêt à trucider
le premier qui refuserait de se prosterner devant Guerra, ne pensa plus
désormais qu’à son idole et semblait ne s’émouvoir que lorsqu’il rapportait et
commentait ses exploits inouïs. Les yeux mi-clos et la voix rauque, dans les
dortoirs de la ferme, il parlait de la passe de poitrine, du saut entre les
cornes, des banderilles à contre-pied, du coup d’épée qui laissait le public
bouche-bée d’admiration pour ce géant ; et il avait, pour faire son éloge,
des enthousiasmes et des délicatesses toutes féminines. Il était si beau, si
fort, si agile, si calme, si courageux, notre matador ! Dans le but d’économiser
l’argent indispensable pour le voir tuer les taureaux, il se martyrisait tout
au long de l’année, se privant de la cuite du dimanche, de la gorgée de gros
rouge à l’apéritif et des joyeuses tournées de Noël ; même les piquantes tentations
de Carnaval ne lui faisaient pas desserrer les cordons de la bourse. Au
contraire ; tandis qu’il moissonnait, vendangeait ou gaulait, qu’il
maniait l’émondoir, la charrue ou le sarcloir, il se donnait du courage en se
remémorant les exploits de « son » toréador et chassait ainsi mille
tentations. Comme il se rattrapait ensuite ! Pendant la fête, combien de
doux excès il s’accordait pour gratter la rouille de sa vertu forcée. Disputes
et rugissements à y perdre la voix ; un vinasserie agressive, un fort
parfum de sang, au point que ses nerfs se changeaient en fils de fer
électrisés ; enfin, des femmes et de l’alcool jusqu’à l’anéantissement.
Pour un crâneur comme Salas, qui l’avait chassé lâchement, ou un crétin comme
don Salvador, il allait rester à la campagne ? Tandis que des morveux
avaient des billets et des douros plein les poches ?…
Il laissa là le contremaître et s’éloigna sans but
précis. Qui solliciter ? Près des Merinales, il ne manquait pas de gens
fortunés : le señorito de La Garbosa, le chanoine don Bonifacio, le
père Juan, le grossiste… Mais le père Juan et le señorito devaient être
à la foire, et il n’y avait pas moyen d’approcher le chanoine, car ses parents
veillaient jalousement sur lui. Il ne lui restait donc que son compère,
et son compère, qui était aussi têtu que lui, faisait la sourde oreille.
« L’année avait été très mauvaise et il avait la corde au cou ; il n’avait
pas encore réuni les cent douros qu’on lui réclamerait à la Saint-Jean…
Il devait les réunir, sans compter qu’il fallait manger ». Pure avarice et
mauvaise volonté. Il n’est pas plus difficile de réunir 550 pesetas que 500,
non ? Cet avare n’avait qu’à se serrer un peu plus la ceinture ; ce
n’est pas pour rien qu’ils étaient compères. Il s’exposait à un petit
désagrément. On ne se moquait pas de lui. Sans détours, il mettrait cartes sur
table.
Dans cette intention, il s’éloigna des Merinales et se
dirigea vers La Fermette.
II
Le père Rafael Gros-Pif, le père Pierre Sourdingue
et Sébastien Bien Léché interrompirent leur travail lorsqu’il les salua.
Gros-Pif, qui l’avait effectivement gigantesque et qui était fier des
proportions anormales d’un appendice si intéressant, était un vieillard
musculeux, de haute taille, plein d’allant et de gaieté ; le père Pierre,
la quarantaine, pauvre de mots mais extraordinairement bavard, recouvrait par
miracle son ouïe chaque fois que cela lui était utile et se distinguait par son
manque d’humour et par la faculté qu’il avait de passer des paroles aux coups ;
quant à Bien Léché, sec comme une trique et aussi agité que des
castagnettes, il tranchait par son exquise courtoisie avec les valets du moulin
ou de la ferme.
Il fut le premier à parler :
¬A ton service, compagnon.
¬Et moi au tien, Bien Léché,
et à toute la compagnie.
Le membre le plus jeune de la compagnie, Sourdingue,
se contenta de baisser la tête, et le plus âgé, le père Rafael, lui serra la
main et le gratifia d’une plaisanterie :
¬Pour moi, à moins de te prêter
mon nez, pour faire le beau à la foire…
¬Merci, ami. Je ne le porterais
avec autant de prestance que vous.
Sébastien acquiesça :
¬Tu saurais sûrement le porter,
parce que tu es un vrai gaillard, tu n’as pas mal répondu.
¬Dieu te le rende, Bien Léché.
Il offrit du tabac à la ronde. Les laboureurs se
roulèrent d’énormes barreaux et les allumèrent avec une délectation
voluptueuse ; le père Pierre, pour le remercier, lui offrit aimablement de
l’eau-de-vie.
¬Goûte-moi ça, c’est du meilleur,
de Rute.
¬Du meilleur, en effet
approuva-t-il, après avoir savouré la liqueur et passé le cruchon à Gros Pif.
Vous vous la coulez douce par ici.
¬En travaillant un jour de
foire ? demanda ironiquement le père Rafael. Demandez à mon gendre si la
vie est si belle.
¬J’allais le voir. Il est à la
ferme ?
¬Il y est.
La ferme, blanche comme une boule de neige, posée avec
une malice sournoise au sommet d’une colline d’où l’on domine les terres de La
Fermette, n’était pas très grande ; mais elle avait une grande salle
lumineuse pour le maître, sa femme et le petit dernier, meublé d’une bonne maie
et d’une literie à quatre matelas ; une autre pour la grand-mère et la
fille ; une alcôve, dans laquelle Gros Pif et son petit-fils se
berçaient mutuellement de leurs ronflements ; une superbe cuisine avec des
bancs de pierre sur lesquels les journaliers dormaient comme des loirs ;
de vastes écuries, des greniers spacieux et une grande basse-cour. Ses murs de torchis
et de galets n’auraient pas résisté à l’impact du moindre boulet de
canon ; mais ils pouvaient s’opposer à l’impétuosité brutale des tempêtes
et aux traîtresses bourrasques. Les maîtres de La Fermette pouvaient dormir en
paix tandis que les loups du vent hurlaient et que la grêle tambourinait sur
les tuiles. En somme, leur luxe se résumait au luxe simple des murs blanchis à
la chaux, des métaux qui brillent, du bétail bien soigné, de la volaille bien
grasse.
Rubans Rouges
s’arrêta quelques instants face à la maisonnette. Le soleil, traversant la
frondaison d’un figuier, teignait d’un or verdâtre la terrasse. Une corneille
aux ailes coupées grattait la terre à la recherche de chenilles, à côté des
poussins, aussi timide et pusillanime que si elle n’avait jamais navigué au
milieu des nuages lorsqu’elle avait ses ailes intactes, et comme si elle
n’avait jamais ouvert son bec rouge pour croasser en liberté.
À quoi s’occupait-on dans la ferme ? Il tendit
l’oreille et perçut le bouillonnement d’un fait-tout, le glouglou d’une cruche
que l’on vide et le carillon sonore d’un mortier. Il entendit ensuite une toux
enrouée, puis, tout aussitôt, des petits cris harmonieux qui le firent
sourire : « Ah ! La méchante vieille qui tousse déjà ! Je
m’en vais te la secouer ! » C’était Rosario, la jeune fille qui,
depuis le grenier, où elle devait être occupée à se coiffer, criait assez fort
pour que la vieille, réfugiée dans sa chambre, pût entendre le plaisant
reproche. La mère devait être occupée à la cuisine et les enfants, derrière les
murets, dans l’aire de battage ou au bout du champ d’orge, devaient jouer avec
les agneaux. Mais l’homme ? Est-ce lui qui vidait la cruche ? Il le
trouverait au milieu des femmes ? Il ne pourrait pas lui parler sans
témoins ? Après tout, pour peu qu’il lui donne la galette…
Il avança d’un pas décidé, veillant à adoucir son
visage d’une expression affable, et il entra dans la maisonnette. La maîtresse
était seule, ce qui lui donna du courage.
¬Soyez en paix, madame Antonia.
¬Dieu vous garde, Rubans.
¬Où est-il, ce malotru ?
¬Vous le trouverez dans la
basse-cour. Vous voulez le voir ?
¬Pour vous faire une faveur.
¬Quelle faveur ?
¬Faire de vous une veuve.
Antonia, par politesse, sourit à la plaisanterie, puis
dit, en feignant une plaisante frayeur :
¬Ne me le tuez pas tout à fait.
¬Pourquoi pas ?
Il entra en riant dans la basse-cour et tomba nez à
nez avec le fermier qui, sous l’appentis, réparait la roue d’une charrette. Le
fermier Rafael Luque était un homme agreste, à la bouche largement fendue et à la
nuque épaisse,
qui avait des bras de boxeur et un tronc d’athlète. Il le reçut avec
cordialité.
¬Bonjour, monsieur l’élégant.
¬Salut, compère.
¬Vous avez trouvé ce que vous
cherchiez ?
¬Pas encore.
¬Comment se fait-il alors que
votre Grâce soit sur son trente-et-un ?
¬Parce que je compte bien le
trouver.
¬Mes félicitations.
¬C’est un peu tôt. Vous me
féliciterez lorsque vous m’aurez donné les douros.
Le géant le fixa d’un regard noir et, sans mot dire,
se remit à la tâche.
¬Comme ça, insista Rubans
Rouges, vous n’avez pas l’intention de me les donner, compère ?
¬Je n’en ai pas l’intention et
cela me peine. Cela me peine aussi, ajouta-t-il, de vous voir agir
inconsidérément.
¬Ben, mon bonhomme !
s’exclama le quémandeur, sur un ton mi moqueur, mi offensé.
¬J’en suis un, articula sèchement
Luque. Et comme vous en êtes un aussi, je m’étonne que vous vous comportiez
comme un enfant. Je vous ai déjà dit que je n’avais pas encore réuni la somme
que je dois payer. C’est la vérité. Je ne mens pas. Depuis le temps, vous
auriez dû comprendre.
¬J’ai bien compris. Ce que je
n’avais pas compris, c’est que votre parole vaut de l’or. Quand vous dites
« non », c’est « non », c’est ça, compère ?
¬Quand je dis « non »
comme maintenant, vu que je ne peux pas dire « oui », c’est
« non ».
¬Pas possible ? Avec dix
douros en moins, vous en serez réduit à mendier ?
¬Avec dix douros en moins, je
serais obligé de trouver dix douros en plus.
¬Vous voyez ce qu’il vous reste à
faire.
¬Nous y voilà ! Rien de plus
facile ! Des douros, il en pleut ! Bien, ça suffit. Ne me poussez pas
à bout, compère.
¬Rien pour moi, et tout pour
vous ? Vive la République !
¬Vous commencez à m’ennuyer,
compère.
¬Alors, alignez l’argent !
¬Tu as perdu la tête ?
Rubans, calmez-vous. C’est à croire que vous ne me connaissez pas et que
vous voulez me faire peur.
Mais le rustre, loin de se calmer, lui répliqua,
dressé sur ses ergots, l’expression encore plus menaçante :
¬Je ne veux pas vous faire peur.
Je me moque que vous ayez peur ou non. Ce que je veux, c’est l’argent !
Il asséna ces mots avec une telle force, révélant si
cyniquement sa pensée, que l’autre peu disposé à céder,
désormais sur ses gardes, commença à se fâcher.
¬Réfléchissez un instant et
regardez-moi bien dans les yeux, marmonna-t-il sur le ton sarcastique que lui
dictait son courage. Regardez-moi bien dans les yeux et vous verrez que ce ne
sont ni ceux d’un poitrinaire, ni ceux d’un enfant, ni ceux d’un trouillard.
¬Qu’ils soient à qui vous voudrez.
J’exige mes billets !
¬Par la force ?
¬À vous de choisir.
Luque, très pâle, le mufle contracté et un charbon
ardent dans chaque œil, leva ses poings comme des masses, prêt à les abattre
sur son adversaire. Dans le ténébreux cerveau de Rubans, l’excitation
face au danger fit éclore la larve noire d’une idée infâme et lui fit pousser
des ailes : tuer. Comment n’y avait-il pas songé plus tôt ? Comment
avait-il pu accepter de subir, depuis quinze jours, rebuffade sur rebuffade et
humiliation sur humiliation ? Ces avares étaient-ils ses amis ? S’ils
ne l’étaient pas, qu’est-ce qui mettait un frein à sa fureur ? Tuer,
tuer ! Il tira son poignard, fit sauter le fourreau d’une habile secousse
pour ne pas perdre de temps, et se jeta sur son rival, lequel, surpris, recula
pour se saisir de quelque objet et se défendre, tout en bramant de colère.
¬Ah ! Gros froussard !
Maudite ta mère, sale traître.
Il parvint à se saisir d’une pierre et à se
redresser ; mais, en se redressant, il ne fit qu’épargner une course plus
longue à la lame, qui s’enfonça dans sa gorge à la vitesse de l’éclair, et
zigzagua comme un furet dans un terrier, déchirant tendons, vaisseaux et chair.
Le lutteur, avec la lenteur pesante d’un chêne déraciné, vacilla un instant,
porta les mains à son cou, d’où jaillissait le sang à gros bouillons, et
s’écroula, tandis que l’air enfermé dans ses poumons s’échappait par l’horrible
brèche, sans pouvoir parvenir à la bouche pour y former des paroles de haine et
d’agonie.
Rubans Rouges
quelque peu effrayé par la rapidité avec laquelle il avait fauché cette vie,
sursauta en entendant la voix de la fermière : « Je viens,
Rafael ». Rafael ? Dans la famille ils étaient trois à se prénommer
Rafael : le père, l’époux et un des fils ; mais pour madame Antonia,
il n’y avait pas d’autre Rafael que son compagnon : son fils, elle
l’appelait Falico, et Gros Pif « père ». Elle s’adressait donc
à l’égorgé, comme si elle l’avait entendu appeler. « J’arrive,
Rafael ». Qu’elle y vienne, donc, même si elle devait voir, parce qu’après
avoir vu, elle ne verrait pas une seconde de plus. Elle s’approcha de la porte
et tendit l’oreille. Les poules caquetaient et sur la route sonnait la
clochette d’un âne fatigué par sa marche monotone. On entendit à nouveau le
glouglou de la cruche, la vieille se remit à tousser et la jeune fille à
protester : « Par tous les saints,
je ne connais pas de vieille plus mal embouchée ! » Enfin, la femme
apparut et le « guerriste »,
lui souriant innocemment pour ne pas l’alerter, l’arrêta :
¬Halte là, ma mignonne !
¬Mon mari ne m’a pas
appelée ?
¬Votre mari ?
Les yeux du sauvage, sans que sa bouche cessât de
sourire, furetaient comme deux hyènes repues dans le corsage et le cou de la
fermière, hésitant sur l’endroit où s’enfoncerait la dent d’acier.
¬Votre mari, déclara-t-il après
une pause, ne peut plus vous appeler. Ne vous avais-je pas dit que j’étais venu
pour faire de vous une veuve ?
Madame Antonia l’examina, prise d’une subite
appréhension. Que cachait ce sourire ? Derrière ces paroles ironiques,
qu’y avait-il ? Et ce silence de la basse-cour que son époux ne rompait
pas, que signifiait-il ? Et dans la main droite que son interlocuteur
cachait, qu’y aurait-elle lu ?
¬Auriez-vous peur, commère ?
s’exclama le rustre.
Bien qu’il formulât sa question avec un éclat sinistre
dans le regard, la femme, soudain rassurée, éclata de rire :
¬Que vous êtes drôle !
lâcha-t-elle, confuse d’avoir eu des soupçons. Tu entends, Rafael ?
¬Il ne peut pas entendre.
¬Alors, vous me l’avez tué tout à
fait, tout à fait ?
¬C’est si vrai que les enterrés ne
sont pas plus morts.
La fermière s’approcha de l’appentis et regarda ;
ses yeux s’ouvrirent démesurément ; une bouffée d’épouvantable angoisse
contracta sa poitrine, et avant qu’elle l’ait dilatée assez pour envoyer le
hurlement frénétique à la gorge, le poignard la fit taire.
¬Pas de bruit, marmotta le
bourreau, en remuant le couteau. Pas question de donner l’alerte. Reposez en
paix.
Elle tomba pour reposer éternellement et se retrouva
en boule aux pieds de son compagnon, qui remplissait l’appentis de son cadavre
gigantesque. Le sang qui sortait en jet continu de sa gorge se mêlait à celui
qui, teignant le sol de rouge, le convertissait en une terre d’ocre puante. Un
spasme secoua son corps, qui se redressa et émit un ronflement depuis la
trachée ouverte ; alors Rubans, froidement, frappa à nouveau. Puis,
avec un calme diabolique, comme s’il était dans un abattoir face à deux moutons
égorgés, il alluma une cigarette et s’abandonna à la méditation. Il avait fait
le plus gros, puisque Luque, dont le visage semblait désormais de marbre, ne
gênerait plus, avant de pourrir, que le curé et les fossoyeurs. Il l’avait
exécuté avec tant d’adresse, prenant les devants pour éviter le combat et
maniant la lame avec la science d’un boucher, que le fleuve qui coulait dans
les veines du géant, en débordant impétueusement, ne l’avait pas sali. Une
légère éclaboussure sur les bottes, qu’il effacerait avec un linge humide, et
une goutte sur le pantalon. Mais le plastron, la veste et le gilet étaient
aussi propres que lorsqu’il les avait mis. Il n’avait donc pas à se plaindre.
Ce qu’il lui restait à faire était rude, mais pas difficile : trouver les
clefs, tuer la vieille, qui était déjà à l’article de la mort, la jeune fille,
qui mourrait d’effroi, et les enfants, qui succomberaient comme des agneaux,
puis s’enfuir avec l’argent.
¬Et voilà tout, proféra-t-il à
haute voix. Ils l’ont bien cherché. Pour dix malheureux douros… si c’est pas
malheureux !
Il essuya le poignard sur la robe de la fermière, se
déchaussa et entra dans la ferme, au moment où la vieille se remettait à
tousser.
¬Tu n’as donc pas pris ta
pastille ? cria la jeune fille.
¬À quoi bon ? murmura la
vieille d’une voix tremblante, certaine que sa petite-fille ne l’entendrait
pas. Mon Dieu !
Une simple cloison la séparait de l’assassin, qui
entendait sa respiration d’asthmatique et les crissements qu’elle arrachait à
son fauteuil en bougeant.
¬ Mon Dieu ! Mon Dieu !
De quoi se plaignait cette momie ?
Qu’espérait-elle à ses quatre-vingt-dix ans ? Il l’avait toujours vue dans
sa tanière ou dans la cuisine, près du foyer, soupirant, criant ou se fâchant,
sans comprendre qu’elle était une bouche inutile, un poids mort… Par pure
méchanceté, il lui aurait laissé la vie sauve, pour qu’elle voie comment on
végétait dans les asiles et qu’elle y apprenne la patience. Furieux, il monta
lentement l’escalier, s’appuyant sur la cloison et posant le pied doucement de
façon à ne pas faire gémir le bois, puis il pénétra dans le grenier. Rosarito
qui, sans sa blouse et un sein hors de sa chemise, peignait ses cheveux devant
une lucarne, ne l’entendit pas venir, et l’archi-démon s’immobilisa à deux
toises de la jeune fille, subitement intimidé. Un souvenir mit le feu à son
imagination, l’éblouissant comme un éclair lumineux : il travaillait à la
vigne du chanoine ; un soir, après un festin, éclata un orage, et Rosario,
avec d’autres jeunes filles qui durent coucher à la ferme, s’amusèrent dans
leur chambre commune à comparer leurs mollets, sans soupçonner que les valets,
qui avaient percé au préalable les planches du grenier, prenaient plaisir à
observer les beautés qu’elles exhibaient avec tant de candeur. Celle de La
Fermette, qui était la fille la plus formée, enthousiasma Luarca et, depuis
lors, le rustaud faisait moins de simagrées, lorsqu’il rendait visite à la
famille de son compère. Ces jarrets avaient une blancheur si laiteuse et un
velouté si attirant ! Il en avait rêvé. Repensant à leur joliesse, il les
voyait souvent lorsqu’il était éveillé, interrompant sa tâche, et avait finir
par caresser l’espoir qu’un jour il serait le seul à pouvoir les contempler. Et
maintenant, à cause d’un maudit avare, il était contraint de détruire la
maîtresse de son trésor ! Loin de le faire hésiter, la colère lui donna le
courage de poursuivre sa tâche monstrueuse.
¬Rosario, murmura-t-il.
La jeune fille couvrit son sein, se retourna vivement
et, inquiète et rougissante, tenta de fuir.
¬Rubans, au nom de
Dieu ! Pourquoi êtes-vous monté ? balbutia-t-elle, toute tremblante.
¬Ne crie pas ! ordonna
l’assassin, en l’acculant dans un coin. Tais-toi et ne bouge pas.
¬Mais, vous…
¬Tais-toi ou tu es morte.
La jeune fille épouvantée se mit à pleurer et continua
à parler, tout bas et en contenant ses sanglots.
¬Ce que vous allez me faire, ça
n’est pas bien. Vous, qui ne m’avez jamais adressé la parole, qui ne m’aimez
pas ! Déshonorer une jeune fille sans l’aimer, c’est un très vilain péché,
Rubans Rouges.
La déshonorer ? La brute fut décontenancée. Mais,
sans se laisser attendrir par la douce créature résignée qui, n’écoutant que sa
pudeur, craignait pour sa virginité plus que pour sa vie, inexorable, il décida
de la posséder et de l’égorger ensuite.
Viens, dit-il, la prenant par la
taille et l’entraînant vers un tas de blé.
¬Rubans, Dieu ne te le
pardonnera pas.
¬Allez, viens, bêtasse. Si tu
savais comme je t’aime ! Allez…
¬Non, non et non. Si vous
m’aimiez, vous ne me feriez pas ça ! Et puis, ma mère peut venir.
¬Penses-tu !
¬Allez-vous en, Rubans, au
nom de ce que vous aimez le plus.
Non, il ne s’en irait pas. Et puisque Rosario avait confondu
la faucille de la mort avec la flèche de l’enfant aveugle, il n’escrimerait pas
le poignard avant d’avoir éteint le feu de la luxure qui le brûlait. Elle
l’avait enflammé par ses paroles, alors que lui, en toute innocence, n’était
monté que pour la tuer.
¬Couche-toi là !
¬Rubans !
Il la renversa, se jeta près d’elle dans le blé et,
après avoir relevé sa jupe, il commençait à la caresser, lorsque, tout à coup,
il blêmit en entendant un hurlement véritablement diabolique, d’une
épouvantable violence, un hurlement dans lequel vibraient tout à la fois la
haine, la peur, la souffrance, la férocité, un hurlement capable de faire
trembler l’homme en bonne santé, de faire gémir le malade et de faire pleurer
le moribond. Il se rapprochait aussi vite que s’il avait chevauché la croupe
invisible et terrifiante d’un cyclone. Rubans Rouges, persuadé qu’il
annonçait un danger imminent et convaincu qu’il aurait à se battre pour
survivre, faucha d’un poignet ferme, d’un seul geste, le cou qu’il avait
embrassé, puis empoigna une pelle et se mit à l’affût.
¬C’est Colonel, murmura-t-il
sombrement, Colonel qui a dû les sentir.
Colonel, un molosse aux mâchoires de tigre, avait
traversé la maison en hurlant, avait atteint la basse-cour, était entré sous
l’appentis et, voyant les cadavres de ses maîtres, avait reculé, l’échine
arquée, la tête basse et les poils hérissés, puis commença à glapir, saisi de
terreur. La vieille appela, effrayée, et le monstre, en fureur, se précipita
dans l’escalier, à la manière d’un éclair fatal. Il fallait faire taire les
cris et les gémissements ; il fallait rétablir le silence, à coups de
poignard, en triturant, en pulvérisant, parce que, si l’alerte était donnée, il
n’en réchapperait pas. Il franchit la porte, pressé d’attaquer et eut juste le
temps de lever la pelle et de l’abattre sur le chien qui, poussé par son
instinct, l’attaquait, fou de rage ; mais l’animal tomba, la nuque brisée
et, son horrible ululement s’étant éteint, le calme fut rétabli.
La malade continuait à appeler, mais d’une voix si
faible…
¬Rosarito… Antonia… Mes enfants…
À deux pas de la terrasse on ne pouvait l’entendre,
aussi, le bourreau ne s’inquiéta pas. Elle pouvait toujours appeler, puisque
personne ne viendrait à son secours. Cependant, il vint quelqu’un, quelqu’un
qui, à en juger par le bruit ténu de ses pas et par le calme avec lequel il
sifflotait, devait être un être bien frêle, qui plus est, non prévenu. Mais,
s’il avait quelque soupçon, n’aurait-il pas la force de courir de toutes ses
forces et de crier à en perdre le souffle ? Et lui, comment pourrait-il
s’enfuir, si tous les habitants des environs, sous le coup de l’épouvante,
assiégeaient La Fermette ? Afin de poursuivre dans les meilleures
conditions celui qui sifflotait, au cas où il s’enfuirait, il se chaussa, serra
son poignard, puis alla à sa rencontre. Mais le nouveau venu parla et cette
petite voix l’arrêta. C’était l’aîné des fermiers, un gamin de onze ans, aussi
inoffensif qu’un pigeon, qu’il n’y avait pas lieu de craindre.
¬Grand-mère, grand-mère !
criait-il joyeusement. J’ai retrouvé mon tromblon ! Il était dans la
haie !
¬Où est ta mère ? demanda la
vieille.
¬Est-ce que j’en sais !
¬Elle n’est pas là avec toi ?
¬Pas ici, non.
¬Et ta sœur ?
¬Non plus.
¬Ton père n’est pas sorti de la
basse-cour ?
¬Pas que je sache…
¬ Rubans Rouges, non plus ?
¬Je ne l’ai pas vu.
¬Alors, articula difficilement la
vieille, après quelques secondes de silence, qui a bien pu entrer ?
¬Je n’en sais rien.
¬Seigneur ! Seigneur !
s’exclama la vieille avec angoisse.
¬Tu te sens mal ?
¬Je suis bien malade, mon petit.
Dis-moi, comment se fait-il que le chien n’aboie pas ?
¬J’en sais fichtre rien.
¬Qu’est-ce que tu fais ?
¬Rien. Si j’avais de l’étoupe…
J’aimerais en trouver pour charger mon tromblon.
¬Crie fort pour appeler ton père.
L’enfant
cria :
¬Père, père, papa !
¬Il ne répond pas ? demanda
la vieille.
¬Non.
¬Appelle ta mère, plus fort
encore.
¬Mère, maman ! Mèèère !
¬On dirait qu’elle ne t’entend
pas, murmura la vieille.
¬En effet, affirma l’enfant, tout
étonné.
¬Alors, appelle ta sœur.
¬Sarito ! Rosaritooo !
Pas la peine de pleurer.
¬Je ne pleure pas. C’est cette
maudite toux. Appelle encore.
¬Rosaritooo !
¬Non, elle ne répondra pas. J’ai
toussé millante
fois sans qu’elle me gronde…
¬Sûr qu’ils sont tous allés au
jardin du Sourdingue. Je vais jeter un œil par-dessus le mur.
¬Non, non, Falico ! Ne va pas
dans la basse-cour ! N’y va pas, mon cœur.
Mais lorsque la gémissante mise en garde parvint aux
oreilles de l’enfant, une serre était déjà sur sa bouche et le froid acier
tiédissait dans le sang qui irriguait son cœur. Comme la vieille tendit
l’oreille ! Avec quelle violence elle chercha à se lever ! Et au prix
de quelles sueurs glacées d’agonisante elle tenta de bouger ses jambes sans
vie ! Comme ses yeux examinèrent la paroi, tels des oiseaux aspirant à
s’enfuir ! Avec quelle incroyable énergie elle désira ardemment que la
Faucheuse ne pût l’arracher de son fauteuil ! Entendit-elle le ronflement
aigu et horrible qui jaillit d’une trachée ouverte lorsqu’en sort un souffle
qui voudrait, sans y parvenir, se muer en malédiction, en hurlement ou en
sanglot ? S’avisa-t-elle qu’une force surnaturelle faisait pâlir la
lumière, troublait et refroidissait l’atmosphère ? Perçut-elle quelque
frôlement visqueux ou quelque odeur pestilentielle ? Peut-être pas. Mais,
lorsque le monstre apparut, elle lut clairement dans son sourire félon et dans
son regard fatidique, que c’était la Mort qui lui faisait face ; aussi
s’en remit-elle à la divine miséricorde.
¬Mon Dieu !, gémit-elle sous
l’emprise d’une épouvante infinie. Seigneur Dieu, recueille mon âme… Au nom du
Père, au saint nom du Père !
Et la lame mit fin à l’ouvrage de la terreur.
Rubans Rouges
écarta du pied le cadavre, plus léger qu’un sac de plumes, et se contenta de
formuler une pieuse pensée : « La voilà à peine plus morte
qu’avant ». À peine plus morte, et lui, beaucoup plus serein, réjoui et
confiant. Si totale était sa confiance, qu’il sortit sans précaution de la
pièce, et ne vit pas qu’un petit corps s’agitait sous les couvertures de son
berceau sous l’effet d’une horrifique fébrilité, il n’entendit pas le faible
bruit d’un grincement de dents, et ne fut pas alerté par le battement sourd
d’un tout petit cœur, éperonné par l’épouvante. Tout était pour le mieux. Dans
la ferme, pas d’autres poumons que les siens ne respiraient et personne ne
pourrait le dénoncer. Quant à ceux qui respiraient encore au milieu des
oliviers, il leur restait si peu de temps à vivre ! Ils l’avaient vu, lui
avaient parlé ; ils l’accuseraient, sans nul doute, et même, s’ils
parvenaient à le surprendre, ils se jetteraient sur lui comme des bêtes féroces
pour le dépecer. Non, non ! La pelle et l’acier ! Crânes enfoncés et
gorges grand ouvertes ! Il ne pardonnerait pas par bêtise, ne cèderait pas
par peur, n’agirait pas comme une brute. Ils devaient succomber l’un après
l’autre, sans précipitation ni faiblesse, sous l’effet de la terreur et de la
surprise, comme les autres.
Il se montra à la porte et cria :
¬Eh ! petit père
Rafael !
¬Qu’est-ce qu’il y a ?
¬Votre fille veut vous parler.
¬J’accours.
Il guetta à travers la fenêtre de la cuisine et vit Gros
Pif monter avec agilité le raidillon, et il remarqua qu’il chantonnait.
¬Du diable s’il se figure qu’il va mourir,
marmotta-t-il. Il arrive à toute vapeur et en chantant, comme s’il allait à une
noce et non à un enterrement, pourtant il a dû entendre Colonel. Les humains
ont moins d’instinct que les chiens !
Effectivement, le vieil homme, ragaillardi par la
tiédeur, la lumière et les parfums de Mai,
avançait d’un pas rapide et joyeux, rempli de soleil, sans soupçonner que de sa
bouche édentée plus aucune chanson ne sortirait, et que ses yeux ne se
plongeraient plus dans l’azur resplendissant du ciel, parce que chacun de ses
pas était un coup de bêche de plus dans le creusement de sa tombe. Il s’arrêta
sur la terrasse et caressa la corneille, qui lui était attachée.
¬Bonjour, compagnon, gambettes de
danseur. Tu as faim ?
L’animal aux gambettes de danseur frappa de son bec
rouge la jambe du pantalon du paysan, et croassa joyeusement.
¬Croa, croa, croa, croa !
¬Je sais bien que tu t’appelles
Johan,
mon petit.
Rubans, dans
sa cache, serrait le manche avec tant d’impatience qu’il dut se contenir pour
ne pas sortir hors de la maison et agresser le vieux.
¬Croa, croa, croa, croa !
¬C’est bon, viens mon joli. On
trouvera bien quelques miettes.
« Johan » entra le premier, ses ailes
déployées, se balançant comiquement, à sa suite Gros Nez, qui riait aux
éclats et se baissa pour le prendre. Ainsi, comme s’il cherchait un billot pour
lui offrir sa tête, il reçut le terrible coup et mordit la poussière, la nuque
brisée.
« Johan », de grosses taches rouges sur sa
casaque de deuil, s’enfuit en croassant et Rubans Rouges, avec un
raffinement de prudence, traîna sa victime, l’égorgea dans la basse-cour et
recouvrit d’une peau de mouton le sang qui salissait le sol de la cuisine.
Immédiatement après, il attira un autre condamné.
¬Oh ! Bien Léché,
hurla-t-il, Bien Léché, holà !
¬À vos ordres, exclama
l’interpellé.
¬Dis au Sourdingue de
venir. File-lui en une, qu’il vienne vite.
Bien Léché
répliqua en riant :
¬File-la lui toi-même, je ne suis
pas doué pour ça.
Sûr qu’il allait la lui en filer une ! Avec
plaisir même, parce que le père Pierre, qui était aussi fort que son compère,
se vantait d’être un client sérieux et un type vaillant, et lui, les clients
sérieux et les types vaillants le faisaient vomir. Personne n’était plus
sérieux ni plus vaillant que le fils de sa mère. Les six qui étaient couchés là
pouvaient en témoigner avec leurs plaies ; mais ils étaient bien en peine
de parler.
Il regarda à nouveau à travers la fenêtre et contempla
le Sourdingue qui, après avoir repris son souffle, approchait d’une
allure majestueuse.
¬Je le tiens, murmura-t-il, se
tenant prêt.
Mais le quarantenaire, sans doute surpris par le
silence, se planta face à la maison, comme un mulet soupçonneux, puis annonça
sa présence à grands cris :
¬Il est là le patron !
Le fou furieux était indigné. Sa nouvelle cible,
pourquoi n’entrait-elle pas ? Avait-il flairé quelque chose ? De quoi
avait-il peur ?
Après avoir répété son modeste ou hautain « Il
est là le monsieur ! », le Sourd poursuivit à grands cris :
¬Rafael ! Père
Falico ! Mame Antonia ! Holà !
Le bourreau se garda de souffler mot et le journalier,
l’inquiétude peinte sur son visage, après avoir inspecté attentivement du
regard la maison, exprima ses soupçons en formulant à voix haute une
supposition mal venue :
¬Ou ils sont partis, ou ils sont
devenus sourds, ou ils sont tous morts d’un coup.
Mais, comme il était bien décidé, au lieu de reculer,
il puisa dans l’inquiétude et la surprise la force d’avancer : ayant arraché
une verge, il se dirigea lentement vers la maison.
¬Allons-y voir !
s’exclama-t-il.
¬Ni voir ni entendre ! dit Rubans,
l’assommant d’un coup ahurissant. Crève, gros lourdaud ! Crève à mes
pieds !
Il l’égorgea sans nécessité, comme il l’avait fait
pour Gros Pif, près de l’appentis. Il jeta son cadavre sur celui du
molosse et, avec une impavidité orgueilleuse, il contempla le terrible tableau.
Il y avait six morts, en comptant Colonel, qui avait manifesté plus de
perspicacité, de force et de vigueur que beaucoup de ces humains. Parmi les
défunts, dont le sang formait des rigoles et des flaques dans la basse-cour, il
y en avait deux –Luque et le père Pierre¬ qui, de leur vivant, auraient
déchiqueté un loup avec leurs dents. Cependant, ils étaient là. Vaincus par son
astuce ; mais ils l’auraient été tout autant par son courage. « Ça,
pensa-t-il avec une fierté sordide, personne ne l’a jamais fait avec des humains.
Et avec les taureaux, même pas Guerra qui, pour en tuer sept, dut toréer trois
corridas, un seul dimanche. » En revanche, lui, en moins d’une heure, à
l’aide d’une rustique pelle et d’un bout d’acier, mais avec beaucoup d’habileté
et beaucoup de décision, il avait expédié deux terreurs, un sexagénaire qui
avait autant de cœur que de nez, un chien d’une terrifiante sauvagerie, un
fantôme sans forces, un enfant et deux femmes… Huit adversaires qui avaient
péri de ses mains au cours de cette éprouvante séance, sans même un comparse
pour l’aider et sans les applaudissements pour lui donner du cœur à l’ouvrage. Cela
lui était égal. Ils fêteraient le matador lorsque son exploit serait connu,
ceux-là même qui auraient sonné l’alarme pour le pourchasser, avec l’intention
de le voir gesticuler sur une potence. En guise d’applaudissements, ils lui
offriraient leur curiosité, leur rage, leurs tremblements nerveux, leur pâleur,
leur épouvante.
Tout souriant, flatté par ces pensées, il appela
Sébastien. Mais il ne se cacha pas pour le tuer par derrière ; au
contraire, désireux d’étudier l’effet que produirait son ouvrage sur un
spectateur non averti, il décida de la lui montrer, lui ménageant ainsi,
accessoirement, une mort chrétienne.
¬ Bien Léché, lui dit-il,
dès qu’il fut entré dans la cuisine, tu as les nerfs solides ?
¬Plus ou moins. Pourquoi tu me le
demandes ?
¬Parce que tu vas avoir une sacrée
surprise.
¬De la part de qui ?
¬De tout le monde.
¬Comment ?
¬Si je te le dis, adieu la
surprise. Viens à la basse-cour, ajouta-t-il en riant.
¬Allons-y.
¬Fais bien attention, il y a du
sang sur le pavé, avertit-il aimablement, lorsque Sébastien eut remarqué les
taches. Le pauvre Colonel est devenu enragé et il a fallu l’abattre.
¬C’est maintenant que tu me le
dis ? cria le journalier, pris d’une frayeur subite. Est-ce que Colonel a
mordu quelqu’un ? C’est ça qui serait une surprise !
Il entra précipitamment dans la basse-cour, et Rubans
entendit un cri bref et aigu, qui s’acheva sur un
« hélas ! » brisé.
¬Pas très solides, tes nerfs,
n’est-ce pas ? marmonna-t-il. Bien Léché, tu as un foie de lièvre.
Mais Bien Léché n’était pas un lièvre, parce
qu’un lièvre aurait été au moins capable de courir. Il s’était transformé en
statue, une statue d’angoisse, d’ébahissement et de peur. Le visage blanc comme
du plâtre, les mains inertes, le cœur transi, il détourna son regard des
cadavres, comme s’il était attiré par les yeux terribles de Rubans, et,
fasciné, il fixa ce compagnon qui s’était converti tout à coup en une bête
féroce.
¬Tu es un lièvre, un misérable
lièvre ! répéta le pervers, flatté par l’épouvante glacée qu’il inspirait
au malheureux. Tu devrais avoir honte !
Le paysan approuva plusieurs fois de la tête, et, fasciné
par les pupilles du monstre, se sentant incapable de fuir, tout sanglotant, il
tomba à genoux.
¬Ne me tue pas, gémit-il dans un
filet de voix, le visage trempé de larmes. J’ai toujours été ton ami.
¬Je ne veux pas d’amis aussi minables.
¬Mais, tu veux me tuer pour de
vrai ?
¬Pour de vrai, je le regrette,
parce que c’est assez répugnant. Tu as tout d’une grenouille de bénitier, Bien
Poli.
¬Laisse-moi la vie sauve,
Rafael !
Le misérable devint furieux.
¬Ah çà, es-tu fou ? Sors ton
poignard, allons, et défends-toi, couille molle. Ne sois pas pire qu’une
malheureuse fourmi ! Défends-toi, ou je te démolis à force de
gifles !
¬Bats-moi, mais ne me tue
pas ! Pense à ma mère, Rafael ! Elle t’a si souvent bisé quand tu
étais petit ! Tu vas la priver de son pain ?
¬C’est toi qui l’en prives, en ne
te défendant pas, lâche que tu es !
¬Je ne peux pas, je ne peux
pas !
Fais un effort, couille
molle !
Non, je ne peux pas !
¬Bon, alors, si tu veux mourir
comme un sacristain, fais ta prière. Arrête tes simagrées. J’ai tué tout ce qui
était en vie ici : la vieille, le gosse, Colonel… C’est ton tour
maintenant. Tu n’es pas éternel.
¬Laisse-moi la vie sauve,
Rafael !
¬Pour que tu ailles en courant te
jeter dans les bras du premier garde civil ? Non, tu pourrais te fatiguer !
Sors ton cou.
¬Rafael !
¬Aide-moi, ce n’est pas pour rien
que tu es bien léché.
¬Mais, tu veux me tuer pour de
vrai ?
¬Tu en doutes encore ?
¬Seigneur Jésus-Christ !
balbutia Sébastien, horrifié par l’éclat livide de la lame. Vierge de la Sierra,
protège-moi !
¬Pas ici ! Au ciel, Bien Léché !
Ne pleure pas et sors ton cou une fois pour toutes.
De la main gauche il lui força à présenter son cou, en
appuyant sur le front et, tandis que le malheureux à genoux, saisi par une
angoisse surhumaine et une peur mortifère, se recommandait à Dieu, d’un sauvage
coup de poignard et en une seule taillade, il le mit en état de rejoindre la
source, à la fois consolatrice et terrible, de la miséricorde et du châtiment.
Ayant victorieusement mis un terme à sa tâche, Rubans
constata à la montre de son compère qu’il n’était pas encore dix heures et en
fut tout ébahi. Il avait agi avec une célérité prodigieuse. Il lui restait du
temps pour tout faire puisque, sans se presser, à un pas soutenu, il
rejoindrait la ville, depuis La Fermette, en guère plus d’une heure et demie.
Il pouvait donc opérer calmement. Avec la lenteur du journalier épuisé qui
reçoit son salaire, il ouvrit la maie de Luque, y trouva les douros –
précisément trente au-dessous de la centaine ¬, les empocha et se coucha pour
se reposer sur le banc de la cuisine. On était si bien, sous le soleil, qui,
après quelques jours de pluie, chauffait sans excès ! Et on jouissait
entre ces murs d’une paix si appréciable ! Le pot-au-feu chantait en bouillonnant,
demandant qu’on l’écume ; les poules s’empiffraient de quelques noirs
caillots, dans la crainte qu’on ne les chasse à coups de balai ; la
perdrix sautait dans sa cage, impatiente de se voir sur la terrasse… On aurait
pu croire qu’une femme allait écumer le pot-au-feu, qu’une jeune fille allait
chasser les poules hors de la cuisine, et qu’un homme allait accrocher la cage
sous la treille… Mais, dans ces murs, dans cette atmosphère lumineuse et
paisible, ne respiraient plus ni femmes, ni jeunes filles, ni hommes, ni vieux,
ni enfants, puisque la famille toute entière –son passé, son présent, son
avenir¬ avait été exterminée. Toute entière ?… Tout à coup, le tigre se
souvint de son filleul et se redressa vivement inquiet. Où était Antoñuelo ?
Comment se faisait-il qu’il n’ait pas vu le petit qui pourtant ne s’éloignait
jamais de sa mère. Mais sa mémoire le rassura bien vite : il était prévu
qu’on transporterait le petit à la ville pour l’y faire examiner par les
médecins ; il était sûrement auprès de la sœur d’Antonia, occupé à avaler
des sirops. Il s’en réjouit, vu que, non par méchanceté –puisque si on l’avait
gratifié des dix douros, il aurait continué à être aussi inoffensif qu’une
mouche¬ mais par égoïsme, il aurait assassiné le petit enfant, comme les autres,
pour l’empêcher de le dénoncer. Et le petit était si mignon !… Il
comprit que, s’il pensait trop au gamin, il finirait par s’attendrir et, pour
éviter que cette affection, qui le désarmait, ne l’exposât à se montrer faible,
il voulut raffermir à l’aide de quelque réfection son estomac. La viande du
pot-au-feu, à demi crue et fibreuse, se moquait de l’appétit le plus
féroce ; mais les boudins invitaient à y mordre, aussi Rubans en
détacha un et, interrompant toute activité mentale, se mit à manger. Qu’arriva-t-il
tout à coup ? Quel bruit prétendait rivaliser avec celui de ses
mâchoires ?
¬Toc, toc, toc !
La bouche ouverte, il écouta sans rien entendre ;
mais, à peine l’avait-il refermée pour mâcher, il fut à nouveau alerté par le
léger bruit :
¬Toc, toc, toc !
¬Des gouttières alors qu’il ne
pleut pas ? se dit-il à lui-même.
C’étaient bien des gouttières ; de modestes
petites gouttes, des billes d’une écarlate liquide, prisonnières de quelque
veine pour faire battre un cœur, et qui, en recouvrant la liberté, avaient
traversé un tas de blé et quelques planches mangées des vers, puis tombaient
bruyamment et, brodaient une mare de carmin sur un tapis de soleil.
¬Toc, toc, toc !
Quoi de plus ridicule ! Pour le coup, il avait
découvert la cause du bruit et la découverte, si elle ne l’avait pas vraiment
troublé, ne contribuait pas non plus à lui redonner du courage. Le triste
dégouttement n’avait rien d’insolite, ni de surprenant, ni de menaçant et,
pourtant, l’assassin en avait été troublé.
¬Toc, toc, toc !
Des billes si petites, pourquoi tombaient-elles aussi
vite que si elles avaient été de plomb et pourquoi faisaient-elles tant de
bruit en s’écrasant ? … Et pour quelle raison rougissaient-elles à ce
point la lumière ? Et par quel prodige resplendissaient-elles sur le sol
comme des braises ?… Il craignit que ce sang, qui aurait teinté de rouge
le sommeil du criminel le plus endurci, fît rougir la maison, les arbres, les
nuages et, pour ne pas être trahi par la miraculeuse rougeur, il sortit
prestement de la ferme et s’éloigna.
III
Le père Alguazil protesta en riant aux éclats.
¬Non, mon petit Rubans, ou
on devra me ramener couché sur la monture ! Et alors, qui te ramènera,
toi ?
¬C’est bon. Disons que ce sera l’avant-dernier.
¬On en a déjà avalé vingt !
Même la verrue de mon nez est bourrée !
¬Et après ?
¬Tu es riche à ce point ?
Pourtant ton oncle disait qu’à moins de découvrir une mine d’or tu ne pourrais
pas quitter la campagne…
¬Pas d’autre mine que mes économies.
Trente douros comme trente soleils,
enterrés ; même la terre qui les recouvrait ne le savait pas ! Trente
douros qui, une fois que je les aurais mangés, me donneront autant de maux de
ventre. Mais, je ne suis pas homme à rater Guerra ?
¬Faut-il que tu aies la passion des
taureaux ! dit le père Alguazil, avec bienveillance.
Rubans Rouges
frappa des mains et se mit à hurler :
¬Garçon ! Tu dors ou quoi,
maudit feignant.
Ils étaient dans la cour d’une taverne, près d’une
table couverte de verres, au milieu des paysans et des maquignons.
¬Tu viens juste d’arriver ?
demanda le vieux.
¬Penses-tu ! À midi. J’ai
déjà eu le temps d’aller dans la rue du matador, pour voir sa maison, et dans
la rue Gondomar, pour faire un tour au club et j’ai fait plus de tours dans
l’avenue du Gran Capitán qu’un mulet de noria.
Dans des occasions pareilles, le tout est de ne se refuser aucun plaisir.
Le garçon, d’une saleté repoussante,
se présenta et s’excusa poliment.
¬Mille excuses. Même en courant
comme un fou, pas moyen de faire face à cette heure. Qu’est-ce que vous
prenez ?
¬La même chose, répondit Rubans
Rouges.
¬Pour les trois ?
¬Je t’ai dit la même chose,
non ? Et ne cours pas, vole, parce que je vais à la corrida, mon petit
chou.
¬Je vole.
Comme les gens s’en allaient, le lambin, moins
sollicité, les servit avec une relative promptitude.
¬Ma tournée, messieurs… Un verre
pour monsieur, dit Rubans en plaçant un verre
de montilla devant le père Alguazil; un autre pour vous et un autre pour l’ami,
qui va se remettre à marcher ! Et comment, qu’il va se remettre à
marcher !
« L’ami », en l’occurrence la montre cassée,
brillait au fond d’une coupe large, pleine à ras bords de vin, telle un
crustacé chimérique.
¬Alors, proposa l’amphitryon, on
avale notre petit crabe ?
¬Vas-y toi, répondit l’invité,
avec une moue de dégoût.
¬Ben, à la revoyure, mon petit
Jésus.
Il vida la coupe en trois ou quatre gorgées, sans
reprendre son souffle ; il feignit d’avaler par inadvertance la montre et,
pour mettre un comble à la plaisanterie, il la cracha à la face du garçon.
Puis, flatté par les louanges qu’on lui adressa, il se retira après avoir
acheté une miche de pain, quelques bouteilles et de la charcuterie.
Devant l’entrée des arènes, il dit au revoir à
Alguazil.
¬Amuse-toi bien, Rubans.
¬S’il reste des billets, je vous
invite.
¬Tu sais bien que les bêtes à
cornes me font peur.
¬Quel drôle d’homme vous
faites !
Sur les gradins, le public des passionnés
était si serré qu’il était difficile de se glisser, non seulement dans les
gradins du haut, mais même dans ceux du bas, où ceux qui y prenaient place
étaient condamnés à ne rien voir du spectacle. Mais notre journalier ne s’en
soucia pas le moins du monde, qui cala ses fesses dans le premier fauteuil du
premier rang qu’il trouva libre, aussi à l’aise que si c’était le sien.
¬Bien le bonjour… aux guerristes,
s’exclama-t-il, enveloppant dans la salutation d’un homme poli la profession de
foi d’un homme intransigeant.
Ses voisins, qui appartenaient au beau monde, le
regardèrent sans répondre, et déjà il fronçait le sourcil pour renouveler son
salut avec plus d’énergie, lorsqu’un hidalgo très gros, lui montrant un bout de
papier, l’interpella :
¬Voulez-vous avoir la bonté ?
¬La bonté de quoi ?
¬De me rendre ma place ?
¬Non, monsieur. Je n’ai pas la
bonté.
Le gros homme le regarda, stupéfait.
¬Mais, mon ami…
¬Pas d’ami qui vaille. Je suis
arrivé avant vous et personne ne me fera lever.
¬C’est ce que nous allons voir.
Placeur ! Par ici !
Le placeur s’approcha.
¬Qu’y a-t-il pour votre
service ?
¬Indiquez-moi ma place. Voici mon
billet.
¬Vous devriez le faire encadrer,
marmonna Rubans, en riant.
Le placeur, intimidé, tourna et retourna le billet,
puis s’exclama avec une naïveté sympathique :
¬Messieurs, je suis novice, vous
comprenez ? C’est ma première journée comme placeur. Je ne connais rien à
ces histoires. Pardonnez-moi. Ça ne s’apprend pas au berceau.
¬Je ne vois pas de quelle histoire
vous parlez, affirma le paysan. Je ne bougerai pas, c’est tout. Regardez les
arènes. Vous croyez que je vais tuer un enfant du Bon Dieu pour une place aux
gradins ? Autant en tuer un pour une place numérotée !
¬Vous avez dit
« tuer » ? demanda le lardibineux,
de plus en plus furieux. Qui parle de me tuer ?
¬Celui qui est assez grand pour
vous flanquer dehors. Et ne grognez pas, monsieur le Dégoûté, je sens que je
vais vous faire désenfler de peur.
¬Moi, espèce d’animal ?
Sans se laisser intimider, il se jeta sur le paysan,
qui leva la main droite pour le recevoir avec un coup de poing ; mais il se
retint et les autres spectateurs, par pur égoïsme, tranchèrent.
¬Enfin, messieurs !
¬Au nom de Dieu !
¬Ça n’est pas croyable !
¬Il ne m’a pas menacé,
peut-être ? criait le gros.
¬Et vous, vous n’avez pas voulu me
chasser, peut-être ? répliquait le paysan.
Mais les trompettes sonnèrent et comme, chez le
monsieur adipeux, la colère ne pouvait être plus fugace, et chez Rubans,
plus grand le désir d’applaudir son matador, ils se calmèrent et, à la grande
satisfaction de leurs voisins, celui qui l’avait payé prit ses aises sur le
siège et son premier occupant s’assit sur le dossier.
À l’apparition des toréadors, le journalier, ébloui,
tout tremblant, à moitié fou, commença à crier :
¬Olé ! Vivent les vaillants
fils de Cordoue ! Vive la patrie du toreo !
Lorsque les combattants eurent abandonné leur cape
d’apparat, il s’adressa à Guerra, remplissant l’arène d’une voix de
stentor :
¬Pas de pitié pour le nattier,
Rafael ! Fais-en une figue molle, que je le mette à sécher.
Il y eut quelques exclamations imprécatoires, mais
elles furent étouffées par les applaudissements et les rires, et le rustre en
fut tout flatté. Désormais, avec la constance d’une machine, l’entêtement d’un
sauvage et une jubilation irrationnelle, il parla et discuta avec partisans et
adversaires, s’interrompant de temps en temps pour s’adresser aux toréadors,
les louanger, les offenser ou simplement rugir. Lorsque Guerrita approcha son
premier taureau, comme Espartero avait tué le sien avec tant de courage que le
fou furieux n’avait pu l’insulter –ce dont il enrageait¬ pour se venger, il
offrit au sévillan
un conseil qui ne brillait pas spécialement par sa bienveillance :
¬Prends-en de la graine, Nattiérillon ;
tu ne sais même pas marcher ! Prends-en de la graine, pataud.
Et, pour comble d’ignominie et au grand désespoir du
conseilleur, « le pataud » ne reçut pas seulement une leçon de bien
marcher, mais plusieurs leçons de bien s’enfuir, parce que Guerrita, effrayé
par la nature déloyale du cornu, le toréa en sautillant, avec l’agilité d’un
prestidigitateur ; et traîtreusement, comme un père de famille prudent
aurait abattu une panthère, il l’assassina, enfonçant son épée de côté dans son
cou.
Le public, à l’exception de quelques douzaines d’espartéristes
atrabilaires qui sifflèrent le matador et applaudirent le taureau,
fit l’éloge du héros cordouan pour son adresse et sa science. Comme il s’était
montré habile à planter son épée basse et comme il s’était bien vite aperçu que
son ennemi était un malotru et que nul ne pouvait briller face à lui !
¬Mon œil, messieurs ! hurlait
Rubans Rouges, abaissant de son index la paupière inférieure de son œil
droit. Mon œil, vous dis-je, le taureau en savait plus à lui tout seul que deux
greffiers réunis.
¬Et s’il avait touché celui du
sparte ? grogna l’obèse, en riant sous cape.
¬Eh bien, il le mettait en
pièces ! Jamais vu un bœuf pareil !
En revanche, la troisième bête, à la fois réservée et
fourbe, plus corpulente, plus forte et plus craintive, ne lui sembla pas
difficile à vaincre ;
aussi, quand le toréador sévillan, après l’avoir dominée avec une cape pas plus
grande qu’un foulard et un cœur de lion, l’eut abattue en se couchant de tout
son long sur le frontal et en enfonçant l’épée et sa garde dans la croix,
tandis que le public manifestait un enthousiasme tumultueux, Rubans Rouges se
contenta d’exprimer un jugement méprisant :
¬Du pur hasard ! Un homme qui
court au suicide et qui ne meurt pas parce que son heure n’est pas encore
venue.
Puis il ajouta avec indulgence, lorsque le vainqueur
se fut retiré vers la barrière :
¬Bien, pataud, bien ! Tu as
le courage du désespoir ! Envoie un câble pour qu’on enguirlande la
Giralda.
Il s’exprimait avec calme, cachant son dépit sous un
grand sourire, mais son amour-propre blessé saignait abondamment. Son champion,
qui incarnait l’art, la force et la maîtrise, serait-il vaincu par ce petit
bout d’homme mal habile, qui se tenait à peine sur ses jambes, qui n’avait
jamais su faire qu’un quite
et trois passes, qui ne savait que risquer sa vie au moment de tuer ? Une
foule sans dignité et dégénérée applaudirait à cette énorme injustice ? Il
regarda dans le couloir pour ne pas voir le toréador qui continuait à saluer,
ni le public qui le fêtait encore. Un mot isolé qui parvint à ses oreilles lui
fit tendre l’oreille. Le mot « crime » avait été prononcé par un
policier qui s’adressait très respectueusement au gros monsieur. Ce denier,
très intéressé, l’interrogeait :
¬C’est si terrible que ça,
Séraphin ?
¬Imaginez : huit morts.
¬Et les assassins ?
¬On n’a pas encore de détails. La
chose s’est passée dans une petite métairie qui s’appelle La Fermette. On
soupçonne une bande de Gitans.
¬Mon Dieu, mon Dieu !
¬On raconte qu’il y a des morts
partout : dans la chambre, dans l’alcôve, dans la basse-cour… Une
boucherie !
¬Mon Dieu ! Maudits Gitans !
Le corps de Rubans Rouges s’emplit de toute
l’allégresse du soleil des arènes. Les Gitans, bien sûr, les Gitans ! Il y
avait là de quoi occuper un bout de temps juges, geôliers et bourreaux.
Le policier s’éloigna et l’adipeux don José, en
tressaillant, murmura :
¬Huit ! Que c’est horrible,
horrible !
Il eut la tentation de contredire le ventru !
Pourquoi horrible ? Ne fallait-il pas mourir un jour ? Qu’est-ce qui
était horrible : la mort ? Bah ! Ce qui était horrible, c’était
la faim, la souffrance, la maladie…, autant de démons qui n’étaient jamais
entrés à La Fermette. La Fermette !… Il se la rappelait vaguement, comme
si plusieurs années et non quelques heures s’étaient écoulées depuis le moment
où il s’y était rendu. La toux de la vieille, le bec rouge de
« Johan », les mugissements du compère, la confusion de la jeune
fille, les sanglots du raffiné… Puis, la gouttière, la seule chose qui l’eût
alarmé : « Toc, toc, toc ! ». Tout le reste… Tout le reste
lui paraissait si ancien et si confus !… Cependant, il y avait de quoi
épater les gens, les faire tressaillir, épouvantés, comme le ventru. Si on
avait révélé de but en blanc à ce pauvre don Pepe
la prouesse de celui qui le serrait entre ses mollets, quel saut de cerf
n’aurait-il pas effectué pour se lever et s’enfuir !
¬Vous prendrez bien un morceau,
l’ami.
¬ Sans façon.
¬Pas de façons. Et vous,
ajouta-t-il en s’adressant à ceux qui l’avaient soutenu, servez-vous aussi.
Moi, à la corrida, j’aime régaler ceux qui sont à mes côtés. Je le fais de bon
cœur, et comme je le fais de bon cœur, ou vous partagez ma collation ou vous
vous battez avec moi. À vous de choisir.
¬Dans ce cas, manifesta
jovialement don Pepe, tant qu’à choisir entre un morceau de jambon et une
tarte, sans hésitation je choisis le jambon.
¬Va pour le jambon.
Rubans
répartit le tout puis, tout fier et tout excité par le spectacle de l’arène, se
mit à dévorer gloutonnement. Le quatrième cornu, très brave, fonçait avec une
furie aveugle, subissait les coups de piques sans broncher, comme s’il était de
bronze, et repoussait, culbutait et dépeçait les haridelles avec une violence
implacable. Le rustre, hors de lui, s’agitait comme si, depuis sa place, il
avait voulu aider l’animal à éventrer les chevaux, à briser les planches, à
enfoncer les côtes des picadors. Il criait, hors de lui :
¬Va-s-y, taureau ! Va-s-y,
taureau brave ! Frappe, frappe ces incapables ! Pas de pitié !
Guerra, dans un quite, s’agenouilla et essuya au
passage le museau de l’animal, et ce trait d’audace enthousiasma le paysan.
¬Olé, olé, vive la mère qui t’a
mis au monde, roi de l’univers ! Vous avez vu comment il a mouché la bête,
comme si c’était un morveux ?
Il ajouta, menaçant Espartero d’une bouteille.
¬Allez, va-t’en cueillir ton
sparte, incapable, couille molle ; je m’assieds
sur la Tour de l’Or et même sur l’ange de la Giralda !
Tandis qu’on bandérillait la bête, Guerrita, qui avait
sauté dans le couloir pour qu’on lui rattache un lacet,
accrut sa jubilation par quelques paroles inoubliables. Le gros, qui était
l’ami du toréador, ¬cette supériorité le grandit beaucoup dans la considération
du coupe-tête¬, lui demanda amicalement :
¬Il te plaît, le petit tacheté,
Rafael ?
¬Il est parfait. Grâce à Dieu,
parce que j’en ai ma claque des bêtes sournoises.
¬Que la chance soit avec toi.
¬Comment pourrait-il en être
autrement ? répliqua l’artiste avec superbe. Je vais lui faire une passe
aidée, une autre naturelle pour préparer une passe de poitrine, une par le haut
et une autre aidée par le bas, pour le mettre d’aplomb.
Et une fois d’aplomb, je me jette sur lui et je me retourne un ongle sur son
cou,
et d’une seule estocade je le réduis en cendres.
Sitôt dit sitôt fait. Guerrita, fidèle à ses
prédictions, dessina les cinq passes en une minute et infligea, à la vitesse
d’une flèche, une terrible estocade. Comme une rafale, une exaltation délirante
priva dix mille humains de sens commun. Rubans Rouges, qui pleurait,
tapait des pieds et applaudissait, hurlait de surprenantes trouvailles :
¬Vive Cordoue ! Vive son
saint patron, Rafael, et vive le Calife !
Voilà ce que j’appelle toréer et tuer, tas de cochons ! Prends ça dans les
gencives ! Eh va donc, toi et ta tour de l’Or, que lâcha le cul du More !
Si tu pouvais en crever de dégoût !
Les autres messieurs, y compris don José, les uns
pâles les autres rouges, criaient du plus fort qu’ils pouvaient et
fraternisaient désormais avec le fier-à-bras au poignard. Ils le prenaient pour
un homme tout d’une pièce, sympathique au possible, doté de poumons à vous
faire tomber à la renverse. Ils échangèrent des propos affectueux, commentèrent
le triomphe de l’habile toréador, lorsque le fracas des applaudissements se fut
éteint, sans gâter les éloges par des blâmes à l’intention du toréador vaincu,
que même Rubans Rouges sembla prendre en pitié. Ils auraient poursuivi
ainsi jusqu’à la fin du spectacle à échanger des politesses, à boire à la même
bouteille, à s’offrir mutuellement des amabilités, s’ils n’avaient été
interrompus par un horrible accident. Guerrita, le colosse, le prodige,
l’invincible, eut une distraction digne d’un vulgaire toréador de village et
une bête stupide le fit voler en l’air comme un pantin, l’enroula entre ses
cornes et le jeta à terre avec une fureur sauvage. Lui, rien moins que
Guerrita !… Don Pepe et les autres messieurs qui conversaient avec le
paysan se précipitèrent aux nouvelles auprès des médecins. Quelques spectateurs
poussèrent des cris d’hystériques ;
d’autres s’en remirent avec une confiance aveugle à la divine Providence, et
jusqu’au moment où on apprit que le glorieux champion n’avait subi que de
légères contusions, personne ne s’intéressa à ce qui se passait dans l’arène.
Et moins encore que le guerrista le plus affolé, un petit vieux dont le nez
était décoré d’une verrue rouge, qui, portant un enfant émacié dans les bras,
entouré de gardes civils moustachus et graves, parcourait les arènes inspectant
attentivement les rangs de spectateurs.
Espartero toréait déjà avec la muleta et Rubans
Rouges, dont la frayeur causée par l’incident avait aiguisé la langue, le
harcelait, déversant sur lui le meilleur de son répertoire d’insultes. Il salua
le premier coup d’épée manqué par le toréador d’un petit rire sarcastique et de
plusieurs remarques chargées de venin ; puis, à chaque tentative nouvelle,
à mesure qu’il enfonçait un peu plus profondément son épée, il s’empressa de
vider le sac de ses insolences, de ses grossièretés, de ses impudences afin de
libérer son corps de cette pourriture avant que le taureau ne s’écroule. Mais
le taureau, fort comme une montagne, ne voulait pas rouler sur le sol et,
malgré trois coups d’estoc sur la bosse, avalant son propre sang, il s’appuyait
sur la barrière pour éviter de tomber.
¬Quel martyre ! rugit le
paysan. Tu n’as donc pas de pitié, tu as des tripes tannées ?
Tu n’as même pas appris à égorger, incapable que tu es.
Alors, le petit malade l’entendit, cacha son visage
dans les bras du vieux à la verrue, et, de peur, ses dents grincèrent.
¬Qu’est-ce qu’il y a, Toinin?
¬Là-bas, là-bas !
Les gardes entourèrent l’enfant.
¬Ne pleure pas, mon tout beau. Qui
as-tu vu ?
¬Le compère ! Il va nous
tuer !
¬Tu l’as vu où ?
¬Là-bas, là-bas, en bas.
Alors, ils le découvrirent tous.
¬C’est bien lui, père Alguazil?
demanda un garde.
¬Oui, c’est lui.
¬Allons-y. La chance soit avec
nous.
Ils se concertèrent et aussitôt, lorsque deux d’entre
eux furent parvenus dans le passage, deux autres se placèrent derrière le siège
et un policier interpella le misérable :
¬Pas un geste, Rubans.
Mais Rubans Rouges, qui ne l’avait pas entendu
et n’avait même pas remarqué les tricornes, ne songeait pas à fuir. À l’adresse
du toréador qui, le visage décomposé par la colère, piquait le taureau sur le
museau pour lui faire baisser la tête et pouvoir ainsi l’achever,
Rubans Rouges bramait son indignation la plus généreuse :
¬A la potence, à la potence ! On ne fait pas ça à
un taureau, assassin !
Cf. la note 33 du commentaire.
Les antécédents
LES ANTÉCÉDENTS
Un
motif traditionnel
Antonio
de Hoyos propose une possible source dans l’affaire du paysan du Cagitán, contrée
de la province de Murcie, qui, à une date indéterminée mais qu’il prétend
antérieure à la publication de la nouvelle de López Pinillos, aurait tué quatre
personnes, les aurait dépouillées puis serait allé à la corrida de la foire de
Cieza[1]. Cette tradition locale mérite d’être signalée, car
elle renvoie à un corpus plus ou moins légendaire dont le caractère diffus et
intemporel peut avoir influencé, consciemment ou non, un créateur tenté par un
sujet proche. Elle propose même une conclusion, – après le crime, il se
rendit aux arènes -, qui s’apparente à une formule finale de conte
traditionnel[2]. Il ne faut donc pas écarter d’emblée cette influence
possible, même si d’autres affaires criminelles avérées constituent des
antécédents bien plus plausibles.
Le
crime de Cintas verdes (Rubans verts)
Cordoue 25 (soirée)
La foire, favorisée par un temps superbe, est très
brillante.
Sur le marché, on observe beaucoup d’animation,
particulièrement dans les transactions de bétail bovin et ovin.
On effectue aussi beaucoup de ventes de poulains et de
juments.
Valdelomur. El Imparcial, 26 mai 1890
Le
27 mai 1890, jour de la Foire de Notre-Dame de la Santé[3] à Cordoue, est ensanglanté par un effroyable
fait-divers. Lors de sa visite quotidienne à la ferme El Jardinito,
propriété du Duc d’Almodóvar del Campo, au nord de la ville, sur la route du
sanctuaire de Scala Cœli, le récoltant chargé de retirer les caisses d’oranges
fraîchement cueillies découvre un épouvantable carnage : trois cadavres,
ceux du fermier et des deux jeunes enfants du maître-valet ; deux
agonisants, la femme du valet-maître, ainsi que le garde affecté à la
propriété.
Cet
événement eut un retentissement considérable, tant dans la presse locale que
dans la presse nationale[4]. Dès son édition datée du lendemain, 28 mai, le grand
quotidien de Madrid, El Imparcial, publie sous le titre Cinq
assassinats, la paraphrase du télégramme adressé par le gouverneur de la
province au ministre de l’Intérieur. Il revient sur le sujet, le jour suivant,
se fondant cette fois sur le témoignage d’un voyageur débarquant du train de
nuit.
Les
faits, tels qu’ils ont été reconstitués pendant l’instruction et résumés dans
le questionnaire soumis aux jurés avant leur délibération, sont les suivants.
L’assassin
s’appelle José Pérez Cintabelde Pujazón. Ce jeune homme de vingt-sept ans,
grand et bien proportionné, est originaire d’Almeria. Il vit et travaille à
Cordoue depuis plusieurs années. Il y exerce des métiers divers, dont celui de
maçon. Il n’a pas d’autre antécédent pénal qu’une condamnation pour jeux
interdits (15 juillet 1889). Il se présente à dix heures du matin, le 27 mai,
dans l’exploitation El Jardinito, à cinq kilomètres de Cordoue, dans
l’intention de dérober le produit de la vente d’un attelage de vaches réalisée
par le maître-valet à la foire qui a lieu à cette époque. Il y rencontre la
femme de ce dernier, âgée de trente-quatre ans, en compagnie de ses deux
filles, âgées respectivement de six et deux ans, le fermier qui loue
l’exploitation au duc et le garde de la propriété.
La
venue de Cintabelde ne surprend pas les personnes présentes car lui et sa
maîtresse, Teresa Molinero Galloso, entretenaient des relations amicales avec
le maître-valet et sa femme, Antonia, à l’époque où Teresa était la nourrice de
la dernière-née du couple. Depuis la mort du bébé, leurs relations se sont un
peu refroidies mais pas au point d’interdire à Cintabelde l’accès à El
Jardinito.
Sous
le prétexte de lui faire cueillir un demi cent d’oranges, le jeune homme
entraîne le garde à l’écart dans l’orangeraie et, tandis qu’il est occupé à
cueillir les fruits sur son échelle, il l’abat, sans crier gare, de six coups
de poignard. Puis, il pénètre dans la maison, dans laquelle il trouve Antonia
et ses enfants. Il tire une balle de son fusil à deux coups dans la tête de la
femme puis se retourne contre le fermier, accouru au bruit de la détonation,
auquel il inflige une première blessure à l’arme blanche au visage, avant de
l’achever d’un coup de fusil à la tête. Il se saisit de l’aînée des petites
filles, qui tentait de s’enfuir pour donner l’alerte, et lui tranche la gorge.
La mère de l’enfant parvient à se relever en poussant des cris ;
l’assassin décharge à nouveau son arme sur elle, l’oblige à avouer où est caché
l’argent, puis tire à nouveau en la visant à la tête, sans parvenir toutefois à
la tuer. Cintabelde égorge alors la petite fille de deux ans, dernier témoin du
massacre, après l’avoir conduite à l’étage.
Dans
la chambre où Cintabelde commet son dernier forfait, se trouve le coffre
contenant l’argent la maison. Il s’empare de cent-vingt-cinq pésètes en argent
dans une bourse et vingt dans un porte-monnaie, ainsi que d’un fusil. Il
abandonne les lieux sans être vu par personne, la propriété étant isolée. Dans
un ruisseau, il lave les traces de sang les plus voyantes et se débarrasse du
porte-monnaie et du fusil. Puis il se rend chez sa maîtresse, dans le quartier
de Santa Marina de Cordoue (rue Empedrada, n° 5), se change, déjeune avec
appétit et se rend aux arènes pour la corrida. Peu après le départ de
Cintabelde, le récoltant se présente à El Jardinito, découvre le
massacre et recueille des lèvres du garde qu’il a été assassiné par
« celui qui était là hier ». Il s’empresse de dénoncer le fait à la
Garde Civile. Le lieutenant qui se rend sur place apprend d’Antonia la
véritable identité de l’assassin : « le mari de la nourrice qui a
allaité ma fille, qui s’appelle José Cintabelde ». Connaissant sa passion
pour les taureaux, les autorités ne doutent pas que Cintabelde se soit rendu à
la corrida. Aussi décide-t-on de filtrer le public à la sortie des arènes.
L’assassin n’oppose aucune résistance et avoue son forfait.
De
toute évidence, López Pinillos s’est directement inspiré de ce fait divers[5]. Les emprunts sont nombreux.
Le
théâtre des faits se situe dans la campagne proche de Cordoue, ce qui
représente une relative nouveauté dans l’œuvre de cet auteur sévillan. La date
est la même, à savoir la Foire de la Vierge de la Santé, qui se situe à la fin
du mois de mai. La toponymie est également proche : le théâtre des crimes
est désigné chaque fois par deux diminutifs : El Jardinito (Le
Jardinet), dans le fait divers ; El Cortijuelo (La Fermette),
dans la nouvelle. Les victimes appartiennent à toutes les générations, enfants,
adultes, jeunes et moins jeunes. Plusieurs traits de la personnalité du
protagoniste principal de la nouvelle coïncident aussi avec ceux du criminel.
Ils ont le même âge, même si celui de Luarca n’est pas explicitement indiqué.
Ils n’ont d’autre motivation que de trouver l’argent nécessaire à l’achat d’un
billet pour la corrida, dont l’affiche est la même, à un toréador près.
Enfin, le nom du « héros » de la nouvelle ne se comprend que si on le
rapproche de celui de l’assassin. Nous allons commenter chacun de ces points.
Observons
tout d’abord que ces coïncidences ne répondent pas ou pas seulement à une
recherche d’authenticité, ce qui n’aurait, par ailleurs, pas lieu de surprendre
chez un écrivain qui était aussi un journaliste. Elles ont aussi une fonction
narrative évidente car elles participent à l’économie du récit.
Ainsi,
la proximité de la ferme avec Cordoue rend vraisemblable la présence du
criminel, le même jour, à la campagne et à la ville. La foire, qui est d’abord
un marché aux bestiaux, est aussi l’occasion de festivités, dont le clou est la
corrida, ce qui justifie d’avance la rencontre de Alguacil, qui va y
acquérir un mulet, et du passionné de tauromachie qu’est Luarca. De plus, elle
se situe au printemps et se déroule donc à un moment où les disponibilités
pécuniaires des familles modestes sont réelles, dans une région où les récoltes
qui s’effectuent en hiver, les oranges, dans la réalité du fait-divers, les
olives, dans la nouvelle, représentent la source principale de revenus des travailleurs
agricoles. Il en va autrement pour les fermiers qui voient arriver avec quelque
inquiétude l’échéance de la Saint-Jean, pour laquelle ils devront disposer de
la somme due aux termes de leur bail. Cette réalité économique joue un rôle
essentiel dans la nouvelle de Parmeno.
L’auteur
fournit suffisamment de détails sur son personnage principal pour qu’on puisse
le rapprocher du jeune homme de vingt-sept ans, auteur du massacre de El
Jardinito. Les deux jeunes gens, le réel et le fictif, partagent la même
passion pour les taureaux, sont également désargentés, également décidés à se
procurer de quoi profiter de la foire, et trouvent une solution à ce défaut
d’argent aux dépens de familiers[6].
Si
tous ces faits n’y suffisaient pas, le choix du nom du personnage principal, à
lui seul, fournirait un témoignage indiscutable sur l’évidence de ces emprunts.
Le nom de Cintas Rojas (Rubans Rouges), pour le lecteur non
averti, même s’il est disposé à admettre que, dans ce milieu rural, le surnom a
substitué le nom propre dans l’usage courant, est pour le moins surprenant[7]. Ce surnom, qui n’est pas particulièrement viril,
cadre mal avec une personnalité dont la brutalité semble être l’expression
naturelle. D’ailleurs, le narrateur ne prend pas la peine de le justifier, en
se référant par exemple à certain goût vestimentaire de Luarca, alors même
qu’il s’étend sur ce sujet lorsqu’il décrit minutieusement la tenue de fête du
jeune homme. Pour comprendre le choix de ce nom par López Pinillos, il faut
connaître la confusion provoquée par le nom de l’assassin de El Jardinito,
« Cintabelde », peu courant au demeurant, à l’oreille d’andalous
habitués à remplacer la marque finale du pluriel (-s) par une vague aspirée, et
à transformer le son « l » en « r » et le son
« v » en « b ». C’est ce qui fait que le nom que le
lieutenant croit entendre des lèvres de l’agonisante Antonia n’est peut-être
pas celui qu’elle prononce réellement, c’est-à-dire Cintabelde, mais sa
transposition en phonétique andalouse : « Cinta[s] verde[s] »
(Rubans verts)[8]. López Pinillos joue sur cette confusion, la reprend
à son compte, mais sans la calquer : les rubans, de verts, deviennent
rouges, ce qui ajoute une note inquiétante et prémonitoire au personnage ainsi
désigné. Dans le chapitre des prénoms, il faut ajouter aussi la reprise de ceux
du fermier, Raphaël, et de la fermière, Antonia, qui permet au narrateur des
rapprochements suggestifs : Cintas rojas est lui-même prénommé
Raphaël, de même que trois des habitants de La Fermette qu’il trucidera, ce qui
resserre encore les liens affectifs qu’il avait ou aurait dû avoir avec eux.
Quant au petit dernier de cette famille, celui qui désigne l’assassin à la
Garde Civile, il se prénomme Antoine, comme sa mère (Antonia), et comme la
fermière de El Jardinito, dont les ultimes paroles ont permis
l’identification de Cintabelde.
López
Pinillos ne reproduit pas littéralement chacune de ces données. S’il reprend
l’idée de la corrida, il ne retient que deux toreros seulement, Espartero et
Guerrita, omettant Lagartijo, qui figurait pourtant au cartel de la
Foire de 1890. Le fait n’est pas anodin, sachant que ce dernier était le plus
illustre des trois toreros qui intervinrent en cette mémorable après-midi,
qu’il était par ailleurs lui-même cordouan (il fut surnommé « Le Grand
Calife ») et donc tout à fait apte à jouer le rôle dévolu dans la nouvelle
à son cadet Guerrita. Mais le narrateur a préféré le sacrifier au profit d’une
plus grande efficacité narrative, celle d’un affrontement binaire entre le sévillan
Espartero et le cordouan Guerrita, ce qui favorisait l’expression par Rubans
Rouges d’un chauvinisme exacerbé sur un fond de violence et de brutalité
naturelles.
Les
emprunts effectués par López Pinillos à l’événement vont donc bien au-delà
d’une simple recherche de données : ils inspirent sa démarche et lui
suggèrent des effets d’une certaine subtilité.
Cependant,
s’il est vrai que López Pinillos s’est inspiré de ce fait-divers pour écrire sa
nouvelle, pourquoi a-t-il attendu vingt-cinq ans pour le faire ? Quelle
circonstance –privée ou étrangère- a pu le pousser à réactualiser, en quelque
sorte, un évènement aussi ancien ?
La
réponse à cette question est sans doute à rechercher dans les divergences
existant entre le modèle et sa mise en forme littéraire. Elles ne manquent pas
et concernent des éléments importants de l’intrigue : le nombre des
victimes, les techniques employées pour tuer, le mode de dénonciation du
coupable. Faut-il toutes les mettre sur le compte de la liberté créatrice du
romancier ? Ne les a-t-il pas puisées dans une autre source que celle de
1890 ? C’est l’hypothèse que nous défendrons ici.
L’affaire
Redureau
Ce
fait-divers est rapporté et commenté par André Gide dans le premier volume de
la collection « Ne jugez pas », qu’il créa chez Gallimard en 1930[9].
En
1913, dans le village du Bas-Briacé, commune de Landreau, dans la
Loire-Inférieure (Loire-Atlantique)[10], le jeune Marcel Redureau se rend coupable de
plusieurs assassinats dans la ferme où il est employé.
Voici
les aveux de l’adolescent tels qu’ils figurent dans l’acte d’accusation établi
lors de son procès, mais dont ne nous retenons que le strict récit des
événements :
Le 30
septembre, vers dix heures du soir, Mabit [le fermier] et lui travaillaient
ensemble au pressoir. Le patron tenait la barre qui actionne la vis du
pressoir, tandis que Redureau, debout sur la plate-forme, l’aidait dans cette
besogne et secondait ses efforts. Comme le domestique montrait peu d’ardeur au
travail, Mabit lui fit l’observation qu’il était un fainéant et que depuis
quelques jours il n’était pas content de lui.
Sur cette observation,
Redureau, irrité, descendit du pressoir, et s’armant d’un pilon en bois, sorte
de massue longue de cinquante centimètres qui se trouvait à portée de main, il
en asséna plusieurs coups sur la tête de son maître qui, lâchant la barre,
s’affaissa en poussant des gémissements. Voyant qu’il vivait encore, Redureau
se saisit alors d’un énorme couperet désigné dans la campagne sous le nom de
serpe à raisins, dont on se sert dans les vignes, mais qui est destiné à
sectionner la masse des raisins entassés dans le pressoir.
[…]
À l’aide de cet instrument,
Redureau ouvrit la gorge de son maître, qui râlait, et ne tarda pas à rendre le
dernier soupir.
Ce premier crime perpétré,
l’inculpé affirme qu’il eut d’abord l’intention de prendre la fuite, mais que,
s’étant dirigé vers la cuisine pour y reporter la lanterne du pressoir, il
avait été interpellé par Mme Mabit, occupée à des travaux de couture avec Marie
Dugast [la servante], et qui lui avait demandé ce que devenait son mari.
Craignant qu’elle n’allât dans le pressoir, où elle aurait découvert le cadavre
de ce dernier, Redureau forma le dessein de supprimer tous les témoins du
crime, de manière à s’assurer ainsi l’impunité. Sans répondre à la dame Mabit,
mettant à exécution son idée, l’inculpé retourna vers le pressoir ; il y
prit le couperet ensanglanté dont il venait de faire usage, revint à la cuisine
et assassina les deux femmes.
La grand-mère, soit qu’elle ne
dormît pas encore ou qu’elle fût réveillée par le drame qui s’accomplissait à
quelques pas d’elle, ne pouvait manquer de se porter au secours de sa bru. Il
fallait qu’elle disparût à son tour. Aussi, sans perdre de temps, s’éclairant à
la lanterne, son couperet à la main, Redureau se dresse soudain devant elle et
la tue.
Restaient trois enfants, dont
les cris d’épouvante étaient susceptibles d’attirer l’attention des voisins.
Ils furent tous immolés ; l’enfant de deux ans, trop jeune, semble-t-il,
pour pouvoir inquiéter le criminel, ne fut pas plus épargné que les autres, et
Redureau le frappa avec tant de férocité que, de son propre aveu, c’est sur le
berceau de cette dernière victime qu’il brisa le manche du couperet.
Le
petit Pierre Mabit, qui couchait dans la cuisine et qui, peut-être terrorisé,
peut-être endormi, n’avait pas crié, dut à cette circonstance de n’être pas
compris dans cette tuerie monstrueuse.
Ajoutons
que le crime est découvert par des voisins, surpris de trouver le petit Pierre
pleurant sur le seuil de la maison, alors que rien ne bouge à l’intérieur. Les
soupçons de la gendarmerie se portent immédiatement sur le valet, seul membre
de la maisonnée à n’avoir pas été tué. Il est vite retrouvé et passe des aveux
complets.
Ce
fait-divers présente bien des points communs avec la nouvelle de López
Pinillos. Le nombre des victimes, sept, se rapproche plus de ceux de la
nouvelle que des crimes de Cintabelde. Parmi elles figure une grand-mère ainsi
qu’une jeune femme, lesquelles occupent une place importante dans le récit
espagnol. La chronologie des exécutions suit un schéma semblable : d’abord
le maître de maison, puis successivement les femmes de la maison, la maîtresse,
la fille et la grand-mère, puis l’enfant. Cette succession, qui respecte un
ordre décroissant dans la qualité des personnages et dans le danger relatif que
chacun représente pour l’assassin, propose une sorte de logique dont le
narrateur a pu s’inspirer. Par ailleurs, Redureau utilise exclusivement un
objet contondant ou tranchant pour tuer ses victimes ; de même Luarca fera
alterner le poignard et la pelle, alors que Cintabelde utilise aussi l’arme à
feu. Enfin, c’est un enfant miraculeusement épargné qui donne l’alerte, dans le
massacre de Landreau comme dans la nouvelle.
Ces
coïncidences recouvrent à peu près exactement les divergences observées entre
le fait-divers de Cordoue et la nouvelle de López Pinillos, divergences qui
semblaient relever du libre choix de l’auteur de celle-ci. Il est même possible
de rechercher l’origine de certains aspects originaux de la nouvelle dans le
modèle nantais. Ainsi, certains témoignages affirment que Marcel Redureau
n’aurait pas été insensible aux charmes de la jeune servante et, même, qu’il
aurait tenté d’abuser d’elle, le jour du crime, ce qui lui aurait valu une réprimande
de la part de la maîtresse. On voit le parti que López Pinillos tire de ce
détail non vérifié en transformant la servante en fille du fermier. De même,
l’ajout des trois dernières victimes prolonge jusqu’à l’épuiser une liste de
victimes potentielles, dont la variété tient plus du « tableau de
chasse »[11]. Il semble que López Pinillos en ait pris prétexte
pour dresser une galerie de portraits et se donner l’occasion de décliner la
folie meurtrière de Luarca et aussi d’ajouter une variation sur le comportement
des victimes face au danger ou à la mort.
Au
moment où López Pinillos rédige sa nouvelle, dont nous rappelons qu’elle fut
publiée en octobre 1916, les crimes de Cintabelde appartiennent à un passé déjà
lointain (26 ans). Le fait-divers nantais de 1913, mais plus encore la nouvelle
de la mort de Redureau, survenue au-début de cette année 1916[12], lui redonnent une actualité[13].
On
imagine que López Pinillos fit aussi ce rapprochement et qu’il trouva commode
de puiser dans les circonstances de ces deux faits-divers, selon les besoins de
son récit[14].
DU FAIT-DIVERS À LA NOUVELLE
Personnalité de l’assassin
Dans
aucun des deux assassinats, le passage à l’acte n’est précédé de signes annonciateurs.
Mais la perception de la personnalité de l’un et de l’autre des assassins, par
l’opinion, la presse et le tribunal, est radicalement différente. Cintabelde
est perçu comme un tueur sans scrupules. Le criminel est décidé dès le départ à
commettre son forfait et l’accomplit sans état d’âme et sans remords. Le geste
de Redureau est tout aussi inattendu. Cependant, il ménage un vide préalable,
celui d’une personnalité difficile à cerner, ce qui offre des perspectives
intéressantes à un narrateur, puisqu’il lui donne la possibilité d’un avant au
crime proprement dit.
López
Pinillos exploite cette possibilité pour dresser un véritable portrait physique
et psychologique de son protagoniste, dessiner les contours du milieu qu’il
fréquente, le doter d’un langage propre, bref, le rendre familier au lecteur
avant de le plonger dans l’horreur de ses actes. Il prend ainsi le temps de
préciser le mobile des crimes. Le désir de se procurer de l’argent n’a jamais
cessé d’occuper l’esprit de Luarca. En cela, il est un calque de Cintabelde,
même si ce dernier s’en défend lors du procès[15]. Cependant, chez Luarca, cette obsession ne débouche
pas sur une idée fixe, contrairement à Cintabelde ; elle prend la forme
d’une quête qui le pousse à solliciter des personnes différentes et pour des
motifs différents : le marquis, le grossiste, le chanoine, parce qu’ils en
sont naturellement pourvus ; le fermier du Cortijo parce que les
échéances du fermage sont proches. Elle n’est pas déterminée à déboucher sur
une victime collective désignée d’avance, comme pour Cintabelde. Cette différence
ménage dans la nouvelle un effet de surprise absent du fait-divers.
Pendant
le procès, la maîtresse de Cintabelde[16] précise qu’il était sujet à des crises d’épilepsie et
qu’il avait des « manies »[17], ce qui en fait un être passablement
« dérangé », mais on ignore si cette déclaration ne répondait pas
avant tout au désir d’atténuer la responsabilité du criminel devant le
tribunal. Les médecins appelés à se prononcer sur l’état de la santé mentale de
Cintabelde sont divisés. Les médecins libéraux le déclarent « quasi
irresponsable », en revanche, le médecin de la prison et le
médecin-légiste nient la folie avec des arguments que le correspondant du
journal El Heraldo de Madrid juge « irrécusables ». Le
procureur, de ce fait, demandera la peine de mort. L’avocat-défenseur,
s’appuyant sur le témoignage de Teresa, plaidera « la folie
impulsive » (« la locura impulsiva ») et un enfermement de
l’accusé dans un hospice de fous, sans parvenir à convaincre le jury.
Le
portrait de Redureau tracé par les médecins-légistes est beaucoup plus nuancé.
Ces derniers croient déceler chez le jeune homme un trait de caractère, celui
de « susceptible vindicatif », qui a pu favoriser de sa part
« l’explosion de l’impulsivité et de la violence »[18]. Cette définition s’applique particulièrement bien à
Luarca ; elle se révèle dès sa première manifestation vocale, lorsqu’il
réagit, en aparté, aux propos que son oncle et le père Alguazil tiennent sur
lui. De même est-il piqué au vif lorsque le marquis le traite de
« m’as-tu-vu ». Sa réaction, purement verbale, d’une grossièreté
insigne, témoigne que ce qualificatif l’a profondément blessé. Enfin, on peut
mettre sur le compte de cet aspect de sa personnalité le geste à partir duquel
tout va s’enchaîner, à savoir le couteau tiré face à son compère. Cette fois-là
encore, Luarca réagit à un sentiment de dépit, le refus de son interlocuteur le
renvoyant à une impuissance qu’il ne veut pas admettre.
López
Pinillos accentue même les effets de cette susceptibilité vindicative, en
plaçant Luarca dans un isolement social que ses deux modèles n’ont pas connu.
Cintabelde partage sa vie avec une jeune femme, dont il a eu deux enfants et
qui se fait sa complice en l’accueillant chez elle après son forfait pour
l’aider à se débarrasser de ses vêtements tâchés de sang. De même, Redureau
manifeste un attachement sincère envers sa famille, laquelle le soutiendra de
son mieux dans l’épreuve du jugement et de la condamnation. En revanche, Luarca
n’a personne à qui se confier et personne n’est susceptible de freiner ses
instincts[19].
Redureau
est un adolescent et, pour cette raison, est exposé, selon les
médecins-légistes, à des comportements délictueux[20]. Prises à la lettre, ces considérations s’appliquent
aussi au personnage de López Pinillos, qui se comporterait, en quelque sorte,
comme un adolescent prolongé. Très imbu de sa personne, d’un humour agressif,
il est d’une grande susceptibilité, au point d’inspirer chez certains de ses
interlocuteurs, -les trois compagnons, Antonia- une retenue et une grande
prudence dans les propos qu’ils lui tiennent.
Les
emprunts réalisés par López Pinillos aux personnalités de Cintabelde et
Redureau, qui ont peu de points communs, lui permettent de construire un
personnage d’une plus grande complexité que ses modèles. La marginalité du
premier, sa violence naturelle, qui le poussent à des actes irréfléchis et
désordonnés, sont complétés par l’immaturité du second, victime d’un accès de
démence et soucieux d’en effacer les traces, au prix d’un raisonnement
enfantin. Au résultat, on a un personnage mi-adulte mi-enfant, qui emprunte ses
comportements à l’un ou l’autre, selon les besoins de la situation.
Enchaînement
des actes
Cintabelde
n’offre à l’auteur aucun élément exploitable en vue d’une explication de ses
actes[21]. Contre toute évidence il se défend de les avoir
prémédités. Pour essayer d’en persuader ses juges, il prétendra qu’il n’était
pas poussé par l’appât du gain et laissera entendre qu’il avait une liaison
avec Antonia, tous arguments contredits par le témoignage d’Antonia mais aussi
par les faits eux-mêmes.
Alors
que Cintabelde est venu armé d’un poignard et d’un fusil, avec la ferme
intention d’en user, Redureau, sous l’empire de la colère, s’empare du premier
outil venu et s’en sert pour assommer son patron. Puis il l’achève à l’aide de
la serpe à raisins, qui se trouvait aussi à sa portée. Luarca tue son compère à
l’aide du poignard dont apparemment il ne se sépare jamais, et qui fait partie
intégrante de sa tenue vestimentaire[22]. On reviendra sur la façon dont López Pinillos
justifie qu’il ait tiré son arme. Ce que l’on retiendra, c’est que la mort du
fermier tient à plusieurs facteurs, dont l’un au moins est étranger à Luarca.
Son compère, fou de rage, vient littéralement s’empaler dans la lame de son
adversaire[23]. Pour reprendre une métaphore tauromachique,
l’assassin tue a recibir, c’est-à-dire qu’il attend l’assaut de son
ennemi et détourne à son profit le mouvement qui projette celui-ci en avant. Ce
fait n’efface pas la volonté de tuer qui est manifeste ; affirmer le
contraire reviendrait à dire que le toréador n’a pas l’intention de mettre à
mort le taureau qu’il vise de son épée. Mais la victime, par sa contribution
involontaire, atténue la responsabilité de son meurtrier, en prenant à son
compte ne serait-ce qu’une part minime de l’initiative qui, sans cela, serait
retombée entièrement sur son adversaire. Le fermier a accepté le combat, même
s’il était inégal, ce qui l’oblige à en assumer les conséquences. Que se
serait-il passé si, moins sûr de sa force, il avait refusé de se battre[24] ?
Selon
les médecins-légistes, Redureau, quant à lui, a tué son patron sous l’effet
d’un violent accès de colère. Sous le coup de l’émotion, il tue la patronne
pour qu’elle ne découvre pas le crime et élimine les autres personnes présentes
dans la maison, qui auraient pu témoigner contre lui[25].
Le
premier affrontement de Luarca a lieu avec son adversaire déclaré, le fermier,
et non, comme pour Cintabelde, avec la première personne qu’il croise et qui
est susceptible de le gêner dans son entreprise, en l’occurrence, le gardien.
Au contraire, Luarca s’enquiert auprès d’Antonia de l’endroit où se trouve son
mari. Une fois qu’il a tué le fermier, il n’a plus qu’une idée : supprimer
tous ceux qui pourraient dénoncer son passage à El Jardinito, et par
conséquent témoigner contre lui. C’est exactement la logique qui pousse
Redureau à exécuter toutes ses victimes. Rien de tel dans le cas de Cintabelde.
Même s’il a recours au même argument, se protéger contre d’éventuels témoignages,
son premier meurtre sans raison apparente le rend irrecevable. Contrairement à
Luarca, Cintabelde est venu d’abord pour voler, accessoirement pour tuer[26].
Pour
un littérateur, le cas de Redureau ouvre des perspectives absentes de celui de
Cintabelde. Il propose un scénario possible : le premier meurtre est un
acte isolé ; les autres sont dictés par la nécessité de cacher le premier.
López Pinillos l’a bien vu et s’est servi de cet enchaînement à partir d’un
précédent accidentel pour structurer sa nouvelle.
Par
ailleurs, en poussant le nombre des victimes au-delà de celles de Cintabelde,
l’affaire Redureau fait aussi sauter un verrou, apparemment indépassable sauf à
trahir toute vraisemblance, en offrant la possibilité au narrateur de prolonger
la série des victimes aussi loin qu’il le souhaitera, et, par conséquent,
d’ajouter une certaine variété à l’acte de tuer qui, indéfiniment répété à
l’identique, est susceptible de lasser le lecteur. Ainsi, il n’est pas tenu de
limiter ses victimes au cercle étroit des habitants de la ferme, mais peut
l’élargir à des éléments extérieurs, les trois personnages que l’assassin a
croisés sur son chemin, dont deux sont étrangers à la famille, ce qui donne un
champ d’expansion nouveau à son imagination créatrice.
Condamner
/vs/ comprendre
Des
actes aussi inouïs ne laissent personne indifférent. Ils suscitent un fort
mouvement de rejet, inspiré à la fois par le dégoût et par la peur. Ces
sentiments sont les seuls autorisés dans une société même modérément policée,
comme le sont certaines sociétés rurales ; ce sont aussi les seuls qui
reçoivent une publicité, à travers les comptes rendus de presse ou d’autres
formes de diffusion, orale ou écrite. Tout autre sentiment expose son auteur à
la vindicte. Pourtant, rien n’est plus courant que la fascination que suscitent
de pareils actes. Quelle que soit la motivation profonde qui dicte cette
réaction, pulsions personnelles inavouées, sentiment d’infériorité face
à celui qui ose, tendance à l’héroïser , il n’est pas bon de l’expliciter.
Cependant, l’intérêt pour le fait-divers, d’autant plus grand que celui-ci est
monstrueux, phénomène constant de toute éternité, est un aveu implicite de
cette fascination. Le littérateur, prêt à y puiser son inspiration, aurait
mauvaise grâce à ne pas reconnaître qu’il y est poussé aussi par un sentiment
de cette nature.
Mais,
même en situation de fascination, le public est poussé par un autre désir, tout
aussi puissant, celui de comprendre. Au terme de quel processus, un être
humain, comme vous et moi, a pu en arriver à cette extrémité ?
Ces
deux attitudes complémentaires, – condamner et comprendre -, se rencontrent à
des degrés divers dans les différentes approches du phénomène. La presse et
l’opinion, qui s’influencent mutuellement, sont promptes à condamner. La
justice se veut objective mais, aussi indépendante et sereine soit-elle, elle
est soumise à des pressions d’origine diverse, et, de toute façon, elle est
tenue de sanctionner les auteurs potentiels des actes incriminés, ce qui lui fixe
un impératif incompatible avec la seule prise en considération des faits pour
eux-mêmes. Le littérateur peut aussi adopter des positions contrastées. Gide
n’a aucun scrupule à admettre que lui et ses contemporains ne possèdent pas les
clefs qui permettent de comprendre tous les comportements humains[27]. Il s’en tient donc à une prudente réserve, se
refusant de juger, se contentant d’accumuler des connaissances au profit d’un
futur mieux informé. López Pinillos choisit la voie de l’utilisation du
fait-divers à des fins littéraires. Le choix n’est pas nouveau[28], mais les moyens qu’il se donne méritent l’analyse,
car ils annoncent une innovation considérable dans le traitement de cette sorte
de sources.
L’auteur
et son « héros »
López
Pinillos ne laisse aucun doute sur les sentiments qu’il éprouve à l’égard de
son protagoniste principal. Il ne se montre pas tendre à son endroit, à en
juger par les épithètes qu’il lui attribue et qui reviennent à le condamner
d’avance : avant le crime, en deux occasions il l’appelle « le
rustre » ; après le premier assassinat, il le désigne comme « le
sauvage », « le bourreau », l’« assassin »… ;
il le compare à un diable, à un boucher… Aucune commisération apparente, par
conséquent. Mais la nécessité où il est de rendre crédible sa narration le
conduit à décrire un cheminement qui, d’étape en étape, mènera le jeune homme
d’une relative innocence à la plus terrible des culpabilités.
Bien
qu’il s’en défende, le narrateur ne peut manquer de prendre parti, aussi peu soit-il,
pour son protagoniste, à la manière d’un avocat défenseur qui, tout persuadé
qu’il soit de la culpabilité de son client, lui cherche, par devoir, des
circonstances atténuantes. C’est à ce prix que le créateur évitera l’inintérêt
d’un personnage sans surprise, qui se confondrait avec ses actes et ne leur
apporterait aucune transcendance.
Au
premier plan des facteurs extérieurs qui, selon López Pinillos, ont joué un
rôle dans la conformation de son personnage, figure sa situation socio-économique.
Luarca est condamné à la vie précaire d’un journalier, soumis au bon vouloir
des propriétaires ou de leur contre-maître, qui peuvent, à leur gré, lui donner
du travail ou le priver de tout revenu. De ce point de vue, l’épisode du marquis
illustre bien le comportement des latifundistes à l’égard du prolétariat local.
La solidarité familiale peut compenser cette carence, mais elle ne va guère
au-delà de la satisfaction, pour une durée limitée, des besoins les plus
élémentaires. C’est ainsi que l’oncle de Luarca offre à son neveu de lui céder
un grabat, dans le réduit où loge déjà le jeune valet, et de le nourrir pendant
l’hiver, en échange de certains travaux. Les autres recours potentiels ont
aussi des moyens limités, même les plus fortunés d’entre eux, comme le compère
Luque, tenu par de lourdes échéances qu’il doit honorer, sauf à perdre son
emploi. Cette situation ne contribue pas à procurer de la sérénité à des jeunes
gens qui aimeraient bien pouvoir profiter des rares distractions qu’offre la
rude vie à la campagne. Or, dans ce domaine, Luarca connaît surtout des
frustrations, dès l’instant où il a fait le choix, légitime, de profiter à
plein de la foire de mai, et, en conséquence, de se priver de tout autre
plaisir pendant le reste de l’année. Être dépourvu d’argent, à cette échéance
décisive pour lui, revient à le condamner à une vie sans aucun agrément.
Une
autre considération importante a trait à la violence. Celle-ci n’est pas
l’apanage exclusif du protagoniste. Dans ce monde rural, qui manifeste aussi
peu de commisération pour les démunis, elle est toujours prête à se manifester.
Le marquis n’hésite pas à menacer de son arme un visiteur, certes grossier,
mais qui ne constitue pas à proprement parler pour lui une menace, puisqu’il est
protégé par le nombreux personnel qui l’entoure.
Les
apparences sont trompeuses. Ainsi, les propos et les comportements qui sont de
mise dans ce monde rural sont d’une courtoisie appuyée. Luarca échange
généreusement tabac contre alcool, avec les trois ouvriers qu’il croise. Luarca
et Luque se vouvoient ostensiblement[29]. Les dialogues dénotent un goût pour la recherche de
l’effet typiquement andalou, qui, mêlant une expression généralement châtiée à
un humour permanent, attestent du plaisir éprouvé dans les relations avec
autrui. Cependant, cet humour se caractérise par une agressivité feinte qui
peut déboucher, comme dans le dialogue entre Luarca et sa première victime, sur
une vraie menace puis sur l’acte le plus cruel.
Le
sommet de la violence est atteint dans les arènes. López Pinillos y prépare son
lecteur à la fin de la première partie, dans la description aux accents épiques
qu’il donne du premier spectacle taurin auquel il fut donné à Luarca
d’assister. Dans ce passage, il se concentre sur le spectacle proprement dit,
mettant l’accent sur le sang répandu, les cadavres des animaux, taureaux et
chevaux, et le comportement bravache des toréadors. Dans la partie finale de la
nouvelle, son regard se porte sur les gradins, dans lesquels se manifestent des
comportements d’une violence au moins aussi grande que celle des acteurs de la
corrida[30]. Luarca se distingue par ses excès : il se cesse
de gesticuler, de hurler, de prendre à parti tous ceux qui l’entourent, acteurs
et spectateurs, dans un délire verbal et gestuel qui, en d’autres lieux,
l’aurait immédiatement conduit au poste de garde ou à la maison des fous. Mais,
ses voisins n’étant pas en reste, on ne peut guère lui reprocher que de pousser
un comportement collectif au bout de sa logique[31].
Dans
le public règne une sorte d’unanimisme, qui met un terme momentané et passager
aux différences sociales. Le gros hidalgo et le valet de ferme sont près d’en
venir aux mains, l’un voulant récupérer une place que l’autre occupe
abusivement, mais le son des trompettes suffit à calmer leur fureur. Dans cette
partie des arènes réservée aux plus fortunés, les hommes qui entourent Luarca
fraternisent avec celui-ci, en communiant à la même table[32], celle du spectacle taurin. Ici, point de
catharsis : on ne vient pas aux arènes pour y purger son âme de pulsions
sanguinaires mais pour se rouler avec délices dans une bestialité partagée[33].
C’est
le seul moment de la nouvelle où Luarca se trouve en communion avec les autres.
Jusque-là, soit il obéit à une fraternité de commande (avec le trio d’ouvriers
agricoles), soit il est en conflit ouvert avec ses interlocuteurs (son oncle,
le marquis, Luque et les siens, ses voisins aux arènes au-début de la corrida),
soit il ne parvient qu’à établir une connivence ambiguë avec son entourage
(scène de la taverne avec Alguacil, qui finira par le dénoncer).
On
mesure les ravages qu’une communion aussi peu sincère peut provoquer chez un
être simple tel que le jeune Luarca. Il prend ces faux-semblants pour argent
comptant et s’imagine qu’il est définitivement admis dans une société qu’il ne
fait que côtoyer très occasionnellement et dans des circonstances
exceptionnelles. Il est incapable de comprendre que, dès qu’il aura abandonné
les arènes, il se retrouvera seul, confronté aux difficultés habituelles. Même
dans ce moment privilégié, Luarca se distingue d’ailleurs radicalement de ses
amis de circonstance. À l’annonce du massacre de La Fermette, ceux-ci
sont capables de reprendre leurs esprits et de comprendre l’horreur de ce qui
vient de se passer, alors que, lui, emporté par l’adhésion collective au
spectacle sanglant auquel il assiste, y puise une sorte de fierté, ayant
définitivement ramené la mort, en toute circonstance, à une péripétie sans
importance.
Il
est peu de dire que Luarca a perdu ses repères moraux : il n’est plus
capable de mesurer la différence entre ce qui est licite et ce qui ne l’est
pas. C’est ce qu’exprime magnifiquement López Pinillos en lui prêtant
l’extraordinaire exclamation qui clôt la nouvelle. Le jugement du jeune homme
ne renvoie plus à un code moral mais à une capacité à apprécier, au coup par
coup, la légitimité de tel ou tel acte. En l’occurrence, les coups d’épée
réitérés du matador sont assimilés à un assassinat, compte tenu de la qualité
de la victime, qui se révèle, par contraste, infiniment plus digne de respect
que les humains massacrés à La Fermette. On nage dans la plus complète
confusion éthique.
Passage
à l’acte
La
réalisation d’un acte aussi inouï que celui de tuer convoque, chez l’assassin,
surtout s’agissant d’un « primo-assassin », des ressorts
psychologiques qu’il est très difficile de concevoir, encore plus de décrire[34]. C’est pourtant à cette sorte de gageure qu’est
confronté l’écrivain. Ce premier crime est un phénomène unique, qui n’est
réductible ni à une influence d’éléments extérieurs ni à une expérience intime
de celui qui le commet. Or, le narrateur doit le rendre plausible.
Dans
la nouvelle de López Pinillos, les faits qui aboutiront au premier crime sont
présentés comme un enchaînement logique. L’insistance de Rubans rouges
provoque la colère de Luque. La physionomie de ce dernier se transforme,
acquérant des traits de bestialité inquiétante[35]. Devant les poings menaçants brandis par le géant,
Luarca, lui aussi, subit une mutation sous l’effet de « l’excitation face
au danger » : il décide de faire face. Les conditions de l’échange
entre les deux hommes ont radicalement changé, n’ouvrant d’autre perspective
que celle de l’affrontement physique. Ce nouveau contexte déclenche, chez
Luarca, une opération mentale que López Pinillos traduit par une métaphore
entomologique, celle de la larve qui éclot et est prête à l’envol. L’idée de
tuer s’impose à lui comme une évidence, comme la réponse la plus appropriée,
non seulement à la situation présente, mais à toutes les humiliations reçues
depuis qu’il est en quête d’argent. Ce pas franchi, l’accomplissement de l’acte
est réalisé sans difficultés, d’autant qu’il est favorisé, comme nous l’avons
déjà signalé, par la collaboration involontaire de son adversaire.
Le
choix de López Pinillos porte donc sur un crime non prémédité commis par un
assassin d’occasion. Pour autant, exonère-t-il son personnage de toute
responsabilité ?
Par
bien des aspects, son modèle Cintabelde correspond à la figure du monomaniaque
homicide qui, selon le Dr. Pedro Mata, n’agit pas sous l’influence de la
volonté ou de la passion, de la haine ou de la colère, mais sous celle d’une
« force irrésistible »[36]. Ce « fou qui n’a pas l’apparence de
l’être » deviendra, à la suite des travaux de Cesare Lombroso (1835-1909),
le criminel-né. À l’époque où écrit López Pinillos, la criminologie espagnole a
pris ses distances à l’égard des théories de Lombroso[37], il n’en reste pas moins que la prédestination du
criminel reste une formule commode pour expliquer ce qui, en principe, dépasse
l’entendement. Vient alors le soupçon que Luarca correspond à cette figure de
l’assassin-né
On
pourrait considérer, en effet, que, la larve étant déjà en place, Rubans
rouges était prédestiné à tuer. Mais l’auteur ne nous dit pas que cette
larve était propre à Luarca. Elle pourrait aussi bien avoir couvé dans le
cerveau de Luque, qui semble prêt lui aussi à faire subir un sort équivalent à
son adversaire ; peut-être même est-elle présente dans tout homme. Dans ce
cas, la responsabilité de l’assassin se trouve très amoindrie, puisque son
geste est largement tributaire, à la fois, d’un atavisme générique et d’un
contexte défavorable.
Cette
ambiguïté est levée par la suite, puisque, une fois le premier crime commis,
Luarca s’accommode avec une surprenante rapidité de son nouveau statut
d’assassin. À la grande différence de Redureau, il accomplit ses autres
forfaits avec lucidité et une véritable jouissance, comme si le premier crime
avait mis au jour sa nature profonde, qui était celle d’un assassin qui
s’ignorait. Il recourt à des trésors d’imagination pour attirer ses futures
victimes et pour leur administrer la mort selon des procédures sans cesse
renouvelées, démontrant que le premier crime réveille chez lui un talent
jusque-là caché[38].
Pascual
Duarte et Meursault
La
solution proposée par López Pinillos pour rendre plausible le passage à l’acte
ne manque pas d’originalité. Pour s’en convaincre, il suffit de comparer avec
le héros du roman de Camilo José Cela, Pascual Duarte, dont on convient
généralement, et son auteur le premier, qu’il est inspiré, pour une part non
négligeable, de Rubans rouges.
Un
jour, de retour de la chasse, Pascual Duarte, pourtant accoutumé à voir sa
chienne le regarder fixement pendant le moment de repos qu’il s’accorde, assis
sur une pierre, perçoit, pour une raison qu’on ignore et qu’il ignore sans
doute lui-même, le regard de sa chienne comme inquisiteur, tel « le regard
d’un confesseur, scrutateur et froid, comme on le dit de celui du lynx ».
Sous l’effet conjugué de ce regard insoutenable et de la chaleur ambiante, il
se voit acculé à faire usage de son arme, pour n’avoir pas à « se
livrer ». La terminologie vague employée suggère de rechercher le mobile
du geste non tant dans les circonstances extérieures mais dans la personnalité
du tueur. Avant même d’avoir commis l’acte, sans avoir rien de précis à se
reprocher, Pascual se sent coupable, sans doute parce qu’il sait obscurément
qu’il est porteur de cette faculté de tuer. De fait, c’est sans émotion
apparente qu’il relate ces faits et qu’il raconte comme il prit la peine de
recharger son arme avant de tirer une seconde fois sur sa chienne. De même,
lorsqu’il apprend que sa femme a avorté parce que sa jument l’a jetée à bas, il
se rend dans l’écurie et, avec la lucidité d’un paysan qui sait comment il faut
prendre une bête pour éviter les mauvaises surprises, tue l’animal d’une
vingtaine de coups de couteau. Plus tard, il reconnaît qu’il était « froid
comme un lézard et capable de mesurer la portée de ses actes » lorsqu’il
asséna un coup de banquette à l’amant de sa sœur, lui brisant le dos contre la
cheminée. Puis, ayant transporté le blessé sur le bas-côté de la route et comme
ce dernier menaçait de revenir le tuer, une fois rétabli, il l’achève en
écrasant sa cage thoracique. Pascual Duarte tue sans état d’âme. L’heure n’est
plus à l’explicitation de l’acte criminel comme aboutissement d’un processus
individuel, mais comme le révélateur d’un phénomène qui dépasse la personnalité
de l’assassin et s’impose à lui[39].
De
ce point de vue, tout autant ou plus que dans la lignée de Rubans rouges,
il faut situer Pascual Duarte dans un contexte contemporain, dans lequel les
réponses les plus originales optent pour un détachement du criminel à l’égard
de ses actes.
Pascual
Duarte soutient que « l’on tue sans y penser […] parfois, sans le
vouloir »[40]. Autant qu’au personnage de C. J. Cela, ces propos
conviennent à Meursault, son contemporain[41]. Revenu près du rocher où avait eu lieu le précédent
affrontement avec les jeunes arabes, pour un pas de trop en direction de son
adversaire, celui-ci tire un poignard dont l’éclat de la lame sous le soleil
agresse Meursault, l’entraînant à donner une réponse réflexe à la douleur
ressentie : il appuie sur la gâchette d’un pistolet qui se retrouve
fortuitement dans sa poche[42]. Dans la description qu’en fait Camus, le
protagoniste principal n’est d’ailleurs ni l’assassin ni sa victime, mais la
lumière aveuglante du soleil[43]. Aucune larve ne vient éclore dans son esprit
lorsqu’il appuie sur la gâchette. C’est la conjonction du soleil, de la
présence du pistolet et d’un malentendu qui font de Meursault un assassin. Les
éléments extérieurs, état psychologique du personnage, condition sociale et
situation économique défavorables, qui, à eux seuls, n’avaient pu pousser Rubans
rouges au crime, servent ici de déclencheur direct. On se trouve dans une
logique toute différente.
Faut-il,
pour autant, considérer qu’à l’époque de C. J. Cela et de Camus, la conception
défendue par López Pinillos est définitivement écartée pour cause
d’archaïsme ? Il est vrai qu’entre temps, psychiatres et criminologues ont
introduit des critères nouveaux dans l’appréciation du comportement humain.
Pourtant, chez certains personnages de Jean Genet, on retrouve encore des
comportements relativement proches de celui de Rubans rouges. Parce
qu’une pierre lancée par un adolescent à son chien pour qu’il la rapporte a
effleuré le bas de son pantalon, le héros se met en garde, la main portée au
revolver : « La peur d’abord et la colère d’avoir eu peur et un
mouvement de peur, sous l’œil pur d’un enfant et le fait d’avoir servi de cible
à un Français, avec la nervosité que je mettais dans tous mes gestes, me firent
arracher de l’étui mon revolver dont la main avait empoigné la crosse. En toute
autre circonstance, je fusse revenu à moi. J’eusse rengainé mon arme, mais
j’étais seul et je me sentis l’être. Aussitôt, en regardant le visage délicat
et ironique par sa délicatesse, du gamin, je compris que le moment était venu
de connaître ce que cause un meurtre »[44]. Dans les quelques secondes qui suivent cet instant,
le désir de tuer devient si fort que l’arme finit par devenir un organe
essentiel du corps du personnage et son meilleur moyen d’expression. En
agissant ainsi, à quoi prétend-il aspirer, si ce n’est « au plus haut
moment de liberté », c’est-à-dire à se mettre résolument en dehors de
l’humanité et à rivaliser avec Dieu dans un délire démiurgique[45].
Rubans
rouges n’a pas de préoccupations
métaphysiques de cette espèce, pourtant il rejoint le personnage de Genet dans
cette quête de reconnaissance. Il tient à mériter des autres la haute idée
qu’il se fait de lui-même. Il pense qu’en tuant, il y parviendra plus
efficacement que par d’autres moyens. Par ailleurs, il soupçonne que la
pratique du meurtre est susceptible de lui procurer une jouissance qu’il ignore
mais qu’il soupçonne. Les motivations sont donc assez proches, et il est permis
de penser que le héros de Genet sera tenté de poursuivre dans cette voie, comme
le fera celui de López Pinillos.
Déclinaison
Le
passage à l’acte marque une rupture ineffaçable entre un avant et un après.
Pour celui qui l’a commis, les conséquences sont immenses, car il s’est mis
définitivement hors-jeu, qu’il soit ou non identifié.
La
nouvelle de Rubans rouges n’est pas seulement le récit d’un meurtre
premier, mais celui d’un enchaînement de meurtres, dans la conception et
l’accomplissement desquels l’assassin fait preuve d’une imagination débridée.
On peine à y reconnaître une approche objective, encore moins clinique, du type
de l’assassin, tant l’auteur semble prendre plaisir à cette déclinaison d’un
paradigme qui aurait pu facilement déboucher sur la répétition et la monotonie.
Les faits-divers de départ lui interdisaient de s’en tenir à un seul crime. Il retourne
ce handicap à son avantage, en exploitant avec tout son talent de narrateur les
nombreuses variantes possibles de ses modèles.
C’est
sans doute dans la description minutieuse de chacun des crimes de Luarca que
l’on trouve la meilleure illustration du tremendismo qui caractérise la
manière de cet auteur. Il rejoue un scénario immuable, celui d’une victime qui
ignore ce qui l’attend et d’un assassin déterminé, mais il fait varier ce
schéma de départ, en précipitant l’exécution ou en la retardant, selon son bon
désir ; en ajoutant ici une pincée d’érotisme ou des considérations
pseudo-philosophiques sur l’immoralité de la grande vieillesse ; surtout,
en n’épargnant aucun détail sur l’acte lui-même et sur les derniers instants de
la victime blessée. Ce choix esthétique le pousse à construire des situations à
la limite de l’effet pour l’effet ; ainsi de ce qu’il faut bien appeler
une forme de complaisance pour la description d’actes de violence. Peut-être
a-t-il voulu sacrifier aussi au goût supposé du lectorat de ces nouvelles à 5
centimes[46], friand d’émotions fortes.
Ce
parti-pris d’écrivain a pour effet de pousser au noir la figure du
protagoniste. Luarca dépasse de beaucoup Cintabelde en cruauté, dès l’instant
où il ne se contente pas, s’il est permis de le dire, de tuer ses victimes mais
où il prend soin, pour certaines d’entre elles, de repousser l’acte fatal, rien
que pour le plaisir de voir comment elles réagissent devant cette échéance
inéluctable. Il oblige donc Antonia à considérer le cadavre de son mari, avant
de l’exécuter. Enfin, il fait précéder la mort de Bien Poli d’une mise
en scène macabre, d’un sadisme répugnant.
Au
milieu de cette complaisance pour l’horreur, qui frise parfois le Grand
Guignol, se glisse un phénomène finement exploité, qui finit par structurer
l’ensemble, à savoir le silence. L’assassin est tenu d’agir sans bruit, pour
pouvoir accomplir l’un après l’autre chacun de ses forfaits. S’il choisit la
technique de l’égorgement, c’est d’abord par nécessité, car il faut empêcher
que la future victime ne soit alertée par les cris de la précédente. L’auteur
s’appesantit sur ce point avec des précisions de clinicien. Lorsqu’il a
condamné toute la maisonnée au mutisme, sa tâche est accomplie. Or, au moment
où il devrait se sentir libéré, ce silence durement acquis lui joue le pire des
tours. Un bruit étrange, faible mais régulier, celui du sang de la jeune fille
qui coule à travers le plafond et s’écrase au sol, goutte à goutte, produisant
un son d’une intensité surprenante, suffit à le troubler au point de lui faire
abandonner précipitamment la maison. De fait, on ne sait ce qui le fait fuir
réellement, si c’est ce bruit inattendu ou la conscience fugitive d’une
fragilité qui contredit le sentiment de toute-puissance qui l’a possédé
jusque-là.
Ironie
du sort, voulue ou non par l’auteur : l’assassin sera dénoncé par un
enfant qui a assisté silencieusement au massacre. C’est donc le silence qui
viendra définitivement à bout de lui.
Point
de vue
Le
sujet traité porte en lui une difficulté pour le littérateur, celle du choix du
locuteur. Qui doit parler : le narrateur, l’assassin, les deux ? Sous
quelle forme : narration, monologue intérieur ?
Camus
et Genet s’effacent derrière le héros. La cohérence du choix saute aux
yeux : s’agissant de personnages qui n’ont pas l’entière maîtrise de leurs
actes, le récit profite de cette distance obligée sans se priver des vertus
d’introspection qu’offre le monologue. Camilo José Cela choisit, en principe,
de faire du héros le narrateur de son histoire, par le biais d’une confession
écrite[47]. Le résultat est moins convaincant, car la rusticité
du personnage est contredite par le caractère savant du discours produit.
López
Pinillos s’en tient à une technique plus traditionnelle, celle qui consiste à
laisser se manifester, sous le propos du narrateur, le point de vue du protagoniste,
à travers un usage fréquent du style direct, qu’il s’agisse du dialogue dans
lequel il échange avec d’autres interlocuteurs, ou du monologue intérieur, dans
lequel il est seul à s’exprimer[48].
L’auteur
mêle ces différents registres sans chercher à leur donner une cohérence
forcée ; au contraire, il pratique le contraste avec allégresse. Le propos
du narrateur est de haute tenue, parfois excessivement, étant donné le milieu
traité, ainsi du lyrisme de la description initiale ou de celle de la maison du
crime. Les dialogues sont aussi soignés que s’il s’agissait de dialogues de
théâtre, mais il est vrai que c’était la vocation première de López Pinillos,
et qu’en outre, le parler populaire andalou, particulièrement créatif et imagé,
se prête à cette emphase. Il serait faux, cependant, de n’y voir qu’une
démarche folklorisante, dans la mesure où c’est dans le contexte de violence
maximale que ce parler atteint son plus haut degré d’expressivité, c’est-à-dire
dans les imprécations qu’éructe Luarca, lors de la corrida, au plus fort de son
délire.
Le
point de vue du protagoniste n’est pas absent, mais il ne se différencie pas
formellement de celui du narrateur[49]. C’est ce dernier qui se charge de transcrire les
réflexions intimes du personnage, dont il veille à ne laisser rien ignorer de
ses pensées, car ce sont elles qui le poussent à agir. Mais il utilise rarement
le monologue intérieur. Il le fait dans des séquences courtes souvent ponctuées
par des interrogations ou des exclamations, selon le cas[50]. La plupart du temps, il recourt à une paraphrase en
style indirect des réflexions intimes supposées de son personnage.
Cette
contiguïté formelle entre le discours du narrateur et celui de son personnage
laisse ce dernier sous la permanente autorité de l’auteur, qui, s’il sacrifie
au désir d’expliquer le cheminement suivi par son personnage, ne veut pas
s’exposer à le justifier en l’humanisant outre mesure, ce qui n’aurait pas
manqué s’il avait été tenté de décrire ce cheminement de l’intérieur même du
psychisme de l’assassin. Le regard extérieur permet à l’auteur de prendre une
distance radicale avec son personnage et l’exonère à l’avance de tout soupçon
d’indulgence à son égard.
CONCLUSION
Redureau et Cintabelde connaîtront des fins
édifiantes. Le jeune nantais eut un comportement exemplaire dans la colonie
pénitentiaire où il effectua sa peine. Quant à Cintabelde, pendant ses
dernières semaines de vie et pendant la longue cérémonie de son exécution, il
afficha une dignité, une contrition et une religiosité qui excitèrent la
compassion de ceux qui l’assistèrent dans la prison comme du nombreux public
placé sur le parcours vers l’échafaud. López Pinillos n’a pas jugé bon de
suivre les modèles dont il s’est inspiré jusqu’à ce terme[51]. Ce n’était pas non plus son sujet. Il a préféré interrompre
son récit à son degré de dramatisme maximum, au moment où son personnage atteint
au paroxysme de sa fureur, renonçant à suggérer une fin qui, en restaurant une
paix momentanément troublée, aurait étouffé d’avance chez le lecteur une
réflexion nécessaire. Comme ses contemporains, López Pinillos reste perplexe
devant un comportement qui, tout en restant exceptionnel, mérite d’être analysé
dès l’instant où il traduit des pulsions latentes chez tout être humain. De plus,
la nature rustique du protagoniste ouvrait un champ relativement nouveau à la
réflexion, en l’élargissant au-delà des cercles habituels des héros de romans.
López
Pinillos a perçu que le sujet se prêtait particulièrement à un traitement
littéraire, dans la mesure où il invitait à pénétrer dans le domaine de la
psychologie et, par conséquent, obligeait l’auteur à une certaine forme de
compromission avec son personnage. Le défi consistait à ne pas franchir le
seuil de la connivence, pour maintenir entre eux la distance nécessaire à une
juste appréciation du comportement du protagoniste. Cette préoccupation s’avère
prémonitoire puisque, un quart de siècle plus tard, ce même sujet offrira la
possibilité d’une mutation radicale tant au roman castillan qu’au roman
français. Ce n’est pas le moindre mérite de cette nouvelle.
POSTFACE
Lorsque
López Pinillos écrit sa nouvelle, le fait-divers a définitivement accédé à la
catégorie journalistique qui continue à être la sienne aujourd’hui. L’affaire Cintabelde
a nourri copieusement la presse, non seulement locale mais nationale, entre la
date des crimes et l’exécution du condamné. En réservant sa nouvelle à une
collection bon marché, notre auteur semble partager cette même volonté de
médiatisation.
Pourtant,
s’il s’approprie les faits-divers dont il s’inspire, il les exploite et en tire
le parti qui répond le mieux à ses préoccupations idéologiques ou esthétiques
du moment, sans trop se soucier de leur conserver une visibilité sous la
transposition qu’il leur fait subir. Au terme de son travail d’écriture, il
nous propose un objet littéraire largement indépendant de son point de départ.
Le personnage de Rubans rouges est d’abord sa création avant d’être une
transposition de Rubans verts. Ce dernier est d’ailleurs bien incapable
de rivaliser avec son avatar littéraire, comme le démontre la lecture de la
presse qui, pendant ses derniers mois de vie, nous révèle un être fruste, d’une
affligeante médiocrité. Il y a, chez Luarca, malgré ses excès, une forme de
noblesse, et la folie dont il est saisi au moment du massacre se traduit par
une recherche de perfection dont le personnage réel était totalement incapable.
Qu’il s’agisse d’une réplique exacte ou ressemblante de son modèle importe donc
peu, ce qui compte c’est qu’il soit vraisemblable aux yeux du lecteur.
López
Pinillos assume ses choix esthétiques et leurs conséquences, au risque de
provoquer un écart au regard de l’exactitude des faits sur lesquels il
s’appuie. Les faits-divers lui fournissent un matériau, mais celui-ci disparaît
au cours de l’élaboration du texte. Qui se soucie de retrouver, vingt-six
années après, l’exact déroulement de la tragédie de El Jardinito ?
En revanche, comment nier que la nouvelle de López Pinillos puisse intéresser
encore un lecteur, près d’un siècle après sa publication.
Camilo
José Cela semble, de ce point de vue (qui n’épuise pas tout l’intérêt de son
roman), s’émanciper plus difficilement de l’empreinte de la réalité, comme s’il
lui coûtait, plus qu’à López Pinillos, d’y adhérer assez pour la rendre
plausible. Pascual Duarte est ressenti par l’écrivain comme un être
radicalement étranger, et il ne parvient pas à faire sauter cette barrière, le
récit à la première personne, qui aurait dû l’y aider, finissant par se révéler
comme un artifice. Par contraste, la recréation des usages et de la langue
cordouanes si familières à López Pinillos permet à celui-ci de créer l’illusion
d’une proximité avec le personnage.
Camus
et Genet ne s’exposent pas à ce genre de critique, parce que leur choix
consiste à s’éloigner autant que possible d’un modèle éventuel. Leurs
personnages ne nécessitent aucune béquille « réelle ». Ils sont de
pure fiction, ou, du moins, ils sont accessibles directement, sans qu’il soit
besoin de passer par un détour dans la réalité. De plus, ils n’existent pas
tant en eux-mêmes qu’à travers leurs actes qui, non seulement témoignent de ce
qu’ils sont, mais également contribuent à façonner leur psychologie au fur et à
mesure qu’ils s’accomplissent.
On
est loin de la démarche qu’une pratique récente a mise à la mode, dans laquelle
le littérateur recherche la caution d’un discours, celui du journalisme, parce
qu’il le considère comme porteur de vérité. Le fait-divers devient la caution
de la littérature, la qualité de celle-ci se mesurant à la capacité de son
auteur à recréer les circonstances d’un événement auquel le lecteur puisse
accéder « comme s’il y était ». Cette littérature récente a un point
commun avec les précédentes, c’est qu’elle s’intéresse à des êtres et à des
faits totalement hors norme et généralement monstrueux. En revanche, elle
présente avec elles des différences évidentes. La première est que, pour les
uns, il s’agit d’effacer toute trace d’un antécédent identifiable ou de
transformer celui-ci en un objet largement fictionnel, alors que, pour les
autres, l’écriture vise à expliciter l’événement. C’est ce qui explique sans
doute que les auteurs récents s’intéressent à des sujets qui leur sont en
principe totalement étrangers, au sens géographique et humain du terme et que,
pour parvenir à un certain degré de familiarité avec eux, ils doivent calquer
leur démarche sur celle du journaliste, confronté en permanence à l’obligation
de s’adapter à des réalités qu’il ignore. Leur témoignage ne peut se défaire de
cette contrainte originelle. López Pinillos, Cela, Camus et Genet parlent de ce
qu’ils connaissent, soit parce qu’ils sont familiers du milieu dont ils
parlent, soit parce que, à des degrés divers, ils parlent d’eux-mêmes.
Notre
traduction et notre commentaire ont aussi pour objet de fournir le moyen
d’apprécier la distance qui sépare des démarches aussi différentes, et de
rappeler qu’une mode ne condamne pas à l’obsolescence des enjeux d’écriture qui
ont donné des fruits très remarquables. Alors même que les ressorts secrets du
comportement humain continuent à offrir un champ immense à l’imagination,
faut-il renoncer à une ambition proprement littéraire et accepter de voir le
romancier céder sa position privilégiée au profit de spécialistes divers, anthropologues,
psychologues, sociologues, criminalistes, etc., ou des journalistes et leurs
émules ?
BIBLIOGRAPHIE
López Pinillos “Parmeno”, José,
Cintas Rojas. Madrid: La Novela Corta, Año I, n° 41, 14 octobre
1916.
ANTÉCÉDENTS
Le crime de Cintabelde
– El Imparcial de Madrid; El Diario de Córdoba; El Heraldo
de Madrid, 26-29/05/1890; 15-19/11/1890, 4 au 7/06/1891
– Cruz Gutiérrez, José y Puebla
Povedano, Antonio, Crónica negra de la historia de Córdoba (Antología del
crimen). Córdoba: Publicaciones de la
Librería Luque, 1994, pp. 79-94.
L’affaire Redureau
– Gide, André, La séquestrée de
Poitiers. Paris : éditions Gallimard, 1930. Col. Folio 977, 1977.
– La secuestrada de Poitiers.
Trad. Michèle Poussa. Barcelona:
Tusquets Editor, 1969.
– El caso del inocente niño
asesinado. Trad. Inmaculada Pantoja y Mateu. Barcelona: Tusquets Editor,
1971, 65 p. Cuadernos ínfimos, Serie cotidiana, 4, 25.
ŒUVRES LITTÉRAIRES CONNEXES
– Cela, Camilo José, La familia de
Pascual Duarte,
– Camus, Albert, L’étranger, in Théâtre,
récits, nouvelles. Paris : Bibliothèque de la Pléiade, 1962, pp.
1125-1210.
– Genet, Jean, « Pompes
funèbres », Les Temps Modernes, 1ère année n° 3 (1er
décembre 1945), p. 412-414.
BIBLIOGRAPHIE COMPLÉMENTAIRE
– López Pinillos, José,
Doña Mesalina. Madrid: Editorial Pueyo, 1920.
Cómo se conquista la
notoriedad. Madrid: Editorial Pueyo, 1920.
Las águilas. Novela de la vida del torero. Madrid: ed. Turner, 1991.
– Quirós, Constancio Bernaldo
de, Figuras delincuentes. Figuras delincuentes en el ‘Quijote’. Edgar Poe y
la psicología criminal. Estudio preliminar y notas de Jesús Alonso Burgos.
Alcalá la Real: Alcalá Grupo editorial, 2008.
– Hoyos, Antonio, “Cintas
Rojas, Pascual Duarte y el campesino del Cagitán”. Correo literario,
Madrid, n° 76 du 15 juillet 1953; reproduit dans Hoyos, Antonio de, El
pintor Antonio H. Carpe y otros ensayos. Murcia, Academia Alfonso X el Sabio, 1990, p. 214-220.
– Stendhal, Le rouge et le noir dans
Romans et nouvelles. Paris : Bibliothèque de la Pléiade, 1952, p.
644-645.
– Pérez de Ayala, Ramón, Política y toros. Obras
completas. Vol. XII. Madrid: Renacimiento, 1925.
[1] Hoyos, Antonio, “Cintas Rojas, Pascual Duarte
y el campesino del Cagitán”. Correo literario, Madrid, n° 76 du 15
juillet 1953; reproduit dans Hoyos, Antonio de, El pintor Antonio H. Carpe y
otros ensayos. Murcia, Academia
Alfonso X el Sabio, 1990, p. 214-220. Je remercie le Professeur Andrés Amorós
Guardiola de m’avoir signalé cet article, et le Professeur Francisco Javier
Díez de Revenga, de l’avoir localisé et de m’en avoir fourni une copie. Antonio
de Hoyos n’apporte guère de précisions sur cette affaire. Il signale, cependant,
que l’assassin aurait été arrêté plus tard par la Garde Civile et condamné à la
peine de mort, ce qui accentue encore les similitudes avec l’histoire de Cintas
Rojas.
[2] Dans la tradition, il ne faut probablement pas
prendre cette formule au pied de la lettre (ou pas seulement), car par bien des
aspects, elle présente un caractère incantatoire. On pense à celle qui conclut
les récits très fantaisistes des mythes de la Grèce Antique, par l’héroïne du
film Jamais le dimanche, de Jules Dassin, incarnée par Mélina
Mercouri : « et ils allèrent tous à la plage ».
[3] Ainsi nommée parce que l’intercession de la Vierge
mit fin à une épidémie de peste.
[4] Nous avons consulté, pour la presse locale, le Diario
de Córdoba, et pour la presse nationale, le quotidien madrilène El
Imparcial.
[5] Il avait 15 ans au moment des faits et il se peut
donc qu’il en ait eu connaissance directement. Il est possible que ce tragique
fait-divers ait pu impressionner notre andalou, alors adolescent.
[6] López Pinillos reproduit en le transposant, le lien
qui unit à la famille du Jardinito Cintabelde et sa femme, qui fut la
nourrice d’un de leurs enfants, en faisant de Rubans rouges le parrain d’un de
ceux de Luque, ce que traduit le terme de « compère » appliqué dans
la nouvelle à l’assassin et à sa victime.
[7] Près de la ville de Corrientes, en Argentine, Rubans
rouges désigne un gaucho, Antonio Mamerto Gil Núñez, « el Gauchito
Gil », voleur de grand chemin qui, avant d’être exécuté, suspendu par les
pieds à un arbre et la gorge tranchée, le 8 janvier 1878, annonça à son
bourreau qu’il trouverait, à son retour chez lui, son fils gravement malade
mais que, s’il adressait une prière à son nom, l’enfant serait guéri. La
prophétie se réalisa. À l’emplacement de l’exécution, (à 8 kms de la ville de
Mercedes), on a construit un sanctuaire auquel on se rend en pèlerinage, à la
date anniversaire de l’exécution. Les rubans rouges que l’on y suspend
rappellent le sang versé par le martyr. López Pinillos a-t-il connu cette
légende ? Ce n’est pas impossible, mais si tel était le cas, elle n’aurait
influé que le choix de la couleur des Rubans de son personnage.
[8] Cintabelde était connu sous le surnom de Cintas
Verdes, mais le lieutenant de la Garde Civile qui mena l’enquête l’ignorait
jusqu’à ce qu’un témoin s’en souvienne opportunément.
[9] Réédité dans Gide, André, La séquestrée de
Poitiers. Folio n°977, « L’affaire Redureau », pp. 99-145.
[10] Et non dans la Charente-Inférieure, comme Gide
l’affirme erronément. Landreau se trouve dans l’arrière-pays nantais, aux
confins du Maine-et-Loire.
[11] López Pinillos évite les victimes indifférenciées,
comme les deux enfants de El Jardinito.
[12] « Marcel Redureau mourut tuberculeux, à la
colonie pénitentielle de X…, vers février 1916 », selon le témoignage de Gaëtan
Rondeau, « très aimable correspondant » de Gide, rapporté par
celui-ci (p. 145). La proximité chronologique entre le décès de Redureau et la
publication de la nouvelle en octobre de la même année est éloquente.
[13] Cintabelde fut condamné à mort et exécuté en novembre
1891. Redureau fut condamné à vingt ans de prison, soit le maximum pour un
accusé qui avait moins de seize ans au moment des faits, car il ne bénéficia
d’aucune circonstance atténuante. Bien qu’ils aient abouti tous deux à la peine
maximale, les procès ne donnent pas la même image des condamnés. Cintabelde n’a
droit à aucune indulgence : c’est, en quelque sorte, l’assassin parfait
et, comme tel, son cas fait peu débat. En revanche, celui de Redureau, peut-être
à cause de son jeune âge, ou simplement parce que les mentalités sont
différentes en France et en Espagne et qu’il s’est écoulé plus de trente ans
entre le premier massacre et le second, a donné lieu à une approche plus
nuancée, grâce principalement à la qualité des experts et au talent du
défenseur.
[14] En outre, chacun de ces faits-divers, pris isolément,
peut passer pour un acte monstrueux sans transcendance. Rapprochés l’un de
l’autre, ils suggèrent une réalité qui les dépasse et qui renvoie à des
considérations plus générales sur la condition humaine. En particulier, le
crime de Cintabelde ne peut plus passer comme l’illustration d’une barbarie
typiquement et exclusivement hispanique.
[15] Antonia Córdoba, qui survécut miraculeusement à ses
blessures, insiste sur le fait qu’elle fut dépouillée de son argent. Ibid.
[16] Elle est la mère de ses enfants et finira par épouser
Cintabelde en prison, quelques jours avant son exécution.
[17] Il prenait plaisir à écorcher vifs des chats.
[18] « Ajoutons que Redureau, sans être un taré au
point de vue psychique, est incontestablement possesseur d’un tempérament
nerveux et qu’il semble établi, parmi de nombreux témoignages, qu’il est d’un
caractère particulier qualifié de « sournois », et qui pourrait, sans
doute, tout aussi bien se traduire par la qualification de ‘susceptible
vindicatif’ ; circonstances qui ont certainement favorisé chez lui
l’explosion de l’impulsivité et de la violence » (p. 135).
Gide
semble avoir adopté le point de vue des médecins légistes : « Que
l’on m’entende, que l’on me comprenne bien : je ne prétends nullement
atténuer l’atrocité du crime de Redureau ; mais lorsqu’une affaire est
aussi grave, l’on est en droit d’espérer que l’accusation elle-même tiendra à
cœur de présenter au regard de la justice toutes les circonstances, même celles
qui pourraient être favorables à l’accusé. […]
Si
j’ai longtemps insisté sur ce point c’est aussi parce que l’intérêt
psychologique du cas Redureau serait grandement affaibli s’il était prouvé que
l’idée du crime habitait depuis longtemps l’esprit du jeune assassin, ainsi que
ces propos apocryphes le donneraient à entendre. […] Mais ces propos, il ne les
a jamais tenus ; avant de commettre le crime, il n’avait jamais eu l’idée
de le commettre. » (p. 109)
À
ses yeux, Redureau n’est pas un psychopathe. Son crime peut s’expliquer comme
la conséquence de facteurs convergents : la fatigue physique, la fragilité
psychologique de l’adolescent, ou certains traits de caractère, comme une
tendance à l’impulsivité. C’est d’ailleurs ce qui rend difficile la tâche de
son défenseur : elle aurait été simplifiée s’il avait pu plaider la
dégénérescence mentale d’un criminel par prédestination. Malheureusement, ce
n’est pas le cas. Pire encore, l’aveuglement accidentel qui provoque une
« dementia brevis », n’étant par définition pas prévisible, la loi ne
peut que le sanctionner après coup par le moyen d’une peine maximale, dans
l’espoir, bien vain, que son exemplarité pourra prévenir d’autres cas de cette
nature.
[19] Même ses sentiments à l’égard de la jeune fille de El
jardinito resteront secrets. Cette pudeur contraste singulièrement avec
l’étalage de sentiments dont Luarca fait montre lorsqu’il tresse des lauriers
publics à son torero préféré. Mais il faut bien admettre que l’épisode
des amours secrètes du jeune homme ressemble à un ajout tardif dans la
nouvelle. La preuve en est qu’il prend la forme d’un retour en arrière,
c’est-à-dire que son inclusion dans le récit entraîne une rupture quelque peu
forcée de celui-ci.
[20] « [à l’adolescence] il se produit une sorte de
rupture momentanée de l’équilibre mental avec développement excessif du
sentiment de la personnalité, susceptibilité exagérée, hyperesthésie psychique.
On voit se manifester une véritable tendance à la combativité et une
exagération remarquable de l’impulsivité et des tendances à la violence.
L’adolescent est très sensible aux louanges, et, par contre, ressent beaucoup
plus vivement les blessures d’amour-propre ; les impressions qui arrivent
à son cerveau se transforment plus irrésistiblement en incitations motrices,
c’est-à-dire en actes impulsifs » (p. 134.).
[21] « Il raconte le crime, en disant qu’il ne
comprenait pas comment il avait pu tuer tant de personnes, surtout la petite de
deux ans, qu’il aimait beaucoup ». El Heraldo de Madrid, 16
novembre 1890.
[22] L’auteur le désigne métaphoriquement comme le
‘compagnon’ du jeune homme.
[23] « mais, en se redressant, il ne fit qu’épargner
une course plus longue au poignard, qui s’enfonça dans sa gorge à la vitesse de
l’éclair ».
[24] L’auteur présente la victime comme plus forte que son
agresseur, au point que ce dernier semble surpris de la facilité avec laquelle
il l’a terrassé.
[25] « L’explication que l’inculpé donne de cet
horrible drame a toujours été la même : pour le patron, il a cédé à une
violente colère. […]
« ‘J’avais
peur que la patronne vienne voir son mari dans le cellier…, j’ai frappé la
domestique parce qu’elle était avec la patronne…, j’ai frappé les autres parce
qu’ils criaient’. La véracité de ces réponses semble corroborée par la
suivante, qui en atteste la sincérité : ‘Je n’ai pas touché au petit
Pierre parce qu’il n’avait rien dit et qu’il dormait’ » (p. 128)
[26] Cintabelde cherche avant tout à éliminer les
obstacles qui se dressent entre lui et l’argent dont il veut s’emparer. On ne
peut pas dire qu’il soit particulièrement minutieux dans l’élimination de ces
témoins gênants, puisque l’un d’entre eux, le fermier, survivra plusieurs
heures à ses blessures, et qu’Antonia en réchappera. C’est toute la différence
avec Luarca, qui ne rate jamais son coup.
[27] « Mais nous serons forcés de convenir ici que
les connaissances actuelles de la psychologie ne nous permettent pas de tout
comprendre, et qu’il est, sur la carte de l’âme humaine, bien des régions
inexplorées, bien des terræ incognitæ. » (p. 100).
[28] Cf. ce témoignage emprunté à l’actualité littéraire
française : « Les faits divers sont par essence source de grande
sidération. D’Emmanuel Carrère (L’Adversaire) à Régis Jauffret (Sévère),
ils sont nombreux, les romanciers, à avoir voulu, avec les seules armes de la
littérature, faire parler ce réel qui se dérobe à la compréhension. »
Clarini, Julie, CR de Tout, tout de suite de Morgan Sportès, dans Le
Monde des livres du 26 août 2011, p. 9.
[29] Luque passe au tutoiement en une seule occasion.
[30] López Pinillos a déjà traité de ce sujet, dans des
termes analogues, dans son roman, Las Águilas, publié en 1911. C’est
ainsi qu’il y décrit le public des places bon marché (La traduction est de
moi) : « […] les gens modestes allaient au cirque comme à un champ de
bataille, pour y glorifier leur matador préféré ; la terrible populace,
quant à elle, s’exaltait et s’émouvait, se dressait furieuse comme une mer
agitée, et abaissait jusqu’à terre les combattants avec une horrible cruauté ou
bien se dressait, folle d’enthousiasme, et les déifiait de ses hourrah
frénétiques et de ses applaudissements tempétueux ». (Madrid : éd.
Turner, 1994, p. 20.).
[31] À ce titre, il est intéressant d’observer le
contraste existant entre les propos réfléchis prononcés par Guerrita, alors
qu’il s’apprête à toréer son deuxième animal, et l’exaltation irrationnelle des
spectateurs.
[32] López Pinillos pousse la métaphore jusqu’au partage
des victuailles entre Luarca et ses voisins.
[33] Cet épisode illustre le débat qui anime alors les
intellectuels espagnols face à la corrida, et que López Pinillos a abordé dans Las
águilas. Son contemporain et ami, Ramón Pérez de Ayala, résume la question
dans ces termes : « Si j’étais dictateur de l’Espagne, je
supprimerais d’un trait de plume les corridas. Mais, tant qu’elles existeront,
je continuerai à y assister. Je les supprimerais parce que mon opinion est
qu’elles sont, socialement parlant, un spectacle nocif. Je continue à y
assister parce que, esthétiquement parlant, elles sont un spectacle admirable
et parce que, à titre individuel, en ce qui me concerne, elles ne sont pas
nocives, mais au contraire extraordinairement profitables, comme un texte dans
lequel je peux étudier la psychologie du peuple espagnol ». Pérez de Ayala, Ramón, Política y toros,
ensayos. Obras completas, vol. XII.
Madrid: Renacimiento, 1925. Luarca illustre le danger qu’il y a, selon cette
théorie, à exposer à cette sorte de spectacle des personnes intellectuellement
moins préparées.
[34] Une dementia brevis aveugle une personne et
l’entraîne à tuer ou « fait qu’il ne peut pas ne pas tuer ». Des
formules de ce genre rendent bien compte de la perplexité de l’observateur face
à ce phénomène.
[35] « Luque, très pâle, le mufle contracté ».
[36] Mata, Pedro, Tratado de Medicina y Cirugía
teórica y práctica (1866), cité par Burgos, Jesús Alonso, dans l’Étude
préliminaire à Quirós, Constancia Bernaldo de, Figuras delincuentes. Figuras
delincuentes en el ‘Quijote’. Edgar Poe y la psicología criminal, p. 27.
[37] L’école espagnole se développe principalement à
l’initiative de Francisco Giner de los Ríos, titulaire de la chaire de
Philosophie du Droit de l’Université de Madrid, dont le Laboratoire de
Criminologie (1899-1901) est une émanation. En 1906, sera créée l’École de
criminologie, destinée au personnel des prisons. Giner de los Ríos est un des
créateurs de l’Institución Libre de Enseñanza, fondée en 1876, selon des
principes inspirés de la philosophie de Krause, mais aussi du néo-kantisme et
du positivisme.
[38] On pourrait trouver, dans la nouvelle, d’autres échos
des théories criminologiques. Ainsi, Luarca et Luque appartiennent au type
« athlétique », par nature agressif, par opposition au, petit et
gros, d’humeur pacifique, à l’image de l’hidalgo qui finit par céder une partie
de son siège à Rubans rouges, sans parler de Don Quichotte et Sancho Pança, qui
illustrent parfaitement la complémentarité des deux complexions. De même, le
fait que le criminel soit identifié par un enfant donnerait raison à Lombroso,
pour qui les enfants ont une perception instinctive du criminel. Mais, à trop
vouloir rechercher des précédents scientifiques, on perd de vue certaines
évidences, dont le littérateur ne saurait se départir : les hommes de
forte constitution sont plus tentés par la violence que ceux qui l’ont
faible ; un enfant passe plus facilement inaperçu qu’un adulte.
[39] Le pire des crimes de Pascual Duarte, le meurtre de
sa mère, est paradoxalement moins révélateur de la personnalité de l’assassin,
parce qu’il est traité sans originalité. Le meurtre prémédité de longue date,
réglé à l’avance dans ses moindres détails, et qu’une circonstance fortuite
menace de faire avorter, jusqu’à ce qu’un autre imprévu, tout aussi minime,
autorise à nouveau son accomplissement, est un classique de la littérature.
Julien Sorel a prémédité de tuer madame de Rênal pendant l’office, dans l’église
neuve de Verrières. La preuve en est qu’il n’hésite pas à soudoyer l’armurier
pour acquérir un pistolet. Pourtant, au moment d’accomplir cet acte, saisi d’un
tremblement irrépressible devant cette silhouette qui lui est si familière, il
doit y renoncer : « Je ne le puis, se disait-il à lui-même ;
physiquement, je ne le puis ». C’est alors qu’intervient un autre fait,
qui rend à nouveau possible la réalisation de l’acte criminel. La clochette de
l’élévation ayant retenti, madame de Rênal baisse la tête au point de
disparaître sous les plis de son châle ; alors Julien retrouve la force de
tirer parce que « il ne la reconnaissait plus aussi bien ». Il suffit
donc d’un détail somme toute anecdotique pour que la réalité perçue par l’assassin
ne présente plus d’obstacle à l’accomplissement de son geste (Stendhal, Le
rouge et le noir dans Romans et nouvelles. Paris : Bibliothèque de la Pléiade, 1962, p.
644-645).
[40] “Se mata sin pensar, bien probado lo
tengo ; a veces, sin querer”, p. 116.
[41] L’étranger est publié en juillet 1942 (achevé en mai
1940) ; La familia de Pascual Duarte a paru en décembre 1942.
[42] Meursault ne voulait pas de ce revolver, mais
l’insistance de son ami l’oblige à l’accepter.
[43] « La lumière a giclé sur l’acier et c’était comme
une longue lame étincelante qui m’atteignait au front. […] Cette épée brûlante
rongeait mes cils et fouillait mes yeux douloureux. C’est alors que tout a
vacillé. La mer a charrié un souffle épais et ardent. Il m’a semblé que le ciel
s’ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. Tout mon être
s’est tendu et j’ai crispé ma main sur le revolver. La gâchette a cédé… »,
p. 1166.
[44] Genet, Jean, « Pompes funèbres », Les
Temps Modernes, 1ère année n° 3 (1er décembre 1945),
p. 412-414.
[45] « Tirer sur l’enfant, c’était tirer sur Dieu,
blesser Dieu et s’en faire un ennemi mortel. Je tirai. Je tirai trois
coups ». Ibid. [fin de la nouvelle].
[46] Les premières livraisons de la collection La
Novela corta, parmi lesquelles figure Cintas rojas, étaient vendues
5 cts. Leur prix augmenta bientôt à 10 puis à 15 cts (Information communiquée
par le Professeur R. Mogin Martin).
[47] La réalité est plus complexe, puisque ces mémoires
sont censées avoir été ordonnées par un « transcripteur » qui prétend
les avoir reproduites fidèlement mais reconnaît en avoir retranché les passages
les plus crus. Ce même personnage a complété les mémoires en retraçant les
derniers instants de Pascual Duarte grâce au témoignage du chapelain de la
prison dont il reproduit la correspondance. Par ailleurs, signalons que ces
mémoires ont été adressées par Pascual Duarte à un correspondant qui a souhaité
les détruire mais, ne l’ayant pas fait, les a léguées à des religieuses et
qu’elles ont fini par aboutir, sans qu’on en connaisse la raison, dans
l’arrière-boutique d’un pharmacien, où le transcripteur les a découvertes.
[48] Le style direct laisse transparaître l’art du
dramaturge que fut López Pinillos. Les dialogues sont soignés ; le
monologue prend parfois la forme de l’aparté (première scène).
[49] Il lui arrive, cependant, de l’introduire par une
formule. Ainsi, une fois accompli l’assassinat de Luque, « il alluma une
cigarette et s’abandonna à la méditation ».
[50] Les réflexions sur l’inutilité de la vieille
(« De quoi se plaignait cette momie ?… ») en sont un bon
exemple.
[51] Y aurait-il songé que les dimensions d’une nouvelle
n’y auraient pas suffi.
ANNEXE
CINTAS ROJAS
novela inédita
por
José López Pinillos (Parmeno)
______
A Don
Francisco Vigueras.
I
En cuanto partió el
mozuelo, Rafael Luarca, que espíabalo con los ojos entornados, se incorporó y
tiróse de la yacija. El sol hundía ya el rosicler de sus espadas matinales en
la choza, y teñía de púrpura el camastro, y metíase por el túnel sombrío que daba
a la cuadra. Fuera desafiábanse los gallitos, roznaban al fresco las dos mulas
bajo el palio de un vetusto alcornoque, y las abejas salían de sus obscuros
laboratorios para comenzar su mirífica labor.
Rafael liaba
cachazudamente un cigarro, cuando oyó la voz de su tío.
– ¡Eh, Arguasí!
Güenos días. No pases sin saludá, que no soy un lobo.
– A Córdoba?
– A la feria, a
mercá un muleto.
– Pos, suerte.
Quéate con Dios.
Ya te traeré a Sintas Rojas atasajao, pa que duerma la tajá.
Rióse Alguacil, y
el tío, riéndose también, replicó:
– ¡Lo que es
hogaño!… Como el Sintas no descubra un Perul hoy por la mañana, me paese que
ni le verás el pelo.
Luarca, irritado,
bramó como si le pudiesen oir:
– ¡Lo descubrirá!
¡Un Perul y sincuenta roíos Perules!
Y, temblando de
impaciencia y de ira, apartó el rústico armatoste del lecho, que era de trozos
de olivo sin descortezar, abrió el arca que protegía y extrajo de su vientre
las prendas con que se engalanaba en las ocasiones de gran solemnidad: el
sombrerín sevillano alicorto y brillantísimo, el pantalón de pana fina como el
terciopelo, la chaqueta de lanilla azul, las botas de cuero azafranado, los
calcetines con dibujos verdes, los calzoncillos de algodón blanduzco, tan
recios que no los llevaría más recios el rey, y la camisola de pechera bordada,
que solo podían planchar en los talleres de las artistas cordobesas. Se vistió
en un vuelo; guardóse, por coquetería, una saboneta de níquel que no andaba
desde que, por probar la solidez de su mecanismo, se la estrelló en la nariz
del relojero ambulante a quien se la compró; metióse en la faja el campañero de
Albacete, y se plantó en la puerta. Su tío, el pilongo señor José, que
almorzaba sentado junto a las mulas, llenóse de admiracón.
– ¡Vaya un brazo e
mar, jinojo!… exclamó clavando en él sus ojuelos.
Cintas Rojas pagó
el elogio con un mohín despreciativo.
– ¿Un brazo e mar? articuló.
¡Una charca yena e ranas! ¿Ande tengo yo el dinero pa ser un brazo e mar?
– Las hechuras
valen más que el dinero. Aquí está quien lo dise, Rafaelito.
– ¡Hechuras,
hechuras!… ¡A vel si ha nasío la que me dé un chavo para las hechuras! ¡La
iba a jartal de hechuras!
El vejete contestó
sonriendo:
– Pos abre los ojos
y orfatea, que tú encontrarás.
Y de seguro habría
encontrado alguna jamona que le protegiera, seducida por su estampa, si su
verbo cerril y montuno y su carácter bronco y bravío no hubiesen ahuyentado al
amor. Era huesudo y fibroso, de complexión hercúlea, propenso a la cólera,
caridelantero y vociferador. Tenía la mirada insolente, la nariz agresiva, la
boca enérgica y el entrecejo peludo y aborrascado, propio para subrayar las
actitudes furibundas, y envanecíase de ganarle en vigor a los bueyes y en
tozudez a los mulos.
– Güenodijo
después de unos instantes de vacilación ¿No me quié osté ayudá?
Meneó el viejo la
cabeza melancólicamente, suspiró y rompió a hablar sin mirarle:
– ¡Lo que son los
testarúos, San Rafaé de mi arma!… tripas como cañones de órgano… ¡y me píe
que le ayude!
Se atizó un
manotazo en el pecho, cual si se enfureciera, y agregó:
– ¿Otavía te he
ayudado poco? ¿No te he tenío aquí to el ivierno?
– ¿Jorgando? preguntó
con amenazadora lentitud el hastial.
– ¡Trabajando! Pero
¿nesesitaba yo trabajadores pa labral este pañuelo?… No es que me duela el
pan que te comes, ni que te eche en cara el que te lo comas. Si no que…
¡hinojo!, lo que es se tié con desil, con ojeto de que las palabras no se le
claven a uno en el gañote.
– Está bien tío.
Callaron, y el
viejecillo, que torturábase acometido a la vez por los consejos de la miseria y
por las instigaciones de la generosidad, rompió el silencio, formulando
penosamente una interrogación:
– ¿Te hasen dos
reales?
– ¿Dos reales? ¿Dos
reales de una ves?
– Menos da una
piedra, Rafaelico.
– Pero si es que se
me figura mucha cantidá, tío. Con dos reales compro yo en Córdoba la mesquita y
un coche con cuatro cabayos y un levitín, y me hasen governador y no güelve
usté a verme. No, no quió dos reales.
– Pos me has dao
una pedrá.
– Lo sé… y me largo
para no darle otra. ¡Salú!
Atravesó de un bote
el soladillo, torció por el olivar, desdeñando la estrada, y, minutos después,
corría por las tierras de Los Merinales, hacia el caserón del marqués, seguro
de que habríase refugiado en la campiña para huir del alboroto de la feria. Había
laborado en el cortijo, donde pagaban largamente y trataban con humanidad a los
jornaleros, y como se despidió sin reñir con los dependientes del prócer,
esperaba que le admitieran otra vez. Y, caso de admitirle, ¿qué se opondría a
que accediesen a un sencillo ruego? Le hacían falta diez duros. Esos diez duros
se los descontarían poco a poco de su salario, y nadie sufriría el menor
perjuicio. ¿Se los negaría el marqués, a pesar de sus millones?… ¡Bah! Del
marqués, raro, taciturno y gruñón, no se podía decir que fuera avariento. No,
no se los negaría.
Tuvo la suerte de
que el dueño de los Merinales, que acababa de llegar a la finca, le recibiera,
y con algunos titubeos, hijos de su afán de expresarse con finura, comenzó a
exponer su pretensión:
– Ya sabe el señó
marqué que he estao dos años en el cortijo de los Salas… Güena gente, sin
despresiá al señó marqué, por más que don Lui se las tira de plancheta, comi si
fuá título.
– Al grano.
Al grano. Como me
tuve de dil en Noviembre, cuando ya tenían asituneros en toas partes, pos,
siendo yo quien soy vareando, ni cogí la vara. Y figúrese osté: la santa
inverná entera y plena, en la chosa e mi tío, donde no engordan ni las arañas,
y sin un metá.
– Al grano, al
grano, Cintas Rojas.
– Pero si estoy en
er grano, señó marqué. He dicho lo que he dicho pa decil que por la pará de
este ivierno, que es cuando yo ahorro, me veo con el agua en la nué y
pataleando pa no ajogarme. Y digo ahora que me ajogo si el señó marqué no me
echa una mano.
-¿De qué manera?
– Emprestándome
dies duros y metiéndome en la casa.
– Yo afirmó
gravemente no soy usurero.
– Ni yo me lo he
imaginao, seño marqué. Si osté me empresta, le emprestará a uno de sus mosos y
no pa reventarlo, sino pa haserle un favó.
– Es que tú no eres
un mozo mío.
– No quedrá osté
tomarme.
– No quiero
tomarte.
La frialdad seca e
hiriente de la repulsa alteró al gañán.
-¿Y po sabel por
qué no quiere tomarme, don Sarvadol?
– Lo puedes saber.
Por insolente y por guapo.
– Güeno, cristiano.
No se solfure osté, no se vaya a tragá los dientes. ¿Son de muerto?
Don Salvador, sin
inmutarse, tiró de un cajoncillo, sacó una pistola, y, encañonando a Rafael,
que encogióse de hombros despectivamente, repuso con lentitud:
– De muerto sí que
van a ser los tuyos, si no te largas.
-¡Ca! barbotó el
amenazado! ¡A qué no dispara osté! ¡Y a qué si dispara no me atina!… ¿Van
los dies duros?
El marqués bajó la
browning, y Luarca se echó a reir.
-¿Ve osté como no
dispara? Tiros, a las perdises, que se asustan, señó marqué. “Cóndios”.
Le volvió el
traspontín, y retiróse con fanfarrona calma, escupiendo blasfemias y mirando de
reojo a la servidumbre del señorón, y en el zaguán el caserío, para presumir de
guapeza, se detuvo, y encendió un cigarro. El manijero, que llegaba en aquel
instante, le interpeló con zumbona alegría:
-¿Qué te trae por
estos andurriales, Faé?… Pero da una vuerta, pa que te miren mis ojos, que
vienes más bien jaqueao que un capitán generá, mardesío.
– Una vuerta y sien
vuertas exclamó Cintas, girando y pompeándose.
– Qué, ¿a la
capitá?
– Como que no hay
feria sin mi. Ya me ha yamao el siyetero del gobernadol.
– Pa ti es er
mundo, Sintiyas. Yo, con que mañana me dejen dil un rato, me conformo. En la
plasa, mos veremos.
– Ayí mos veremos.
¡Claro que se verían!
¿Se había compuesto él para maravillar con su fausto a los gorriones y los
zorzales?… Con aquellas botas, con aquel sombrerillo, con aquel terno y con
todos los demás lujosos arrequiles había ido seis años a Córdoba, desde que
conoció a Guerrita y pasmóse ante la belleza sin par de las luchas del coso, y
seguiría yendo para disentir encrestado y para golpear entigrecido en defensa
de su héroe, y para animarle con sus baladros y glorificarle con sus palmadas.
¡Qué gran torero el torero cordobés, y qué magnífica, qué asombrosa fiesta la
cornuda!… Hombres que entraban en el coso con el gesto desafiador, y que se
insultaban o saludábanse gritando; toros que mugían al sentir la bárbara
picadura del hierro, y que corneaban con una cólera infernal; caballos que
huían relinchando y mordiendo, pisándose las entrañas desgajadas; manchurrones
bermejos en la arena; cadáveres de brutos que se estremecían y, para completar
el cuadro, olor de vientres partidos y de sangre, rostros exaltados por la
temeridad o empalidecidos por el pavor, y palabras que restallaban como látigos
y mordían como víboras, que hacían a los lidiadores buscar el triunfo en el
riesgo. Cintas Rojas, que salió de la primera corrida medio loco de emoción y
dispuesto a trucidar al que no se posternase ante el Guerra, desde entonces
solo pensó en su ídolo y solo se conmovió al referir y comentar sus portentosas
hazañas. Con los ojos velados y la voz ronca, hablaba en las gañañías del pase
de pecho, del brinco entre los pitones, del par quebrando y del volapié con que
los había aturdido de admiración el coloso, y tenía para elogiarle
apasionamientos y delicadezas femeninas. ¡Era tan gallardo, tan fornido, tan
ágil, tan sereno y tan valeroso el matador!… A fin de ahorrar el dinero
indispensable para verle abatir a los astados, se martirizaba el año entero,
privándose de la borrachera de los domingos, de la gargantada de mostagán antes
de comer y de las jocundas excursiones navideñas, y ni los picantes estímulos
del Carnaval le hacían abrir la bolsa. No; él, mientras segaba, vendimiaba o
vareaba, y mientras esgrimía la márcola, el arado o el escardillo, fortalecíase
recordando a “su” lidiador y rechazaba así mil sugestiones. Pero ¡cómo se
desquitaba después! Durante la feria, ¡con qué dulces bellaquerías rascábase el
herrín de su forzosa virtud!… Disputas y rugidos, hasta quedarse afónico;
vinazo batallador y agudo aroma de sangre, hasta tener los nervios como
alambradillos electrizados, y hembras y alcohol, hasta caer desecho. ¿Y por un
“planchetillo” como Salas, que le había despedido cobardemente, y por un idiota
como don Salvador, iba él a quedarse en el campo? ¿Quedarse él, habiendo
criaturas con billetes y con duros?…
Se despidió del
manijero, y alejóse sin dirección. ¿A quién recurriría? Cerca de los Merinales
no escaseaba la gente con dinero: el señorito de la Garbosa, don Bonifacio el
canónigo, tío Juan el acaparador… Pero tío Juan y el señorito estarían en la
feria, y al canónigo, por el recelo de sus parientes, no había quien se pudiera
acercar. No le quedaba, pues, más que su compadre, y su compadre, que era tan
testarudo como él, se había cerrado a la banda. “El año, malísimo, le tenía con
una soga al cuello; aun no contaba con los cien duros que le exigirían por la
San Juan…, y debía juntarlos y comer.” Avaricia y pocos deseos de servirle. ¿No
costaba el mismo trabajo juntar quinientas pesetas que ciento diez duros? ¡Pues
entonces!… Que se apretara un poquitín más la soga el avaro, que para eso era
su compadre, o se expondría a que le obsequiaran con un disgustillo. Chuleos
con él, no. Claridad, las cartas boca arriba.
Y con la decisión
de ponerlas, dejó atrás los Merinales e hizo rumbo hacia el Cortijuelo.
II
Tío Rafael Narices,
tío Pedro el Sordo y Sebastián el Cumplío interrumpieron el trabajo cuando los
saludó. Narices, que las tenía gigantescas y que se ufanaba del irregular
desarrollo de tan interesante facción, era un viejo musculoso, de aventajada
estatura, alentado y alegre; tío Pedro, cuarentón corto de palabras y de
grandísima prosopopeya, realizaba el milagro de recobrar el oído siempre que le
convenía oir, y distinguíase por la poca extensión de su correa y por la
facilidad con que pasaba de los razonamientos a los trastazos; y el Cumplío,
cenceño como una espada y bullicioso como unas castañuelas, destacábase por la
exquisitez de su cortesía entre los garzones de molino y cortijo.
Fue el primero que
habló:
– Pa servilte,
compañero.
– Y yo a ti,
Cumplío, y a la compaña.
La parte más joven
de la compaña, el Sordo, se limitó a bajar el testuz, y la parte más vieja, tío
Rafael, apretóle la mano y le regaló con una broma:
– Pos yo, como no
te empreste la narí pa que te luscas en el ferial…
– Grasias, amigo.
No sabría yevarla con los reaños de osté.
Sebastián aprobó:
– Anque la sabrías
yeval, poque tú eres mu macho, no has parlao malamente.
– Dios te lo pague,
Cumplío.
Ofreció tabaco: los
labriegos confeccionaron unas trancas enormes, y encendiéronlas con voluptuoso
regodeo, y el cuarentón, para pagar la fineza, obsequiólo con un capcioso
aguardiente.
– Empina, que es
gloria de Rute.
– Sí que es gloria afirmó,
después de paladear el líquido, pasándole el botijo al Narices. Bien se trunfa
aquí.
-¿Trunfar y
trabajamos en feria? preguntó irónicamente tío Rafael. ¡Que diga mi yerno si
trunfamos!
– A verlo voy.
¿Está en el caserío?
– En el caserío
está.
El caserío, como
una pella de nieve y posado con redomada malicia en un alcor para dominar las
tierras del Cortijuelo, no era muy grande; pero tenía una clara sala para el
amo, su mujer y el pequeñín, con su buen arcón y su lecho, que sostenía cuatro
colchones; otra para la abuela y la mocita; una covacha, en la que arrullábanse
con sus ronquidos el Narices y su nieto; una hermosa cocina con poyos, en los
que los jornaleros dormían como lirones; amplias cuadras, sobrados espaciosos y
extenso corral. Sus muros, de glebas apisonadas y pedruscos, no hubieran
resistido victoriosamente el estallido del más liviano proyectil de cañón; pero
atajaban el ímpetu brutal de los ventarrones y los taimados ataques de la
cellisca, y los dueños del Cortijo podían reposar tranquilamente, mientras
aullaban los lobos del viento y el granizo tamborileaba en las tejas. Y, por
último, su lujo era el lujo simple de las paredes enjalbegadas, del metal brillador,
del ganado limpio, del averío craso.
Cintas Rojas se
detuvo un momento frente a la casita. El sol, atravesando la frondosidad de una
higuera, teñía de un oro verdoso el soladillo. Un grajo alicortado escarbaba,
buscando orugas junto a los polluelos, tan encogido y pusilánime como si jamás
hubiese navegado entre las nubes con sus alas enteras, y como si nunca hubiera
abierto su pico rojo para graznar en libertad. “¿Qué harían en el caserío?”
Escuchó atentamente, y percibió el borbotar de un puchero, el “gluglu” de un
cántaro al vaciarse y el repique sonoro de un almirez. Después oyó una ronca
tos, y en seguida unos grititos musicales, que le hicieron sonreir: “¡Ay, la
vieja mala, que ya está tosiendo! ¡Ay, que le voy a dar una soba”. Era Rosario,
la mocita, que, desde el granero, donde estaría peinándose, gritaba a fin de
que la abuela, refugiada en su habitación, oyese el gracioso regaño. La madre
trabajaría en la cocina, y los hermanillos destrás de las tapias, en la era o
en la linde del alcacer, jugarían con sus corderos. Mas ¿y “él”? ¿Había sido el
quien vació el cántaro? ¿Le encontraría allí, entre faldas? ¿No le podría
hablar sin testigos?… Pero, después de todo, con que le diese el parnés…
Avanzó decidido,
procurando que ablandara su rostro una expresión afable, y entró en la casita.
La dueña hallábase sola, y esto le animó.
– Gente de pá, señá
Antonia.
– Dios le guarde,
Sintas.
-¿Y ese bicho malo?
– En er corrá lo
tiene osté. ¿Le hase farta?
– Pa haserle a osté
un favó.
-¿Cuá favó?
– Dejarla viuda.
Antonia, por
atención, sonrióse para celebrar la chanza, y dijo, fingiendo una chusca
medrosía:
– Enteramente, no
me lo mate osté.
-¿Por qué no?
Pasó riéndose al
corral, y se encaró con el cortijero, que, en el colgadizo, componía la rueda
de un carro. El cortijero, Rafael Luque, era un hombretón agreste,
boquirrasgado y cervigudo, que tenía los remos de púgil y el tronco de atleta.
Le recibió cordialmente.
– Güenos días,
pinturero.
– Hola, compadre.
-¿Encontró osté?
– Hasta ahora, no.
– Entonses, ¿cómo
viene su mersé tan aseñoritao?
– Porque pienso
encontral.
– Enhoragüena.
– Otavía, no. La
enhoragüena me la dará osté después de darme los duros.
El hombracho lo
miró fijamente con el rostro ensombrecido, y sin chistar reanudó su tarea.
– Qué insistió
Cintas Rojas, ¿no piensa osté dármela, compadre?
– No pienso dársela
y me duele. Y me duele tamién añadió que sea osté desconsiderao.
-¡Hombre! exclamó
entre burlón y ofendido el pedigüeño.
– Lo soy articuló
con sequedad Luque. Y como osté lo es iguarmente, me asombra que se porte osté
lo mesmo que un chiquiyo. Le dije que no había juntao ni lo que tengo que
pagal, y esa es la fija. Yo no engaño nunca. Tiempo ha tenío osté para
enterarse.
– Ya me he enterao.
De lo que no me había enterao es de que su palabra fuera de rey. Cuando osté
dise “no”, ¿ha de sel “no”, compadre?
– Cuando digo “no”,
como ahora, porque desil “si” es imposible, ha de sel “no”.
-¿Imposible? Con
diez duros menos, ¿pedirá osté limosna?
– Con dies duros
menos, me veré obligao a reunil dies duros más.
– Pos con
reunirlos…
– ¡Ya está! ¡Es mu
fásil reunirlos! ¡Como ahora yuven duros!… Y güeno va. No me dijuste osté,
compadre.
– ¿Yo a osté, no, y
osté a mi, sí? ¡Viva la Repúblca!
– No sea osté
pesao, compadre.
– ¡Pos venga er
dinero!
– ¿Has perdío la
cabesa? Sintas, no se ponga osté así. Cualquiera pensaría que no me conose osté
y que quiere acoquinarme.
Pero el gañán, sin
aplacarse, le replicó engallado, y con el ceño aun más torvo:
– Yo no le quiero acoquinal.
A mí no me importa que osté se acoquine. ¡Lo que me importa es yevarme los
duros!
Lo aseveró con una
pujanza tan descomunal, desnudando tan cínicamente su pensamiento, que el
cervigudo, ya en guarda, comenzó a encenderse en ira.
– Piense osté un
minuto, y fíjese en mis farsiones barbotó con un sarcasmo hijo de su bizarría.
Fíjese y repare que no son de hético, ni de niño, ni de collón.
– Sean de lo que
sean, ¡quiero mis biyetes!
– ¿Por riñones?
– Osté desidirá.
Luque, muy pálido,
con la jeta contraída y con un ascua en cada ojo, levantó sus puños como
batanes para caer sobre él, y la excitación del peligro hizo que de pronto se
agrandase y adquiriese alas en el cerebro tenebroso de Cintas Rojas la negra
larva de una vil idea: matar. ¿Por qué no se le había ocurrido antes? ¿Por qué
había saltado durante quince días de desprecio en desprecio y de humillación en
humillación? Acaso ¿eran sus amigos aquellos verrugos? Y si no lo eran, ¿qué
contenía su furia?… ¡Matar, matar!… Sacó la faca, la desenvainó con una
hábil sacudido para no perder tiempo, y arrojóse contra su rival que ,
sorprendido, retrocedió para coger algo y defenderse, bramando de cólera.
– ¡Ay, cobardón!
¡Ay, maldita madre, traicionero!
Pudo empuñar una
piedra y erguirse; mas solo se irguió para ahorrarle camino a la cuchilla, que
hundióse en su garganta con la celeridad de un rayo, y que zigzagueó como un
hurón en una madriguera, partiendo ternillas, vasos y carnes. El púgil, con la
pesadez de una encina desarraigada, vaciló un punto, llevóse las manos al
cuello, por el que surtía a borbotones la sangre, y se desplomó, mientras que
el aire encerrado en sus pulmones se escapaba por la horrenda brecha, sin poder
llegar a la boca para engendrar palabras de odio y agonía.
Cintas Rojas, un
poco empavorecido por la rapidez con que había segado aquella vida, tembló al
oir la voz de la casera: “Ya voy, Rafaé”. ¿Rafael?… En la familia eran tres
los Rafaeles: el padre, el esposo y uno de los hijos; mas para la señá Antonia,
no había otro Rafael que su compañero y al muchacho le decía Falico, y al
Narices “pae”. Dirigíase, pues, al degollado, como si lo hubierse oído llamar.
“Ya voy, Rafaé”. Que viniera, aunque viese, porque después de haber visto no
vería un segundo más. Acercóse a la puerta y escuchó. Las gallinas cacareaban,
y en la carretera zumbaba el cencerro de un liviano con la fatiga tediosa del
camino. Volvió a sonar el “gluglu” del cántaro, volvió a toser la vieja y
volvió a reñir la niña: “!Por vínchile, por vínchile, que no hay una viejarrona
peor mandá!”… Y, por fin, se presentó la mujer, y el “guerrista”, sonriendo
cándidamente para que no desconfiase, la detuvo.
– ¡Arto ahí, güena
mosa!
– ¿No me ha yamao
mi marío?
– ¿Su marío?
Los ojos del
montaraz, sin que su boca dejase de sonreir, recorrían como dos hienas hartas
las ubres y el cuello de la cortijera, buscando indecisos el lugar donde
sepultaríase el diente de acero.
– Su marido declaró
después de una pausa ya no la pué yamal. ¿No le dije a osté que venía a
dejarla viuda?
La señá Antonia le
examinó con un principio de sobresalto. ¿Qué ocultaba aquella sonrisa? Detrás
de aquellas palabras de burlón, ¿qué podía haber? Y aquel silencio del corral
que no rompía su esposo, ¿qué significaba? Y en aquella mano diestra que su interlocutor
escondía, ¿qué hubiese leído?
– ¿Hay mieo
comadre? exclamó el hastial.
Y aunque lo
preguntó con un brillo siniestro en la mirada, la mujer, tranquilizándose de
súbito, se echó a reir.
– ¡Sería grasioso! manifestó
avergonzada de sus sospechas. ¿No oyes tú, Rafaé?
– Tampoco puede
oil.
– Pero ¿me lo ha
matao osté der to, der to?
– Tan der to, que
los enterraos no están más muertos.
Y la cortijera
aproximóse al colgadizo y miró, y se le abrieron terriblemente los ojos, y una
inspiración de pavorosa angustia le contrajo el pecho, y antes de que lo
dilatara para enviar el frenético alarido a las fauces, la cuchilla hízola
enmudecer.
– ¡No,
escandaleras, no! masculló, meneando el hierro, el verdugo. Aquí no se da er
soplo. Descanse osté.
Cayó para descansar
eternamente, y quedóse encogida junto a los pies de su compañero, que, con su
gigantesca humanidad, llenaba el colgadizo. El caño de sangre que salía de su
garganta mezclábase con la que, tapizando el suelo de rojo, lo convertía en un
hediondo almagral. Una contracción espasmódica sacudió el cuerpo, que
enderezóse e hizo brotar un ronquido de la traquea rota, y Cintas, fríamente,
tornó a herir. Luego, con la calma de un diablo, como si estuviese en un
matadero frente a dos ovejas degolladas, encendió un pitillo y entregóse a la
meditación. Lo más importante lo había ejecutado, puesto que Luque, cuyo rostro
parecía ya de mármol, solo molestaría, antes de pudrirse, al cura y a los
sepultureros. Y lo había ejecutado con tanta destreza “madrigando” para evitar
el combate, e hiriendo con la sabiduría de un matarife que el río que
circulaba por las venas del ombretón, al desbordarse impetuoso, no le pudo
manchar. Un leve sarpullido en las botas, que borraría un trapo húmedo, y un
goterón en los pantalones; pero la pechera, la cazadora y el chaleco estaban
como se los pudo de limpios. No había, pues, que lamentarse de la suerte. Lo
que aun debía realizar era duro, pero no difícil: coger las llaves, matar a la
vieja, que hallábase en las últimas, a la muchacha, que se moriría del susto, y
a los chiquillos, que sucumbirían como corderuelos, y salir pitando con los
duros.
– Y na más profirió
en voz alta. Ellos se lo han buscao. Por dies roíos duros… ¡que es lo que da
grima!
Secó la faca en el
vestido de la cortijera, se descalzó y metióse en el caserío, a tiempo que la
vieja tornaba a toser.
– Pero, mujé, ¿no
has tomao una pastiya? gritó la moza.
– Pa lo que me van
a servi ya! murmuró con una vocecilla temblequeante la anciana, segura de que
no lo oiría su nieta. ¡Ay, Señó!
No la separaba más
que un tabique del facineroso, que percibió su alentar asmático y los crujidos
que le arrancaba el sillón al rebullirse.
– ¡Ay, Señó, Señó!
¿Por qué se
quejaría la momia?… ¿Qué esperaba con sus noventa años? Siempre la había
visto en su madriguera o en la cocina, junto al fuego, suspirando, clamando o
sulfurándose, sin comprender que era una boca inútil, un estorbo… Por
malignidad la hubiese perdonado, para que viese cómo se vegetaba en los asilos
y aprendiese a tener paciencia. Con indignación trepó lentamente por la
escalerilla, apoyándose en la colaña y asentando poco a poco los pies, a fin de
que no gimiese la madera, y penetró en el sobrado. Rosarito, que, sin blusa y
con un pecho fuera de la camisilla, estaba peinándose frente a un ventanuco, no
le sintió, y el archidemonio quedóse a dos varas de la moza, súbitamente
cohibido. Un recuerdo le incendió la imaginación, deslumbrándole con su
claridad de relámpago; trabajaba él en la viña del canónigo; una noche, después
de un festín, estalló una tempestad, y Rosario y otras muchachas que
pernoctaron en el caserío, entretuviéronse, recogidas ya en su dormitorio, en
medirse las pantorrillas, sin sospechar que los gañanes, que agujerearon
previamente las tablas del granero, recreábanse con las bellezas que mostraban
con tal candor. La del Cortijuelo, que era la mozuela más fornida, entusiasmó a
Luarca, y desde entonces hubo menos corcovos en la conducta del jayán, cuando
visitaba a la familia de su compadre. ¡Aquellas pantorras tenían tan lechoso
blancor y tan aterciopelada opulencia!… Las había visto en sueños; pensando
en su lindura, habíase quedado embaído muchas veces durante la vigilia,
interrumpiendo su labor, y había acabado por acariciar la idea de que algún día
el único que pudiese contemplarlas sería él. ¡Y ahora, por un miserable
avariento, tendría que destruir la dueña de su tesoro!… Pero, en vez de
hacerle vacilar, la ira le infundió ánimos para proseguir su ultrainfame tarea.
– ¡Rosario! murmuró.
La mocita se tapó
el pecho, volvióse vivamente y, desasosegada y ruborosa, intentó huir.
– ¡Sintas, por
Dios!… ¿Pa qué ha subido osté? balbuceó temblando.
– ¡No chiyes! ordenó,
arrinconándola, el asesino. ¡Caya y no te muevas!
– ¡Pero si osté…
– ¡Caya o mueres!
La moza rompió a
llorar despavorida y, aunque muy bajito y conteniendo los sollozos, continuó
hablando:
– !No está bien lo
que va osté a hasel conmigo!… ¡Osté, que nunca me ha dicho ná, que no me
quiere!… ¡Y perderla a una sin cariño es un pecao mu remalo, Sintas Rojas!
¿Perderla?… El
desalmado se asombró; pero sin enternecerse ante la dulce y resignada criatura,
que, no escuchando otros avisos que los del pudor, temía por su virginidad más
que por su vida, decidióse a poseerla y a degollarla después, inexorable.
– Ven dijo,
cogiéndola por la cintura y arrastrándola hacia un montón de trigo.
– ¡Sintas, Dios no
le perdonará!
– Anda, ven,
tontona… ¡Pos si te quió yo má!… Anda…
– ¡No, no, no!…
¡Si me quisiera osté, no haría esto! ¡Y pué venil mi madre!…
– ¡Qué ha de venil!
– Váyase osté!
¡Sintas, por lo que más quiera!
No, no se iría, y
ya que Rosario había confundido la hoz de la muerte con la flecha del parvulico
ciego, no esgrimiría la faca hasta que no se hubiese apagado el fuego lujurioso
que socarrábale.Ella lo encendió con sus palabras, puesto que él, hombre
decente, solo subió para matar.
– ¡Échate ahí!
– ¡Sintas!…
La derribó, tumbóse
junto a ella en el trigo, y, después de haberla sofaldado, comenzaba a acariciarla,
cuando hízole palidecer un aullido superdiabólico de una violencia espantable,
un aullido en que vibraban el odio, el medio, el dolor y la ferocidad, y que
hubiese hecho temblar al sano, gemir al doliente y llorar al moribundo. Se
acercaba con idéntica prontitud que si hubiese cabalgado sobre el lomo
invisible y terrorífico de un ciclón, y Cintas Rojas, seguro de que le
anunciaba un riesgo, y convencido de que tendría que luchar para vivir, segó
con firme pulso, de un solo corte, el cuello que había besado, empuñó una pala
y se puso en acecho.
– Es Coroné murmuró
sombríamente. Coroné, que los ha debío de venteal.
Y Coronel un
mastín con quijadas de tigre atravesó ululante la casita, llegó al corral,
metióse en el colgadizo, y al ver los cadáveres de sus dueños, retrocedió
arqueándose, con las testa gacha y los pelos erizados, y empezó a gañir,
oprimido por el terror. La viejecita llamó empavorecida, y el monstruo,
encorajado, precipitóse por la escalera con la pujanza fatal de una exhalación.
Había que apagar voces y gañidos; había que restablecer el silencio,
apuñalando, triturando o pulverizando, porque alarmar a la gente equivalía a sucumbir.
Desembocó por la puertecilla, ansioso de acometer, y no tuvo más que los
instantes precisos para levantar la pala y descargar el golpe sobre el perro,
que, azuzado por el instinto, le atacó loco de furia; pero el animal abatióse
con la nuca rota, y al extinguirse su horrendo ululato, la calma quedó
restablecida.
La enferma
continuaba llamando; mas con tan débil voz…
– Rosario… Antonia…
Hijas…
A una vara del
solejar no la hubiesen oído, y el verdugo no se intranquilizó. Que llamara,
puesto que nadie podía acudir; pero alguien acudió: alguien que, a juzgar por
el leve ruido de sus pasos y por el sosiego con que silbaba, debía de ser muy
poquita cosa y debía de estar por completo desprevenido. Mas, si sospechaba,
¿le faltaría vigor para correr desalado y para gritar anhelante? Y ¿cómo
escaparía él, si la campiña entera, bajo la presión del espanto, cercaba el
Cortijuelo?… A fin de perseguir en buenas condiciones al de los silbidos, si
huía, se calzó, y “empalmóse” la faca para salir a su encuentro; mas el recién
llegado habló, y su vocecilla le contuvo. Era el hijo mayor de los cortijeros,
un zagal de once años, inocente como un palomo, al que no había que temer.
– ¡Agüela, agüela! chilló
alborozadamente. ¡Ya pareció mi trabuco! ¡Estaba en er vayao!
– ¿Y tu madre? preguntó
la anciana.
– ¡Qué sé yo!
– ¿No está ahí
contigo?
– Aquí no, señora.
– ¿Ni tu hermana?
– Ni mi hermana.
– ¿Y no salió tu
padre del corrá?
– Que yo sepa…
– ¿Ni Sintas Rojas?
– Yo no lo he
visto.
– Entonses articuló
penosamente la mujer, después de unos segundos de silencio ¿quién ha entrao?
– No sé
– ¡Señó, Señó! exclamó
la vieja con angustia.
– ¿Te has puesto
mala?
– Mala estoy, hijo
mío. Dime: y ahora, ¿por qué no auya el perro?
– Menos lo sé.
– ¿Qué hases?
– Ná. Si hubiera
estopa… Me gustaría encontrarla pa cargal mi trabuco.
– Yama fuerte a tu
padre.
El niño gritó:
– ¡Pae, pae,
papá!…
– ¿No contesta? interrogó
la anciana.
– No contesta.
– Yama a tu madre y
más de recio otavía.
– ¡Mae, mamá!…
¡Maéee!…
– Parese que no te
oye susurró la abuela.
– No me oye afirmó
el chico, pasmado.
– Pos yama a tu
hermana.
– ¡Sarito!…
¡Rosaritóoo!… Pero no yores tú.
– Si no yoro… Si es
por la tos pícara… Yama otra ves.
– ¡Rosaritóoo!
– No, no te
responderá. He tosío yo milenta veses sin que me riña…
– ¿A que se han
largao tos a la huerta del Sordo?… ¡Voy a asomarme a la tapia!
– ¡No, no, Falico!
¡No entres en er corrá! ¡No entres, gloria mía!
Pero cuando llegó
la gimiente prohibición a los oídos de la criatura, ya había llegado una garra
a su boca, y ya el gélido acero calentábase en la sangre que alimentaba su
corazón. ¡Cómo escuchó la anciana, con qué arrojo se quiso levantar, y con qué
helados sudores de agonía pretendió mover sus inútiles piernas!… ¡Cómo
examinaron las paredes sus ojos, cual si fueran pajarillos con ansias de
escapar, y con qué increíble energía la sacudió el deseo de que la Hedionda no
la arrancase de su sillón!… ¿Oyó el ronquido acérrimo y horrible que brota de
una tráquea abierta al salir el aire que quiere y no puede ser maldición,
alarido o sollozo? ¿Notó que el influjo de una fuerza sobrenatural hacía lividecer
la luz y enturbiaba y enfriaba la atmósfera?… ¿Percibió algún roce viscoso o
algún olor pestilencial?… Tal vez no; mas, al aparecer el desalmado, bien
claramente leyó en su sonrisa felona y su fatídica mirada, que se había
presentado la Muerte, y solo apeló a la divina misericordia.
– ¡Dios mío! gimió
con un pavor infinito. ¡Señol Dios mío, arrecoge mi alma!… ¡En el nombre del
Padre, en el santo nombre del Padre!…
Y la cuchilla dio
fin a la obra del terror.
Cintas Rojas apartó
de un puntapié el cadáver, más liviano que un costal de plumas, y conformóse
con formular una pía reflexión: “Ahora está un poquiyo más muerta que estaba”.
Un poquillo más muerta y él mucho más sereno, jubiloso y confiado. Tan absoluta
era su confianza, que salió incautamente del trascuarto, y no vio que un
corpezuelo alebrábase bajo los cobertores de su camita con hórrida febrilidad,
no sintió el rumorcillo de unos dientes rechinantes, ni lo puso en guardia el
sordo tamborileo de un corazón chiquitín, espoleado por el espanto. Todo iba
bien. En el caserío no alentaban más pulmones que los suyos, y nadie le podía
denunciar. Y los que aun respiraban entre los olivos ¡tardarían tan poco en
caer!… Le habían visto, le habían hablado, le acusarían de seguro, y hasta si
llegaban a sorprenderle, arrojaríanse contra él, como fieras, para destrozarlo.
¡No, no! ¡Pala y acero! ¡Cráneos y gargantas abiertas de par en par! Ni
perdonaría como un tonto, ni se afligiría como un cobarde, ni procedería como
un bruto. Tenían que sucumbir uno a uno sin estrépito y sin defensa, aterrados
y sorpendidos, igual que los demás.
Asomóse a la puerta
y voceó:
– ¡Eh, tío
Rafaelico!
– ¿Qué hay?
– Que le quié
hablal su hija.
– Corriendito voy.
Oteó, avizorando,
desde la ventana de la cocina, y vio al Narices subir ágilmente por el
recuesto, y se fijó en que tarareaba una copla.
– Uno que mardito
si se figura que va a moril mascujó. Ahí viene a toa máquina y cantando, como
si fuera a una boa y no a un entierro, después de habel escuchao a Coroné. ¡Que
tengan las criaturas menos estinto que los perros!
Y, efectivamente,
el vejancón, rejuvenecido por la tibieza, la luz y el perfume de Mayo, ascendía
con jocunda rapidez, lleno de sol, sin sospechar que de su boca desdentada no
volverían a salir más canciones, ni que sus ojos no tornarían a hundirse en el
azul resplandeciente de los cielos, porque cada uno de sus pasos era un golpe
que daba a fin de abrir su fosa. En el solejar paróse y acarició al grajo, que
le conocía.
– Hola, compañero,
patas de bailarín… ¿Hay gasusa?
El de las patas de
bailarín percutió con su pico encarnado los pantalones del labriego, y graznó
jubilosamente:
– ¡Guá, guá, guá,
guá!…
– Ya sé que te
yamas Juan, hijo.
Cintas, escondido,
oprimía la pala de tal modo impaciente, que se tuvo que contener para no
plantarse fuera del casucho y agredirle.
– ¡Guá, guá,
guá!…
– Anda, ven bonito.
Buscaremos unos pitracos.
Primero entró “Juan”,
con las alas abiertas, balaceándose cómicamente, y después el Narices, que se
reía a carcajadas y que se inclinó para atraparle. Y así, como si buscara un tajo
para ofrecer el cuello, recibió el golpe atronante, y mordió la tierra
desnucado.
“Juan”, con
manchurrones bermejos en su casaca de luto, escapóse grajeando, y Cintas Rojas,
por un refinamiento de previsión, llevóse a rastras al caído, lo degolló en el
corral y tapó con una zalea la sangre que emporcaba el suelo de la cocina. E
inmediatamente atrajo a otro condenado.
– ¡Eh, tú, Cumplío!
bramó estentóreamente. ¡Cumplíooo!.. ¡Jay!…
– A la olden exclamó
el interpelado.
– Dile al Sordo que
venga. Y jíncale argo pa que se dé prisa.
El Cumplío replicó
riéndose:
– Jíncaselo tú, que
no vargo pa jincal.
¡Claro que se lo jincaría!
Y con gusto, porque el tío Pedro, tan hombretón como su compadre, presumía de
serio y de riñonudo, y a él le estomagaban los riñonudos y los serios. Para
formalidad y valentía, el hijo de su madre. Y si no que contestaran con sus
brechas los seis que ya se hubiesen guardado muy bien de hablar.
Atalayó nuevamente,
junto a la ventana, y contempló al Sordo que, vencido el repecho, acercábase
con majestad.
– ¡A él! murmuró
preparándose.
Pero el cuarentón,
a quien sin duda había sorprendido el silencio, se plantó frente al caserío,
como un mulo receloso, y anunció a voces su presencia:
– ¡Aquí está un
hombre!
El forajido se
indignó. Aquel blanco, ¿por qué no entraba? ¿Qué se había olido? ¿Qué cosa
hacíale temer?
Tras de repetir su
humilde o altivo “¡Aquí está un hombre!”, el Sordo continuó gritando:
– ¡Rafaé!… ¡Tío
Falico!… ¡Seña Antonia!… ¡Jay!…
No se atrevió el
verdugo a chistar, y el jornalero, con la inquietud pintada en el rostro,
después de fijarse atentamente en la casita, exteriorizó sus sospechas
formulando en voz alta una desagradable suposición:
– O se han dío, o
se han quedao sordos, o toitos se han muerto de repente.
Pero como su ánimo
era firme, en vez de retroceder, extrajo bríos de la inquietud y de la sorpresa
para avanzar, y arrancó una vardasca y dirigióse con lentitud hacia el casucho.
– ¡Amos a vé! exclamó.
– ¡Ni a vel ni a
oil! dijo Cintas, derribándolo de un zurrido pasmoso. ¡A moril,
sorrastrón!… ¡A moril a mis plantas!
Le degolló sin
necesidad, como al tío Narices, al lado del colgadizo; le tiró sobre el mastín,
y con una impavidez orgullosa examinó el tremendo cuadro. Había seis difuntos, contando
a Coronel, que tenía más caletre, más vigor y más redaños que muchas personas,
y entre aquellos difuntos, cuya sangre formaba ríos y lagunas en el corral,
había dos Luque y tío Pedro que en vida hubiesen derrotado a dentelladas a un
lobo.Y, no obstante, allí estaban. Vencidos por su astucia; pero igualmente los
hubiera vencido su valor. “Esto pensó con un sórdido engreimiento no lo ha
hecho nadie con humanos. Y con toros, ni el Guerra, que, para estoquear
siete, tuvo que lidiar tres corridas un domingo.” Y, en cambio él, en menos de
una hora, con una rústica pala y un cacho de acero, mas con mucha habilidad y
mucha decisión, había despavilado a dos temerones, a un sesentón que tenía
tantos hígados como narices, a un can de horrífica fiereza, a una estantigua
mortecina, a un chicuelo y a dos mujeres… Ocho que fenecieron a sus manos en
aquella dura función sin que le auxiliase un chulillo ni le animase una
palmada. Pero era igual. Ya aplaudirían al matador cuando su hazaña se
descubriese, los mismos que le hubieran tocado a rebato para perseguirle, con
la intención de verle patear en una horca. Le aplaudirían con su curiosidad,
con su rabia, con sus estremecimientos nerviosos, con su lividez, con su pavor.
Sonriéndose,
halagado por estos pensamientos, llamó a Sebastián; mas no se escondió para
asesinarle por la espalda, sino que, deseoso de estudiar el efecto que
produciría su obra en el espectador desprevenido, decidió mostrársela,
preparándose así, de paso, a fin de que feneciera cristianamente.
– Cumplío díjole
en cuanto penetró en la cocina, ¿tiés fuersa de nelvios?
– Regulá tar cuá.
¿por qué lo preguntas?
– Porque vas a
mamarte una solpresa.
– ¿Y quién va a
dármela?
– Tos.
– De qué modo?
– Hombre, si te lo
digo, adios sorpresa. Ven al corrá añadió riéndose.
– Vamos.
– Ten cuidaíto, que
hay sangre en las losas advirtió amablemente, al fijarse en las manchas
Sebastián. Ha rabiao el pobre Coroné y han tenío que matarlo.
– ¿Y ahora me lo
dises? chilló el jornalero con súbita emoción. ¿A que Coroné le ha mordido a
arguien? ¡Esa era la sorpresa!
Entró a escape en
el corral, y Cintas oyó un grito breve y desentonado, que se apagó en un “ay”
roto.
– ¿Y tú estabas
regulá tar cuá de nelvios? barbotó. ¡Cumplío, eres una liebre!
Pero Cumplío no era
una liebre, porque una liebre siquiera habría podido correr; era una estatua:
la de la congoja, el asombro y el terror. Con la cara de yeso, con las manos
yertas, con el corazón helado, apartó sus miradas de los cadáveres, como si lo
atrajesen los terribles ojos de Cintas, y quedó fascinado ante el compañero que
convertíase de pronto en el más cruel vestiglo.
– ¡Eres una liebre,
una roía liebre! repitió el protervo, lisonjeado por el glacial pavor que
inspiraba al infeliz. ¡Vergüenza te debía dal!
Asintió a cabezadas
el labrador, que, maleficiado por las pupilas del monstruo, sentíase incapaz de
huir, y sollozando, cayó de rodillas.
– ¡No me mates! gimió
con la voz ahilada y el rostro mojado por el llanto. Yo siempre fui tu amigo.
– No quió yo amigos
tan fullastres.
– Pero ¿me vas a
matal así?
– Así, y lo siento,
porque la cosa es asquerosiya. Paeses una beata, Cumplío.
¡Perdóname, Rafaé!
El miserable se
enfureció:
– ¿Te has güerto
loco?… ¡Anda y saca er cuchiyo y defiéndete, manté! ¡No seas peol que una
triste jormiga! ¡Defiéndete, o te breo a guantás!
– ¡Pégame pero no
me mates! ¡Acuéldate de mi vieja, Rafaé! Con tantísimo como te ha besao cuando
eras chiquitejo, ¿la vas a dejal sin pan?
– ¡La dejas tú, que
no te defiendes, cobarde!
– ¡No pueo, no pueo!…
– ¡Has un podé,
mantesón!
– ¡No, no pueo!
– Pos entonses, si
quies moril como un sacristán, resa. Y se acabaron las pamplinas. He matao aquí
a to bicho viviente: a la viejarranca, ar niño, a Coroné… Ahora te toca a ti.
No vas a quearte pa simiente de rábanos.
– ¡Perdón, Rafaé!
– ¿Pa que estés
corriendo jasta que te topes con un siví?… ¡No, que te pués cansal mucho! Y
alarga la gaita.
– ¡Rafaé!
– Ayúame, que pa
argo eres fino, criatura.
– Pero ¿de veras
quiés matalme?
– Mira si es de
veras.
– ¡Señol mío
Jesucristo! balbuceó Sebastián horrorizado, al ver el lívido resplandor de la
cuchilla. ¡Virgen de la Sierra, ampárame!
– ¡Aquí no! ¡En er
sielo, Cumplío! ¡Y no llores y alarga la gaita de una ves!
Con la mano zurda
le forzó a mostrar el cuello, empujándole en la frente, y mientras el
desventurado, de rodillas, con una congoja sobrehumana y un miedo letal
encomendábase a Dios, de una fiera puñalada y un limpio tajo le puso en
condiciones de llegar a la consoladora y triste fuente de la misericordia y el
castigo.
Rematada
victoriosamente su tarea, Cintas vio en el reloj de su compadre que aun no eran
las diez, y quedóse maravillado. Había procedido con una celeridad portentosa,
y le sobraba tiempo para todo, ya que, sin apresurarse, a paso de andarín,
poníase en la capital, desde el Cortijuelo, en poco más de hora y media. Podía,
pues, operar con calma, y, con la lentitud del jornalero rendido que coge su
salario, abrió el arcón de Luque, dio con los duros treinta menos del
centenar, efectivamente guardóselos y tumbóse para descansar en el poyo de la
cocina. ¡Se estaba allí tan bien, al sol, que, después de unos días de lluvia,
calentaba sin socarrar!… ¡Y disfrutábase entre aquellos muros de una paz tan
gustosa!… El puchero, al hervir, cantaba, pidiendo que lo espumasen; las
gallinas se atracaban de ciertos oscuros cuajarones, temerosas de que les
persiguiera el escobón; la perdiz brincaba en su jaula, ansiosa de que la
sacasen al solejar… Parecía que una mujer iba a espumar el puchero, que una
moza iba a oxear las gallinas y que un hombre iba a colgar en el emparrado la
perdiz…Pero entre aquellos muros, en aquel ámbito luminoso y apacible no
alentaban ya mujeres, ni mozas, ni hombres, ni viejos, ni muchachos, puesto que
la familia entera su pasado, su presente, su porvenir había sido exterminada.
¿Entera?… Y de súbito, el tigre se acordó de su ahijado, y se incorporó con
viva inquietud. ¿Qué sería del Antoñuelo? ¿Cómo no había visto al pequeñín ,
que jamás se apartaba de su madre? Mas en el acto lo tranquilizó su memoria: al
nene, enfermito, querían trasladarle a la ciudad para que le examinaran los
médicos, y seguramente estaría ya junto a la hermana de Antonia, tragando
jaropes. Lo celebró porque, no por maldad puesto que si no le hubiesen
favorecido con los diez duros habría continuado siendo una mosca, sino por
egoísmo, habría asesinado al chiquituelo, como a los otros, para impedir que le
delatase. Y el chiquituelo ¡era tan riñonudo!… Comprendió que pensando en la
criatura acabaría por enternecerse, y para que su debilidad, que le desarmaba,
no le hiciera incurrir en tal flaqueza, quiso fortalecer con algún reparo su
estómago. La carne del puchero, sancochada y pitracosa, burlábase del más
perruno apetito; pero los morcones invitaban a hincarles el diente, y Cintas
cortó uno y, suspendiendo toda labor mental, púsose a comer. Y ¿qué ocurrió de
pronto? ¿Qué ruidillo fue aquel que pretendió competir con el de sus
mandíbulas?
– “!Toc, toc, toc!”
Con la boca
abierta, escuchó sin percibir nada; mas, en cuanto la cerró para masticar, le
sorprendió nuevamente el ruidillo:
– “!Toc, toc, toc!”
– “¿Goteras sin
llovel?” dijo para sus adentros.
Y sí eran goteras;
goterillas humildes, globitos de líquida escarlata que habían estado presos en
unas venas para mover un corazón, y que, al recibir la libertad, habían
atravesado un montón de trigo y unas tablas que agujereó la carcoma, y caían
sonoramente y en un tapiz de sol bordaban un lago de carmín.
– “!Toc, toc, toc!”
¡Cosa más
ridícula!… Esta vez descubrió el valiente la causa del ruido, y el
descubrimiento, si bien no le azoró, tampoco sirvióle para acendrar su
bizarría. El triste goteo nada tenía de insólito, ni de sorprendente, ni de
amenazador, y, sin embargo, turbóse el asesino.
– “!Toc, toc, toc!”
Siendo tan pequeños
los globitos, ¿por qué caían con igual velocidad que si fueran de plomo y por
qué sonaban tanto al estrellarse?… ¿Y por qué razón enrojecían de tal manera
la luz? ¿Y por qué prodigio resplandecían en el suelo como ascuas?… Temió que
aquella sangre, que hubiera teñido de rojo los sueños del más pétreo ciminal,
ruborizara la casita, y los árboles, y las nubes, y para que no le vendiera el
milagroso rubor, salió prestamente del caserío y alejóse.
III
Tío Alguacil protestó
riéndose a carcajadas.
– ¡No, hijo,
Sintiyas; que van a tenel que llevarme atasajao! Y entonses ¿quién te yeva a
ti?
– Güeno. Pos nos
tragaremos la penúrtima.
– ¡Si nos hemos
tragao ya veinte! ¡Si jasta la verruga de la narí la tengo ya borrachuela!
– ¡Y qué importa!
– ¿Tan sobrao
andas? Pos si desía tu tío que como no descubrieras un Perul no te podrías
movel der campo…
– ¿Y qué más Perul
que mis ahorros? ¡Treinta chulés como treinta soles, que estaban enterraítos
sin que la misma tierra que los tapaba lo supiese! Treinta chulés que, cuando
los haiga machacao, me van a produsil treinta dolores de barriga!… Pero
¿quién no ve ar Guerra?
– ¡Lo que tira la
afisión! dijo benévolamente el tío Alguacil.
Cintas Rojas
palmoteó y púsose a berrear:
– ¡Niñiooo!…
¿Estás dulmiendo, roío sangón?…
Hallábanse en el
patio de una taberna, junto a un velador lleno de vasos, entre campesinos y
chalanes.
– ¿Has llegao hase
poco? preguntó el viejo.
– ¡Quite osté! A
las dose. Ya he pasao por la calle der matadol, pa ve su casa, y por la de
Gondomá, pa asomalme ar Clú, y he dado por el Gran Capitán más güertas que un
mulo de noria. En estos días, la custión es no privarse de ningún gusto.
El “niño”, un
merdellón como un granadero, presentóse y se disculpó con amabilidad.
– Disimulen ostés.
Pero es que ni con seis cuelpos cumpliría uno en estas horitas? ¿Qué van a
tomal?
– Lo mesmo respondió
Cintas Rojas.
– ¿Pa los tres?
– ¿No he dicho que
lo mesmo?… Y por el aire, que me voy a los toros, arma mía.
– Por el aire.
Como la gente se
apresuraba a partir, el zangón, menos atareado, sirvióles con relativa rapidez.
– La convidá,
cabayeros… Uno pa el señó dijo poniendo un “chato” de montilla frente al tío
Alguacil; otro pa osté, y otro pa el amigo, que va a andal… ¡ay, cómo va a
andal!
“El amigo”, que era
el reloj descompuesto de Cintas, brillaba en el fondo de una ancha copa, llena
hasta los bordes de vino, como un quimérico custáceo.
– Qué propuso el
anfitrión, ¿le ayunamos el cangrejete?
– Tú repuso el invitado,
haciendo un mohín de repugnancia.
– Pos, hasta verte,
Cristo mío.
Apuró la copa de
tres o cuatro gargantadas, sin tomar aliento; fingió que por descuido tragábase
la saboneta, y para redondear el chiste, se la escupió al rostro al camarero,
y, agradecido a las frases de loa, se retiró después de adquirir una hogaza,
unas botellas y unos fiambres.
Frente a la plaza
se despidió el tío Alguacil.
– Diviéltete,
Sintas.
– Si hay papeletas,
le convido a osté.
– Pero ¿no sabes
que me asusto de los cuelnos?
– ¡Por vía del
hombre de estopa!…
En el tendido
apiñábase de tal modo “la afición”, que no ya en las filas altas, sino en las
bajas, donde tomar asiento equivalía a prescindir del espectáculo, era difícil
colocarse; pero la dificultad no preocupó lo más mínimo al jornalero, que
encajó el nalgatorio en el primer sillón de barrera que encontró desocupado,
tan tranquilo como si fuese suyo.
– Guënas tardes… a
los guerristas exclamó envolviendo en un saludo de hombre urbano una profesión
de fe de hombre intransigente.
Sus vecinos,
caballeros de gran vitola, le miraron sin replicar, y ya apretaba el ceño para
repetir el saludo con más energía, cuando un hidalgo muy gordo, que mostrábale
un papelito, le interpeló:
– ¿Tiene la bondad?
– ¿La bondad de
qué?
De dejarme mi
sitio.
– No, señol. No
tengo la bondá.
El gordo le miró
estupefacto.
– Pero, amigo…
– No hay amigo que
varga. He yegao antes que osté, y no hay quien me levante.
– Eso lo veremos.
¡Acomodador! ¡Eh, aquí!
Acercóse el
acomodador. ¿Qué se ofrese?
– Que me coloque
usté. Ahí va la papeleta.
– Póngale usté un
marco mascujó Cintas, riéndose.
El acomodador,
pávido, diole unas vueltas al billete, y exclamó con simpática ingenuidad:
– Señores, yo soy
er nuevo, ¿están ostés?… Es mi primel día de acomodaol, y no sé ná de estos
líos. Ostés dispensen. Nadie nase sabiendo.
– ¡Pero si aquí no
hay líos! afirmó el labrador. ¡Aquí lo que hay es que no me muevo! Desaminen
ostés la plasa. ¿Voy a matal a una criatura por un asiento de tendío?… ¡Pa
eso la mato por una de barrera!
– ¿Qué ha dicho de
matar? preguntó, encolorizándose, el pingüedinoso. ¿Quién me va a matar a mí?
– El primerito que
le saque del perneo. ¡Y no gruña osté, don Tiriya, que lo voy a ponel flaco de
un dijusto!
– ¿A mi, so tío
bestia?
Sin arredrarse,
abalanzóse al gañán, que alzó la diestra para recibirle con una puñada; pero le
contuvo “el nuevo”, y los otros espectadores, por egoísmo, cortaron la
cuestión.
– ¡Pero, caballeros!
– ¡Por Dios!
– ¡Parece mentira!
– ¿No me ha
amenazado? gritaba el gordo.
– ¿Y no ha querido
echarme? argüía el jayán.
Pero sonaron los
clarines, y como en el señor adiposo no podía ser mayor la fugacidad de la
cólera, ni en Cintas más grande el deseo de aplaudir a su espada, aplacáronse
y, con arreglo al laudo de sus vecinos, se arrellanó en el asiento el que lo
había pagado y sentóse en el espaldar su primer occupante.
Al salir las
cuadrillas, el jornalero, deslumbrado, tembloroso, como enloquecido, empezó a
gritar:
– ¡Ole!… ¡Vivan
los reaños de Córdoba!… ¡Viva la tierra der toreo!…
Cuando los
lidiadores soltaron los capotillos, se encaró con el Guerra, llenando la plaza
con su vocejón estentóreo:
– ¡Duro con ese del
esparto, Rafaé! ¡ponlo como una breva maúra, pa que lo saque yo en un espoltón!
Hubo algunas
exclamaciones imprecatorias; mas las ahogaron las palmadas y las risas, y el
modrego triunfó. Y desde entonces, con la resistencia de una máquina y con un
encono salvaje o un júbilo irracional, charló y discutió con los de su bando y
los del bando enemigo, interrumpiendo de vez en vez la cháchara para dirigirse
a los lidiadores y elogiar, ofender o rugir. Al aproximarse Guerra a su primer
toro, como el Espartero había matado al suyo con tanto valor que el forajido no
le pudo insultar omisión que teníale desasosegado para vengarse, obsequió al
de Sevilla con un consejo en el que no brillaba precisamente la benevolencia:
– ¡Apriende ahora,
Esparteriyo, que no sabes ni andal! :Apriende ahí, pato!
Y, para ignominia y
afrenta del consejero, no solo recibió “el pato” una lección de andar, sino
varias lecciones de huir, porque el Guerrita, asustado por la artera condición
del cornudo, lo toreó a brincos, con la agilidad de un titiritero, y a
traición, como hubiese derribado a una pantera un prudente padre de familia, lo
asesinó, hundiéndole en el cuello la espada.
El público, menos
varias docenas de esparteristas atrabiliarios que silbaron al matador y
aplaudieron al toro, encomió al héroe cordobés por su destreza y su sabiduría.
¡Con qué habilidad atizó el golletazo y qué pronto vio que su enemigo era un
sinvergüenza con el que nadie se podía lucir!
– ¡Quinqué,
señores! voceaba Cintas Rojas, bajándose con el índice el párpado inferior de
su ojo derecho. ¡Quinqué roío, porque el toro sabía más que dos escribanos.
– ¿Eh, si le toca
al del esparto? gruñó el obeso con regocijada picardía.
– ¡Pos los
despeasa! ¡Qué barbaridá de güey!
En cambio, la
tercera res, más taimadamente cautelosa, más corpulenta, más fuerte y más
cobarde, no le pareció difícil de vencer al campesino, y cuando el lidiador
sevillano, después de dominarla con su muletilla como un pañuelo y con su
leonino corazón, la abatió tumbándose en el testuz y metiendo la espada y el
puño en las agujas, limitóse a murmurar despeciativamente, mientras manifestaba
“la afición” su tumultuoso entusiamo:
– ¡Casolidades!…
Un hombre que va al susidio y que no se muere porque otravía no le ha yegao la
hora de moril.
Y añadió con
benignidad al retirarse al estribo el vencedor:
– ¡Bien, pato,
bien!… ¡De riñón de mono güelfano! Manda un parte pa que que le pongan
corgaúras a la Girarda.
Espresábase con
tranquilidad, disimulando muy risueñamente su despecho; pero su amor propio
herido manaba sangre. ¿Derrotaría a su campeón, todo arte, reciedumbre, valor y
dominio, aquel torpe hombrezuelo de piernas de lana, que no había aprendido más
que un quite y tres pases y que siempre se jugaba la vida al matar? ¿Y
celebraría tal desdicha la indecorosa y descastada multitud?… Miró al
callejón para no ver al torero, que seguía saludando, ni al público, que
continuaba jaleándole, y una palabra suelta que llegó a sus oídos hízole
escuchar con viva atención. La palabra, “crimen”, la había pronunciado un guindilla
que, con mucho respeto, dirigíase al señor gordo, y éste, interesado, le
interrogó:
– Pero ¿es tan
espantosísimo, Serafín?
– Figúrese osté:
ocho mueltos.
– ¿Y los asesinos?
– Toavía no hay
detayes. La cosa ha pasao en una fincuela que se yama el Cortijuelo. Se
sospecha de una partía de gitanos.
– ¡Jesús, Jesús!
Disen que hay
mueltos por toas partes: en la cámara, en la arcoba, en er corrá… ¡Una
carnisería!
– ¡Jesús! ¡Malditos
gitanos!
A Cintas Rojas se
le metió en el cuerpo la alegría de todo el sol que alumbraba la plaza.
¡Gitanos, sí, gitanos! Ya tenían ocupaciones jueces, carceleros y verdugos.
Se alejó el
guindilla, y el adiposo don José, estremiéndose, murmuró:
– ¡Ocho!… ¡Será
horrible, horrible!
¡Sintió unas
tentaciones de desmentir al barrigudo!… ¿Por qué horrible? ¿No había que
morir alguna vez? ¿Qué era lo horrible: la muerte?… ¡Bah! Lo horrible era el
hambre, el dolor, la enfermedad…, demonios que no habían penetrado en el
Cortijuelo. ¡El Cortijuelo!… Se acordaba del caserío vagamente, como si desde
que lo visitó hubieran transcurrido unos años y unas horas. La tos de la
anciana, el pico encarnado de “Juan”, los bramidos del compadre, la
equivocación de la mocita, los sollozos del de la finura… Y luego el goterón,
lo único que le había alarmado: “!Toc, toc, toc!” Lo demás… ¡Le parecía tan
viejo y tan obscuro lo demás!… Y, sin embargo, todo asombraría a la gente,
que estremeceríase, aterrada, como el barrigón. Si le hubiesen revelado de
pronto la hazaña del que oprimíale entre sus pantorrillas, ¡con qué brinco de
ciervo habríase levantado don Pepe para huir!… Le regocijó la idea, y,
conteniendo la risa, deshizo el envoltorio de los fiambres y el pan y le
invitó:
– Un bocao, amigo.
– Gracias.
– Sin grasias. Y
ostedes añadió encarándose con los del laudo piquen tamién. Yo en los toros
tengo que convidal a los que estén a mi verita. Pero lo hago de güena fe, y
como lo hago de güena fe, meriendan conmigo o pelean conmigo. Ostés elegirán.
– Hombre, yo,
manifestó jocosamente don Pepe, entre un cacho de jamón y una torta, la verdá,
me quedo con el jamón.
– Pos al jamón.
Hizo el reparto
Cintas, y enorgullecido y ecxitado por lo que ocurría en el redondel, comenzó a
emborrar ávidamente. El cuarto cornudo, bravísimo, acometía con ciega furia,
soportaba los puyazos con tanta insensibilidad como si fuera de bronce, y
empujaba, volteaba y abría en canal a los jamelgos con una violencia
incontrastable. El campesino, fuera de sí, movíase como si desde su asiento
quisiera ayudarle al bruto a despachurrar caballos, romper tablas y hundir
costillas de picador, y gritaba enajenado:
– ¡Jay, toro!…
¡Tú, toro bravo!… ¡Dale, dale a esos tumbones!… ¡Duro ahí!…
El Guerra, en un
quite, arrodillóse y le limpió el hocico al animal, y este rasgo de audacia
pasmó al labriego.
– ¡Ole! ¡Ole!, y
viva la madre que te parió, rey der mundo! Pero ¿habéis visto ostés cómo le ha
limpiao los mocos ar bicho, iguá que si fuese una criaturiya?
Y agregó,
amenazando con una botella al Espartero:
– ¡Anda a cogel
esparto, tío sirote, mantesón, que me caigo en la torre del Oro y hasta en er
girardiyo!
Mientras
banderilleaban a la res, Gurerrita, que había saltado al callejón para que le
amarrasen un macho, aumentó su júbilo con unas palabras inolvidables. El gordo,
que era amigo del lidiador y tal superioridad hízole crecer un metro en el
concepto del cortacabezas le interrogó cariñosamente:
– ¿Te gusta el
berrendiyo, Rafael?
– Como que es
canela de la fina. ¡Grasias a Dios, que ya está uno jarto de marrajos!
– A ver si hay
suerte.
– ¡No la ha de
habel! replicó soberbiamente el artista. Le voy a da un pase ayudao, otro ar
naturá, pa prepará uno de pecho, otro por arto y otro ayudao por bajo, pa que
me se cuadre. Y como me se cuadre, entro, me doblo esta uña en er morriyo, y de
la estocá lo jago calbón.
Y así fue.
Guerrita, ejecutando lo que había anunciado, dibujó en un minuto los cinco pases
y atizó, acometiendo como un rehilete, una estocada tremenda, y una ráfaga de
exaltación delirante privó de sentido común a diez mil criaturas. Cintas Rojas,
llorando, pataleando y aplaudiendo, aullaba bravías singularidades:
– ¡Viva Córdoba!…
¡Viva San Rafé su patrón y viva er califa!… ¡Eso es toreal y matal, cochinos!
¡Jorobalse ahí! Tomal ahí torre del Oro der que sortó por el culo er moro!
¡Morilse ahí de asco!
Los otros señores y
don José, pálidos o enrojecidos, chillaban cuanto podían y fraternizaban ya con
el fierabrás del cuchillo, que parecíales un hombre de una vez, lleno de
simpatía y con unas despachaderas que tumbaban de espaldas. Charlando
afectuosamente, comentaron el triunfo del hábil lidiador al apagarse el
estrépito de los aplausos, sin envenenar los elogios con censuras para el
matador obscurecido, al que hasta Cintas Rojas pareció compadecer, y así,
obsequiándose mutuamente con finuras, y bebiendo en la misma botella, y
agasajándose con los fililíes de la amabilidad, hubiesen estado el término de
la función si no los hubiera separado un horrendo accidente: Guerrita, el
coloso, el portento, el invencible, se descuidó como un torerillo vulgar, y una
res estúpida le volteó igual que habría volteado a un pelele, y le hizo una
pelota entre sus pitones y le arrojó a tierra con selvático furor. ¡A él, a
Guerrita!… Don Pepe y los demás señores que alternaban con el campesino
fuéronse a escape para interrogar a los médicos; algunos “aficionados”
lamentáronse como histéricas; otros reconvinieron con excesiva confianza a la
Divinidad, y hasta que se supo que el glorioso campeón no había padecido más
que leves contusiones, nadie se preocupó de lo que pasaba en el ruedo. Y menos
que el guerrista más próximo a la locura, un vejete cuya nariz decoraba una
verriguilla bermeja, que con un niño macilento en los brazos, entre bigotudos y
graves guardias civiles, recorría la plaza con lentitud mirando al público.
El Espartero estaba
ya toreando con su muletilla, y Cintas Rojas, a quien el dolor de la catástrofe
le había afilado la lengua, le hostigaba con la flor del repertorio de sus
insultos. El primer pinchazo del torero lo castigó con una risilla sarcástica y
varios juicios ponzoñosos, y después, al herir con más profundidad el lidiador
unas cuantas veces, se apresuró a vaciar el fardel de sus insolencias, sus
groserías y sus procacidades para que, si rodaba el cornudo, no se le pudriesen
en el cuerpo. Mas el toro, fuerte como una montaña, no quería rodar, y con tres
estoques en el morrillo y tragándose su propia sangre se apoyaba en la barrera,
a fin de no caer.
– ¡Qué maltirio! rugió
el labriego. ¿No te da lástima, tripas de cordobán? ¿Ni a degoyal has
aprendido, sirote indesente?
Y entonces le oyó
el pequeñín enfermito, y se alebró entre los brazos del viejo de la verruga y
rechinaron sus dientes de pavor.
– ¿Qué te pasa,
Antoñuelo?
– ¡Ayí, ayí!
Los guardias rodearon
al niño.
– No llores,
hermoso. ¿A quién has visto tú?
– ¡Al compadre!
¡Nos va a matal!
– Pero ¿dónde le
has visto?
– ¡Ayí, ayí abajo!
Y le descubrieron
todos.
– ¿Es, tío
Alguacil? preguntó un guardia.
– Sí es.
– Vamos, buena
suerte.
Pusiéronse de
acuerdo, y en seguida, en cuanto llegó una pareja al callejón, apostóse otra
detrás del banco, y un sargento interpeló al miserable:
– ¡No se mueva,
Cintas!
Pero Cintas Rojas,
que no le sintió y que ni siquiera había reparado en los tricornios, no pensaba
en fugarse; Cintas Rojas, frente al matador que, descompuesto y airado,
pinchaba al toro en el hocico para que agachase el testuz y le permitiera
descabellar, bramaba con indignación generosísima:
– ¡A la jorca, a la
jorca! ¡Eso no se hase a un toro, asesino!